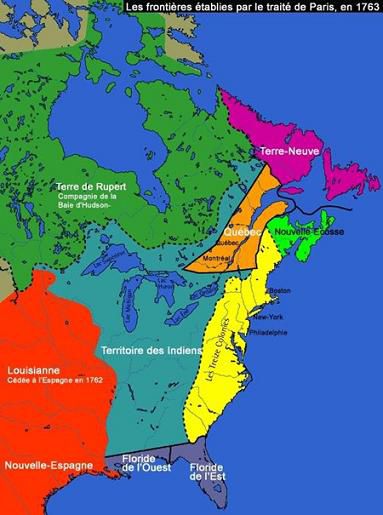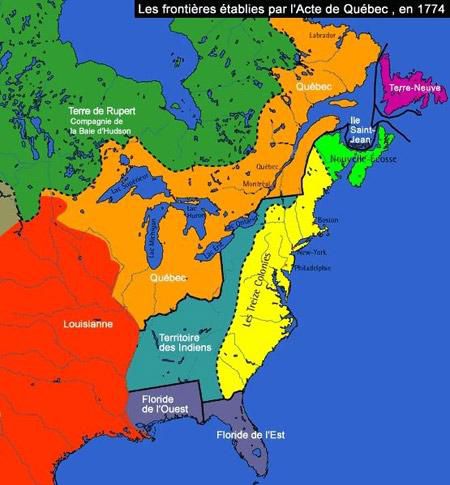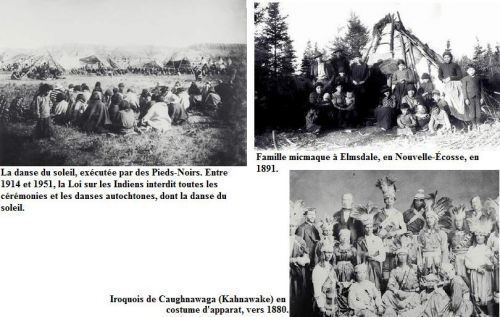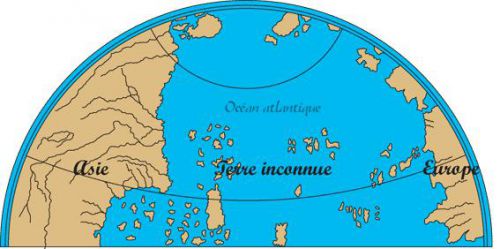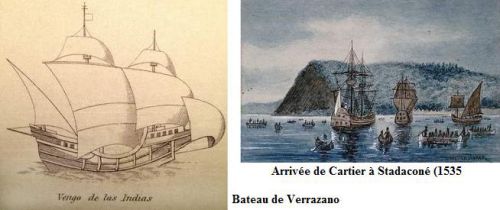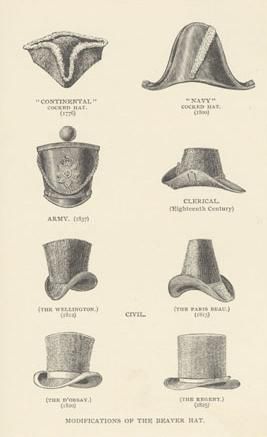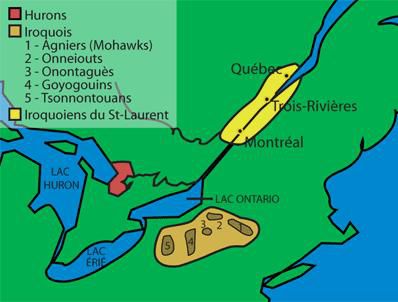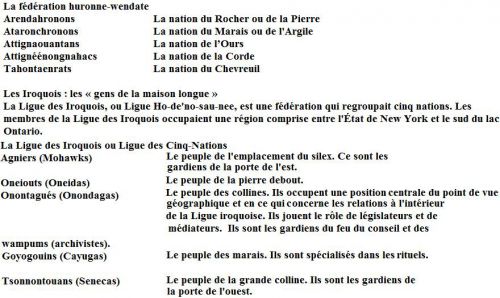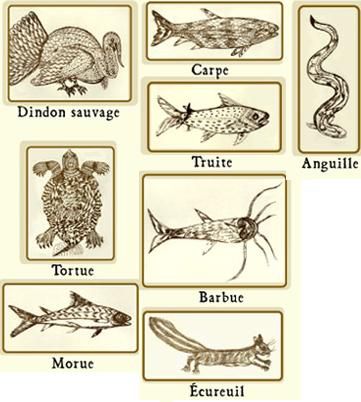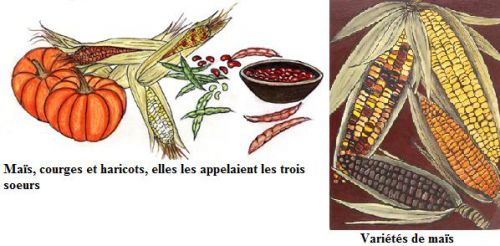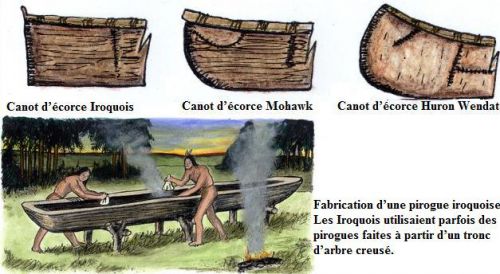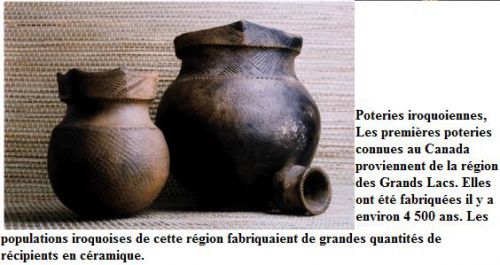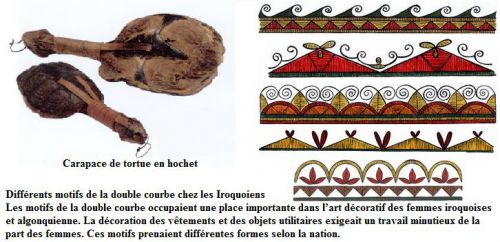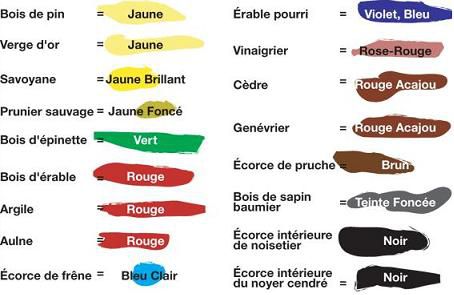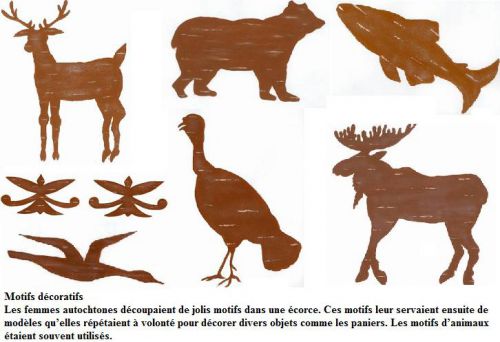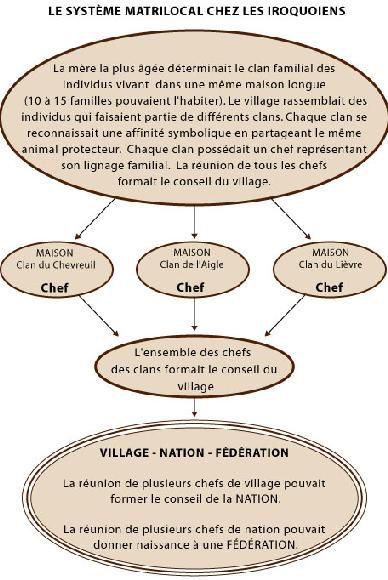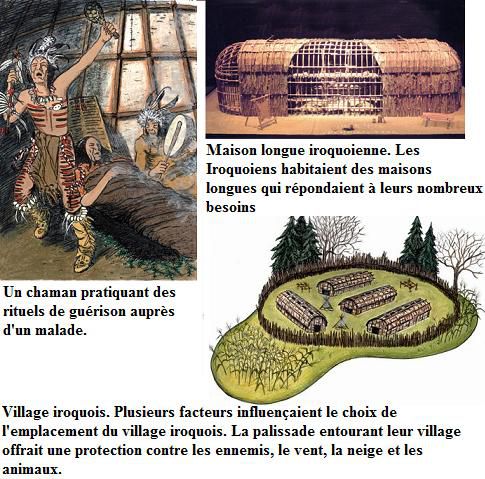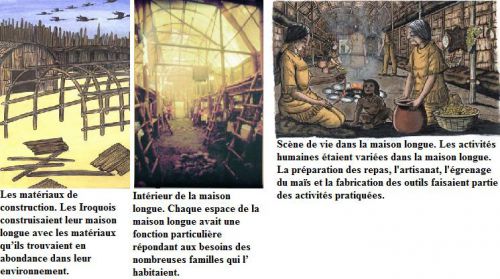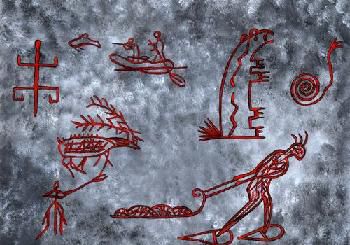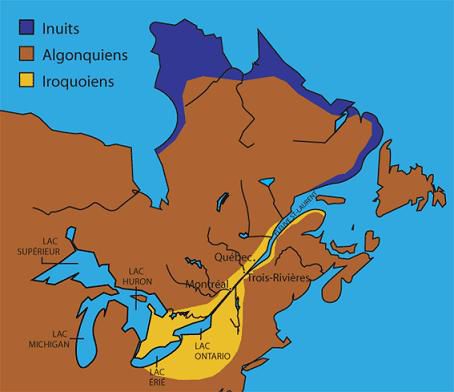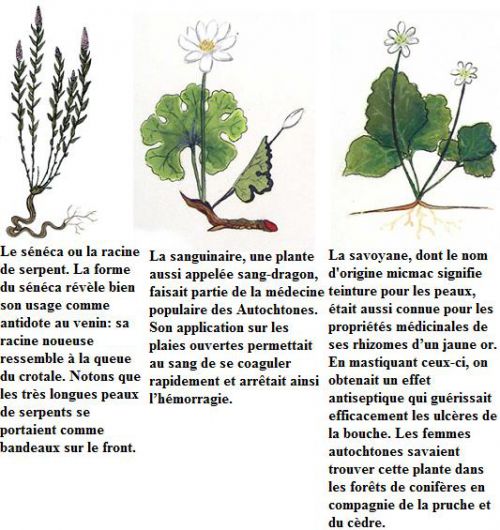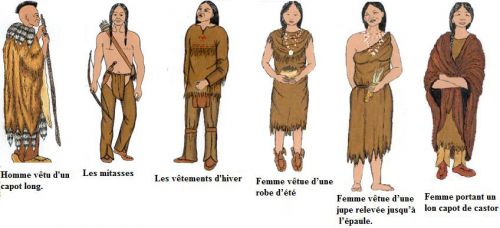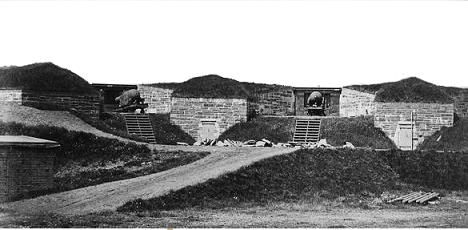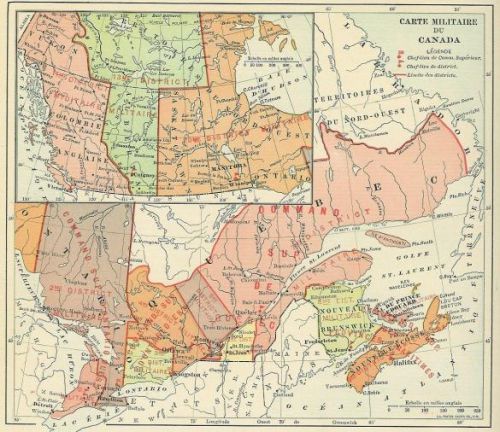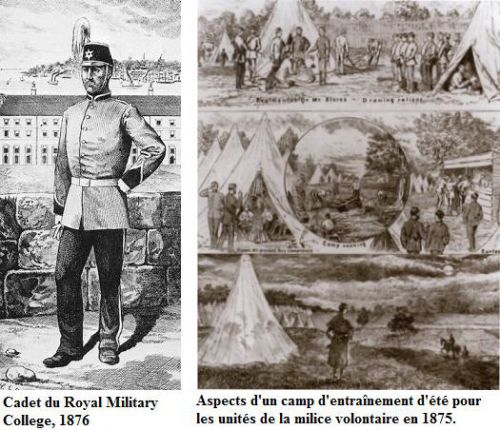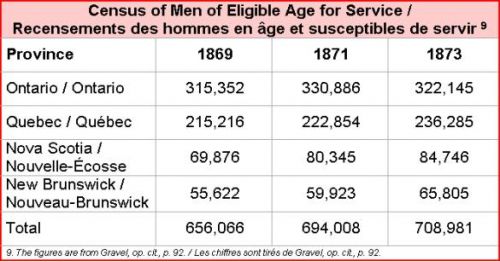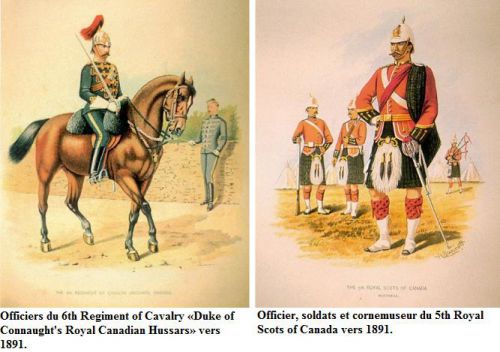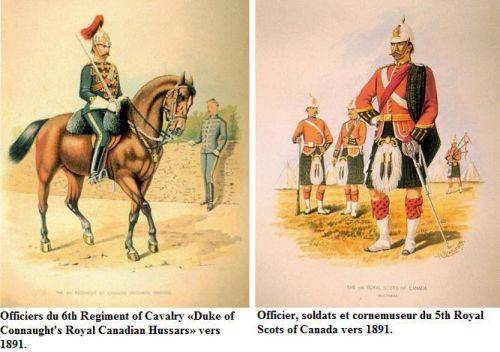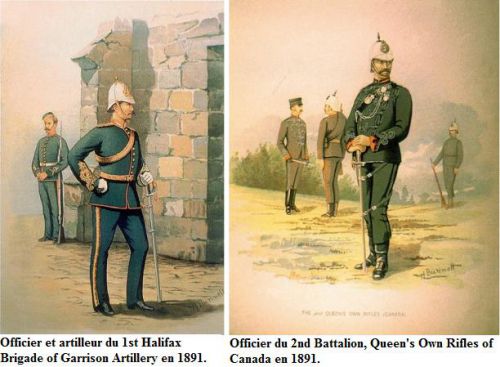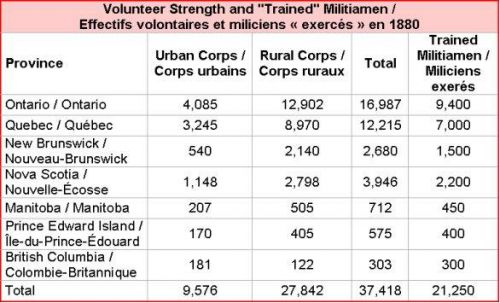Territoires et sociétés autochtones vers 1745
Les Premières nations ont vu leur nombre et leur territoire diminuer sans cesse depuis leurs premières rencontres avec les Européens. Tous les aspects de leur vie ont été bouleversés. Ils ont fourni l’aide et l'espace nécessaires à la venue de nombreux immigrants européens pour ce qui allait devenir le Canada. L'histoire de cette rencontre et de ses suites permet de mieux comprendre les difficultés qu'affrontent les Autochtones aujourd’hui, ainsi que leurs aspirations et leurs revendications actuelles. C'est pour eux la fin d'une époque.
La Proclamation royale de 1763
À la suite de la défaite de la Nouvelle-France, en 1760, les Autochtones qui étaient alliés aux Français concluent des ententes avec les Britanniques. Ces Amérindiens deviennent neutres et sont considérés comme des amis. Les Britanniques leur promettent qu’ils pourront conserver leurs terres et leurs coutumes, commercer avec eux et exercer la religion qu’ils ont apprise des Français.
En 1763, la guerre entre la France et la Grande-Bretagne est bien terminée. La France cède toutes ses possessions en Amérique du Nord à la Grande-Bretagne (sauf les îles Saint-Pierre et Miquelon et ses droits de pêche à Terre-Neuve). La même année, une proclamation du roi George lll d’Angleterre reconnaît l’existence d’un territoire indien. C’est la Proclamation royale de 1763. Le territoire indien couvre une vaste étendue située entre les montagnes Appalaches et le fleuve Mississippi. En agissant ainsi, le roi souhaite conserver de bonnes relations avec les anciens alliés des Français. Il veut aussi s’assurer leur appui militaire en cas de guerre, sinon, qu’ils resteront neutres.
La Proclamation royale du roi George III d'Angleterre n'intègre pas les Autochtones comme des sujets britanniques, mais comme des alliés. Elle oblige les colonies britanniques à obtenir des Autochtones des cessions de droits sur leurs terres avant d'en faire la colonisation.
Des terres réservées
Personne n’a le droit de s’installer sur le territoire réservé par la Proclamation royale de 1763 sans l’accord des Autochtones et du roi d’Angleterre. Les Autochtones ne peuvent céder leurs droits territoriaux qu’au gouvernement et cela en échange d’une compensation déterminée par négociation. L’occupation d’un territoire autochtone, qui n’a pas déjà été cédé par eux au gouvernement, est donc considérée illégale.
Malgré la protection accordée aux terres autochtones, le gouvernement se garantit un accès à ces terres pour les coloniser. Effectivement, les colons débordent rapidement sur le territoire indien. Quelques années à peine après la Proclamation royale, des colons s’installent sur des terres situées en plein territoire réservé aux Autochtones. Les empiètements sur les terres amérindiennes vont se poursuivre par la suite. La frontière ouest, délimitée par la Proclamation royale, ne cessera pas d’être repoussée plus loin afin de donner accès à de nouvelles terres pour la colonisation.
En 1774, l'Acte de Québec étend les frontières du Québec (Bas-Canada) vers le nord, jusqu'au Labrador, et vers le sud, jusqu'à la rivière Ohio. Cet acte constitue un empiètement massif sur le territoire réservé aux Autochtones par la Proclamation royale de 1763.
La Proclamation royale de 1763 est toujours très importante en ce qui concerne les droits territoriaux et les revendications autochtones. En 1973, une injonction est accordée aux Cris, par le juge Malouf de la Cour suprême, afin d'arrêter la construction des barrages hydroélectriques sur leur territoire. La décision du juge repose alors sur les droits accordés aux Autochtones par la Proclamation royale de 1763. Peu de temps après, le jugement est renversé, mais le gouvernement québécois doit négocier avec les Cris. Les négociations mènent à une entente entre les Cris, les Inuits et les gouvernements du Québec et du Canada : la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
La Loi sur les Indiens
Au moment de la Confédération canadienne, en 1867, toute la juridiction sur les Affaires indiennes est attribuée au gouvernement fédéral. Le gouvernement a le pouvoir de faire des lois et des règlements sur toutes les questions liées «aux Indiens et aux terres réservées pour les Indiens. En 1876, le gouvernement décide de regrouper toutes les lois concernant les Autochtones pour n’en former qu’une seule : l’Acte des Sauvages. Cela donne naissance à la Loi sur les Indiens.
L'administration des affaires indiennes au Canada est encore aujourd’hui basée sur cette loi adoptée en 1876. Elle était pourtant considérée comme temporaire puisqu’elle visait l'assimilation des Autochtones à la société blanche. L’agent des affaires indiennes (l’agent des Sauvages) représentait le gouvernement fédéral dans les réserves. Il administrait les affaires des Autochtones et il contrôlait à peu près tous les aspects de leur vie dans la réserve. L’Acte des Sauvages donnait de nombreux pouvoirs au gouvernement :
Définir qui est Indien, contrôler les terres réservées, contrôler les structures politiques autochtones, réglementer certaines coutumes ou pratiques qui n’allaient pas dans le sens des objectifs d’assimilation du gouvernement
La Loi sur les Indiens visait à maintenir les Autochtones sous la tutelle du gouvernement fédéral. Elle régissait leur vie à l'intérieur comme à l'extérieur de la réserve. La loi sera modifiée à plusieurs reprises par la suite, dont une dernière fois en 1985.
Indiens inscrits et Indiens non inscrits
La distinction entre Indiens inscrits et Indiens non inscrits est formulée pour la première fois. L’Indien inscrit désigne celui qui possède le statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (1876). Un Autochtone, qui n’est pas inscrit sur la liste officielle du gouvernement, n’est pas reconnu comme membre des Premières Nations.
Le gouvernement décrète aussi que le droit d’appartenance à une nation autochtone se transmet seulement par l’homme. La femme autochtone mariée à un non Autochtone perd son statut d'Indienne. Selon cette loi, elle n'est plus considérée comme Autochtone ni ses enfants. Plusieurs femmes et enfants autochtones perdent alors leur statut d’Indien. Par contre, la femme non Autochtone peut acquérir le statut d'Indienne en mariant un Autochtone. Il faudra attendre l’année 1985 pour que les femmes autochtones et leurs enfants - qui ont perdu leur statut d’Indien - le retrouvent.
Le gouvernement détient aussi plusieurs pouvoirs concernant l’administration des terres autochtones. Son contrôle s’étend aux terres des réserves, que ce soit pour leur location ou pour leur vente. Par exemple, en 1888, les Autochtones n’ont pratiquement plus de pouvoir pour contester l’établissement de colons blancs sur leurs terres. Ainsi, des terres localisées sur des réserves sont affectées à la colonisation. La loi prévoit aussi l’élection des chefs de bandes sans tenir compte du système politique des Autochtones. Ces chefs aux pouvoirs limités seraient sous la supervision du gouvernement.
La création des réserves
Au début du 19e siècle, les peuples autochtones sont durement affectés par les empiètements sur leurs territoires à cause de l’augmentation rapide de la population au Québec, du développement de la colonisation et de l’industrie forestière. Les activités de chasse et de pêche des Autochtones sont menacées et le gibier se fait de plus en plus rare. Les Autochtones demandent alors au gouvernement de protéger leurs terres et leurs ressources. Ils veulent des terres réservées à leur usage exclusif ainsi que des compensations monétaires pour celles qui ont été dévastées. Sans cesse, les Autochtones doivent s’adapter pour survivre. Le gouvernement, qui souhaite toujours les sédentariser, répond à leurs requêtes.
Nicolas Vincent Isawanhonhi fut chef de la nation huronne-wendate entre 1810 et 1844. À quelques reprises, il s'est adressé à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada (Québec). Ses discours dénonçaient la détérioration des conditions de vie des Wendats et abordaient la question des droits de chasse. Il s'est rendu à Londres comme ambassadeur en compagnie de trois autres chefs wendats. Ils ont présenté leurs revendications sur les terres de Sillery au roi George IV. Des terres leur avaient été concédées à cet endroit à l’époque de leur arrivée dans la région de Québec.
En 1851, le gouvernement édicte l’Acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l’usage des Autochtones. Par cette loi, 230 000 acres de terres sont réservées aux Autochtones du Québec dans le but de les dédommager pour les terres perdues. La majorité de ces terres est cédée aux Algonquins, aux Atikamekw, aux Montagnais et aux Népissingues. Le reste est partagé entre les Micmacs, les Abénakis, les Mohawks, les Hurons-Wendats et les Malécites de la vallée du Saint-Laurent.
Amérindien se livrant au labourage, dans une réserve, vers 1920
La politique du gouvernement fédéral était d'amener les Amérindiens à abandonner progressivement leurs activités traditionnelles pour adopter le mode de vie des Blancs, comme on le voit ici.
Deux ans plus tard, cette loi mène à la création de onze nouvelles réserves au Bas-Canada (Québec). On les qualifie de réserves modernes afin de les distinguer des réserves qui tirent leur origine des missions fondées à l’époque de la Nouvelle-France. De ces onze réserves, sept ont disparu à la suite de cessions ou d’échanges. Celles qui existent toujours sont : Doncaster, Maniwaki (Kitigan Zibi), Mann (Listuguj) et Témiscamingue.
Ces terres réservées représentaient une indemnité pour les terres perdues, occupées ou ravagées par les activités des Canadiens. Elles ne représentaient pas une cession des droits territoriaux des Autochtones qui n’avaient pas été négociés. Ces terres réservées seront elles aussi morcelées par des empiètements illégaux de la part des gouvernements et des voisins canadiens. Plusieurs communautés autochtones ont déjà déposé des revendications à ce sujet.
Chronologie historique des nations autochtones du Québec de 1745 à nos jours
1744-1748
Troisième guerre franco-anglaise en Amérique : la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) où les Autochtones alliés participent aux côtés des Français.
1752
Les Britanniques reconnaissent et confirment les droits de chasse et de pêche des Micmacs. Ils entérinent aussi le traité de paix et d'amitié de 1725. La valeur de ce traité de 1752 sera reconnue par la Cour suprême en 1985 (l’arrêt Simon).
1754-1763
Quatrième guerre franco-anglaise en Amérique : la guerre de Sept Ans (1756-1763) nommée aussi Guerre de la Conquête ou French and Indian War à cause de la participation active des Autochtones aux côtés des Français.
1755
Le gouvernement britannique crée le Département des Affaires indiennes qui relève alors de l'administration militaire. Le premier surintendant des Affaires indiennes est William Johnson.
1758
Le traité d'Easton est signé entre la Pennsylvanie et les nations de l'Ohio. Les montagnes Appalaches-Alleghanys deviennent la frontière des terres indiennes. Les Britanniques reconnaissent que toutes les terres situées à l'ouest des Appalaches appartiennent aux Autochtones. Cette limite sera plus tard repoussée vers l’ouest au détriment des Autochtones.
1759
Capitulation de Québec. À ce moment, les colonies françaises regroupent 80 000 colons (environ 15 000 en Acadie, 60 000 au Canada, 5 000 en Louisiane et sur le reste du territoire).
1760
L'acte de capitulation de Montréal est signé le 8 septembre 1760 en présence du général Jeffrey Amherst. Tout le territoire de la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais. L'article 40 de cet acte protège les terres indiennes et assure le maintien de leurs propriétés, de leur droit de religion et de leur liberté de se déplacer.
1760-1774
La nouvelle alliance entre les Britanniques et les Autochtones oriente désormais les relations dans un contexte qui a changé : la France est éliminée, l'alliance franco-amérindienne s'est désintégrée lors de la chute de Montréal (1760). Les Britanniques, qui tentent de se rapprocher des Autochtones, concluent des traités avec les nations autrefois alliées des Français.
1761-1762
Entre 1761 et 1762, deux proclamations royales définissent différentes mesures afin d'assurer la protection des territoires autochtones. La Couronne britannique recherche alors le soutien des alliés autochtones.
1763
La France signe le traité de Paris, le 10 février 1763. Elle cède toutes ses possessions en Amérique du Nord au profit de l'Angleterre (sauf Saint-Pierre et Miquelon et ses droits de pêche à Terre-Neuve). La Louisiane est cédée à l'Espagne. Aucune clause ne concerne les Autochtones.
1763
La Proclamation royale du roi George III d'Angleterre n'intègre pas les Autochtones comme des sujets britanniques, mais comme des alliés. Elle reconnaît le droit foncier des Autochtones et délimite un territoire indien. Elle oblige les colonies britanniques à obtenir des Autochtones des cessions de droits sur leurs terres avant d'en faire la colonisation.
1763-1766
Le chef de la tribu des Outaouais, Pontiac, dirige le soulèvement des nations des Grands Lacs et de l’Ohio. Plusieurs Autochtones se révoltent contre la présence des Britanniques sur leurs terres. Tandis que les Amérindiens souhaitent de la part des Britanniques un comportement d’alliés, ces derniers agissent plutôt comme des conquérants. Les Autochtones, qui cherchent à conserver la possession de leurs terres, s’emparent de plusieurs postes militaires que les Britanniques venaient d’enlever aux Français. Mais le manque de munitions, l’obligation des guerriers de partir pour les camps de chasse d’hiver afin de nourrir leur famille, le désaccord qui s’installe entre les nations ralliées, l’absence de l’aide souhaitée de la part des Français ainsi que la variole qui se répand à cause de couvertures infectées remises consciemment aux Autochtones par les Britanniques font en sorte que la coalition menée par Pontiac échoue. Toutefois l’agitation dure jusqu’à la signature du traité d’Oswego en 1766 et à l’assassinat de Pontiac en 1769. La décision du roi de rendre officielle la reconnaissance d’un vaste territoire indien, par la Proclamation royale, a été influencée par cette révolte.
1763-1800
Une série de 24 traités à contenu territorial sont signés entre les Britanniques et divers groupes autochtones. La plupart de ces traités portent sur des terres fertiles du nord de l’Ontario. Leur but est de libérer ces terres du titre de propriété indienne, dont l'existence était sous-entendue dans la Proclamation royale, en échange de compensations.
1768
Traité du Fort Stanwix (New York) entre les Britanniques, les Iroquois et des représentants des Sept-Nations (organisation politique qui regroupait les Indiens domiciliés de la Province du Québec). Ce traité repousse vers l'ouest la frontière délimitée en 1763 entre les colons et les Autochtones, au détriment de ces derniers.
1774
L'Acte de Québec reconnaît les lois civiles françaises et le libre exercice de la religion pour les Canadiens. Il étend les frontières du Québec (Bas-Canada) vers le nord, jusqu'au Labrador, et vers le sud, jusqu'à la rivière Ohio. Cet acte constitue un autre empiètement massif sur le territoire réservé aux Autochtones en 1763.
1774-1783
Pendant la Révolution américaine (guerre d'indépendance des États-Unis), les Britanniques sollicitent l'aide des Autochtones contre les Américains en échange de la promesse de protéger leurs terres. Plusieurs Autochtones vivant au Québec appuient les Britanniques lors de la Révolution américaine. Les pressions des Américains et des Britanniques pour se rallier les membres de la Ligue des Six Nations (Ligue des Iroquois) provoquent des dissensions parmi les nations iroquoises et mènent à la rupture de la Ligue des Iroquois.
1783
Le traité de Versailles reconnaît l'indépendance des États-Unis. Il fixe les frontières canado-américaines de l'Atlantique jusqu'au Lac des Bois (le Canada perd le sud des Grands Lacs). Aucune clause ne concerne les Autochtones, malgré la participation de plusieurs d’entre eux dans cette guerre à titre d'alliés aux côtés des Britanniques. La pleine autorité sur le territoire indien est cédée aux États-Unis par l'Angleterre. La Proclamation royale cesse donc de régir les relations entre les Autochtones et les Américains.
1783
Les États-Unis adoptent, le 22 septembre, une proclamation qui interdit la colonisation des terres indiennes sans l'autorisation du Congrès américain.
1783-1796
Migration des Loyalistes et d’Iroquois au Canada.
1784-1850
Quelque 24 actes de cessions de terres sont signés entre des groupes autochtones et le gouvernement.
1791
L'Acte constitutionnel entraîne la création du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec).
1794
Le traité de Jay, ou traité d'amitié, de commerce et de navigation, instaure la paix entre le Canada et les États-Unis. Il suscite un rapprochement entre les Britanniques et les Américains. Certains Iroquois demeurent dans la vallée de l'Ohio, sous la protection du traité de Jay, pour faire la traite des fourrures avec les Américains. La Clause III du traité assure la libre circulation des Autochtones (et de leurs biens) de chaque côté de la frontière canado-américaine.
1794
Les Jésuites concèdent un terrain pour la réserve huronne-wendate de Lorette.
1795
Le traité de Greenville. Entre 1783 et 1794, une alliance défensive réunit des Autochtones provenant de 35 nations des Grands Lacs, des Iroquois du Canada et les membres de la Fédération des Sept-Nations (Amérindiens domiciliés au Québec). À la suite de leur défaite en 1794, les Autochtones signent avec les Américains le traité de Greenville. Les Autochtones doivent renoncer à la frontière définie par le traité de Stanwix en 1768. Ils cèdent les deux tiers de la vallée de l'Ohio.
1796-1830
Malgré leur situation de plus en plus précaire, les Autochtones continuent de se gouverner eux-mêmes, les politiques mises en place sont plutôt négociées qu'imposées.
1803
Vente de la Louisiane aux États-Unis. En 1763, elle avait été cédée à l’Espagne par la France.
Vers 1800
La traite des fourrures décline devant d’autres activités économiques comme l’exploitation forestière et l’agriculture.
1812-1814
La guerre éclate entre les États-Unis et l'Angleterre. Les Britanniques demandent l'aide des Autochtones contre les Américains. La plupart des Mohawks (Agniers) et des Abénakis se battent aux côtés des Britanniques, alors que les Iroquois du côté américain de Saint-Régis (Akwesasne) se rangent du côté des Américains. Les Britanniques veulent conserver le Haut-Canada (Ontario) attaqué par les Américains. Cette dernière participation importante des Autochtones à un grand conflit représente un tournant pour eux. Les alliances militaires entre les Autochtones et les Britanniques perdent leur importance à la fin de cette guerre, qui est le dernier conflit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis en Amérique du Nord.
En 1814, le traité de Gand met fin aux hostilités de la guerre anglo-américaine. Il assure la restitution réciproque des conquêtes. On prévoit rendre aux Autochtones toutes leurs possessions, leurs droits et les privilèges dont ils jouissaient en 1811. Mais les Autochtones n'arriveront pas à récupérer les terres perdues. Ils n'obtiennent aucune garantie pour l'avenir, ils devront désormais signer des traités séparés.
Les questions reliées aux Autochtones passent d'une administration militaire à une administration civile. Car, avec la fin de la guerre de 1812, les Britanniques ne craignent plus d'invasion américaine. La nouvelle administration des dossiers autochtones favorise une politique d'assimilation et de confinement dans des réserves. Les missionnaires exhortent les gouvernements (américain et britannique) à améliorer le sort des Autochtones au moyen de programmes destinés à les «civiliser» en leur enseignant le christianisme et l'agriculture.
1815 à 1840
La population du Québec (Bas-Canada) s'accroît rapidement. Le Bas-Canada compte 335 000 habitants en 1815; environ 600 000 en 1840. La population croissante du Bas-Canada et du Haut-Canada continue d'empiéter sur les terres occupées par les Indiens. Ces derniers commencent à être considérés comme des obstacles à la colonisation eurocanadienne et au progrès.
1817
Aux États-Unis, on commence la mise en application du déménagement forcé des Amérindiens vivant sur leurs terres ancestrales dans la vallée de l'Ohio. La politique atteint son point culminant sur le «Chemin des larmes» que devront suivre les Cherokees dans les années 1830.
1818
Une convention canado-américaine confirme la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49e parallèle jusqu'aux Rocheuses.
1820
À partir des années 1820, des Autochtones du Bas-Canada, dont les Algonquins, les Népissingues, puis les Montagnais, déposent des requêtes auprès des autorités coloniales. Ils demandent la création de terres réservées à leur usage et des compensations monétaires pour les terres déjà prises par les colons.
1820
La politique britannique prend une nouvelle orientation. On met en oeuvre un vaste programme de civilisation (intégration). En 1822, le gouvernement prévoit l'abolition complète du Département des Sauvages. De toute façon, on pense alors que les Autochtones, dont le nombre a beaucoup diminué, vont disparaître.
1821
La Compagnie de la Baie d'Hudson (fusionnée en 1821 à la Compagnie du Nord-Ouest) obtient l'exclusivité de la traite avec les Autochtones dans toutes les régions inhabitées du Canada.
1821 à 1851
Pendant cette période, la population du Canada triple. Elle passe d'environ 750 000 habitants, en 1821, à 2 300 000 habitants en 1851.
1829
Shawnadithit, la dernière représentante connue des Béothuks, meurt en 1829.
1830
Le Removal Act, aux États-Unis, implique la déportation à l'ouest du Mississippi de tous les Amérindiens vivant à l'est de ce fleuve (sauf les Iroquois). Des Iroquois, les Oneidas (Oneiouts) et les Tuscaroras, conservent leurs terres, mais de nombreux traités réduisent par la suite leur étendue. Les autres nations iroquoises sont placées dans des réserves.
1830
Sous l'influence de groupes humanitaires de Grande-Bretagne, une nouvelle politique indienne est adoptée. On encourage la civilisation et la christianisation des Autochtones au moyen des terres de réserves.
1839-1840
À la suite d’une vaste enquête menée sur les populations autochtones du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec), dans les années 1830, le gouvernement se rend compte que la colonisation est désastreuse pour les Autochtones. Il promulgue l'Act for the Protection of the Land (Haut-Canada, 1839) et l'Ordonnance pour pourvoir à la protection des Indiens ou Sauvages (Bas-Canada, 1840). La Couronne britannique, propriétaire des terres indiennes, les garde pour eux.
1840
L'Acte d'Union effectue le rattachement du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec) dans un Canada uni.
1847
Une commission royale d'enquête sur la situation des Autochtones recommande la création de réserves pour compenser la perte de leurs territoires devant le nombre grandissant de squatters, de bûcherons et de braconniers qui s’y installent.
1847
Arrivée de nombreux Irlandais chassés par la famine.
1850-1854
Entre 1850 et 1854, quatorze transactions d'achat de terres sont faites avec les nations autochtones de l'Île de Vancouver pour des fins de colonisation et d'exploitation minière. Les territoires sont échangés contre des montants forfaitaires, des couvertures et la liberté de chasser et de pêcher sur les terres inoccupées.
1850
Signature des deux traités Robinson. Les Saulteux (Ojibways du Lac Huron et du lac Supérieur) signent les traités Robinson concernant la cession de leurs terres au nord des lacs Huron et Supérieur en vue de l'exploitation minière dans cette région du Haut-Canada (Ontario). En retour, vingt petites réserves sont créées.
1850
Adoption de l'Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés des Sauvages dans le Bas-Canada qui détermine, selon certains critères, qui est Indien.
1851
Au Bas-Canada (Québec), la Loi de 1851, l'Acte pour mettre à part certaines étendues de terre pour l'usage de certaines tribus de Sauvages dans le Bas-Canada, autorise le commissaire aux terres de la Couronne à mettre de côté des étendues de terres du Bas-Canada pour l'usage des Amérindiens. La Loi de 1851 permet la création de plusieurs réserves puisque 230 000 acres de terres, administrées par le commissaire des terres indiennes, sont réservés à l'usage des Indiens. En 1853, ces terres sont partagées entre les Autochtones. De nouvelles réserves sont créées: Témiskamingue, Maniwaki, Coleraine (Bécancour), Doncaster (Mohawks de Kanawake et de Oka), Coucoucache et Weymontachie (Atikamekw de la Mauricie), Roquemont (Hurons-Wendats de Lorette, vendue en 1904), Viger (Malécites de la Rivière Verte, abandonnée en 1869 et vendue), Restigouche (Mik'maqs), Pointe-Bleue (Innu-Montagnais du Lac-Saint-Jean), Bersimis (Innu-Montagnais de la région de Manicouagan) et Betsiamites (Innu-Montagnais).
1851
Une loi du Haut-Canada (Ontario) interdit de traiter avec les Autochtones, de pénétrer sur leurs terres, de s'emparer ou de s'installer sur ces terres sous quelque prétexte que ce soit.
1851
Le gouvernement canadien reconnaît deux sortes de terres indiennes, soit les territoires de chasse et les terres accordées aux Amérindiens directement ou par le truchement des missionnaires. La Loi prévoit un dédommagement de 1 000 livres annuellement à être réparties parmi les nations autochtones dont les terres ont été usurpées ou ruinées par le développement du Canada.
1857
Adoption de l'Acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette Province et pour amender les lois relatives aux Sauvages. C'est le début du principe de l'émancipation légale, c’est-à-dire que l’on encourage les hommes autochtones à renoncer à leur statut et à leurs droits afin d’être intégrés dans la société canadienne.
1860
Le Colonial Office cède la responsabilité des Affaires indiennes aux gouvernements des provinces. Au Québec, les Affaires indiennes vont relever du Département des Terres de la Couronne jusqu'en 1867.
1867
Adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique, qui réunit le Bas-Canada (Québec) et le Haut-Canada (Ontario), la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La Loi constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement du Canada la compétence «sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» (article 91) . Le Canada poursuivra la politique des traités.
1868
Le gouvernement américain met en place la plus grande réserve des États-Unis, soit 64 745 km carrés répartis sur les États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. Cette réserve n'est qu'une partie du territoire ancestral des Navajos.
1868
Le parlement fédéral adopte l'Acte pourvoyant à l'organisation du Département du Secrétaire d'État du Canada ainsi qu'à l'administration des terres des Sauvages. Cet acte, fondé sur la politique de protection, d'assimilation et de christianisation d'avant la confédération, réunit toutes les anciennes lois sur les Indiens.
1869
Adoption d'un amendement à la Loi sur les Indiens intitulé Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages, et à l'extension des dispositions de l'acte trente et un. Cette loi confère des pouvoirs plus étendus au surintendant des Affaires indiennes. Il établit des administrations de type municipal dans les réserves. Il a aussi comme objectifs d'apprendre aux Amérindiens le fonctionnement de l'ensemble de la société blanche et de faciliter leur assimilation à l'intérieur de celle-ci.
1869
Gouvernement provisoire des Métis à la Rivière Rouge. Acquisition des Territoires du Nord-Ouest par le Canada. Les Métis des Plaines expulsent les arpenteurs envoyés par le gouvernement du Canada pour tracer de nouvelles routes pour les colons.
1870
Le gouvernement du Canada achète la terre de Rupert de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Une clause de l'arrêté ministériel précise que le Canada doit respecter les réclamations des Autochtones par rapport à la colonisation.
1870
Adoption de l'Acte du Manitoba, créant cette province. Cet acte prévoit que 600 000 hectares de terres devront être réservés aux Métis.
1871
La Colombie-Britannique devient une province du Canada.
1871
Le Congrès américain met fin à la signature de traités avec les nations autochtones des États-Unis.
1871-1921
Période des grands traités entre le gouvernement canadien et les nations autochtones. Par onze traités numérotés, les Autochtones cèdent des droits sur la majorité du territoire de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. Ces onze traités incluent des terres réservées, des versements de compensation, l'octroi de vêtements, des versements annuels pour des munitions et des cordes, des allocations de scolarité, de l'aide médicale et de l'aide alimentaire en cas de famine.
1873
L'Île-du-Prince-Édouard entre dans la Confédération.
1876
Les Cheyennes et les Sioux du chef Sitting Bull exterminent le 7e régiment de cavalerie du colonel Custer, lors de la célèbre bataille de Little Big Horn aux États-Unis. Les Sioux se sauvent par la suite au Canada. Ce fut la fin du nomadisme des Autochtones des Plaines américaines qui ont dû vivre dans des réserves par la suite.
1876
La refonte de l'ensemble des lois concernant les Autochtones du Canada donne naissance à la Loi sur les Indiens. L'Acte des Sauvages vise l'assimilation des Autochtones avec l'émancipation obligatoire des femmes qui marient des non Indiens (elles perdent leur statut d’Indienne). Elle fixe aussi une tutelle sur les Indiens et leurs terres. Les manifestations culturelles sont aussi surveillées de près. Des lois subséquentes interdiront certaines traditions, dont des cérémonies et des danses autochtones. L'administration des affaires indiennes au Canada est toujours basée sur la Loi des Indiens adoptée en 1876. Considérée comme temporaire, elle visait l'assimilation des Autochtones à la société blanche. Jusqu'au milieu des années 1950, les agents des Affaires indiennes contrôlent à peu près tous les aspects de la vie des Autochtones des réserves.
1879
À la suite de la chasse intensive, le bison est pratiquement disparu des plaines canadiennes.
1880
Un amendement à la Loi sur les Indiens permet l'émancipation de tout Indien qui obtient un diplôme universitaire.
1884
Un amendement à la Loi sur les Indiens interdit les potlatch, des cérémonies traditionnelles où les biens sont redistribués entre les Autochtones. Cette interdiction sera en vigueur jusqu'en 1951.
1885
Pendaison de Louis Riel et de huit Autochtones à la suite de la rébellion des Métis de la Rivière Rouge et de l'Ouest. Ils s'opposaient au lotissement des terres pour la colonisation.
1889
Un amendement à la Loi sur les Indiens permet au gouvernement fédéral de passer outre à l'opposition des bandes indiennes à la location de leurs terres.
1898-1899
Le gouvernement fédéral impose les conseils de bande aux communautés autochtones.
1898 et 1912
Lois d'extension des frontières du Québec et de l'Ontario dont l’annexion des bassins versants de la Baie James et de la Baie d'Hudson.
1905
Création de deux nouvelles provinces : la Saskatchewan et l’Alberta.
1912
Le Québec obtient le territoire de l'Ungava. Extension des frontières du Québec, de l'Ontario et du Manitoba.
1917
Obtention du droit de vote par les femmes au Canada.
1922
La Loi sur les terres et forêts du Québec de 1922 autorise le gouvernement du Québec à réserver des terres pour l'usage des Autochtones. En vertu de cette loi, la superficie maximale des réserves indiennes au Québec passe de 230 000 acres à 330 000 acres.
1923
Création de réserves plus nordiques (Baie James et Nord-Ouest québécois).
1927
Un amendement à la Loi sur les Indiens interdit aux Autochtones de lever des fonds à des fins de revendication sans le consentement écrit du surintendant aux Affaires indiennes. L'autorisation du Ministère des Affaires indiennes devient nécessaire pour que «soient payés les avocats et les autres personnes dont les Autochtones auraient retenu les services pour faire valoir leurs droits».
1927
Le Conseil privé de Londres statue sur la frontière du Labrador et attribue le Labrador à Terre-Neuve.
1933
Un amendement à la Loi sur les Indiens force l'«émancipation» de tout Autochtone qui obtient un diplôme universitaire.
1940
Obtention du droit de vote par les femmes au Québec.
1946
Le Parlement du Canada met sur pied un comité chargé d'étudier différentes révisions de la Loi sur les Indiens.
1949
Entrée de Terre-Neuve dans la Confédération.
1951
Modifications portées à la Loi sur les Indiens à la suite d’audiences tenues par le comité mixte du Sénat et la Chambre des Communes entre 1946 et 1948 et de consultations auprès des dirigeants autochtones. Un amendement à la Loi sur les Indiens annule l'interdiction du potlatch et d'autres cérémonies traditionnelles. Il autorise aussi les Autochtones à entrer dans les bars. Le comité recommande de créer une commission sur les revendications au sujet de l'application des traités. Les pouvoirs du ministre des Affaires indiennes sont restreints à certains égards (même si certains de ces pouvoirs sont transférés aux provinces). Des pouvoirs accrus sont attribués aux bandes pour les affaires locales. On tente également d'augmenter la participation aux élections des bandes.
1960
Les Autochtones obtiennent le droit de vote au fédéral.
1960
La responsabilité des Autochtones étant de juridiction fédérale, les relations plus étroites entre la province de Québec et les Autochtones ne datent que des années 1960.
1966
Commission Hawthorn-Tremblay : une étude sur les Indiens contemporains au Canada, débutée en 1964. Les consultations auprès des bandes au sujet de la situation sociale, économique et de l'éducation des Autochtones se poursuivent pendant des mois. À cette époque, le responsable des Affaires indiennes est le Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.
1968
Création de la Fraternité des Indiens du Canada dans le but de représenter les intérêts des Indiens inscrits auprès du gouvernement fédéral.
1968
Une Mohawk, Mary Two Axe Early, entame une lutte contre la discrimination faite aux femmes en vertu de la Loi sur les Indiens. Cette lutte, qui a impliqué d’autres femmes autochtones dont l’Abénakise Evelyn O’Bomsawin, aura cours jusqu'à la modification de la loi en 1985.
1969
Le Livre Blanc de 1969 ne tient aucunement compte des recommandations du Rapport Hawthorn-Tremblay déposé en 1966. Le gouvernement du Canada propose d'abolir la Loi sur les Indiens, le Ministère des Affaires indiennes et le statut particulier des Autochtones en les considérant comme des citoyens ordinaires. Les traités conclus seraient également éliminés. Le gouvernement préconise une politique d'assimilation qui rejette tout droit ancestral. Les agents du Ministère des Affaires indiennes sont retirés des réserves. Les Autochtones réagissent avec colère au Livre blanc. Ils présentent au gouvernement le Livre rouge, intitulé Citizen Plus. De vives oppositions et des critiques suivent le dépôt du Livre Blanc. Le gouvernement fédéral abandonne ce projet. On conserve le statu quo.
1969
Les Autochtones obtiennent le droit de vote au provincial.
1970
Le gouvernement fédéral finance les groupes et les organismes autochtones pour qu'ils effectuent des recherches sur les traités et les droits ancestraux.
1971
La Convention de l'Alaska, aux États-Unis, crée des corporations de villages et des corporations régionales chez les Inuits, les Indiens Dénés et les Aléoutes du Nord. Elle accorde des compensations et reconnaît un titre de propriété indien sur 18 millions d'acres et de pratique d'activités traditionnelles sur 4 millions d'acres. La Convention élimine les réserves et accorde des royautés sur l'exploitation des mines et des forêts.
1972
La Fraternité des Indiens du Canada, devenue l'Assemblée des Premières Nations, revendique au nom des communautés autochtones le droit de gérer l'éducation et la mise sur pied de leurs propres conseils scolaires. Cette revendication est acceptée en 1973.
1973
Le gouvernement fédéral se donne une politique sur les revendications territoriales globales (droits ancestraux) et sur les revendications particulières (droits issus des traités et administration des fonds et des terres des Amérindiens). Les revendications globales doivent être fondées sur l'occupation et l'utilisation traditionnelle des terres et le titre ne doit pas avoir fait l'objet de traité, ni d'acte légal de cession ou d'extinction. Les régions concernées se situent au Québec, au Yukon, en Colombie-Britannique, au Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest.
1973
L'injonction demandée par les Cris afin d'arrêter la construction des barrages hydroélectriques sur leur territoire leur est accordée par le juge Malouf de la Cour suprême. La décision du juge repose alors sur les droits accordés par la Proclamation royale de 1763. Peu de temps après, le jugement est renversé, mais le gouvernement québécois doit négocier avec les Cris.
1974
Le Bureau des revendications des Autochtones est mis sur pied par le Ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada.
1975
Les Cris, les Inuits et les gouvernements du Québec et du Canada signent la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) qui permettra le développement hydroélectrique sur le territoire visé. Par ce traité, les Cris et les Inuits cèdent des droits et des titres sur un territoire de 981 610 km carrés. En échange, ils obtiennent la propriété foncière de 10 400 km carrés (l’usage et le bénéfice des terres de catégorie 1), des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage, l'administration régionale de l'éducation, des services sociaux, de la santé, du développement social et économique, et le versement, sur une période de 20 ans, d’une compensation de 225 millions de dollars. Le régime des terres issu de la CBJNQ délimite la superficie des territoires cris et inuits et les droits qui s’y rattachent. Il s'agit de la première entente du genre à être signée au Québec et au Canada.
1978
Les gouvernements du Québec et du Canada signent la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) avec les Naskapis (et les Inuits de Port Burwell). La nation cède ses droits territoriaux en échange de la propriété de 285 km carrés, de droits de chasse et de piégeage sur un territoire de 4 150 km carrés et d’une compensation de 9 millions de dollars.
1981
Le gouvernement du Canada apporte des modifications à sa politique sur les revendications autochtones en élargissant les critères d'acceptation des revendications. Il accroît également les montants pour financer les groupes autochtones.
1982
La nouvelle Loi constitutionnelle du Canada reconnaît les droits ancestraux et issus de traités aux Indiens, aux Inuits et aux Métis. Elle précise aussi que la Charte canadienne des droits et libertés ne diminue pas les droits et les libertés qui ont été reconnus aux Autochtones par la Proclamation royale de 1763.
1983
Le Comité sur l'autonomie politique des Autochtones rend son rapport public après l'audition de 567 témoins, la tenue de 215 présentations et de 60 réunions publiques. Il recommande que le gouvernement fédéral établisse de nouvelles relations avec les Premières Nations et que l'élément essentiel de cette relation soit l'autonomie gouvernementale des Autochtones.
1983
Le gouvernement du Québec se donne une politique autochtone basée sur quinze grands principes.
1984 et 1993
Convention définitive des Inuvialuit (puis des Inuits) des Territoires du Nord-Ouest.
1985
Un amendement à la Loi sur les Indiens met fin à plus de cent ans de discrimination en permettant à tous les Autochtones qui ont perdu leur statut de le recouvrer. Sont particulièrement visées par cet amendement les femmes autochtones, qui ont épousé un Blanc, toutes les personnes qui sont entrées dans l'armée ou dans les ordres ou qui ont obtenu un diplôme universitaire ou voté à une élection fédérale.
1990
La crise d'Oka (juillet à septembre). Des Mohawks de Kanesatake protestent contre les projets de développement de la municipalité d'Oka sur des terres qu’ils considèrent comme les leurs.
1990
En 1990, la Cour suprême du Canada a confirmé que la Proclamation royale de 1763 réserve aux Autochtones deux catégories de terres : les terres qui étaient situées en dehors des limites territoriales de la colonie de Québec en 1763 et les établissements qui existaient à l’intérieur des limites du Québec en 1763 et qui étaient autorisés par le gouvernement, principalement les réserves créées à l’époque de la Nouvelle-France.
1990
En 1990, l'arrêt Sioui de la Cour suprême reconnaît comme traité le document remis aux Hurons-Wendats par le général James Murray en 1760. Ce traité leur garantissait, aux mêmes conditions que les Canadiens, le libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et du commerce avec les garnisons anglaises. Ce document, du 5 septembre 1760, est encore l’objet de débats puisque certains le considèrent comme un traité, d’autres comme un simple sauf-conduit remis aux Hurons-Wendats pour qu’ils rejoignent en toute sécurité leur village de Lorette (Wendake).
Pour connaître d’autres ententes conclues entre les Premières Nations du Québec et le gouvernement québécois, consulter le site du Secrétariat aux Affaires autochtones du Québec
1996
Dépôt du Rapport de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones (Commission Erasmus-Dussault). Cette étude sur la situation des Autochtones au Canada, amorcée en 1991 et rendue publique en novembre 1996, recommande la formation d'un troisième palier de gouvernement pour les Autochtones.
1999
Le premier avril 1999 : création du Nunavut, notre terre, un territoire qui couvre l’est et le centre des Territoires du Nord-Ouest, soit 2 millions de kilomètres carrés (environ le cinquième de la surface terrestre du Canada). Les Inuits totalisent 85% de la population de ce territoire. Le gouvernement élu possède des pouvoirs de légiférer semblables à ceux des gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
1999
La Cour suprême du Canada permet aux Autochtones hors réserve de voter lors de l’élection des conseils de bandes.
1999
La Cour suprême du Canada convient qu’un traité de 1760 garantit aux Mi’kmaqs (Micmacs) des droits de pêche et de chasse toute l’année. Ce jugement déclenche une controverse. La Cour suprême précise alors que ces droits ne permettent pas de pêcher en toutes saisons.
1999
Les Nisga’a du nord-ouest de la Colombie-Britannique se voient accorder le droit à l’autonomie gouvernementale.
1999
La province de Québec met sur pied une politique de partenariat économique avec les Premières Nations. Cela mène à l’instauration d’un Fonds de développement pour les Autochtones.
2002
La Paix des Braves est signée entre le Québec et les Cris. Cette entente, d’une durée de 50 ans, vise la collaboration entre le Québec et les Cris ainsi que le développement économique, social et communautaire de cette nation.
FAITS ET ÉVÈNEMENT ENTRE 1500 ET 1745
Le castor deviendra le principal enjeu commercial entre 1500 et 1745. Les Européens auront un intérêt particulier pour sa fourrure qu’ils utilisent pour la fabrication des chapeaux haute-forme devenus si populaires en Europe.
Au début du 16e siècle, quand les premiers Européens débarquent dans ce qui deviendra le Québec, la vallée du Saint-Laurent est habitée par des Autochtones membres des sociétés iroquoiennes. Les autres parties du Québec abritent des sociétés nomades algonquiennes. Les Européens ne savent pas comment se débrouiller dans ce nouvel environnement. Ils doivent compter sur l’hospitalité, l’aide et les connaissances de ses habitants. Ils concluent des ententes avec les Autochtones afin d'assurer le commerce des fourrures et le succès des premiers établissements.
Le commerce des fourrures, puis l’implantation européenne en Amérique du Nord-Est a des implications profondes sur la vie des Premières nations. Des changements importants bouleversent les sociétés autochtones: leur situation démographique, leur organisation sociale, politique et culturelle. La conséquence la plus tragique de la rencontre des deux mondes reste l’introduction de maladies d’origine européenne qui provoquent le déclin des peuples autochtones.
Les motivations européennes
Plusieurs raisons expliquent les explorations entreprises par les Européens à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle. À cette époque, l’Europe est en pleine renaissance démographique et économique. Les pays de l’Europe de l’Ouest recherchent de nouvelles ressources et de nouveaux territoires afin de répondre aux besoins de leur population. La curiosité scientifique s’éveille et l’Europe élargit ses horizons. Toutes les conditions sont réunies pour faire éclater le monde connu. Ce nouveau contexte et les innovations technologiques permettent l’aventure sur l’Atlantique.
Mythes et perceptions du monde par les Européens
Carte inspirée de Martin Behaim (1492)
Avant la progression des connaissances géographiques liée aux voyages d’exploration entrepris par les Européens, le monde était traditionnellement divisé en trois parties: l’Europe, l’Asie et l’Afrique. On pense qu’entrent l’Europe et l’Asie, il n’y a que des îles fabuleuses. On ne connaît pas encore l’existence du continent américain. En dehors des limites du monde connu, on croit à l’existence de régions où habitent des animaux terrifiants et des hommes monstrueux. On imagine des hommes à la tête dans la poitrine ou sans tête, des hommes à tête de chien et des cyclopes. Ces croyances difficiles à briser continuent à se répandre malgré les explorations effectuées. L’idée d’un être couverte de poils de la tête au pied, plus près de la bête que de l’humain, subsiste également. Les Autochtones rencontrés par les Européens sont rapidement qualifiés de Sauvages puisque selon eux ils vivent comme les bêtes dans les bois et ils ne sont pas civilisés.
L’Europe à la recherche de nouvelles richesses
Au 16e siècle, cinq pays européens participent au mouvement des grandes découvertes et veulent se partager le monde. L’Espagne et le Portugal ont un intérêt surtout pour la partie sud du continent américain où l’or se retrouve en grande quantité. L’Angleterre, la Hollande et la France se tournent vers le territoire fréquenté par les pêcheurs, situé plus au nord. Sur la route de l’Asie, les Européens espèrent s’enrichir et acquérir de nouvelles terres. Les pays se disputent la possession des territoires sans tenir compte de leurs habitants, les Autochtones. C’est la course aux trésors américains. De nombreuses richesses passent du Nouveau Monde (l’Amérique) vers l’Ancien (l’Europe). En provenance d’Amérique du Sud, l’Europe acquiert des métaux précieux, de l’or et de l’argent, du coton et du sucre. D’Amérique du Nord, elle reçoit de la morue et des fourrures.
En quête d’une nouvelle voie vers l’Asie
Les découvertes de Jacques Cartier
Depuis la prise de Constantinople par les Turcs (1453), la route terrestre vers l’Inde et la Chine est coupée. Le commerce habituel est perturbé, car les marchands n’ont plus d’accès direct aux richesses des marchés asiatiques. Ils en convoitent les épices, indispensables à la conservation des aliments, la soie, l’or et les pierres précieuses. Les Européens se mettent en quête d’une route plus rapide vers l’Asie en naviguant sur l’Atlantique, vers l’ouest, ou en contournant l’Afrique. Loin de concevoir l’étendue du Nouveau Monde, les explorateurs pensent trouver l’Asie soit en longeant le littoral atlantique de l’Amérique du Nord, soit en recherchant un passage par le Nord. Cette recherche d’une route vers l’Asie préoccupera longtemps les Européens. Les Anglais (Martin Frobisher et Henry Hudson) penseront trouver un passage par l’Arctique. Les Français (Jacques Cartier) souhaiteront y parvenir en pénétrant plus avant dans le fleuve Saint-Laurent.
Les explorations européennes
Les explorateurs européens n’ont pas découvert l’Amérique puisque les Autochtones y habitaient déjà depuis des millénaires. Les Européens ont plutôt trouvé les voies maritimes pour se rendre à un continent inconnu d’eux. Bien avant la venue des explorateurs et des pêcheurs en provenance de l’Europe de l’Ouest, les Vikings avaient fréquenté les Autochtones.
Les perceptions et le choc des premières rencontres
Iroquois allant à la guerre
Deux perceptions se répandent depuis les premiers contacts entre Autochtones et Européens. Une première présente les Autochtones comme des barbares, des sauvages, des êtres non civilisés. La seconde en fait de bons sauvages, des enfants de la nature par rapport aux Européens civilisés et adultes, des êtres qu’on idéalise.
Des Sauvages
À la fin du 16e siècle, on s’entendait généralement pour dire que ce n’était pas des monstres qui habitaient les nouvelles régions découvertes, mais des sauvages sans foi, ni loi, ni roi. Ils vivaient dans la nature comme les bêtes dans les bois. Ils allaient nus, étaient sales, se peignaient le visage et le corps, n’avaient pas de religion et se contentaient de peu.
Le bon ou le noble Sauvage
Au 17e siècle, mais surtout au 18e siècle, certains auteurs insistent davantage sur les qualités de l’Autochtone et les aspects positifs qu’ils perçoivent de leur culture. Du point de vue physique, on les décrit comme des êtres bien faits, bien proportionnés, et de taille généralement supérieure à celle des Européens. Jouissant d’une bonne santé, ils sont robustes et agiles. Les habitants de l’Amérique ont de l’esprit, sont bons pour leurs parents et hospitaliers envers les étrangers. Ils sont généreux, tolérants et dépourvus de l'ambition et de l'avidité qui tourmente tant d'Européens. Leur innocence apparente et leur simplicité suscitent l'admiration. Ce sont des enfants de la nature, non corrompus par la société. Ils vivent dans un paradis terrestre comme aux débuts de l’humanité.
Des Peaux-Rouges
Les premiers à être nommés Peaux-Rouges furent probablement les Béothuks à cause de l’habitude de couvrir leur corps et leurs vêtements d’ocre rouge. Les Autochtones du Brésil et des Antilles se peignaient eux aussi le corps en rouge. Ces derniers utilisaient, par contre, le bois de teinture ou rocouyer. Comme l’ocre rouge, la pâte obtenue à l’aide des graines du fruit de cet arbuste est insectifuge, c’est-à-dire qu’elle éloigne les insectes.
Les Français nomment les Autochtones
Au cours de l’histoire, les nations autochtones ont souvent été désignées par des noms qui n’étaient pas les leurs. Certaines appellations leur étaient inconnues, parfois même péjoratives, car ces noms leur étaient souvent donnés par une nation ennemie ou étrangère. Les noms utilisés pouvaient aussi provenir des Européens, ou encore, d’une nation voisine qui donnait un surnom plutôt que le vrai nom à cette nation. Souvent, ils n’ont rien à voir avec les noms que les Autochtones se donnaient eux-mêmes. Le nom d'un groupe autochtone décrivait habituellement la région où il vivait.
L’appellation Huron provient d’un surnom donné par les Français. Leur coiffure aux cheveux relevés (une bande de cheveux raides sur le dessus de la tête) avec les côtés rasés du crâne leur rappelait la hure, c’est-à-dire la raie à rebrousse-poil des sangliers. Ils se nommaient eux-mêmes Wendats ou Ouendats: les «habitants de la péninsule, de l’île». Les Français appelaient les occupants des montagnes de la Basse-Côte-Nord, Montagnais, à cause de l’aspect montagneux de l’embouchure de la rivière Saguenay près de Tadoussac. Ces derniers se désignaient eux-mêmes comme «Innu», c’est-à-dire «homme» (être humain).
La perception des Autochtones vis-à-vis des Européens
Lorsque les Autochtones aperçoivent au loin les navires européens, ils ressentent un mélange de curiosité, de crainte et d’émerveillement. Des questions surgissent. Qui sont ces nouveaux venus ? Des dieux ? Des hommes ou des animaux ? Quelles sont leurs intentions ? Le premier moment de surprise étant passé, leur perception change et on les considère comme des étrangers dont l’apparence et les usages paraissent bien étranges.
Pauvres Européens
Les Autochtones se sentent privilégiés par rapport aux nouveaux venus. Ils se demandent pourquoi le dieu des Européens, qu’on dit riche, ne leur donne pas ce qui leur est nécessaire pour survivre. Pourquoi sont-ils obligés de se donner tant de peine pour venir chercher en Amérique ce qui leur manque ? Ils s’étonnent de les voir abandonner femme et enfants pour affronter les périls de la traversée. Les Autochtones s’estiment plus heureux que les Européens qui ne jouissent pas de la même liberté qu’eux. Ils les considèrent comme des gens toujours soumis à quelqu’un. Ils les voient comme des êtres dépendants puisqu’ils se nourrissent à tous les repas de morue prise chez eux, sinon de leur chasse. Finalement, les premiers habitants ne se croient pas inférieurs aux Européens, même s’ils peuvent apprécier leur technologie. Ils pensent que leur mode de vie est le meilleur et ils apprécient l’environnement dans lequel ils vivent.
Indienne de la tribu des Béothuks, en 1819
Au début, les Béothuks ne touchent pas à l’attirail de pêche ni aux bateaux laissés par les Basques sur la grève. Par la suite, ils ramassent ce qu’ils y laissent afin d’acquérir des produits européens (hachettes, couteaux, lignes, hameçons). Les pêcheurs qualifient ces gestes de pillage. Ils traitent les Béothuks de «mauvaises gens» et de «peuples rudes et cruels». Dès la fin du 16e siècle, les rapports entre les deux groupes se détériorent. Les pêcheurs, qui s’établissent le long du littoral, accaparent de plus en plus d’espace pour le séchage du poisson. Cette appropriation du territoire par les Européens fait en sorte que les Béothuks sont repoussés et contraints de se réfugier de plus en plus loin à l’intérieur de l’île. Cette présence européenne limite leur accès aux endroits de pêche qui assurent la subsistance du groupe. De plus, l’exploitation des ressources de l’île, la coupe de bois pour le chauffage et la construction, ainsi que de vastes incendies de forêt, bouleversent l’équilibre écologique de l’île. Le mode de vie traditionnel et la survie des Béothuks sont menacés.
Avec la colonisation de cette région, les relations des Béothuks avec les Français et les Anglais s’enveniment. Elles deviennent carrément hostiles. Les Béothuks sont traqués par les pêcheurs, les Français mettent leurs têtes à prix et les Anglais les chassent. De nombreux meurtres sont commis. Au début du 19e siècle, il ne reste que 72 Béothuks. La dernière représentante connue de ce peuple, Shawnadithit, meurt en 1829. Divers facteurs expliquent leur rapide disparition: l’intrusion d’étrangers sur leurs terres, qu’ils ne peuvent défendre sans aviver leur haine et être pourchassés, l’inaccessibilité à la mer et à ses ressources pour se nourrir, les guerres avec les Autochtones, dont les Micmacs, les conflits avec les Européens ainsi que les épidémies.
Le caractère de l'Amérindien 1632
Tous les Sauvages, en général, ont l'esprit et l'entendement assez bons et ne sont point si grossiers et si lourdauds que nous nous imaginons en France. Ils sont d'une humeur assez joyeuse et contente; toutefois ils sont un peu saturniens taciturnes, ils parlent fort posément, comme se voulant bien faire entendre, et s'arrêtent aussitôt en songeant un grand laps de temps, puis reprennent leur parole. Et cette modestie est cause qu'ils appellent nos Français femmes, lorsque, trop précipités et bouillants en leurs actions, ils parlent tous à la fois et s'interrompent l'un l'autre. Ils craignent le déshonneur et le reproche et ils sont excités à bien faire par honneur puisqu'entre eux est toujours honoré celui qui a fait quelque bel exploit.
Pour la libéralité, nos sauvages sont louables en l'exercice de cette vertu, selon leur pauvreté, car, quand ils se visitent les uns les autres, ils se font des présents mutuels et, pour montrer leur galantise, ils ne marchandent point volontiers et se contentent de ce qu'on leur baille donne honnêtement et raisonnablement, méprisant et blâmant les façons de faire de nos marchands qui barguignent une heure pour marchander une peau de castor. Ils ont aussi la mansuétude et la clémence en la victoire envers les femmes et petits enfants de leurs ennemis, auxquels ils sauvent la vie, bien qu'ils demeurent leurs prisonniers pour servir.
Ce n'est pas à dire pourtant qu'ils n'aient de l'imperfection, car tout homme y est sujet et, à plus forte raison, celui qui est privé de la connaissance d'un Dieu et de la lumière de la foi, comme sont nos Sauvages, car si on vient à parler de l'honnêteté et de la civilité, il n'y a pas de quoi les louer, puisqu'ils n'en pratiquent aucun trait, excepté ce que la simple nature leur dicte et enseigne. Ils n'usent d'aucun compliment entre eux et sont fort malpropres et mal nets en l'apprêt de leurs viandes nourriture.
Un portrait de l'Amérindien au 17e siècle
Il est juste à présent, pour contenter pleinement la curiosité du Lecteur, de lui faire ici un portrait naturel de leurs mœurs en général, et un abrégé des bonnes et mauvaises qualités des Gaspésiens Micmacs, soit du corps, soit de l'esprit.
Ils sont tous naturellement bien faits de corps, d'une riche taille, haute, bien proportionnée, et sans aucune difformité; puissants, robustes, adroits, et d'une agilité surprenante, surtout quand ils poursuivent les orignaux, dont la vitesse ne cède point à celle des daims et des cerfs. Les hommes sont plus grands que les femmes, qui sont presque toutes petites; mais les uns et les autres d'un maintien grave, sérieux, et fort modeste; marchant posément, comme s'ils avaient toujours quelque grosse affaire à ruminer, et à décider dans leur esprit. Leur couleur est brune, olivâtre et basanée; mais leurs dents sont extrêmement blanches, peut-être à cause de la gomme de sapin, qu'ils mâchent fort souvent, et qui leur communique cette blancheur. Cette couleur cependant ne diminue rien de la beauté naturelle des traits de leur visage: et on peut dire avec vérité, qu'on voit dans la Gaspésie d'aussi beaux enfants, et des personnes aussi bien faites qu'en France; entre lesquelles il n'y a pour l'ordinaire ni bossus, boiteux, borgnes, aveugles, ni manchots.
Ils jouissent d'une santé parfaite, n'étant pas sujets à une infinité de maladies comme nous: ils ne sont ni trop gras, ni trop maigres; et l'on ne voit pas chez les Gaspésiens, de ces gros ventres pleins d'humeurs et de graisse: aussi les noms de gouttes, de pierre, de gravelle, de galle, de colique, de rhumatisme, leur sont entièrement inconnus.
Ils ont tous naturellement de l'esprit, et le sens commun au-delà de ce qu'on se persuade en France; ils conduisent adroitement leurs desseins, et prennent des moyens justes et nécessaires, pour y parvenir heureusement; sont fort éloquents et persuasifs parmi ceux de leur Nation, usant de métaphores et de circonlocutions fort agréables dans leurs harangues, qui sont très éloquentes, particulièrement quand elles sont prononcées dans les Conseils et les Assemblées publiques et générales.
Une comparaison entre les sociétés au début du 18e siècle
Enfin, pour vous tracer en raccourci le Portrait de ces Peuples: avec un extérieur sauvage, des manières et des usages, qui se sentent tout à fait de la barbarie; on remarque en eux une société exempte de presque tous les défauts, qui altèrent si souvent la douceur de la nôtre. Ils paraissent sans passion, mais ils sont de sang-froid, et quelquefois par principe, ce que la passion la plus violente et la plus effrénée peut inspirer à ceux, qui n'écoutent plus la raison. Ils semblent mener la vie du monde la plus misérable, et ils étaient peut-être les seuls heureux sur la Terre, avant que la connaissance des objets, qui nous remuent et nous séduisent, eût réveillé en eux une cupidité, que l'ignorance retenait dans l'assoupissement, et qui n'a pourtant pas encore fait de grands ravages parmi eux. On aperçoit en eux un mélange des mœurs les plus féroces et les plus douces, des défauts des Bêtes carnassières, et des vertus et des qualités de cœur et d'esprit, qui font le plus d'honneur à l'Humanité. On croirait d'abord qu'ils n'ont aucune forme de gouvernement, qu'ils ne connaissent ni loi, ni subordination, et que vivant dans une indépendance entière, ils se laissent uniquement conduire au hasard et au caprice le plus indompté; cependant ils jouissent de presque tous les avantages, qu'une autorité bien réglée peut procurer aux Nations les plus policées. Nés libres et indépendants, ils ont en horreur jusqu'à l'ombre du pouvoir despotique, mais ils s'écartent rarement de certains principes et de certains usages, fondés sur le bon sens, qui leur tiennent lieu de Loi, et qui suppléent en quelque façon à l'autorité légitime. Toute contrainte les révolte, mais la raison toute seule les retient dans une espèce de subordination, qui pour être volontaire, n'en atteint pas moins au but, qu'ils se sont proposés.
Le voyage durant la traversée de l'Atlantique
Avant de s’installer en Nouvelle-France, l’immigrant français devait affronter les périls de la traversée. Ce voyage représentait de nombreux dangers. Les navires affrontaient les tempêtes et les bancs de brume qui cachaient les glaces flottantes qu’il fallait contourner afin d’éviter un naufrage. L’absence de vent empêchait le navire d’avancer. Dans ces conditions, la durée de la traversée était imprévisible. Elle dépendait de la température et des vents. Le voyage vers l’Amérique pouvait prendre deux mois à deux mois et demi environ. Mais il pouvait se prolonger pendant près de 100 jours. Le retour vers la France était toujours plus rapide à cause des vents d’ouest plus favorables. Il prenait un peu plus d’un mois en moyenne.
Les navires mesuraient entre 37 et 57 mètres de long, mais d’autres plus petits effectuaient aussi la traversée vers la Nouvelle-France. Le nombre de membres de l’équipage et de passagers variaient selon l’importance du bateau. On transportait aussi des marchandises, des provisions pour la traversée et des animaux vivants qui seraient consommés pendant le voyage. Dans ces navires, l’espace était très restreint et il n’y avait aucun confort. Les passagers dormaient dans des lits superposés ou des hamacs. Leurs journées étaient monotones. Trois repas par jour étaient servis. Au menu du petit-déjeuner : des biscuits souvent agrémentés de vers après quelques semaines de navigation. Pour le dîner et le souper, un potage nourrissant et, quelques fois par semaine, du poisson ou de la viande salée. Le breuvage principal était la ration quotidienne d’eau. Il y avait aussi du cidre et du vin, ces breuvages étaient également disponibles en quantité limitée.
Dès les premiers jours de la traversée, plusieurs passagers étaient atteints du mal de mer. Un mal très désagréable, mais qui n’était pas dangereux. Par contre, le mal de terre, connu sous le nom de scorbut, pouvait provoquer la mort. Cette maladie était due à un manque de vitamine C surtout causé par l’alimentation sèche et salée consommée pendant le voyage. Diverses fièvres faisaient souvent de nombreuses victimes. Des épidémies mortelles survenaient aussi à cause des mauvaises conditions d’hygiène à bord. Par exemple, sur le navire, il était impossible de faire sa toilette et de laver ses vêtements, étant donné la rareté de l’eau potable. Conservée dans des tonneaux de bois, cette eau ne restait potable qu’une trentaine de jours au plus. Lorsque la traversée se prolongeait trop, le risque de famine survenait puisque les provisions s’épuisaient. Enfin arrivé à Terre-Neuve, on pouvait s’adonner à la pêche à la morue et manger une nourriture fraîche. On était prêt à affronter le nouveau milieu de vie.
Les principaux explorateurs et les principales routes d'exploration
Jacques Cartier dresse une croix à Québec 1534
Les explorations de Giovanni da Verrazano et de Jacques Cartier
Au début du 16e siècle, deux expéditions officielles sont commanditées par le roi français, celles de Giovanni Verrazano et de Jacques Cartier. Lors de son voyage, en 1524, Giovanni Verrazano longe les côtes nord-américaines depuis la Caroline du Nord, en passant par Terre-Neuve, jusqu’à l’île du Cap Breton. Sa prospection des côtes lui permet de conclure que ces terres forment un continent distinct, non pas une île comme on le croyait auparavant. Il nomme le territoire visité Nouvelle France.
Jacques Cartier est le premier explorateur à pénétrer à l’intérieur du fleuve Saint-Laurent au nom du roi de France. Le territoire qu’il visite est peuplé d’Autochtones. Des Iroquoiens sont installés sur l’une ou l’autre rive du fleuve qui constitue un axe de rencontres et d’échanges. Les Amérindiens désignent ces terres sous le nom de kanata; un mot iroquoien qui signifie village ou bourgade. Pour Cartier et ses contemporains, le mot Canada représente le territoire situé entre l’île-aux-Coudres et Hochelaga (Montréal).
À la fin du 15e siècle, plusieurs expéditions sont commanditées par les rois et les marchands européens. Christophe Colomb, qui atteint l’Amérique centrale, se croit arriver aux Indes (1492). Giovanni Caboto se rend à Terre-Neuve où les eaux foisonnantes de morues attireront les bateaux de pêche (1497). Un autre explorateur, Amerigo Vespucci, effectue des expéditions en Amérique du Sud (1499). Son prénom, Americus en latin, est à l’origine du mot Amérique.
Des Vikings à Terre-Neuve
À bord de leurs drakkars, des embarcations à voiles et à rames, des Vikings, aussi appelés Norrois, partent des pays scandinaves. Ils migrent vers l’ouest et fondent une importante colonie en Islande, à la fin du 9e siècle. De là, quelques familles repartent vers l’ouest et colonisent le sud du Groenland. Vers l’an 900, on y retrouve plusieurs de leurs établissements. Ils subsistent grâce à la chasse, à la pêche et à l’élevage. Ils effectuent également du commerce avec le nord de l’Europe et des échanges avec les Inuits et les Amérindiens. Le fer, le bois et le blé sont troqués contre des fourrures, de l’huile de phoque et des dents de morse.
Aux environs de l’an 1000, les Vikings fréquentent le Labrador et Terre-Neuve. Le site archéologique de l’Anse-aux-Meadows, sur la pointe nord-est de Terre-Neuve, atteste leur présence dans cette région. Les archéologues y ont retrouvé les vestiges de trois complexes d’habitation avec une forge. Les relations entre les Autochtones et les Vikings sont difficiles. Souvent, des conflits mettent fin aux tentatives d’échange entre les deux groupes. Les Vikings abandonnent finalement leur établissement à Terre-Neuve et cessent leurs expéditions le long des côtes nord-américaines.
Les pêcheurs européens et les premiers échanges
Dès le début du 16e siècle, les Autochtones du nord-est de l’Amérique entrent en contact avec les pêcheurs et les baleiniers européens. Leur pêche permet de subvenir aux besoins alimentaires de l'Europe dont les réserves de poisson sont épuisées. Rappelons qu’à cette époque, les catholiques doivent faire abstinence, c’est-à-dire ne pas manger de viande, pendant plus de 150 jours par année. La morue est recherchée pour sa chair et pour son huile extraite des foies. Tout comme l’huile de baleine, elle sert de lubrifiant et d’huile à lampe.
L'origine et le nombre de pêcheurs
Les pêcheurs et les baleiniers européens viennent régulièrement s’approvisionner dans le golfe du Saint-Laurent et les bancs de Terre-Neuve. Ils pêchent la morue et chassent la baleine. Des pêcheurs français (normands, bretons), basques (espagnols), anglais, hollandais et portugais s’y rendent en grand nombre. Vers 1570, les eaux poissonneuses de l’Atlantique Nord attirent en moyenne 300 navires et 4 000 personnes par année. Trente années plus tard, jusqu’à un millier de navires européens exploitent annuellement les ressources de ces eaux. À la même époque, une vingtaine de baleiniers basques et leur équipage sont également présente chaque année dans le détroit de Belle-Isle entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve.
Les baleiniers et les morutiers
On rapporte en Europe de la morue verte et de la «morue sèche. La morue nettoyée et salée, afin de la conserver, est appelée morue verte. La préparation du poisson et la salaison s’effectuent en mer. Dans ce cas, les rencontres avec les Autochtones sont limitées. Les pêcheurs ne fréquentent la terre ferme que le temps de renouveler leurs provisions d’eau douce et de s’approvisionner en nourriture. Pour la morue sèche, il faut s’installer sur les rives pendant deux à trois mois. C’est-à-dire le temps de la pêche à bord de petites embarcations et du séchage, au soleil, du poisson placé sur des vigneaux (des échafauds ou treillis surélevés). Les pêcheurs, qui disposent de moins de sel que les premiers, pratiquent ce type de pêche et de conservation. La chasse à la baleine, une autre activité importante, nécessite aussi des bases terrestres. Les chasseurs s’installent pendant six mois pour chasser, dépecer et préparer les baleines. Ils en extraient l’huile grâce à des fours, puis l’entreposent. Leurs activités les mettent inévitablement en contact avec les Autochtones habitant ces régions.
Les premiers échanges entre Européens et Autochtones
Le long des côtes, les Autochtones rencontrent les pêcheurs et les chasseurs installés sur la terre ferme pour la saison. Ils en profitent pour faire un peu de troc. Ils échangent de la viande, du poisson, des peaux de castor et d’orignal contre des objets d’origine européenne comme des chaudrons de cuivre utiles pour la cuisson, des aiguilles et des grattoirs. Les objets en fer tels les couteaux, les haches, les pointes de flèche et d’autres outils tranchants, suscitent le plus d’intérêt. Ces articles européens se répandent dans le Nord-Est par les voies commerciales autochtones. Ils servent à consolider les alliances économiques et politiques entre les nations.
l'expansion coloniale
Les premières tentatives de colonisation européenne en Amérique du Nord échouent au 16e siècle. Celle des Français chez les Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent, avec Jacques Cartier en 1541, dure à peine un an. Une colonie portugaise est établie dans la région du Cap-Breton ou de l’Île-du-Prince-Édouard en territoire micmac (entre 1521 et 1525). Elle n’a pas davantage remporté de succès. Celle des Anglais, en Virginie (entre 1585 et 1590), est aussi abandonnée.
Les Européens apprendront que pour s’adapter au nouveau milieu et y survivre la coopération et les alliances avec les Autochtones sont essentielles. C’est avec Samuel de Champlain que l’expansion de la colonisation débutera véritablement. Le commerce des fourrures donnera naissance aux premiers postes de traite comme celui de Tadoussac, situé à l’embouchure du Saguenay, en territoire innu. Ces postes sont localisés dans les lieux traditionnels de rencontre des Autochtones. Le désir des puissances européennes d’exploiter les richesses du pays, de prendre possession de nouvelles terres, ainsi que le besoin de s’approvisionner en fourrures, poussent les Européens à envisager des établissements permanents.
Les établissements européens
Les Français s’installent d’abord en Acadie à l’île Sainte-Croix (1604), en territoire malécite, puis à Port-Royal (1605) en territoire micmac où le chef Membertou accueille Samuel de Champlain et ses hommes. Les Français s’établissent ensuite à Québec (1608) et construisent l’Habitation de Québec. À ce moment, la vallée du Saint-Laurent est fréquentée par les Innus et les Algonquins. Ils ont remplacé les populations iroquoiennes qui occupaient autrefois ce territoire.
De leur côté, les Anglais fondent une première colonie permanente à Jamestown en Virginie (1607). Les Puritains, des dissidents religieux anglais, se fixent plus tard à Plymouth, Massachusetts (1620). Afin d'exploiter le réseau commercial de la vallée de l'Hudson, les Hollandais s’installent à New York (1609). Les Suédois choisissent plutôt la Pennsylvanie (1645). Au milieu du 17e siècle, des colonies françaises, anglaises, hollandaises et suédoises jalonnent la côte est de l’Amérique du Nord.
La perception du Nouveau Monde par les colons
À l’arrivée des colons européens, le paysage naturel du continent américain est encore à peu près intact. Les Autochtones n’ont pas vraiment modifié la nature, sauf d’une façon temporaire. Les explorateurs, et plus tard les premiers colons, parlent de la nature idyllique du Nouveau Monde. Ils vantent sa salubrité et son abondance. Les forêts ne manquent pas et les richesses de la faune et de la flore sont inouïes. Les cours d’eau abondent en poissons de toutes sortes et la pêche y semble prodigieuse. Une grande variété de volatiles (oie blanche, outarde ou bernache, sarcelle, perdrix) survole le pays. Les observateurs ont décrit des migrations énormes de tourtes, d’outardes et de canards qui, à leur passage, obscurcissent le ciel. Ils mentionnent aussi l’immensité du territoire et la disponibilité des terres, contrairement à l’Europe où elles se font déjà rares à cette époque. Les hivers longs et rigoureux surprennent aussi les premiers colons.
La vie en France
Pendant la première moitié du 17e siècle, au moment où les contacts entre Amérindiens et Européens se multiplient, la France est marquée par de nombreuses guerres avec l’Angleterre, l’Espagne, les Pays-Bas et d’autres pays. À l’intérieur même de la France, les catholiques et les protestants s’affrontent avec violence dans le cadre des guerres de religion. À la même époque, la chasse aux sorcières atteint son apogée. La France, dont l’économie est en crise, est également agitée par des soulèvements populaires contre l’absolutisme de l’autorité royale. Les épidémies, les famines et les guerres affectent durement les paysans qui regroupent la majorité (90%) de la population française. Une petite classe de privilégiés, formée de nobles, s’en tire mieux.
L'influence des Amérindiens sur les colons français
Les Européens empruntent au monde amérindien des connaissances géographiques, botaniques et fauniques. On découvre le continent et on exploite ses ressources, principalement les fourrures, grâce à l'aide autochtone. On recueille des informations auprès de ceux-ci à propos des peuples habitant les diverses régions, de la faune, des différents usages de la flore (dont l'utilisation des plantes médicinales) et des ressources (comme les sites de mines de cuivre ou de plomb). On s'initie aux nouvelles techniques d'orientation en forêt, de chasse et de pêche comme le pistage, la trappe et la pêche sous la glace.
En 1634, le premier hivernement des habitants à Trois-Rivières s’avère difficile. Le scorbut cause le décès de quelques colons et la faim tenaille les premiers occupants. On réussit finalement à remédier au manque de vivres grâce à l’aide d’un Amérindien qui montre aux Trifluviens à pêcher sous la glace.
Les coureurs des bois
Plusieurs jeunes gens migrent vers les régions de traite. On les a nommés coureurs de bois. Ces hommes étaient attirés par les profits rapides que procurait la traite des fourrures et par la liberté du mode de vie des Autochtones. Ils quittaient la colonie pour faire la traite et pour vivre auprès des Amérindiens dont ils adoptaient le mode de vie.
L’éducation des enfants
L'éducation des enfants semble aussi touchée. Le grand amour des Amérindiens pour leurs enfants est un thème qui revient fréquemment dans les écrits des 17e et 18e siècles. Selon les critères européens, cet amour est souvent jugé démesuré. Les missionnaires parlent de « tendresse extraordinaire ou encore d'amour excessif pour les enfants. Ils se plaignent de la très grande liberté accordée aux enfants et du mode d'éducation où l’on refuse de recourir à la violence pour dresser les jeunes. Selon le missionnaire jésuite Paul Le Jeune, les Autochtones ne peuvent supporter qu'on châtie leurs enfants, non pas même de paroles; ne pouvant rien refuser à un enfant qui pleure. En 1707, l'intendant de la Nouvelle-France se plaindra du fait que les habitants de ce pays-ci les Canadiens n’ayant jamais d’éducation à cause de la faiblesse qui vient d’une folle tendresse que les père et mère ont pour eux dans leur enfance, imitant en cela les sauvages, ce qui les empêche de les corriger et discipliner.
La guerre à l’indienne
À l'école indienne, les Canadiens ont appris à faire la petite guerre. Une guerre d'embuscade, proche de la chasse, mieux adaptée aux conditions du nouveau pays. Le guerrier y possède beaucoup d'autonomie et de mobilité contrairement aux soldats des grandes armées européennes s'affrontant, en rangée et à découvert, sur d'immenses champs de bataille.
Les efforts de christianisation des missionnaires
Les Français, qui s’établissent dans la vallée du Saint-Laurent, désirent évangéliser et civiliser les Autochtones, c’est-à-dire les transformer en Français catholiques. Dès les débuts de la colonie, les dirigeants mettent de l’avant des moyens pour y parvenir: l’éducation des jeunes, le mariage mixte (le mariage entre Autochtones et Français), l’évangélisation et la sédentarisation.
Des missionnaires et des religieuses prennent en charge ces projets d’assimilation. Certains se consacrent à l’étude des langues autochtones afin de gagner leur amitié et de transmettre plus efficacement leur enseignement. Des missionnaires se rendent en mission dans les communautés amérindiennes. Leur connaissance de la langue et des cultures en font de précieux intermédiaires pour les dirigeants coloniaux. Notons qu’à la même époque, en France, des missionnaires parcourent déjà les campagnes pour changer les mœurs des paysans français qu’ils considèrent aussi comme des païens.
Les Français croient fermement que les Autochtones s’apercevront rapidement des avantages de leur mode de vie et qu’ils l’adopteront aussitôt. Au début, on pense que les efforts d’évangélisation dans les réserves et les missions éloignées portent fruit.
Une colonie qui repose sur le commerce des fourrures
Dès le début du 17e siècle, les commerçants français établissent des postes de traite, entre autres, à Tadoussac et à Québec. Afin de réglementer le commerce des fourrures, le roi de France accorde le monopole de la traite à certaines compagnies. En échange, la compagnie s’engage à explorer le territoire, à aider à convertir les Autochtones à la foi catholique, à peupler et à développer la colonie. Les compagnies ne remplissent pas leurs engagements en ce qui concerne le peuplement de la colonie et l’évangélisation des Autochtones. Quant à lui, le commerce des fourrures reste rentable malgré les profits qui varient irrégulièrement selon les années. La colonie se développe autour du commerce des fourrures.
La traite des fourrures devient donc la base de l’économie de la Nouvelle-France. À partir de 1715, ce commerce prend beaucoup d’ampleur. En dehors de ses retombées économiques, il mène à l’exploration de régions situées plus à l’ouest. C’est à cette époque que Gaultier de la Vérendrye explore l’intérieur du continent. Avec ses fils, il fonde des postes de traite dans l’ouest. Ils se rendent jusqu’au pied des Rocheuses. Ces explorations permettent au roi de France de revendiquer le droit d’occuper un plus vaste territoire pour le coloniser. Elles mènent aussi à l’élargissement du réseau de traite des fourrures.
Malgré le développement de l’agriculture et d’industries, comme les forges du Saint-Maurice et la construction navale à Québec, le commerce des fourrures représente toujours au milieu du 18e siècle environ 70% des exportations vers la France. L’économie de la Nouvelle-France repose donc sur cette ressource. Entre 1660 et 1760, le nombre de peaux de castor expédiées en France est évalué à 25 millions. À ces peaux, s’ajoutent les peaux de renard, de martre, d’ours, de caribou, de rat musqué et d’autres mammifères.
Les réactions provenant des personnages politiques autochtones
Dès les premières rencontres avec les Européens, des chefs autochtones réagissent à leur façon de s’approprier le territoire. Les Autochtones ne sont pas réduits au silence, ils affirment leur préférence, expriment leur mécontentement ou s’objectent selon les circonstances.
À la fin du 16e siècle, les peaux de castor sont très appréciées en Europe pour la confection de chapeaux dont la mode se répand dans les classes aisées. La demande pour les fourrures en provenance d’Amérique du Nord s’accroît à mesure que ces chapeaux deviennent plus populaires et que les réserves européennes de castor s’épuisent. Elle prend tellement d’ampleur qu’on organise des expéditions chargées uniquement de rapporter des fourrures. Ce commerce est à l’origine de la colonisation du territoire.
Les chapeaux faits de peau de castor étaient très en demande
La christianisation des peuples autochtones
Le couvent des Ursulines, accueille des enfants amérindiens. Cependant, ceux-ci tolèrent mal la vie réglée, derrière des portes closes, et s’enfuient à la première occasion. Les autorités françaises, lors des négociations de paix avec les Iroquois, demandent toujours à ceux-ci d’envoyer quelques-uns de leurs enfants au couvent de Québec. En fait, elles pensent que les Amérindiens retiendront leurs attaques pour ne pas blesser leurs enfants.
Les premiers Européens à débarquer en Nouvelle-France ont sous-estimé l'importance de l'univers religieux autochtone. Ne voyant parmi eux aucun lieu de culte ni de religieux, ils concluent à l'absence de religion. Mais l'importance et la complexité de l'univers spirituel autochtone sont peu à peu dévoilées lors des rencontres qui deviennent plus fréquentes. Les missionnaires se rendent compte que la vie quotidienne est empreinte de spiritualité, qu’elle est imprégnée d'une vision religieuse des choses. Malgré l’échec relatif des projets d’assimilation, le travail des missionnaires va déstabiliser les individus et les communautés. L’activité missionnaire remet en cause plusieurs aspects de la civilisation amérindienne dont la conception de la famille, la place de la femme et les relations entre les personnes.
Les maladies européennes
Depuis des millénaires, l’Europe, l’Asie et l’Afrique entretenaient des contacts réguliers. L’Amérique, étant restée en dehors de ce circuit d’échanges, les habitants du continent étaient isolés géographiquement et protégés de nombreuses maladies. Dès les premières rencontres entre Autochtones et Européens, c’est-à-dire à l’époque des pêcheurs et des premiers explorateurs, les maladies commencent à circuler. L’impact des nouvelles maladies qui se répandent en Amérique est terrible, c’est une véritable catastrophe démographique.
Des maladies dévastatrices
Les Autochtones ignorent la plupart des infections présentes en Europe. N’ayant pas développé d'immunité, ils sont très vulnérables face à ces celles-ci. Quelles sont donc ces maladies qui font tant de ravages ? Parmi les affections introduites en Amérique, l’on retrouve: les fièvres typhoïdes, la blennorragie, la diphtérie, la coqueluche et la syphilis. Cette dernière maladie existait aussi en Amérique, mais sous une autre forme. D’autres infections, comme la pneumonie, même la grippe et des maladies d’enfants (rougeole, roséole, rubéole, varicelle, scarlatine) sont souvent mortelles pour les Autochtones qui en sont atteints.
La variole, la rougeole et le typhus restent les maladies les plus meurtrières. En Europe, la variole (picote ou «petite vérole) touchait surtout les enfants; en Amérique, cette infection est celle qui fait le plus de ravages parmi les Autochtones. La variole se transmet directement, d’individu à individu, mais également par des couvertures et des vêtements. Elle est très contagieuse.
Les guerres coloniales et leurs effets
Défaite des Iroquois au lac de Champlain
À la fin du 17e siècle, les rivalités entre Français et Anglais dépassent la question du commerce. Il s’agit alors d’un affrontement entre deux empires qui souhaitent coloniser le territoire. Les guerres entre Français et Anglais, qui sont déclarées en Europe, se répercutent en Amérique et deviennent ce qu’on nommera les guerres franco-anglaises. Les Amérindiens, à titre d’alliés de l’un ou de l’autre camp, y seront impliqués.
Les Autochtones autour des postes français
Tentes de Montagnais et de Naskapis
À cause de l’intérêt suscité par le commerce des fourrures, puis de la détérioration des conditions de vie à la suite des épidémies et des guerres, diverses nations autochtones se rapprochent des Français et fréquentent leurs établissements. Ces Autochtones établis dans des villages près des colons sont nommés les Amérindiens domiciliés.
Les Amérindiens domiciliés
Campement de la pointe Lévis
En tout, cinq nations viennent habiter dans les missions (villages) situées à proximité des colons français dans la vallée du Saint-Laurent : les Algonquins, les Innus-Montagnais, les Hurons, les Iroquois et les Abénakis. Ils y viennent pour différentes raisons :
Se rapprocher dans le but de faire la traite des fourrures, fuir leurs ennemis, se réfugier parce qu’ils ont été délogés de leur territoire, échapper aux tensions entre convertis et traditionalistes (non convertis) qui existent dans leur village, profiter des avantages matériels qu’offrent les missionnaires dans les réserves trouver un abri et de la nourriture
Les Autochtones viennent s’installer près des Français à titre d’alliés et non de sujets. Les habitants de ces villages représentent de précieux alliés militaires pour les Français. Ils protègeront et défendront la colonie.
L’exemple des Abénakis (1705)
Sa Majesté est persuadée que c'est à bonne fin qu'il a porté les Abénakis à venir s'établir parmi les Français, elle ne laisse pas cependant d'y trouver de l'inconvénient parce que partie de ces Sauvages étant restés dans leurs anciennes habitations, il est à craindre que les Anglais ne les accablent et que nous ne perdions cette barrière qui occupent les Anglais du côté de Pentagouet et que ceux qui sont venus dans la Colonie ne soient beaucoup à charge, cependant, puisque cela est fait, il n'y a qu'à le laisser subsister, il fera savoir dans la suite l'effet que ce changement aura produit
Le village abénaki de Wôlinak (1721)
Le village abénaki de Bécancour n'est pas présentement aussi peuplé qu'il l'était il y a quelques années. Il ne laisserait pourtant pas de nous être d'un grand secours, si la guerre recommençait. Ces Sauvages sont les meilleurs partisans du pays, et toujours disposés à faire des courses dans la Nouvelle-Angleterre, où leur nom seul a souvent jeté l'épouvante jusque dans Boston. Ils ne nous serviraient pas moins bien contre les Iroquois, à qui ils ne cèdent point en valeur, et qui ne sont pas aussi bien disciplinés qu'eux.
Les Amérindiens : des alliés indispensables à la colonie
Champlain explorant l’intérieur du continent
Dès le début du 17e siècle, les relations entre Autochtones et Européens s’élaborent dans le cadre d’ententes entre nations. Elles sont essentielles afin d’assurer le succès du commerce des fourrures et des premiers établissements européens. Pour les Amérindiens, l’alliance vise le maintien de leur position dans le réseau commercial déjà existant avant l’arrivée des Européens, l’acquisition de nouveaux produits et l’appui militaire en cas de besoin. Pour eux, devenir partenaires implique la réciprocité dans le commerce et dans la guerre. Les échanges, dans quelque domaine que ce soit, doivent s’équilibrer.
Territoire et population Iroiquoises vers 1500
Les sociétés Iroquoises comptaient une vingtaine de nations sédentaires dont la population était dispersée dans une centaine de villages.
Localisation
Les sociétés Iroquoises occupaient le sud des Grands Lacs (lacs Huron, Érié et Ontario), l'État de New York et la vallée du Saint-Laurent. Les Hurons-Wendats et les Iroquois en sont les représentants les mieux connus. Certaines nations iroquoiennes comme les Andastes, les Ériés, les Neutres et les Pétuns sont aujourd’hui disparues.
Les Iroquois du Saint-Laurent
Vers l'an 1 000, des populations iroquoiennes habitaient le long du fleuve Saint-Laurent. Leurs villages étaient répartis entre les villes actuelles de Québec et de Montréal. Les Iroquois du Saint-Laurent partageaient le même mode de vie que les autres membres des familles iroquoises. Ils vivaient des produits que leur procuraient l’agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette. Pendant la seconde moitié du 17e siècle, ces populations iroquoiennes ont mystérieusement disparu. Les archéologues tentent toujours de résoudre cette énigme.
Les Hurons-Wendats : les gens de la péninsule
Les Hurons-Wendats étaient établis sur une péninsule située au sud-est du lac qui porte leur nom dans le sud de l'Ontario. Cinq nations parlant une langue similaire et partageant des intérêts communs étaient membres de la fédération huronne-wendate. La population était répartie dans une vingtaine de gros villages situés l’un près de l’autre.
La fédération huronne-wendate
Arendahronons La nation du Rocher ou de la Pierre
Ataronchronons La nation du Marais ou de l'Argile
Attignaouantans La nation de l’Ours
Attignéénongnahacs La nation de la Corde
Tahontaenrats La nation du Chevreuil
Les Iroquois : les « gens de la maison longue »
La Ligue des Iroquois, ou Ligue Ho-de'no-sau-nee, est une fédération qui regroupait cinq nations. Les membres de la Ligue des Iroquois occupaient une région comprise entre l'État de New York et le sud du lac Ontario.
Les termes français pour désigner les nations iroquoises sont d'origine huronne-wendate. Ils seraient plus proches du nom que ces nations se donnaient elles-mêmes avant leur rencontre avec les Européens. On utilise souvent les termes anglais qui apparaissent entre parenthèses.
Qualité du sol et reliefs
Les Iroquois habitaient des terres fertiles argileuses ou sablonneuses et riches en ressources de toutes sortes. Au pays des Hurons-Wendats, on retrouvait des petites collines et de très belles plaines. Mais le sol sablonneux qui retenait peu l'eau, manquait parfois d'humidité ce qui affectait les récoltes. Il y avait aussi les Adirondaks, des chaînes de montagnes importantes situées au sud et à l’est dont le sommet le plus élevé atteignait 1638 mètres. Sur la rive gauche de l’Hudson, soit au sud-est de cette même chaîne de montagnes, s’élevait le massif des Catskill et les Green Mountains.
Flore
Une grande variété de petits fruits tels que les fraises, les framboises, les bleuets et les mûres faisait le régal des Iroquois. Dans les régions fréquentées par les Iroquois, des centaines de plantes médicinales ou comestibles étaient également utilisées pour se nourrir ou se guérir.
Faune
Les Iroquois du Saint-Laurent profitaient des eaux poissonneuses du fleuve et des forêts giboyeuses des alentours. Les rivières et les lacs d’Huronie et d’Iroquoise renfermaient de grandes quantités de poissons et de tortues. On y retrouvait plus de 70 espèces de poissons (aloze, anguille, barbue, brochet, carpe, doré, corégone, esturgeon, saumon, truite, flétan, hareng, maquereau, morue, perchaude, etc.) et des crustacés. L'esturgeon de lac était une espèce présente en abondance dans la région des Grands Lacs. Il remontait les rivières à l'automne pour frayer. Le saumon de l’Atlantique remontait également l’Hudson pour nager ensuite dans le Saint-Laurent et le lac Ontario.
Quelques espèces d’oiseaux migrateurs, comme les grues et les oies, faisaient escale dans les régions habitées par les Iroquois. Au pays des Hurons-Wendats, on dénombrait de grandes quantités de dindons sauvages (coqs d'Inde).
Dans les forêts environnantes, le gibier comme le cerf (chevreuil), l’ours et le castor était très abondant. On retrouvait aussi des martres, des loups et des écureuils noirs.
Les chevreuils et les wapitis
Dans le pays des Hurons-Wendats et de leurs voisins, les Neutres, les chevreuils étaient innombrables. On raconte qu’ils pouvaient être jusqu’à des centaines rassemblés au même endroit. Par contre, il n’y avait pas de chevreuil dans la vallée du Saint-Laurent. On chassait également les wapitis présents dans l’Est de l’Amérique du Nord jusqu’à Montréal et en Estrie. Cette espèce, le wapiti de l’Est, est aujourd’hui éteinte. Il existe toujours une sous-espèce de ce cervidé dans l'Ouest de l'Amérique du Nord.
Voici des illustrations d'animaux qui ont été réalisées au 17e siècle par Louis Nicolas :
Illustrations de Louis Nicolas (1634-après 1678)
Feuillus et conifères
Les feuillus (bouleau, cèdre, chêne, hêtre, orme, tilleul, hickory) et les conifères de diverses espèces (pins, sapins) poussaient en grande quantité dans les territoires occupés par les Iroquois. Toutefois, les Iroquois habitaient une région où le bouleau ne poussait pas mais où le pin était très présent. Diverses sortes d'arbres, comme l'hickory (noyer blanc) donnaient aussi des noix comestibles.
Hydrographie
Trois des cinq Grands Lacs occupaient le territoire des Iroquois : les lacs Huron, Érié et Ontario. Les Iroquois vivaient près d'une grande étendue d'eau douce, le lac Ontario, et près de la rivière Hudson. Les Hurons-Wendats étaient situés sur une pointe de terre qui s'avance dans le lac qui porte leur nom. Leur territoire était aussi entrecoupé de plusieurs rivières (Richelieu, des Outaouais, Hudson, Susquehanna, etc.) et ruisseaux. Dans cette région, entourée d'eau, on retrouvait de grandes zones marécageuses.
Hydrographie des Grands Lacs
Population
La population iroquoienne du nord-est de l’Amérique est évaluée à environ 100 000 individus au début du 17e siècle. La nation huronne-wendate regroupait au moins 30 000 personnes à la même époque. Pour sa part, la population iroquoise comptait environ 15 000 individus au milieu du 17e siècle. Les sociétés iroquoises étaient probablement plus nombreuses avant cette date. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets dévastateurs des épidémies d'origine européenne.
Activités de subsistance
Les Iroquois qui pratiquaient l’agriculture vivaient essentiellement de leurs récoltes. La pêche, la chasse et la cueillette des petits fruits et des noix complétaient leur alimentation. L'importance respective de ces ressources variait selon les nations iroquoises et le milieu qu'elles habitaient. Certaines nations iroquoises vivant dans des régions moins propices à l'agriculture, dont les habitants de Stadaconé, dépendaient davantage de la pêche et de la chasse. D'autres, comme les Hurons-Wendats, étaient surtout des agriculteurs. Les Iroquois pratiquaient également des activités de subsistance au fil des saisons.
En plus du maïs, les femmes iroquoises cultivaient des courges, des haricots et des tournesols. Le maïs, la courge et le haricot étaient tellement bien associés dans leur esprit qu’elles nommaient ces plantes les trois sœurs. Cultivées ensemble, elles étaient bénéfiques pour le sol. Tandis que les feuilles du maïs protégeaient les courges du soleil et du vent, ses tiges servaient de tuteurs aux haricots grimpants.
Les haricots fixaient l’azote dans le sol et en retardaient l’épuisement. Quant à elles, les courges qui s'étendaient sur le sol limitaient la présence des mauvaises herbes et prévenaient l'érosion tout en conservant l'humidité du sol. Cette connaissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le compagnonnage des plantes dénote une observation attentive de la part des agricultrices autochtones.
Les techniques agricoles des Iroquoises donnaient de très bons rendements. Leurs méthodes permettaient l'accumulation de larges surplus pour l'hiver et même de réserves pour deux, trois ou quatre ans, en cas de mauvaise récolte.
Une fois leurs besoins comblés, les surplus accumulés étaient échangés avec d’autres nations autochtones contre divers produits.
L'agriculture des Wendates et des Iroquoises
Les Huronnes-Wendates avaient acquis une longue expérience dans le domaine de l’agriculture. Elles cultivaient d’immenses champs de maïs qui entouraient leurs villages. Le récollet Gabriel Sagard, un missionnaire qui visitera leur pays, la Huronie, au début du 17e siècle, mentionnera qu’il est plus facile de s’y perdre dans un champ de maïs que dans une forêt.
Comme les Huronnes-Wendates, les femmes iroquoises pratiquaient également l'agriculture. Un observateur du 17e siècle mentionnera que les Onontagués cultivent des champs de maïs qui s’étendent sur une distance de trois kilomètres autour de leur village.
La préparation des champs, les semences et les récoltes
Les hommes avaient pour tâche de défricher les terres nécessaires à l’agriculture en pratiquant la méthode d’abattage des arbres par brûlis. Ils enlevaient l’écorce et les branches des arbres puis les faisaient brûler à leurs pieds après avoir appliquer une couche d’argile sur leur tronc pour empêcher la propagation du feu dans la cime des arbres.
L'arbre brûlé était ainsi plus facile à couper à l'aide d'une hache faite d'une pierre très dure et peu cassante. Avec le temps, les souches pourrissaient et pouvaient facilement être déracinées. Toutes les autres tâches reliées à l'agriculture, des semences en passant par l'entretien des champs jusqu'à la récolte, revenaient aux femmes aidées des enfants. Seule la culture du tabac était réservée aux hommes.
Dès que les neiges étaient fondues, les femmes se réunissaient dans les champs situés près du village. À l’aide de l’herminette et du houx, elles préparaient le sol pour les semences. Elles formaient de petites buttes où elles semaient de neuf à dix grains de maïs. Ces grains avaient déjà été placés entre deux écorces humides pour hâter leur germination.
Pendant l’été, elles entretenaient leurs jardins. Accompagnées de leurs enfants, elles arrachaient les mauvaises herbes et repoussaient les oiseaux qui venaient manger leur maïs.
À l'automne, les Iroquoises récoltaient le maïs et les autres plantes cultivées. Les épis de maïs cueillis étaient attachés en paquets à l’aide des feuilles qui les enveloppaient et qui étaient retournées vers le haut. Cette activité donnait lieu à la fête des récoltes. Pendant la nuit, les femmes et les hommes se rassemblaient dans les champs pour tresser le maïs. Les épis de maïs étaient ensuite disposés à l’intérieur de la maison, le long des murs, sur des perches où ils séchaient.
Une fois que le grain était sec et prêt à être serré, les femmes et les filles l'égrenaient, puis le nettoyaient. Ensuite, elles l’entreposaient dans de grands paniers d’écorce ou de grands vases en argile à l’intérieur des maisons. La plus grande partie du maïs récolté était ainsi séché, pilé, puis transformé en farine.
Chasse, pêche et piégeage. Les techniques de chasse et de piégeage
Pour s'assurer de bonnes chasses et de bonnes pêches, les Iroquois comptaient sur leur habileté, leur connaissance du territoire et les habitudes des animaux. Ils maîtrisaient aussi plusieurs techniques de pêche et de chasse qui leur permettaient de tirer profit de l’abondance des ressources pendant toute l'année. Les territoires de chasse, de pêche et de cueillette étaient partagés selon une entente conclue entre les groupes familiaux, les membres de la bande ou de la nation.
La plupart des Autochtones employaient les mêmes techniques de chasse et les mêmes armes (arcs et flèches, massues et lances). Différentes techniques afin d'attirer et de piéger le gibier existaient : les assommoirs, les collets, les filets, les trappes, les caches à canards et les appeaux. Le collet, fait de lanières de cuir ou de babiches, était souvent utilisé pour capturer le petit gibier comme le lièvre, mais aussi pour attraper de plus grands animaux comme le chevreuil. L'animal était pris au piège par le cou ou par la patte. Les oiseaux migrateurs, comme les oies sauvages, étaient aussi attrapés au collet, au filet ou à l'arc. Les perdrix et les tourtes (aujourd'hui disparues) étaient tellement abondantes qu'elles pouvaient même être prises au filet.
La grande chasse
Parmi les Iroquois, la chasse se pratiquait surtout pendant l'automne et l'hiver. Les hommes, qui partaient pour la grande chasse annuelle à l'automne, revenaient habituellement au village en décembre. Les Iroquois pourchassaient surtout les cerfs de Virginie, appelés chevreuils au Québec, et les ours noirs bien gras à l’automne. Ils chassaient aussi des castors, des lièvres, des martres, des loups et des écureuils noirs. Quant à la chasse aux oiseaux, elle prenait davantage d'importance à l'automne et au printemps. Les grues et les oies étaient attrapées au collet ou à l'arc.
Les Iroquois, qui retrouvaient moins de dindons et de chevreuils dans la région qu'ils habitaient, devaient s'éloigner davantage que les Hurons-Wendats pour la chasse. Les Iroquois quittaient leurs villages pendant plusieurs semaines pour chasser à l'intérieur des terres.
La chasse aux Chevreuils
Pour capturer les chevreuils, les Iroquois utilisaient la technique de rabattage. Plusieurs chasseurs se plaçaient dans les bois de manière à fermer une pointe de terre qui menait jusqu’à une rivière. Ils avançaient en criant et en faisant beaucoup de bruit. Les animaux effrayés fuyaient. Arrivés au bout de cette pointe de terre, qui formait un cul-de-sac, ils étaient pris au piège dans des filets. Sinon, les chasseurs les attendaient armés de leur arc et de leurs flèches. Certains animaux se jetaient à l’eau pour tenter de fuir, mais cela facilitait leur capture par les chasseurs qui étaient dans les canots. La battue était très efficace sur les îles où les cerfs abondaient. Les Iroquois et les Neutres avaient la réputation de courir aussi vite que les chevreuils même lorsqu'ils étaient chaussés de raquettes. Ainsi, ils en attrapaient en grande quantité.
La chasse à l'ours
Les chasseurs, qui savaient reconnaître la présence de l'ours dans les bois, s'approchaient prudemment de sa tanière et l'encerclaient. L'ours surpris ne pouvait pas s'échapper. Pour le faire sortir, les hommes frappaient l'arbre qui l'abritait et l'assommaient dès sa sortie. Les ours étaient aussi chassés à l'arc ou attrapés au piège. Lorsque les chasseurs capturaient un ourson, on le gardait parfois au village. Pendant deux à trois ans, il était enfermé dans un petit enclos fait de pieux de bois plantés en terre. Il était engraissé avec les restes de sagamité, puis mangé lors d'un festin.
Samuel de Champlain, Les voyages de la Nouvelle France occidentale, dicte Canada, 1632. Champlain a laissé une description d'une chasse aux chevreuils à laquelle il participe, à l'automne 1615, en compagnie de chasseurs wendats. En 38 jours, ils capturent 120 cerfs au nord de Kingston (Ontario).
Des enclos à chevreuils
Les Hurons-Wendats utilisaient une technique tout à fait particulière pour chasser les cerfs. Ils organisaient de grandes chasses collectives qui réunissaient plusieurs dizaines de chasseurs pendant environ un mois. Accompagnés de leurs chiens, ils rabattaient les cerfs vers une sorte d’enclos, une palissade en forme de triangle. Des chasseurs armés d’arc et de flèches y attendaient les cerfs. Une fois entrés à l’intérieur, les cerfs ne pouvaient sortir que par une petite ouverture. Grâce à cette technique de chasse, les Hurons-Wendats pouvaient prendre jusqu’à cent cerfs en un mois environ.
Pendant qu’ils dirigeaient les cerfs vers les enclos, les Hurons-Wendats en profitaient pour découvrir où étaient établis les castors qu'ils traqueraient une fois la chasse aux cerfs terminée. Leur campement était souvent installé près d’un lac. Les hommes pouvaient y pêcher la truite. Ils prenaient aussi des loutres dans des pièges appâtés avec quelques-unes de ces truites qu'ils venaient de capturer.
La pêche
Plusieurs familles iroquoises vivaient dans des camps de pêche une bonne partie de l’année. Les femmes collaboraient à cette activité en sortant le poisson des canots et en l’apprêtant. Les Iroquoises connaissaient les périodes les plus favorables pour la capture des poissons et savaient où les trouver. L'été assurait un bon approvisionnement. Mais les saisons les plus propices pour pêcher étaient l’automne et le printemps à l’époque des migrations de certaines espèces (alozes, anguilles, saumon) et pendant les périodes de frai (esturgeons, barbues). L’automne, les pêcheurs accumulaient des surplus considérables de poissons qui permettaient de faire des provisions pour l’hiver à venir. L'hiver, la pêche à la ligne ou au harpon sous la glace permettait des captures occasionnelles.
Les Iroquois connaissaient diverses techniques pour s'assurer de bonnes pêches. Les Hurons-Wendats et les Iroquois utilisaient surtout des filets qu'ils tendaient le soir dans la rivière. Au matin, ils recueillaient cette manne. Ils capturaient les esturgeons avec des filets durant l'hiver ou avec un harpon pendant l'été. Les Iroquois construisaient aussi des barrages en des endroits précis y laissant de petites ouvertures où ils mettaient leurs filets. Des barrages étaient aussi dressés dans les cours d'eau. Ces sortes de murets faits de bois et de buissons empêchaient les poissons de passer tout en laissant l'eau circuler. Les filets et les flèches étaient aussi utilisés pour la pêche.
Indiennes pêchant au harpon à la lueur d'une torche, au Canada-Est (Québec)
vers 1860. Un flambeau, installé sur la pointe du canot, attirait les poissons lors des pêches nocturnes. Un pêcheur s'installait à l'avant du canot, un harpon à la main; un autre, assis derrière, dirigeait l'embarcation.
Les Iroquois pêchaient à la ligne en utilisant souvent comme appât la peau d'une grenouille. L'hameçon était formé d'un morceau de bois où était fixé un os qui servait de crochet. Lorsqu'ils voyageaient en canot, les Autochtones laissaient traîner la ligne derrière eux. Le harpon était fort utile en été quand l'anguille était abondante et pendant les pêches nocturnes faites à l'aide de flambeaux.
Cueillette
Selon les saisons, les Iroquoises ramassaient des petits fruits, des racines, des noix et des plantes médicinales.
Elles profitaient du printemps pour recueillir la sève d’érable. Pendant l’été, elles cueillaient des fraises, des framboises, des bleuets et des mûres. La récolte de ces petits fruits était assez importante pour donner lieu à la fête des fraises ou celle des framboises.
Les canneberges (atocas), les prunes, les petites cerises, les pommes et les raisins sauvages étaient d’autres produits de la cueillette.
Les Iroquoises récoltaient aussi plusieurs sortes de noix, des noisettes, des châtaignes et des glands. La cueillette des noix se déroulait surtout à la fin de septembre et en octobre. L’abondance des noix permettait d’en conserver pour les mois suivants.
La cueillette de l'eau d'érable
Au printemps, les femmes et les enfants recueillaient l’eau d’érable dans des paniers faits d’écorce de bouleau.
Ils faisaient bouillir l’eau sucrée dans des récipients en écorce ou, parfois, dans de grands contenants creusés à même un tronc d'arbre en y jetant des pierres brûlantes rougies par le feu.
Ils devaient constamment remplacer ces pierres afin de garder une température assez élevée pour maintenir le point d’ébullition qui permettait l’épaississement du sirop.
La cueillette des plantes médicinales
Même si les femmes autochtones cueillaient des plantes médicinales tout au long de l’été, l’automne demeurait tout de même le temps idéal pour récolter de nombreuses variétés de plantes qui atteignaient plus tardivement leur plein mûrissement.
Pour conserver ces plantes, les femmes devaient les faire sécher afin de pouvoir les utiliser plus tard au cours de l’hiver.
Commerce
Les Iroquois faisaient du commerce et échangeaient leurs surplus agricoles contre les produits de la chasse des nations algonquennes. Le pays des Hurons-Wendats était présenté à juste titre comme le grenier alimentaire de la plupart des Algonquins. Les Hurons-Wendats étaient considérés comme les plus grands commerçants de l’Amérique du Nord-Est. Ils maintenaient des liens diplomatiques et économiques avec plus d’une cinquantaine de nations, dont les Andastes situés à environ 800 kilomètres au sud de la Huronie. Leur pays était situé sur la route qui reliait les Grands Lacs à la vallée du Saint-Laurent, en passant par la rivière des Outaouais. Il était devenu le carrefour du commerce amérindien.
Réseau de commerce vers 1500.
Le commerce préhistorique
Bien avant l’arrivée des Européens, des liens commerciaux existaient entre les premiers habitants. Dans l’est du Canada, l’activité commerciale remonterait au moins à 6 000 ans. Aux ressources du territoire qu’elles occupaient, les nations autochtones ajoutaient les denrées, les matériaux et les objets acquis par le commerce. Les surplus de biens étaient échangés contre des objets rares ou étrangers dans sa propre région. Plus l'objet venait de loin et plus il était rare, plus il prenait de la valeur.
Les biens offerts variaient selon la spécialisation des groupes. Les Iroquois échangeaient leurs surplus agricoles (maïs, courges, fèves, haricots, citrouilles, tournesols et tabac) contre la viande et les animaux à fourrures des peuples nomades. Ils obtenaient aussi de l'écorce de bouleau en échange de leurs filets de pêche. Les Algonquins des côtes du golfe et du fleuve Saint-Laurent offraient plutôt du poisson fumé et des filets de pêche. Les coquillages ramassés sur la côte atlantique ainsi que les plumes d’aigle et les peaux d’écureuil noir connaissaient une grande popularité. Le silex était très apprécié pour la fabrication des pointes de flèches et de certains outils. Les amulettes des Algonquins, qui avaient la réputation d’être dotées de grands pouvoirs spirituels, étaient également très recherchées.
Le troc et les foires annuelles
Les échanges se faisaient de proche à proche grâce au troc ou à l’occasion de foires annuelles. Plusieurs nations autochtones se donnaient rendez-vous pour échanger leurs produits. L’été était la saison idéale pour ce genre de rencontre puisque certains groupes, qui venaient de très loin, devaient parcourir de longues distances pour s'y rendre. Un de ces lieux d'échange était situé à Nekouba, sur le lac Nikabau au nord-est du lac Saint-Jean. Les premiers jours de la foire étaient consacrés aux festivités. Chacun prenait plaisir à raconter en détail les péripéties de leur voyage.
Grâce au troc, les marchandises circulaient de mains en mains selon les besoins de chacun. Les objets de commerce pouvaient franchir de grandes distances après de multiples échanges. Des produits en cuivre du lac Supérieur se retrouvaient sur la côte atlantique. De l’obsidienne, utile dans la fabrication des outils, parvenait jusqu’à des sites très éloignés de son lieu d’origine (surtout le nord-ouest du Wyoming aux États-Unis). Des dents de requin ou des coquillages se rendaient jusqu’à l’intérieur du continent. La présence de quartzite du Labrador et de jaspe de Pennsylvanie sur des sites du Québec témoigne aussi de l'étendue de ce réseau d'échanges et de communications.
La réciprocité dans les échanges
Le commerce était basé sur la réciprocité, c'est-à-dire sur un échange équivalent entre les deux partenaires comme lors d'un échange de cadeaux. Cette activité représentait plus qu'un simple aspect économique. Le but était d'entretenir de bonnes relations et de consolider les alliances entre les nations. Les liens commerciaux impliquaient aussi le soutien mutuel contre les ennemis en cas de besoin. Par exemple, les Algonquins et les Innus (Montagnais) qui commerçaient avec les Hurons-Wendats étaient aussi leurs alliés militaires.
La gestion du territoire
Les groupes autochtones s’assuraient de leur droit sur les ressources et la circulation des échanges. Chaque groupe se déplaçait à l'intérieur d'un territoire qui lui était propre. Le premier à exploiter une voie commerciale obtenait des droits sur elle. On pouvait toutefois, en échange de présents, obtenir la permission d’utiliser ce parcours ou de traverser le territoire d’un autre groupe dans le but de commercer.
La diplomatie et les ententes entre nations
Les Amérindiens avaient développé une tradition diplomatique efficace. Les ambassades et la coutume de réparation permettaient d’éviter les conflits ou d’y mettre un terme. Grâce à la coutume de réparation, au lieu de se venger ou de punir le coupable, on pouvait réparer les torts faits à la victime ou à sa famille en lui offrant des présents. La valeur des cadeaux variait selon l’importance de l’individu ou son sexe. Chez les Hurons-Wendats, on devait donner davantage de présents pour une femme que pour un homme.
Le déroulement des ambassades se faisait selon les règles et les rituels diplomatiques autochtones. Ces rencontres servaient à négocier des trêves, sceller des ententes ou consolider l’amitié entre les groupes. Les pourparlers débutaient par l’expression des condoléances. Cette cérémonie imagée permettait la réconciliation. On pleurait réciproquement ses morts, on couvrait les dépouilles de présents et on essuyait les larmes de ses ennemis. Ensuite, on débouchait les oreilles pour bien entendre et on dégageait la gorge pour pouvoir s’exprimer avec facilité et parler de paix avec sincérité. Les nuages étant dissipés de l’air, les délégués pouvaient voir clair dans leurs cœurs. Les discours des orateurs étaient appuyés par des colliers de porcelaine ou wampums.
Les accords entre nations étaient confirmés par un échange de présents, généralement le wampum. Le troc de cadeaux était une obligation diplomatique et sociale quand les gens se rendaient visite. Les présents étaient essentiels puisqu'ils détenaient le pouvoir d’apaiser la colère, de sécher les larmes, de conclure des traités de paix ou de mener des nations à la guerre, et de délivrer des prisonniers. On les utilisait périodiquement lors de cérémonies pour remémorer et renouveler des ententes. Le don, puis l'acceptation des présents représentaient un engagement mutuel.
Tout comme les expéditions commerciales, ces réunions étaient agrémentées de fêtes et de festins qui duraient plusieurs jours. On troquait des biens, on dansait, on participait à des rituels et on écoutait des discours très imagés, ponctués de métaphores.
Les perles de la diplomatie, les Wampums, coquillage, peau, Musée de la civilisation, dépôt du Séminaire de Québec. Les coquillages, appelés wampum ou porcelaine, remplissaient des rôles diplomatique, commercial et cérémoniel. Les wampums témoignaient des événements importants comme la conclusion d'ententes commerciale, politique ou militaire. Conservés précieusement, ils représentaient les archives de la nation que les aînés interprétaient. Ils servaient également de parures, de dédommagements en cas de meurtre et dans les rituels de condoléances. En l’absence de wampum, surtout chez les nations des Grands Lacs, moins pourvues en coquillages que les nations côtières et les Iroquois, des peaux de castor ou d’autres animaux, du tabac, des haches et des vêtements servaient d’objets d’échange.
Techniques
La culture matérielle des Autochtones était très bien adaptée à la vie sur le continent américain. Il suffit de penser aux habitations, aux moyens de transport, aux outils et aux armes. Les Autochtones avaient développé la connaissance des matériaux de base et des endroits où les trouver. Ils savaient comment les travailler et connaissaient leurs réactions dans diverses conditions ainsi que leurs usages potentiels.
Outils et objets utilitaires
Les techniques anciennes, qui sont habituellement qualifiées de simples, étaient tout de même efficaces. Par exemple, les tranchants des outils ou des armes pour la chasse pouvaient être plus acérés que les lames de métal. Les lances de bois étaient munies de pointes acérées obtenues en faisant patiemment éclater les tranches d'un morceau de silex. Évidemment, la plupart de ces techniques exigeaient beaucoup de temps et de travail. Les Autochtones avaient aussi découvert diverses façons de faire du feu pour se chauffer et cuisiner.
Les matériaux usuels étaient la pierre, l'os, le bois, l'écorce, les racines des arbres et les fibres. Différentes parties des animaux chassés servaient de matières premières pour fabriquer des objets très utiles (aiguilles, couteaux, lanières, vêtements et couvertures). Les Autochtones conservaient les dents des castors pour fabriquer des couteaux croches et des grattoirs pour les peaux. À partir de la peau ou des viscères d'un mammifère ou d'un oiseau, on fabriquait des sacs.
En dehors de l'alimentation et de l'habillement, les plantes cultivées, les mammifères et les poissons détenaient d’autres utilités. Par exemple, les Iroquoises extrayaient des poissons, surtout des esturgeons, une très bonne colle qui était utilisée à diverses fins. Grâce à cette colle, les hommes fixaient à un bout de leur flèche une pointe acérée de pierre ou d’os. Les Iroquois utilisaient aussi quotidiennement le bois et l'écorce pour de nombreux usages.
L'utilisation du bois et de l'écorce
Plusieurs objets utilisés quotidiennement par les Iroquois étaient en bois ou en écorce: les maisons longues, les palissades, les échafauds de rangement ou de sécherie, les canots, les arcs et les flèches, les plats et les louches, les paniers et même les jouets. Le traîneau, ou toboggan, utilisé l’hiver pour transporter les charges sur la glace était formé de longues planches de bois de cèdre. Les écorces utilisées pour le revêtement de la maison longue ou la confection d’autres objets étaient préparées à l’avance. Elles étaient enlevées des arbres lorsqu’ils étaient en sève. Ensuite, on les empilait les unes sur les autres afin qu’elles ne se déforment pas, puis on les laissait sécher.
Les Iroquois reconnaissaient de multiples usages pour chaque espèce d’arbre. Les racines de conifères et l’écorce de certains feuillus, comme l'intérieur de l'écorce du tilleul, étaient utilisées pour fixer le revêtement des maisons longues et des canots. Les voyageurs, qui se trouvaient sans eau, pouvaient s’abreuver de la sève de certains arbres. Celle du hêtre donnait un breuvage doux et agréable. Lors de fêtes ou de cérémonies de guérison, l’écorce séchée se transformait en instrument de musique. On y battait la mesure avec des bâtons.
Le cèdre
Le cèdre blanc, ou thuya, était particulièrement apprécié pour une de ses qualités: sa résistance à la pourriture. Les pieux de cèdre, enfoncés dans le sol pour former la palissade ou construire la structure des maisons longues, duraient plus longtemps que les troncs de pins par exemple. Les récipients d’écorce, dans lesquels on entreposait le maïs séché et égrené, étaient souvent faits de cèdre. L’armature des canots et les boucliers, qui couvraient presque tout le corps des Hurons-Wendats lorsqu’ils partaient en guerre, étaient aussi en cèdre.
L'utilisation du maïs et du jonc
Avec les feuilles de l'enveloppe de maïs tressées, les Iroquoises confectionnaient des paniers, des sacs, des masques, des poupées et des souliers sans talon qui étaient peints de diverses couleurs. Les hommes en fabriquaient leurs carquois. À partir des tiges évidées, ils obtenaient des flotteurs pour la pêche. Les feuilles de maïs tenaient aussi lieu de bandage et de couche pour la fillette installée dans un porte-bébé. Placée entre les cuisses de la petite fille, une feuille de maïs conduisait son urine jusqu'à une petite ouverture par où elle s'écoulait à l'extérieur du porte-bébé sans la mouiller.
Durant l’hiver, les femmes tressaient des nattes de feuilles de maïs et de jonc. Elles entrelaçaient le jonc ramassé le long des rivières et des lacs pour en faire de belles nattes teintes de diverses couleurs et ornées de plusieurs motifs. Ces petites nattes de jonc servaient pour s’asseoir dans la maison longue et pour dormir en voyage. Elles étaient aussi suspendues aux portes de l’habitation.
La confection du fil
L'écorce du tilleul, l’ortie et le chanvre était employée par les Hurons-Wendats et les Iroquois pour la fabrication du fil et des cordages. Ils en faisaient également des sacs pour mettre les provisions en voyage, des colliers pour transporter les fardeaux, des armatures et des filets de pêche. Pour les Iroquoises, le chanvre était une plante textile importante. L’hiver, elles battaient les tiges ramassées à l’été ou à l’automne. Puis, elles filaient le chanvre en le roulant sur leurs cuisses. La mousse du chanvre donnait un très bon fil.
Jeux et sports
Une fois leurs tâches accomplies, les Iroquois disposaient de beaucoup de temps pour les loisirs et les rencontres. Les habitants des villages voisins étaient souvent invités à participer aux compétitions sportives (crosse, course, tir à la corde ou à l’arc) et aux jeux de chance (jeux de dés ou de pailles). Ces activités se tenaient habituellement à la suite du rêve d'un malade ou à la demande d'un chaman. Les Iroquois considéraient que jouer pouvait éloigner un malheur, une sécheresse ou une épidémie et favoriser la guérison des malades.
Des parties de crosse étaient organisées entre des équipes de villages différents ou d’un même village. La crosse, formée d'un bâton allongé, mesurant près d’un mètre, était pourvue d’un filet lacé. La balle, de la grosseur d'un oeuf de dinde, était faite de bois ou de peau bourrée de poils d’orignal. Le but de ce jeu, très offensif, consistait à introduire la balle dans le but de l’adversaire. L’hiver, ils jouaient au serpent des neiges. Il s'agissait de faire glisser une lance sur une surface glacée pour qu’elle se rende le plus loin possible. Le joueur, dont les lances parcouraient la plus grande distance, gagnait la partie.
Pour le jeu de plat ou de bol, six noyaux de prunes ou de petites boules d'argile aplaties servaient de dés. Ces dés, peints en noir d'un côté, en blanc ou en jaune de l'autre, étaient placés dans un grand bol de bois. Assis par terre, les joueurs prenaient à tour de rôle le bol à deux mains et le soulevaient un peu. Ils y agitaient les dés, puis frappaient le bol par terre pour en faire sauter les dés. Le gagnant était celui dont les noyaux étaient tous retombés du même côté.
Le jeu de pailles
Pour le jeu de pailles, on se servait de 300 à 400 petits joncs blancs de même longueur (30 cm environ). À chacun son tour, on tentait de ramasser ces pailles en les piquant avec une alêne ou un petit os pointu. On les comptait rapidement. La partie adverse essayait de prendre celles qui restaient.
Moyens de transport
À parcourir continuellement de grandes distances, les Autochtones avaient appris à s’orienter en forêt sans avoir recours à la boussole. Leur sens de l’orientation était en grande partie basé sur leur connaissance du territoire. Cette connaissance leur était léguée de génération en génération à travers les récits de chasse que les aînés racontaient. Elle était aussi basée sur une observation constante de l’environnement lors des déplacements. Les montagnes et les cours d’eau, qui jalonnaient leur territoire, devenaient ainsi des points de repères importants. Cependant d’autres éléments de la nature les aidaient à s’orienter. Le cours des rivières leur indiquait le sud et le nord; la mousse, qui pousse sur le tronc des arbres, leur montrait toujours où se situait le nord et la cime des gros arbres, comme celles des pins, penchait toujours vers l’est ou le sud. L’axe du soleil et leur connaissance des étoiles étaient également des moyens qui leur permettaient de trouver leur route en forêt.
Les Autochtones avaient inventé différents moyens pour se déplacer et transporter leur matériel selon les saisons tels le canot d'écorce, le toboggan, les raquettes, le collier de charge et le porte-bébé.
Le canot d'écorce
Les Hurons-Wendats construisaient leurs canots en écorce de bouleau. Les Iroquois, qui vivaient dans une région où le bouleau ne poussait pas, devaient se contenter d’écorce d’orme rouge ou d’hickory. Ils enlevaient délicatement l'écorce d'un gros orme, en un seul morceau. Ils la fixaient sur la charpente en bois pour la colmater ensuite aux deux extrémités. L'écorce du hickory, aussi appelé noyer blanc, pouvait remplacer celle du tilleul pour fixer les écorces recouvrant l'armature des canots. Ces jeunes pousses très solides et flexibles étaient employées à la place de celle du bouleau. Deux journées de travail suffisaient à deux hommes pour construire ce type de canot. La forme des canots d’écorce d’orme était presque identique à celle des canots d’écorce de bouleau. Cependant les canots iroquois étaient plus robustes, plus larges et plus longs. On pouvait y transporter le double ou le triple de la charge et jusqu'à vingt personnes à la fois. Par contre, la vitesse que l’on pouvait atteindre était beaucoup moins élevée. On naviguait dans ces canots sur les Grands Lacs, la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent.
Malgré ces avantages, l’écorce d’orme rendait les canots beaucoup plus lourds et moins maniables. De plus, ces canots prenaient souvent l’eau malgré la gomme de frêne utilisée pour assurer leur étanchéité et l'écorce d'orme broyée pour calfater ses deux extrémités. Dans ces conditions, les Iroquois préféraient se déplacer sur la terre ferme. Ils avaient la réputation d’être de très bons marcheurs et d’excellents coureurs. Ils pouvaient parcourir de très longues distances en un temps record. Ils se procuraient aussi des canots d’écorce de bouleau des nations qui en construisaient.
La fabrication des raquettes
Les hommes fabriquaient les raquettes en prévision des déplacements et des grandes chasses d’hiver. Les raquettes étaient un excellent moyen de poursuivre le gros gibier dans la neige profonde sans se fatiguer. Il existait plusieurs formes de raquettes adaptées à différentes conditions ou milieux. La raquette ronde et large servait dans les terrains escarpés et dans la neige épaisse. Celle qui était longue, étroite et à bout relevé, était adaptée aux terrains plats et aux lacs gelés. Finalement, celle qui avait la forme d’une goutte d’eau servait dans les sous-bois dégagés.
Arts
L’art des Autochtones s’inspirait grandement de leur spiritualité et des nombreuses ressources de leur environnement. Cet art se manifestait par la fabrication d’objets répondant à la fois à des besoins d’utilité quotidienne, mais aussi à des pratiques rituelles sacrées.
Pour fabriquer les raquettes, les hommes abattaient un bouleau ou un frêne bien droit. Ils le taillaient en baguettes pour en faire le fût (cadre) de la raquette. Les baguettes de bouleau ou de frêne étaient trempées dans l’eau chaude pour les ramollir et leur donner plus facilement la forme désirée. Le nattage de la raquette s’effectuait avec de la peau d’orignal ou de caribou taillée en fines lanières. Ces lanières de peau, nommées babiches, étaient trempées, tordues, étirées, séchées puis roulées en peloton que l’on conservait précieusement. Au moment du tressage de la raquette, il suffisait de refaire tremper celles-ci pour qu’elles retrouvent une bonne souplesse. La plupart du temps, ce sont les femmes qui voyaient à cette dernière opération.
Pratiquement tous les objets étaient fabriqués à partir d’un élément vivant : peau, nerf, racine, écorce, arbre, poil, etc.
C’est ainsi qu’un objet comme un tambour, un panier, un canot, une mitaine pouvait devenir, pour l’artiste, une oeuvre d’art dont il était fier et dont sa technique de fabrication demandait un grand savoir-faire qui lui était transmis de génération en génération.
La poterie
Les Huronnes et les Iroquoises maîtrisaient l’art de la poterie. Elles produisaient une grande variété de vases et de pots en terre cuite. Elles savaient où trouver l'argile de qualité et elles connaissaient les matières qu'il fallait lui ajouter pour l'empêcher de se fêler en séchant.
L'argile recueilli était d’abord dégraissée, c'est-à-dire nettoyé, puis longuement pétri en y mêlant un peu de grès. Les femmes en faisaient une boule dans laquelle elles formaient un creux avec leur poing, puis elles l’agrandissaient. La technique du colombin était également pratiquée pour confectionner des récipients. Ce procédé consistait à préparer de longs boudins d'argile. Les parois du pot étaient élevées en ajoutant successivement ces colombins. La surface du récipient était ensuite égalisée et les parois amincies. Les pots de forme arrondie, et sans anse, étaient décorés de lignes ou de motifs géométriques dessinés dans la terre humide. Après les avoir fait sécher au soleil, ils étaient cuits sur le feu avec des écorces.
Une fois refroidis, les contenants de dimensions variées étaient employés pour la préparation, la cuisson et l'entreposage des aliments. Ces récipients étaient fragiles, mais ils pouvaient être suspendus au-dessus du feu. Ces techniques de fabrication étaient issues d’une longue tradition. Elles étaient transmises de mère en fille. Toutefois, la fabrication des pipes en céramique était accessible aux hommes comme aux femmes.
La confection des masques
Les carapaces de tortues
Une fois vidée, séchée et remplie de cailloux, la carapace de tortue devenait un instrument de musique. Ce hochet était utilisé lors des danses, des chants et pendant les rituels de guérison. La tortue détenait une place très importante dans le mythe de la création du monde chez les Iroquois.
Les motifs décoratrifs
Les femmes décoraient les vêtements et les accessoires de perles d'os, de coquillages et de piquants de porc-épic. Les piquants, creux à l’intérieur, ressemblent à une aiguille d’environ dix centimètres. Ils se travaillaient difficilement. Cet art demandait une grande habileté de la part des artisanes. Une fois bouillis, pour les rendre plus souples, et teints à l’aide de racines ou d’autres substances naturelles, les piquants de porc-épic servaient à broder de jolis motifs sur le cuir ou l’écorce.
Les teintures naturelles
C’est dans la forêt que les femmes autochtones récoltaient tout ce qui leur était nécessaire pour obtenir les teintures. Leur savoir-faire dans ce domaine était indéniable. Ces femmes avaient développé au fil du temps mille et un secrets au sujet des teintures naturelles qui offraient, d’une manière assez étonnante, une grande diversité de couleurs. Avec les couleurs obtenues, elles teignaient les peaux, les poils d’orignal, les piquants de porc-épic et l’écorce. Toutes ces teintures étaient extraites à partir de fleurs, de bourgeons, de feuilles, de racines, de graines de plante, d’écorces ou de petites feuilles. Ce travail était un art en soi, car la réaction chimique de chaque végétal pouvait varier et obliger les femmes à y ajouter d’autres substances, comme de la terre noire ou de la glaise, et à utiliser divers procédés comme le trempage ou la fumaison.
Le Wampum
Les perles de la diplomatie les Wampums, coquillage, peau. L’agencement des cylindres du wampum formait des symboles visuels servant à illustrer et à officialiser des ententes entre nations. La couleur blanche des perles signifiait la paix et la vie, le pourpre représentait le deuil et le rouge était un signe de guerre.
À l’origine, le collier ou la ceinture de wampum était fabriqué à partir de coquillages provenant des côtes de la Nouvelle-Angleterre, des provinces maritimes et de la Gaspésie. La confection d’un wampum demandait énormément de dextérité étant donné la fragilité des coquillages. Ils étaient découpés en petits morceaux, polis afin de leur donner la forme d’un cylindre, puis troués. Les cylindres étaient ensuite enfilés sur des nerfs d’animaux ou de fines lanières de cuir de chevreuil.
Individu et société
Malgré les différences dans les modes d’organisation sociale et politique, surtout entre les sédentaires et les nomades, les nations qui occupaient le Nord-Est de l’Amérique partageaient une civilisation commune. L’importance des femmes, des hommes et des enfants au sein des sociétés autochtones était comparable. En principe tous étaient égaux. Chacun était autonome et bénéficiait d’une certaine liberté. La division sexuelle des tâches favorisait le maintien de l’ordre dans la vie quotidienne. Cette répartition des responsabilités assurait la satisfaction des besoins de la communauté. Une fois les tâches accomplies, on pouvait se divertir, se rencontrer et discuter.
Le respect de l’autre, l'hospitalité, le partage et l'entraide caractérisait l'organisation sociale des sociétés autochtones du Nord-Est. L'hospitalité et l'entraide assuraient un abri et de la nourriture pour tous. Cela était considéré normal de partager avec celui qui disposait d’encore moins que soi. Les lois de l’hospitalité étaient rigoureusement observées, parfois même jusqu’à l’appauvrissement. Plusieurs observateurs d’origine européenne remarqueront la générosité des peuples autochtones. Le sens de l’humour est aussi une qualité très appréciée au sein des sociétés autochtones.
Clans familiaux
Le clan constituait l’unité de base de la société iroquoienne. Il détenait une grande importance lors des prises de décision. Il fixait aussi les règles du mariage. Les membres d'un même clan ne pouvaient se marier entre eux puisqu'ils se considéraient comme des cousins. L'époux s’installait dans la maison de sa femme au moment du mariage. On parle alors de sociétés matrilocales. Chaque nation iroquoienne était donc divisée en un certain nombre de clans. Chaque clan possédait son propre symbole. Il portait le nom d'un animal qui, pensait-on, l'avait fondé. Cela pouvait être le lynx, la tortue, l'ours, l'aigle, le chevreuil ou le loup.
Rôle des femmes
Femmes grattant les peaux
Les femmes, qui devaient s'occuper des champs, étaient plus sédentaires que les hommes. Tout comme l'agriculture, la cueillette des fruits, des racines et des plantes médicinales leur était réservée. Les autres tâches féminines consistaient à préparer les repas, ramasser le bois de chauffage et pêcher. Elles préparaient les peaux d’animaux et confectionnaient les vêtements, fabriquaient divers objets faits d'écorce, de feuilles de maïs, de jonc ou de terre cuite. Les femmes cousaient l'écorce du canot et tissaient l’intérieur des raquettes.es femmes étaient à la base de l'organisation sociale iroquoienne. Elles donnaient l’identité clanique aux enfants. Chaque individu au moment de la naissance devenait membre du clan de sa mère. Dans la mythologie iroquoienne, une femme nommée Aataentsic est à l'origine de l'humanité. Elle est considérée comme la mère des êtres humains.
Les relations de parenté étaient à la base de l'organisation sociale et politique des sociétés iroquoiennes. Leur système de parenté reposait sur l'ascendance maternelle. C'est pour cette raison que ces sociétés sont qualifiées de matriarcales ou matrilocales. En fait, le lignage était défini par les femmes. Une habitation communautaire, la maison longue, réunissait les membres d'une même lignée, c'est-à-dire les individus apparentés entre eux du côté des femmes, ceux qui descendaient d'une même mère ou d'une même grand-mère.
Rôle des hommes
Réunion du conseil les hommes iroquois se réunissaient en conseil pour prendre des décisions politiques ou résoudre des problèmes communautaires.
Les hommes iroquois voyageaient régulièrement afin de participer aux expéditions commerciales et diplomatiques. Ils parcouraient de grandes distances à pied, en canot ou en raquettes selon les saisons. Ils s’occupaient aussi de pêche, un peu de chasse et de guerre. Ils défrichaient les champs, voyaient à la construction des habitations et des palissades, coupaient le bois de chauffage et l’écorce.
Ils confectionnaient aussi les canots, les toboggans et fabriquaient les outils en pierre (pointes de flèches, grattoirs, haches). Une fois polis, affilés et aiguisés, ces outils servaient au travail du bois et des peaux. Ils faisaient aussi des armes (arcs et flèches), des plats et des cuillères de bois, des pipes de pierre rouge (calumets) et des armures.
Ils tissaient les filets de pêche à partir du chanvre filé par les femmes et confectionnaient les cadres des raquettes.
Éducation des enfants
Les parents autochtones démontraient un profond respect pour leurs enfants qu’ils élevaient sans contrainte. Ils usaient de patience et de douceur et ne recouraient jamais aux châtiments corporels.
D’autres moyens d’éducation et d’apprentissage étaient privilégiés au lieu de réprimander l’enfant qui ne se conformait pas aux usages. On comptait sur les coutumes et l’influence de la communauté pour orienter leur comportement.
Les enfants apprenaient par l'exemple en participant aux différentes tâches selon leur sexe et leur âge et en imitant les adultes dans leurs jeux.
Rôle des aînés
Un homme ou une femme qu’on reconnaissait comme un individu sage, expérimenté ou aux qualités exceptionnelles, pouvait acquérir une grande influence comme ancien. Les Autochtones consultaient régulièrement les aînés pour connaître leur avis. Ils étaient aussi les gardiens de la tradition et des connaissances acquises qu'ils transmettaient aux générations suivantes.
Vie politique
Avant l’arrivée des Européens, probablement vers le milieu du 15e siècle, les Hurons-Wendats et les Iroquois s’étaient organisés en fédérations. Ces regroupements réunissaient des nations ayant des intérêts et des ennemis communs. Les pouvoirs du conseil de la fédération se limitaient aux affaires extérieures, aux questions relatives à la guerre, à la paix et au commerce. Pour toutes les décisions, on cherchait à rallier l’opinion en s’en tenant souvent au consensus, c’est-à-dire à l’accord et au consentement du plus grand nombre des participants. Dans certains cas, le pouvoir de persuasion et la force de l’éloquence des individus menaient un groupe à prendre une décision à l’unanimité. Une nation dissidente pouvait toujours décider de poursuivre sa propre politique. Chaque nation membre de la fédération occupait ses propres villages et conservait une grande autonomie.
Les réunions du conseil de la fédération iroquoise se tenaient au «feu qui ne meurt jamais», à Onontagué, la capitale de la Ligue. Le conseil central était tenu dans une maison longue conçue pour ces assemblées. Des chefs issus des cinq nations iroquoises s’y rassemblaient. Les Iroquois avaient justement choisi une maison longue à cinq feux comme symbole de leur organisation politique. La capitale de la fédération huronne-wendate, Ossossané, était située quant à elle sur les rives de la baie Georgienne.
Les conflits entre nations
Les guerres et les hostilités entre nations existaient déjà en Amérique avant l’arrivée des Européens, mais elles survenaient pour des raisons assez différentes de celles qui motivaient les nouveaux venus. Contrairement aux Européens, les Amérindiens ne se battaient pas pour l’acquisition des terres elles-mêmes ni pour des motifs religieux ou dynastiques. Ils ne cherchaient pas à conquérir les villages ennemis ni à détruire complètement leurs adversaires. La protection des routes commerciales, des territoires de chasse ou des camps de pêche menait à la guerre. La pression exercée sur les ressources par des populations denses pouvait aussi causer des frictions.
La guerre, qu'on nomme guerre de deuil ou de capture, visait surtout à remplacer les morts, souvent un enfant ou un autre membre de la famille décédé à cause de la maladie, d'un accident ou de la guerre. Chez les Iroquois, une femme en deuil pouvait être à l'origine d'une expédition guerrière en demandant à un groupe de guerriers de remplacer l'enfant qu'elle avait perdu.
La guerre se faisait par surprise, un peu comme la chasse. De petites bandes pratiquaient la guérilla, une guerre d’embuscades caractérisée par la rapidité des déplacements. Les incursions avaient surtout lieu entre la fin du printemps et le début de l'automne.
Casse-tête, noyer, probablement début du XIXe siècle,
Les principales armes employées par les guerriers étaient l'arc et les flèches pour le combat à distance ainsi que le casse-tête. Cette dernière arme, aussi nommé tomahawk, était faite de bois ou d'une pierre aiguisée solidement attachée à un manche en bois. Certains Iroquoiens se couvraient d'armures, faites de pièces de vannerie ou de bois, attachées avec des cordes et recouvertes de cuir.
Personnes importantes. Les femmes iroquoises
Les femmes détenaient une très grande influence au sein des sociétés iroquoiennes. Elles réglaient les affaires courantes en prenant part aux grandes décisions comme celle de faire la guerre ou de déplacer le village. Ce sont les femmes qui possédaient les champs et les maisons et qui négociaient les mariages. En plus d'être les gardiennes de la tradition, les femmes avaient un rôle politique important. Celles qu'on nomme les mères de clan (les femmes les plus âgées et les plus expérimentées) choisissaient les hommes qui formaient le gouvernement. Les femmes choisissaient le chef pour leur clan et quand ce dernier ne remplissait pas bien ses fonctions, elles pouvaient essayer de le destituer. Les femmes ne siégeaient pas aux conseils, mais elles pouvaient y présenter des discours.
Le rôle des chefs
L’organisation du pouvoir parmi les peuples du Nord-Est variait d’une société à l’autre. Mais chaque groupe, bande ou clan, se donnait un chef. Ce dernier, qu’il soit chef civil ou militaire, devait s’en remettre aux décisions prises par le conseil après de longues palabres. Les discussions visaient à rallier le plus grand nombre de personnes. Il fallait donc prévoir un certain délai pour que l’opinion générale s’accorde.
Les qualités requises pour devenir chef étaient: la force, l’habileté, le courage, la sagesse ainsi que la générosité. À ces caractéristiques essentielles s’ajoutaient d’autres qualités personnelles comme le fait d’être un bon orateur ou un grand chaman. Le chef ne portait pas de signes extérieurs de supériorité. Il ne se distinguait des autres que par sa valeur et le respect qu’on lui portait. Son influence reposait sur ses qualités personnelles et son pouvoir de persuasion qui était lié à son habileté oratoire, son éloquence, c'est-à-dire son talent de bien parler, d’émouvoir et de convaincre par son discours. Son autorité restait limitée et ne lui donnait aucun pouvoir de contrainte ni aucun droit de faire usage de la force.
Le chef civil et le chef militaire
Les Hurons-Wendats et les Iroquois reconnaissaient deux sortes de chefs: le chef civil et le chef militaire. Le chef civil avait la responsabilité des affaires internes du clan dont l'organisation des fêtes et des jeux. Ils s'occupaient aussi des relations avec les autres clans. Le chef civil était élu selon son lignage clanique. La filiation était souvent héréditaire par les femmes, mais le mérite de l'individu importait aussi. Tous les chefs de clan faisaient partie du conseil du village qui se réunissait fréquemment pour traiter des affaires de la communauté. Les chefs de tous les villages se rassemblaient pour former le conseil de la nation. Les conseils des nations formaient un regroupement encore plus large, la fédération.
L’autre chef avait la charge des activités entourant la guerre. Il était choisi en tenant compte de ses qualités personnelles, même si le lignage pouvait être pris en compte. Les chefs militaires se regroupaient de la même façon que les chefs civils, en conseils de village, de nation, puis au sein de la fédération.
Dekanahouideh
Selon une tradition iroquoise, la Ligue iroquoise (Ho-de’no-sau-nee) est créée vers la seconde moitié du 15e siècle. Sa naissance est associée à une éclipse de soleil qui serait survenue en Iroquoisie en 1451. La croissance de la population, le commerce et la guerre aurait suscité la création de cette fédération sous la conduite du héros légendaire, Dekanahouideh, le «Messager céleste». Après avoir perdu sa famille dans un conflit intertribal, Hiaouatha se serait rallié à ce projet de paix entre toutes les nations iroquoises. Le symbole de Ligue Ho-de’no-sau-nee est l’arbre de la paix, le pin blanc.
Le chaman
Le chaman était un individu respecté au sein des sociétés autochtones puisqu’il était en mesure de guérir, de rompre les sorts, mais aussi d’ensorceler. Il ne possédait toutefois pas l’exclusivité de l’univers surnaturel. Chacun restait autonome dans ses rapports avec les esprits et chacun pouvait communiquer avec eux. Différents moyens d'entrer en contact avec le surnaturel, comme le jeûne, la vision, la danse et le rêve, étaient accessibles au chaman, mais aussi aux autres individus.
Cet homme médecin, parfois une femme, était reconnu comme le spécialiste de l’univers surnaturel. Il servait d'intermédiaire entre les esprits et les humains. On le nommait arendiouane, «celui dont la puissance spirituelle est grande» ou oki, «esprit puissant» chez les Hurons-Wendats. Le chaman pouvait prévenir la maladie, diagnostiquer le mal et suggérer le remède approprié puisqu'il connaissait très bien les plantes médicinales. Il était aussi très habile pour interpréter les rêves.
Cette fonction n’était pas nécessairement héréditaire. Elle exigeait des qualités personnelles exceptionnelles et un long apprentissage. Le chaman possédait des talents particuliers dont l’aptitude à entrer en contact avec les esprits et à faire des prédictions. Il détenait ses pouvoirs de la force d'un oki (esprit) particulier et de sa pratique du jeûne.
Certains chamans se spécialisaient dans la recherche des objets perdus, des personnes disparues et dans la prédiction des lieux où se trouverait du gibier. Pour y arriver, ils exécutaient la cérémonie de la tente tremblante. Le chaman entrait dans une petite cabane où il chantait et envoyait des esprits à la recherche de ce qu'il voulait trouver. Les chamans iroquois, hommes ou femmes, se regroupaient souvent au sein de sociétés de médecine.
Habitation
Le type d’habitation des Iroquois répondait aux besoins et à la vie sociale que privilégiaient ces sociétés. Pour des peuples agriculteurs, la maison longue iroquoise était suffisamment grande pour réserver des espaces d’entreposage lors de la récolte des légumes à l’automne.
Les sociétés iroquoises construisaient des demeures qui pouvaient loger de 10 à 15 familles faisant toutes partie d'un même lignage familial. L’intérieur de la maison longue offrait des espaces pratiques et permettaient cette vie en groupe. En quelque sorte, on peut dire que les Iroquoiens sont les premiers à avoir inventé les habitations à appartements.
Choix de l’emplacement du village
Les Iroquois, qui étaient sédentaires, s'établissaient au même endroit pendant plusieurs années. Un village pouvait regrouper de 10 à 15 maisons longues, parfois davantage. Certains villages rassemblaient de 1 500 à 2 000 personnes, mais d’autres en comptaient moins. À la même époque en Europe, les villages comptaient rarement plus de 500 habitants.
Le déménagement du village vers un nouvel emplacement survenait tous les 12 à 30 ans. Les Hurons-Wendats profitaient souvent de cette occasion pour célébrer la grande fête des âmes. Les principales raisons qui obligeaient les Iroquois à déplacer leur village et à défricher de nouvelles terres étaient l'épuisement du sol, l'éloignement de l'approvisionnement en bois, la détérioration des maisons et la diminution du gibier. Cette forme cyclique de l'occupation du territoire permettait le repos de la terre et le maintien de la forêt à diverses étapes de sa croissance. Ceci favorisait la vie végétale et animale, dont la multiplication du chevreuil.
Plusieurs facteurs influençaient le choix de l'emplacement du village. Des terres fertiles, un ruisseau ou un étang comme source d’eau potable et une forêt située à proximité pour l'approvisionnement en bois de chauffage et de construction étaient recherchés. Les Iroquois appréciaient aussi les sites possédant des défenses naturelles. Les sommets de collines escarpées offraient davantage de protection et plus de faciliter pour observer les environs immédiats du village.
Les villages les plus importants et les plus exposés aux groupes ennemis étaient entourés de palissades de 5 à 11 mètres de haut. Ces fortifications se composaient habituellement de trois rangées de pieux. Quand les palissades étaient assez hautes, des galeries étaient installées à l’intérieur. À partir de celles-ci, les défenseurs pouvaient lancer des flèches ou des pierres sur les assaillants. La palissade offrait aussi aux habitants du village une protection contre le vent, la neige et les animaux.
Construction de l’habitation
L'intérieur de l’habitation iroquoise était très fonctionnel. Une rangée de feux, ou foyers, divisait la maison dans le sens de la longueur. Chaque feu servait à deux familles, installées de part et d'autre de l’allée centrale, pour cuisiner et se chauffer.
La fumée s'échappait par une ouverture faite au sommet de la maison et de là, entrait la lumière. Une ou deux écorces amovibles servaient à fermer ce trou quand il survenait de fortes pluies ou lorsque des vents forts repoussaient la fumée à l'intérieur. De chaque côté de la maison, le long des feux, se trouvaient les lits.
Les lits étaient placés à un pied du sol pour éviter l'humidité et la fumée des feux. On y étendait des écorces, des nattes de jonc ou des peaux de fourrure. Sous les lits, on entreposait le bois de chauffage et entre les lits, on plaçait de grands récipients d'écorce où l'on mettait le maïs égrené. Des nattes de jonc étaient également suspendues le long des murs de la maison.
Les espaces disponibles au-dessus des lits étaient utilisés pour le rangement ou servaient de lits pour les plus jeunes. Les maisons avaient une entrée à chaque extrémité. Des écorces suspendues, doublées avec des peaux pour se garantir du froid, servaient de portes. Au bout de certaines maisons, il pouvait y avoir un vestibule où l’on entreposait le bois de chauffage et la récolte de maïs.
La vie sociale dans les habitations
La maison longue logeait de cinq à dix familles représentant de deux à trois générations: la mère, son mari (qui venait toujours d’un autre clan), ses fils non mariés, ses filles et leur mari (d’un autre clan) et les enfants de ces dernières. Les Iroquoiens passaient la plus grande partie de l’hiver au village bien à l’abri dans leurs maisons longues. En dehors des festivités auxquelles ils participaient, les hommes et les femmes consacraient leur temps à la confection et à la décoration d’objets utilitaires.
Spiritualité
Chez les Autochtones, tous les gestes de la vie quotidienne baignaient dans la spiritualité. Selon eux, tout ce qui existe, même les objets fabriqués par les humains, possède un esprit immortel et doit être respecté. Ils considèrent la vie comme un grand cercle de relations entre tous les êtres. Chaque animal, chaque plante, chaque minéral, chaque individu fait partie de ce cercle. Tous ces êtres sont égaux et en continuelle interaction. Les Autochtones veillaient à ne pas perturber l'équilibre établi entre eux. Leurs rites religieux, comme leurs rituels de guérison, visaient à conserver l'harmonie entre les êtres. Ils servaient aussi à maintenir la communication entre les mondes visible et invisible, en constante relation, et à s'assurer la bienveillance des esprits.
Le quotidien était imprégné de l’univers surnaturel. De nombreuses fêtes étaient célébrées pendant l’année ainsi que des rituels autour de la pêche, de la chasse et de l’agriculture. Des événements comme la fabrication des canots d’écorce revêtaient un caractère sacré. Cette activité prenait la forme d’un rituel accompagnant toutes les étapes, de la cueillette de l’écorce à la décoration du canot. Des rites soulignaient les grandes étapes de la vie, de la naissance à la mort.
Perception et relation avec les mondes vivants
La Tortue, illustration de Louis Nicolas (1634-après 1678.Les Iroquois croyaient que la Tortue était à l’origine de la Terre.
Selon la mythologie iroquoise, la terre avait été soulevée de l’eau par une énorme tortue. Ainsi naquit le monde dans lequel les Iroquois vivaient. Ils croyaient que la Grande Tortue soutenait toujours la terre.
Les Wendats croyaient, tels les Iroquois, que la terre où vivent tous les hommes était une île sur laquelle était descendue d'un monde céleste une femme, nommée Aataentsic. Cette femme fut recueillie sur le dos de la Grande Tortue, à la demande des animaux (qui n'étaient alors qu'aquatiques). Le plus humble de ceux-ci, le crapaud, réussit à ramasser, en plongeant, du limon que la Petite Tortue étendit sur la carapace de la Grande Tortue, laquelle s'agrandit jusqu'à former le monde (l'Amérique) tel que le connurent les Amérindiens.
Le destin d’un homme ou d’une femme était guidé par des esprits, ou des puissances animales, qui pouvaient l’aider. Ceux-ci lui étaient révélés au cours d’une vision. La recherche de ces esprits commençait à la puberté par le biais de prières et de jeûnes. Par exemple, à l'adolescence, les garçons partaient en quête d'une vision afin de trouver leur esprit gardien, celui qui les guiderait et les aiderait à la chasse et dans leurs autres activités.
Les amulettes
Les amulettes étaient considérées comme des porte-bonheur. Certaines amulettes possédaient davantage de puissance. Celles des Algonquins, alliés aux Hurons-Wendats, avaient la réputation d’être dotées de grands pouvoirs spirituels. Cette précieuse marchandise était très recherchée. La plupart des amulettes étaient faites d'os, de pierre ou de coquillage. Elles se présentaient parfois sous l'aspect de petites figurines taillées dans l'os, de pierres aux formes bizarres, de griffes d'animaux ou d'autres objets mis dans un sac avec du tabac. Les amulettes favorisaient la chance et assuraient la protection.
La vie dans l’au-delà
Pour les Autochtones, la vie dans l’au-delà était une continuation de la vie sur terre. Le défunt était enterré avec tous ses objets familiers pour l’aider dans son dernier voyage. Pour réconforter et diminuer la peine de ceux qui avaient perdu cet être cher, on leur offrait des cadeaux. Après un long et difficile périple, l’esprit de la personne décédée atteignait le «village des âmes», toujours situé à l’Ouest. La vie menée dans ce lieu ressemblait à la vie sur terre. Les esprits des humains, des animaux, des objets animés et inanimés s'y retrouvaient. Tous ces esprits y poursuivaient leur vie, semblable à la précédente. Sous cette forme désincarnée, le chasseur continuait de poursuivre le chevreuil sur ses raquettes.
Croyance aux rêves
Selon les Autochtones, le rêve est le langage de l'âme. Durant le sommeil, tandis que le corps est au repos, l'âme accomplit de multiples actions, aussi réelles que le réel extérieur lui-même. Elle voyage, combat, aime, se réjouit, s'attriste, et surtout manifeste ses désirs, ses volontés.
L'Amérindien restait à l'écoute de ses rêves et les analysait selon ses propres conceptions. Le rêve était interprété comme une visite des esprits. Il pouvait être un présage pour la chasse, une ligne de conduite à adopter ou un conseil pour la vie quotidienne. Le rêve représentait également un mode d'expression des besoins de l'âme qu'il fallait satisfaire. Il exprimait des désirs secrets ou refoulés et soulageait les tensions psychiques et psychosomatiques. Selon les Iroquoiens, plusieurs maladies provenaient d'un désir de l'âme resté inassouvi. Quand le rêve devenait plus difficile à comprendre, on avait recours au chaman pour en saisir le sens. Les Iroquois poussaient très loin l’interprétation des rêves. Dans ce domaine, ils avaient une longueur d’avance sur les Européens des 17e et 18e siècles.
Animaux et protecteurs
Formaient la structure sociale de plusieurs nations. L’emblème du clan était l’ancêtre mythique du groupe ou l’animal protecteur du clan avec lequel une relation privilégiée était établie. Des animaux protecteurs guidaient et protégeaient les nations et les individus. Les animaux représentaient aussi des sources d’enseignement. Leur comportement et leur attitude, leur courage, leur vaillance ou leur détermination étaient donnés en modèle aux jeunes.
Par exemple, les Autochtones accordaient une grande importance à l’ours qu’ils respectaient énormément. Avant de tuer un ours, le chasseur lui chantait une chanson ou lui parlait pour lui dire que sa mort assurerait la survie de sa famille. Souvent appelé grand-père par eux, il symbolisait la force et la vie. Selon les Iroquoiens, le savoir concernant les remèdes leur aurait été transmis par un ours mythique qui l’aurait révélé au clan de l’ours.
Langues
Pictogrammes autochtones. Les Autochtones d'Amérique du Nord ne connaissaient pas l’écriture avant l’arrivée des Européens. Toutefois, certaines représentations comme des pétroglyphes (documents écrits sur la pierre), des parchemins sur écorce de bouleau (cartes du territoire) et des pictogrammes existaient. Les wampums palliaient également à l’absence d’écriture. Ils permettaient de conserver le souvenir d’événements importants survenus dans la communauté.
Les Iroquois parlaient plusieurs dialectes. Même s'ils provenaient d'une souche commune, les Iroquoiens qui avaient une langue différente pouvaient parfois difficilement se comprendre. Les Iroquois du Saint-Laurent utilisaient aussi une autre variante des langues iroquoises. La langue huronne-wendate était utilisée dans le commerce et les négociations entre nations. Les nations voisines en apprenaient les rudiments pour participer au réseau d’échange.
Les langues autochtones
À partir d’une souche commune, les langues autochtones ont évolué pendant des milliers d’années. Elles se sont perfectionnées et elles se sont différenciées selon l’environnement et le mode de vie des premiers peuples. Les individus appartenant à un même groupe communiquaient grâce à un même langage. Les nations autochtones parlant des langues différentes avaient développé un langage commun afin de pouvoir communiquer entre elles lorsqu’elles se rencontraient pour discuter et faire du commerce. Certaines nations, comme celles qui vivaient dans la région des Plaines, avaient inventé un langage gestuel complexe comprenant près de 1 000 signes différents. Les langues autochtones ne servaient pas qu’à communiquer, elles détenaient aussi un rôle très important comme outil de transmission des connaissances et de la culture chez ces peuples de tradition orale.
Les anthropologues et les linguistes ont classé les langues autochtones en plusieurs familles linguistiques. Ils sont arrivés à ce résultat en comparant minutieusement les différents mots, leurs significations et leurs prononciations. Chaque famille regroupe un ensemble de nations autochtones apparentées par la langue, c’est-à-dire que leur langue provient de la même souche. Ces nations de même famille linguistique ne partagent pas nécessairement une culture identique. Par exemple, la grande famille algonquienne réunit des nations dispersées depuis les provinces des Maritimes jusqu’à celle de l’Alberta. Au Québec, l’on retrouve des représentants des familles algonquiennes, iroquoienne et eskimo-aléoute. Il ne faut pas confondre les termes algonquiens et iroquois qui représentent des familles linguistiques (un ensemble de nations) et les mots Algonquin et Iroquois qui désignent deux nations spécifiques. Plusieurs langues autochtones sont disparues et, actuellement, certaines sont en voie de s’éteindre. De nombreuses traces des langues autochtones subsistent dans la toponymie et les mots de vocabulaire empruntés aux Autochtones.
La médecine
Les Autochtones avaient acquis d’excellentes connaissances médicales. Les propriétés des plantes médicinales n’avaient plus de secret pour eux et ce savoir-faire était transmis de génération en génération. Leurs manières de soigner les maladies étaient intimement liées à leur spiritualité. Pour chaque type de maladie qui survenait, les Autochtones utilisaient une pratique de guérison différente et appropriée. En plus de soigner les maladies, ils savaient aussi comment soulager une fracture et amputer un membre afin qu'une infection ne se répande pas dans tout le corps.
Types de maladies et causes
Les rites religieux et les rituels de guérison étaient intimement liés chez les Autochtones. Trois sortes de maladie étaient reconnues par les Iroquoiens et, d’une façon semblable, chez les Algonquiens: les maladies d’origine naturelle, celles provenant de désirs insatisfaits ou cachés de l'âme et d'autres causées par des sortilèges. À chaque type de maladie correspondait un traitement approprié, soit des remèdes naturels, la satisfaction des désirs ou le désensorcellement.
Il est difficile de connaître l'état de santé des Autochtones vers 1500. Toutefois, les études paléontologiques, effectuées sur des ossements retrouvés dans les sites archéologiques, ont démontré l’existence de certaines maladies en Amérique du Nord. Des cas de tuberculose, de maladies des articulations (arthrite, rhumatisme), du système respiratoire et du système digestif, d’hépatite, d’encéphalite et de poliomyélite ont été retracés. Cependant, aucune de ces maladies ne semble avoir eu d’effets dévastateurs sur les peuples autochtones.
Étant donné la faible densité des populations et l'éparpillement des groupes sur le territoire, les maladies contagieuses faisaient peu de victimes. Les Autochtones pouvaient contracter une maladie à la suite de la consommation d'une viande infectée ou par une plaie souillée (tétanos). Des accidents faisaient des blessés et même des morts. Quand une grande famine survenait pendant l'hiver, elle pouvait faire de nombreuses victimes. Plusieurs maladies connues en Europe comme la rougeole, la variole, la varicelle et le typhus n'existaient pas en Amérique.
Les Européens décriront les Autochtones comme des gens jouissant d'une excellente santé. On vivait aussi longtemps en Amérique qu'en Europe. Aux 16e et 17e siècles, l’espérance de vie ne dépassait pas 25 ans, ce qui ne signifie pas que tous les individus décédaient à cet âge moyen, car il faut aussi tenir compte, dans ces calculs, du haut taux de mortalité infantile à cette époque. Il pouvait donc arriver que plusieurs individus vivent au-delà de 50 ans.
Les connaissances médicinales
Les remèdes naturels étaient confectionnés à partir de certaines parties de plantes (racine, feuille), d'arbres (écorce, sève) et d'animaux dont les propriétés médicinales étaient bien connues. Ce savoir était transmis de génération en génération dans les familles, souvent de mère en fille, par la tradition orale. La forêt offrait une multitude de plantes pouvant prévenir et guérir de nombreuses maladies. Les plantes médicinales n’étaient pas toutes préparées de la même manière. Elles pouvaient être mastiquées, consommées sous forme d’infusion et également utilisées en cataplasme. Les Autochtones savaient aussi comment soulager une fracture et amputer un membre afin qu'une infection ne se répande pas dans tout le corps.
Les Iroquois du Saint-Laurent connaissaient les bienfaits du cèdre. La tisane de cèdre blanc, riche en vitamine C, donnait un excellent remède contre le rhume et le scorbut. Les symptômes du scorbut étaient la fièvre, l'anémie et des hémorragies.
Les remèdes naturels
Il existait plusieurs formules pour traiter le même malaise. Des écorces bouillies étaient utilisées en usage interne ou externe, en décoction ou en cataplasme, pour guérir différents maux. Par exemple, une décoction d'écorce de pin soulageait la toux et les brûlures. La gomme de sapin était antiseptique et servait comme cataplasme. Elle permettait de soigner les inflammations des poumons, de la vessie et des reins, elle soulageait aussi l’asthme, les blessures et les brûlures. Les feuilles et l’écorce du bouleau étaient aussi utilisées pour soigner certaines maladies de la peau et du foie, le rhumatisme et pour calmer les fièvres sporadiques. De plus, on lui attribuait une propriété aseptique, ce qui expliquerait pourquoi les aliments des Autochtones se conservaient si bien dans les grands paniers d’écorce. L’hart rouge était un excellent vermifuge. La jeune écorce du tilleul servait à soigner les blessures et à soulager les brûlures. Au moment de sa floraison estivale, plusieurs groupes autochtones cueillaient ses fleurs pour préparer des tisanes qui étaient très efficaces pour combattre l’épilepsie, les maux de tête et les spasmes.
Les petits fruits et les plantes forestières ne servaient pas seulement de nourriture, les Autochtones leur reconnaissaient aussi plusieurs propriétés médicinales.
Les propriétés médicinales des animaux étaient aussi bien connues. Par exemple, on employait la graisse d'ours contre les enflures et pour masser les parties douloureuses du corps, comme les jambes après une longue marche. On se couvrait aussi de cette graisse de la tête aux pieds afin de se protéger de la rigueur du climat et des moustiques.
Soins aux malades
À part les remèdes naturels, on retrouvait, parmi les méthodes de guérison, les festins, les danses, les chants, les jeux, les jeûnes et les rituels de purification comme la hutte de sudation (bain de vapeur). Les membres de la communauté conjuguaient souvent leur énergie pour accroître la puissance des rituels de guérison. Si un malade rêvait de sa guérison et exprimait le désir de son âme, qu’il avait vu dans un rêve, son entourage prenait les moyens de le satisfaire afin qu’il guérisse. Les Hurons-Wendats organisaient une de ces célébrations pour les malades, nommée l’Ononharoia. Lorsque le recours aux remèdes naturels et aux efforts de la communauté était épuisé, on sollicitait l’aide du chaman.
Les sociétés de médecine
Parmi les Hurons-Wendats et les Iroquois, il existait des sociétés de médecine. Les plus connues sont la Société des Visages en feuilles de maïs et celle des Faux Visages. L’hiver, les réunions de ces confréries se tenaient presque tous les soirs dans les maisons longues. On renouvelait les anciennes cures pour qu’elles restent efficaces et on en ordonnait de nouvelles. Des hommes et des femmes faisaient partie de ces regroupements. Ils étaient spécialisés dans la guérison de certaines maladies. On devenait membre d’un tel groupe après avoir été guéri par celui-ci. On pensait que plus le nombre d’individus guéris, puis devenus membres de la société, n’augmentait, plus le pouvoir de guérison de la société s'accroissait.
Lors des rituels de guérison, les membres de la Société des Faux Visages portaient des masques en bois sculpté et agitaient des hochets en carapace de tortue. Le masque confectionné soigneusement conférait des pouvoirs de guérison à celui qui le portait. Son allure grimaçante effrayait les esprits qui causaient les maladies.
Les vêtements
La plupart des vêtements se ressemblaient chez les nations iroquoises. Ceux-ci étaient confectionnés surtout à partir de peaux de chevreuil et de différentes peaux d’animaux comme l’écureuil noir, la loutre, le castor, l’ours, le lynx et le renard. Ces peaux, servant à faire les vêtements, étaient portées de deux manières : la fourrure à l’intérieur ou bien à l’extérieur.
La plupart des vêtements étaient amples et confortables. Chez les Iroquois, il était fréquent d’échanger ses vêtements ou de les emprunter. Ainsi un homme pouvait porter un vêtement de femme et inversement, la femme pouvait adopter un vêtement d’homme si elle le trouvait confortable et utile.
Les mocassins
Les femmes confectionnaient les mocassins surtout avec des peaux de cerf, d'ours ou de castor déjà portées, car celles-ci étaient beaucoup plus souples que les peaux n’ayant jamais été portées. Pour les mocassins d’hiver, les femmes rembourraient ceux-ci de fourrure de lièvre. Ces chaussures souples et sans talon étaient conçues pour aller en raquettes. Les mocassins que l’on portait par temps plus chauds étaient beaucoup plus courts que ceux d’hiver montant jusqu’à la mi-jambe. Durant l’été, les Iroquoiens marchaient la plupart du temps pieds nus.
Les mitasses sont une sorte de jambières faites à partir de pattes de chevreuil à l’envers, que l’on portait le poil à l’intérieur. Ces jambières, suffisamment longues pour recouvrir la cuisse, étaient retenues à la ceinture par des petites cordes. Les Iroquois appréciaient les mitasses pour se protéger du froid, mais aussi pour éviter de se faire des égratignures sur les jambes lors des déplacements en forêt ou dans les marécages.
Confection des vêtements
Pour assouplir les peaux, les femmes devaient d’abord les gratter pour enlever autant que possible le gras et la chair.
La préparation des peaux
Les femmes apprêtaient les peaux d’animaux pour en confectionner des pagnes pour les garçons et les hommes, des jupes et des robes pour les filles. Pour la saison froide, elles préparaient des mocassins, des mitasses (une sorte de jambières) et des manteaux longs ressemblant à de grandes capes.
La préparation des peaux comportait plusieurs étapes. Les femmes grattaient d’abord les peaux à l’aide d’un grattoir en os afin d’y éliminer tous les résidus de chair ou de graisse. La peau était ensuite trempée dans l’eau et bien essorée. Pour assouplir la peau, les femmes devaient bien en étirer les fibres en long et en large, car les fibres de la peau risquaient de sécher et de durcir très rapidement. Cette étape d’étirement de la peau exigeait une grande force physique de la part des femmes. Après un deuxième grattage, elles enduisaient la peau d’une graisse faite à partir de la cervelle de l’animal et cousaient celle-ci en forme de tuyau. Les femmes suspendaient alors ce tuyau de peau au-dessus d’un feu de bois pourri, souvent du cèdre. Le tannin contenu dans le bois passait alors dans le tuyau de peau et pénétrait bien celle-ci. Cela permettait aux peaux de bien se conserver, de ne pas pourrir. La couleur obtenue dépendait du temps de fumage de la peau et de l’essence de l’arbre utilisé pour la teindre.
La confection des vêtements
Les femmes iroquoiennes se servaient d'un couteau de pierre pour tailler les peaux et d’une alêne, une sorte de poinçon fait d’os ou de bois dur, pour percer les trous. Comme fil, elles utilisaient surtout du nerf animal (tendons d'orignal, de caribou ou de cerf).
Les Iroquoiennes pouvaient coudre très finement un grand nombre de peaux ensemble. Elles assemblaient également les différentes parties du vêtement en utilisant des boyaux d’animaux desséchés, des nerfs d’orignal effilochés, de fines et minces languettes de peau tannée.
Les Amérindiens appréciaient beaucoup la décoration des vêtements. Ainsi, la majorité des vêtements, même ceux des enfants, étaient décorés avec de beaux motifs peints ou brodés à la main. Les broderies étaient généralement faites de piquants de porc-épic ou de poils d’orignal teints de couleurs variées (jaune, noir, violet et rouge) à partir de teintures naturelles. Diverses retailles de peaux et certaines queues d’animaux étaient utilisées pour décorer les bordures des manteaux.
Les Iroquois portaient un pagne fait d’une peau de chevreuil qui leur servait de cache-sexe. Ce pagne était retenu par une ceinture qui permettait également d’attacher leurs mitasses (jambières). Les hommes avaient l’habitude de fixer des cordelettes de peau à leurs mitasses pour y suspendre leur couteau ou pour se dépanner plus facilement en forêt. Par exemple, ces cordelettes pouvaient servir à confectionner un piège et à fabriquer un outil ou, encore, faire un garrot pour empêcher une blessure de trop saigner.
Les vêtements d'hiver
Par temps froids, ils se couvraient les jambes de leurs mitasses et le haut du corps d’une chemise de peau à manches longues qui descendait jusqu’à la ceinture. Lorsque ces vêtements n’étaient plus suffisamment chauds pour affronter les grands froids, les Iroquoiens ajoutaient une couverture de peaux (capot long) par-dessus ceux-ci.
Les vêtements d'été
Durant l’été, il arrivait que les hommes se couvrent d’une chemise sans manche et qu’ils l’utilisent pour se draper nonchalamment sur un bras ou sur l’autre ou bien ils choisissaient de la rejeter dans le dos en la retenant par deux lacets de peaux noués sur leur poitrine.
Vêtements pour les femmes
Maquillage, coiffes et pendentifs
La sanguinaire. Le latex tiré de la sanguinaire servait aussi à maquiller le corps et le visage en plus d’avoir l’avantage de faire fuir les insectes.
Les coiffes
Plusieurs sortes de coiffes étaient appréciées des nations iroquoiennes. Celles-ci ornaient leur tête telle une couronne décorée avec des plumes ou des becs d’oiseaux, des bois de cervidés ou des poils d’orignal qu’ils avaient teints en rouge. La couronne faite de perles de coquillage n'était, quant à elle, portée qu’à de rares occasions, lors d’événements reliés à la politique ou à la guerre.
Aussi, les Iroquoiens portaient fréquemment le bandeau ou «tour de tête» qu’ils confectionnaient à partir du chanvre teint ou d’une matière végétale, d’une peau de serpent qui pendait jusqu’à mi-jambe ou d’une bande de cuir décorée avec des poils d’orignal.
Les chapeaux ou les bonnets étaient quasiment absents de la tenue vestimentaire des Amérindiens. Le plus souvent, ils allaient nu-tête. Cependant, il pouvait arriver qu’ils ajoutent un capuchon à un vêtement d’hiver, qu’ils se confectionnent un chapeau en écorce de bouleau ou qu’ils transforment une oreille d’orignal en bonnet pour se protéger de la neige tombant des arbres.
Ces coiffes étaient beaucoup moins imposantes que les grands panaches de plumes des nations autochtones des Plaines de l’ouest.
Les pendentifs
Les Autochtones, sauf les vieillards, appréciaient les pendentifs. Par contre, ce sont les femmes qui en portaient une plus grande variété. Toutes sortes d’objets, parfois même très inusités, servaient de pendentifs pour orner le cou, les oreilles, les bras, les poignets, la ceinture, les jambes, les chevilles, etc.
Parmi les coquillages, les griffes ou les poils d’animaux, les piquants de porc-épic, les serres, les bois de chevreuil, les ergots ou l’os d’un orignal, ce sont les carapaces de tortue qui étaient les plus recherchées pour confectionner les colliers, les boucles d’oreilles, les bracelets ou les jarretières.
L'alimentation
Les produits récoltés, comme les courges et les citrouilles, étaient placés dans des greniers souterrains faits par les femmes dans leurs champs. Le fond de ces grands trous d'un mètre à un mètre et demi de profondeur était recouvert d’écorce. Les légumes et les fruits s'y conservaient très bien. La terre, puis la neige qui les recouvraient, empêchaient la gelée de les atteindre. Les citrouilles étaient aussi découpées en longues tranches qu'on suspendait au soleil ou près du feu à l'intérieur de la maison pour les faire sécher. Sèches, elles se conservaient plus d'une année. Les voyageurs en emportaient souvent en voyage. Les petits fruits étaient séchés au soleil afin de les conserver pour l’hiver. Les femmes en faisaient des confitures pour les malades.
Les poissons éventrés étaient étendus sur des treillis faits de perches pour les faire sécher ou boucaner. Quand la température ne permettait pas de procéder ainsi, on plaçait les poissons sur les perches au-dessus des feux de la maison longue. Cette étape de conservation terminée, les poissons étaient mis dans des tonneaux afin d’éviter que les chiens ou les souris s’en nourrissent. La chair de l'esturgeon était découpée en lanières, puis séchée au soleil. Elle servait de nourriture pendant l'hiver. Les Iroquoiens conservaient la viande de cerf en la faisant fumer ou sécher comme les autres viandes ou les poissons. Une bonne partie de la viande était entreposée au village en prévision des festins. La graisse de cerf était employée comme du beurre.
Les réserves de sirop d'érable étaient conservées dans de grands paniers d’écorce de bouleau scellés avec de la graisse d’ours et de la résine de sapin ou d'autres résineux. Ce mode de conservation empêchait le sirop de se cristalliser en sucre. L’eau d’érable transformée en sirop était très importante pour les Autochtones. Elle constituait leur unique réserve en sucre pour toute l’année. C'était une source d’énergie essentielle pour survivre aux grands froids de l’hiver.
La plus grande partie de l'alimentation des Iroquoiens reposait sur les plantes cultivées, surtout le maïs. La chasse ainsi que la pêche avait probablement pris une plus grande place dans la diète des Iroquoiens avant le développement et le perfectionnement de l'agriculture.
Cuisson des aliments
La sagamité était préparée en prenant quelques poignées de farine de maïs qu’on mettait dans un pot rempli d’eau. On faisait bouillir ce mélange en brassant de temps en temps. On obtenait ainsi un potage assez clair. Le pain de maïs était préparé à partir de grains de maïs secs, grillés ou légèrement bouillis. Les femmes les broyaient, puis les pétrissaient en forme de galettes avec de l’eau tiède. On pouvait aussi utiliser la farine déjà prête qu’on mêlait à de l’eau. Selon les saisons, elles ajoutaient à la pâte des haricots cuits, des petits fruits frais ou secs. Ce pain sans levain était cuit sous la cendre chaude, la plupart du temps enveloppé de feuilles de maïs. Il était consommé en sortant du four. Le pain de maïs était parfois cuit en le déposant dans l'eau bouillante.
Les Iroquoises aimaient aussi régaler les visiteurs en leur servant du blé fleuri ou maïs éclaté (pop-corn). Pour préparer le blé fleuri, elles ajoutaient des grains de maïs secs à du sable brûlant. Elles les faisaient cuire jusqu'à ce que les grains éclatent.
Les courges coupées en petits morceaux étaient ajoutées à la sagamité. On les mangeait aussi cuites sous les braises ou bouillies. Le topinambour était consommé cru ou cuit sous la cendre. Certaines noix étaient parfois chauffées pour faciliter leur cassage. Habituellement, on utilisait une enclume de pierre où une petite dépression permettait de les retenir pour les casser. Les glands étaient bouillis à plusieurs reprises dans la cendre pour en diminuer la saveur amère.
Les poissons (esturgeon, saumon, truite, anguille) étaient consommés frais et bouillis, séchés ou fumés. Ils servaient surtout de mets d’accompagnement et ils donnaient du goût à la sagamité. Du corégone bouilli dans de grandes chaudières, les Iroquoiens tiraient une huile douce. Les Iroquois mangeaient aussi des tortues cuites sous les cendres chaudes ou bouillies dans l’eau, les pattes vers le haut.
Une défense quasi autonome (1871-1898)
La situation géopolitique du Canada en 1871
Au cours du XIXe siècle, le monde occidental, plus particulièrement l'Europe, est secoué par de profonds bouleversements géopolitiques. On assiste en effet à l'effritement progressif des grands empires et à leur remplacement par une foule d'États-nations. Lente au début, cette montée des nationalismes s'accélère à compter de 1871. À cette date, l'Italie et l'Allemagne viennent tout juste de compléter leur unification, de sorte que l'Europe de l'Ouest ressemble déjà à celle que nous connaissons aujourd'hui. Il en va tout autrement par ailleurs pour l'Europe du centre et de l'Est. Mises à part, la Grèce ainsi que les trois minuscules principautés de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, les empires austro-hongrois, ottoman et russe se partagent cet immense territoire où vivent plusieurs groupes ethniques qui aspirent à l'autonomie politique.
Toujours à compter de 1871, on remarque aussi un regain d'intérêt pour les explorations et les découvertes, de sorte que, partant de leurs établissements côtiers échelonnés tout autour de l'Afrique, les Européens se ruent vers l'intérieur. Ce mouvement d'expansion coloniale lié à la montée des nationalismes, crée des hostilités nouvelles ou en ranime d'anciennes.
En Amérique du Nord, l'unification territoriale des États-Unis et du Canada se poursuit. Le Colorado va se joindre à l'Union américaine en 1876, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Montana et l'État de Washington en 1889, l'Idaho et le Wyoming l'année suivante, l'Utah en 1896, l'Oklahoma en 1907 et l'Arizona ainsi que le Nouveau-Mexique en 1912. Enfin, au Canada, les immenses Territoires du Nord-Ouest demeurent inorganisés. Acquis de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1870, mais ne représentant qu'une infime parcelle de cette possession, le Manitoba en a alors été détaché pour former la cinquième province. Puis, en 1871, c'est au tour de la Colombie-Britannique d'adhérer à la Confédération canadienne. D'un côté, l'Angleterre relâche peu à peu son emprise sur ses colonies d'Amérique du Nord. De l'autre, le Canada naissant se solidifie lentement d'un océan à l'autre.
La croissance d’un empire
Officier et canonniers, Royal Regiment of Artillery, 1889. Des officiers et canonniers du Royal Regiment of Artillery sont envoyés en détachement à Halifax afin de servir auprès de la défense côtière qui protège leur base navale depuis 1905.
L'influence de l'Angleterre impériale ne disparaît pas au Canada au moment où le gros de ses troupes le quittent, en 1871. Au contraire, dans cette seconde partie du XIXe siècle, elle s'incruste et imprègne notre pays, en particulier nos élites politiques, économiques et militaires. Elle connaît même un certain crescendo au moment du soixantième anniversaire de l'accession au trône de la reine Victoria, en 1897.
Cet impérialisme florissant est difficile à définir avec précision. Il comporte un aspect économique qui pousse les Anglais et d'autres Européens à la conquête de nouveaux marchés dans le monde. Il est aussi raciste, reconnaissant la supériorité de la race blanche. Ce sentiment de supériorité est nuancé par une volonté de changement social en Angleterre, y compris en faveur des « inférieurs », dont « l'homme blanc » porte le fardeau de la rédemption. Parmi les Blancs, les Anglo-Saxons seraient sur la plus haute marche. Ces grandes tendances sont certainement importantes, mais elles comprennent, on l'imagine, une part de contradictions et de non-dits. Ainsi, au Canada, la partie du sentiment impérial faisant des Anglo-Saxons de la terre une race unie et supérieure se frappe à trois écueils. Le premier est formé de tous ceux qui ne sont pas anglo-saxons, surtout les autochtones, les Métis et les Canadiens de langue française, ce qui représente plus de 35 pour cent de la population. Le deuxième est constitué des États-Unis, dont la population, tout en étant en grande partie anglo-saxonne, a son propre rêve impérial d'expansion qui est un danger pour le Canada. Le bloc anglo-saxon n'est donc pas aussi monolithique que certains le souhaiteraient. Le troisième repose sur le sentiment national canadien qui se développe, en partie contre la « destinée manifeste » des États-Unis, en partie contre l'emprise qu'exerce encore l'Angleterre sur le Canada.
L'impérialisme tel qu'on l'entend parfois à Londres et dans certaines couches canadiennes est fait d'un renforcement de l'Empire britannique grâce à une coopération économique, militaire et navale accrue entre les différents territoires qui composent ce dernier. Or, pour beaucoup de Canadiens, ce resserrement des liens est porteur de changements qui donneront à terme aux colonies une influence dans la mise en place de la politique étrangère de l'Empire et, ce faisant, contribueront à l'affirmation du nationalisme canadien. Quant au commerce impérial, il est en voie d'être dépassé par les échanges canado-américains.
Deux faits se situant l'un en 1871 et l'autre en 1897 illustrent mieux que toutes les tendances divergentes en ce qui concerne l'Empire. Le traité de Washington de 1871 démontre sans l'ombre d'un doute au premier ministre canadien John A. Macdonald, présent lors des discussions anglo-américaines, que les intérêts canadiens peuvent souffrir de la stratégie prônée par les Anglais visant à neutraliser la menace américaine afin de mieux se dépenser ailleurs dans le monde. Un petit exemple : le Canada est appelé à rembourser les dégâts causés durant la guerre de Sécession aux banques de St. Albans lors d'un raid monté contre elles, à partir du Canada, par les Sudistes. Mais l'Angleterre refuse de réclamer aux Américains les dommages résultant des incursions fenianes dont la dernière vient d'avoir lieu. Dans l'entente de 1871, le Canada perdra sur les plans économique, politique et géographique, sans parler de la blessure faite à l'amour-propre anglais et canadien.
Un partenariat impérial
Armstong RML guns à Ives Point Battery, Halifax, 1873. C'était l'un des plusiers batteries gardant le port d'Halifax dont les canons traversent des plates-formes en acier.
D'autre part, à l'occasion des réjouissances entourant le long règne de Victoria, en 1897, le secrétaire d'État anglais aux Colonies, Joseph Chamberlain, organise une conférence coloniale où de grandioses cérémonies protocolaires enrobent le fond de la pensée de l'hôte. « Les discussions informelles sur des questions d'un grand intérêt impérial 1 » auxquelles Chamberlain convie ses invités portent, en fait, sur un lien impérial qui serait resserré à l'aide d'un grand conseil de l'Empire, centralisé à Londres, où les problèmes seraient étudiés et les décisions prises. Chamberlain aborde aussi la question d'un vrai partenariat qui reposerait sur un partage des droits et des responsabilités au niveau de la défense. Que répond le premier ministre canadien Wilfrid Laurier ? Plus ou moins que l'état des choses actuelles lui sied très bien. Il admet que les Puissances (Dominions) voudront participer aux décisions impériales. Mais il se montre peu réceptif à l'idée que cela se fasse en contrepartie d'une plus grande participation militaire aux missions mondiales de l'Angleterre. Pourtant, cet homme aime les institutions anglaises. Il le clame d'ailleurs un peu partout, aussi bien au Canada qu'à l'étranger, dans des discours où il glorifie l'Empire. Mais pas au point de s'engager à le défendre coûte que coûte, ni d'abandonner des parcelles du nationalisme canadien naissant. Laurier se montre donc plus nationaliste qu'impérialiste. En cela, il représente une bonne partie de la population, surtout les Canadiens français. Car, dans la fièvre impérialiste qui prévaut, des voix s'élèvent ici et là au Canada, dont celle d'Honoré Mercier, premier ministre du Québec (1887-1891), avertissant qu'un jour ou l'autre, le fanatisme de certains, dont celui de la puissante Ligue de la fédération impériale, conduira les jeunes Canadiens à aller mourir en terre étrangère pour une cause qui leur sera tout aussi étrangère.
La conférence coloniale de 1897 aboutit tout de même à quelques décisions qui, tout en étant vagues, ont leur importance du côté militaire. On prévoit une coopération de plus en plus grande entre le War Office et les différents ministères chargés de la défense dans les dominions, un principe général que l'on désire rendre vivant par une organisation, un entraînement et un équipement similaires pour les armées de l'Empire.
En cette fin de XIXe siècle, l'expression « peindre la mappemonde en rouge », que l'on entend alors souvent, est devenue une impossibilité reconnue depuis longtemps par nombre d'impérialistes. Mais le romantisme s'entretient de mythes et celui de l'Angleterre impériale se maintiendra vaille que vaille, jusqu'à la Première Guerre mondiale, entraînant dans son sillage bon nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes, sans doute plus attirés par la possibilité d'aventure que leur offre le rêve impérial que par le rêve lui-même.
La défense du Canada par les Canadiens. Les troupes britanniques se retirent du Canada
L'année charnière 1871 est marquée, sur le plan militaire canadien, par la pacification, jusqu'à ce jour, de notre frontière avec les États-Unis. De cette nouvelle situation résulte un assainissement des finances anglaises causé aussi bien par l'abandon de projets de construction de fortifications, au Canada, prévues contre d'éventuelles invasions américaines, que par le départ de notre sol des troupes anglaises, sauf en ce qui concerne la place d'Halifax, qui joue un rôle important dans la stratégie navale anglaise.
À compter de 1871, et à son corps défendant, le Canada doit assumer entièrement sa défense. Il s'y emploie de plus en plus depuis 1855, comme nous l'avons déjà signalé, et sa loi constitutive de 1867 comprend un article sur la Défense et la Milice (terrestre et navale). Quelle est l'urgence ? En 1867, la possibilité d'une attaque de l'extérieur, donc des États-Unis, est assez sérieuse et doit donc être prise en compte. La menace de mouvements violents intérieurs doit aussi être envisagée ainsi que celle pouvant peser contre l'Empire anglais tentaculaire dont, en définitive, le Canada fait partie. Ce sont ces deux dernières options qui seront prédominantes jusqu'en 1945, même si la vision des stratèges de 1867 ne s'étend pas jusqu'à cet horizon.
Une milice de volontaires
Carte militaire du Canada, vers 1910.Le ministère de la Milice et de la Défense canadien naît en 1868. Le pays fut divisé en 9 zones militaires et de nouvelles zones se sont ajoutées plus tard.
L'analyse de la situation, des contraintes de nature économique et sociale ainsi que le mythe de l'invincibilité du milicien (le citoyen-soldat) vont faire, dans un premier temps, que l'organisation de la défense reposera sur les troupes régulières britanniques renforcées de 40 000 volontaires de la milice active enrôlés pour une période de trois à cinq ans. Bien que l'on fasse mention d'une milice navale, dans cette loi adoptée en 1868, les volontaires de la milice active sont essentiellement chargés de la défense terrestre, jusqu'au XXe siècle. Notons également que le principe du service obligatoire est maintenu, même s'il ne sera pas utilisé.
La Milice active non permanente peut accueillir les hommes âgés entre 18 et 60 ans, qui sont subdivisés en quatre classes : ceux de 18 à 30 ans, célibataires ou veufs sans enfants ; de 30 à 45 ans, possédant ces mêmes particularités ; de 18 à 45 ans, mariés et veufs avec enfants ; et, enfin, de 45 à 60 ans. Le Canada est séparé en neuf districts et en 200 divisions régimentaires, chacune commandée par un lieutenant-colonel. Un exercice annuel, d'une durée de 8 à 16 jours, est prévu. Chaque milicien doit se procurer un fusil Enfield-Snider moyennant 12 $, le gouvernement payant la différence. Sont exempts de l'enrôlement : les juges, les religieux, les policiers, les gardes de pénitenciers ou d'asiles d'aliénés, les personnes handicapées, les fils uniques ou soutiens de famille.
Avec un budget initial de 900 000 $, le ministère de la Milice et de la Défense canadienne naît officiellement en 1868. Les anciennes milices provinciales ou canadiennes sont dissoutes en 1869 et, aussitôt, l'enrôlement débute dans les nouveaux districts militaires. Les officiers ne sont pas obligés de se réengager, mais, s'ils le font, ils doivent prêter un nouveau serment d'allégeance. L'opération permet de se débarrasser d'une partie du bois mort qui existait dans les milices d'avant 1867.
Les districts ontariens sont les premiers à être officiellement acceptés mais, dès avril 1869, 10 bataillons plus quelques compagnies indépendantes, constitués surtout de Canadiens français, ne font leur apparition au Québec. La Milice active comptera rapidement 37 170 volontaires, à moins de 3 000 de l'effectif permis. Quant à la milice sédentaire - qui se résume à la constitution de la liste des noms de tous les hommes susceptibles de servir -, elle comprendra 618 896 noms.
Les premiers soldats professionnels canadiens
B Battery Garrison Artillery en 1873. La B battery fut l'une des premières unités permanente de l'Armée canadienne : l'artillerie Garrison. Formée à Québec en 1870, la B battery fut considérée une école d'artillerie de la milice canadienne. Cette photo du Canadian Illustrated News, du 19 avril 1873, démontre une compétition de tir sur la glace de la rivière Saint-Charles. Les armes chargeurs à muselière de canon à âme lisse sont montées sur des carrioles de transport utilisées durant l'hiver. Les artilleurs sont vêtus de leurs uniformes d'hiver.
La loi de 1868 ne veut pas effaroucher les Canadiens, anglophones ou francophones, qui ne sont guère favorables à l'armée de métier. En temps et lieu, la Milice viendra appuyer les troupes anglaises pour chasser tout envahisseur, se dit-on. Mais, ce postulat est remis en cause par le départ des militaires britanniques, à l'automne 1871. Pour les remplacer, le Canada prend aussitôt une mesure modérée, probablement justifiable dans les circonstances, puisque les États-Unis ne sont plus aussi menaçants qu'ils l'étaient quatre ans plus tôt. En octobre 1871 donc, avant même que la garnison britannique quitte Québec, le pays met sur pied deux batteries d'artillerie de campagne qui auront pour tâches, entre autres, de protéger les fortifications de Québec et de Kingston. Ces quelques centaines d'hommes fourniront aussi l'instruction aux artilleurs et aux fantassins de la Milice active non permanente. Les Batteries A (Kingston) et B (Québec) forment le premier noyau de l'armée régulière canadienne ou Milice active permanente, comme on l'appelait à l'époque. Le premier commandant de la Batterie B est le lieutenant-colonel Thomas Bland Strange. Il parle français et possède des états de service impressionnants, ayant servi en Inde, en Angleterre, en Irlande, à Gibraltar et aux Antilles avant de venir à Québec. Ce choix est bon, puisque la Batterie B (6 officiers et 153 sous-officiers et hommes) inclut plusieurs francophones venus de la Milice volontaire de Québec. Cette batterie s'occupe des fortifications de Québec, de Lévis et de l'île Sainte-Hélène. En 1874, un détachement est envoyé à Grosse-Isle pour se transformer en artillerie de garnison. Les Batteries A et B inter-changera leurs positions une première fois, en 1880, et encore en 1885. En 1883, la nouvelle Batterie C, sera créée et stationnée à Esquimalt, chargée de la défense de cette partie de la côte ouest. Les trois batteries formeront désormais un régiment. En 1893, celui-ci est réorganisé en trois batteries de campagne et deux compagnies de garnison. Les batteries de campagne seront amalgamées plus tard au sein de la Royal Canadian Field Artillery qui, en 1905, deviendra la Royal Canadian Horse Artillery : pour leur part, les compagnies de garnison donneront la Royal Canadian Garrison Artillery.
La cavalerie et l’infanterie régulière.
Mais, entre-temps, la loi de la Milice aura été modifiée en plusieurs occasions. Le changement de 1883 sera le plus important. Citonsen un article central.
Étant donné qu'il est nécessaire, par suite du départ des troupes régulières impériales d'assurer la protection et l'entretien des forts, des magasins, de l'armement, des dépôts de matériel de guerre et services assimilés, et d'assurer la création d'écoles d'instruction militaire relativement aux Corps recrutés pour le service permanent, il est légitime pour Sa Majesté de lever... une troupe de cavalerie, trois batteries d'artillerie (dont les deux Batteries A et B déjà organisées) et pas plus de trois compagnies d'infanterie, le total des effectifs de toutes ces unités ne devant pas dépasser 750 hommes.
C'est ainsi qu'un corps école de cavalerie apparaît à Québec (qui deviendra le Royal Canadian Dragoons) et un autre d'infanterie (Royal Canadian Régiment), qui aura des compagnies à Fredericton, Saint-Jean et Toronto. Celles-ci auront approximativement l'effectif suivant : 1 commandant, 3 officiers et 150 sous-officiers instructeurs et hommes. En 1885, une école d'infanterie à cheval est mise sur pied à Winnipeg (qui prendra plus tard le nom de Lord Strathcona's Horse).
Cette réorganisation donne un solide noyau à la force permanente, un fait que le ministre de l'époque, Adolphe Caron, tente d'atténuer, insistant plutôt sur la vocation d'instruction qu'auront ces soldats réguliers. Caron explique que le gouvernement civil sera ainsi renforcé, qu'il pourra faire exécuter ses lois, prévenir des troubles intérieurs et repousser d'éventuelles attaques. Comme on le voit, entre 1867 et 1883, la préoccupation première de l'effort de défense est passée de la menace venue de l'extérieur à celle venant de l'intérieur.
En 1886, après les troubles dans le Nord-Ouest, avec Louis Riel, la Loi de la Milice est à nouveau changée faisant passer le nombre de compagnies d'infanterie de trois à cinq et celui de l'effectif total de la force régulière de 750 à 1 000 hommes.
Le commandement de la milice
Cette machine militaire doit être commandée. Entre 1867 et 1874, le commandant, un officier fourni par l'armée anglaise, portera le titre d'adjudant général. À compter de 1874, et jusqu'en 1904, on créera le nouveau poste d'officier général commandant, qui sera aussi rempli par un professionnel britannique détenant au moins le grade de colonel bien qu'au Canada il puisse devenir major général, voire lieutenant général. L'adjudant général reste dans l'organigramme, le poste étant dorénavant rempli par un Canadien.
On peut espérer une certaine objectivité de l'officier anglais prenant charge de notre appareil de défense par rapport aux deux grands partis politiques qui gouverneront successivement le pays. En principe, son professionnalisme le fera agir en faveur d'une meilleure milice, plutôt qu'en fonction d'intérêts partisans limités. Malheureusement, l'objectivité que l'officier général commandant applique face aux politiciens canadiens ressemble très souvent à de l'asservissement quant aux grands objectifs impériaux des politiciens britanniques. Cela, on l'imagine bien, aboutit à certaines collisions avec le nationalisme des ministres canadiens, aussi timoré soit-il en cette fin de siècle. Dans son rapport annuel, l'officier général commandant livre fréquemment des considérations qui ont peu à voir avec le Canada. Ainsi, le général Edward Selby Smyth, écrit-il en 1877 : nous ne devons pas permettre un instant que le communisme fasse impunément quelque grande expérience dans le moindre coin de l'Empire britannique» Le bon général nous entretient de notre autonomie, qu'il faut bien sûr protéger, et d'un autre ennemi, bien plus éloigné que notre voisin immédiat, auquel il fait alors référence de façon subtile mais qui inquiète déjà, la Russie, avec laquelle l'Angleterre a souvent maille à partir.
Ces hommes que nous envoie l'Angleterre, qui affrontent, souvent avec raison, nos ministres concernant le patronage lié à certaines nominations, sont-ils les meilleurs dans leur profession ? Comme nous aurons l'occasion de le constater, ce n'est pas toujours le cas. Qui plus est, le système de défense canadien leur est en général à peu près incompréhensible. Comme ils aimeraient le mettre à leur main et en faire un instrument entièrement dévoué à la volonté anglaise !
Au milieu de l'apathie à peu près générale des Canadiens, de la fluctuation des budgets au gré de l'évolution de l'économie et d'une certaine animosité des ministres titulaires, les officiers généraux commandants essaient de faire bouger les choses. Entre 1890 et 1895, par exemple, le major général I.J.C. Herbert réorganise la milice en ajoutant du personnel à son quartier général, où ne se trouvaient que trois officiers et un aide de camp, et en diminuant le nombre d'officiers dans les districts. Du côté des forces permanentes, il organise en régiment les écoles d'infanterie et de cavalerie apparues au fil des années, expédie plusieurs de leurs officiers en entraînement en Angleterre, améliore les critères de recrutement et de sélection des hommes et s'attache à moderniser le matériel.
L’instruction et l’évolution de la milice
Les efforts de chacun des généraux britanniques combinés à l'intérêt intermittent des ministres, souvent allumé par des raisons politiques ou des crises intérieures qui ont démontré la faiblesse du système existant, donnent cependant peu à peu des résultats. On l'a noté, le nombre de soldats réguliers s'accroît entre 1871 et 1898. Mais il y a plus. En 1876, on ouvre le Royal Military College of Canada (RMC), qui sera une pépinière d'officiers pour les unités permanentes et non permanentes ainsi que pour la Police montée du Nord-Ouest. La politique nationale du Parti conservateur amène le Canada à construire une cartoucherie, la Dominion Arsenal, à Québec, dont la production commence en 1882 et s'étend aux boulets et aux obus de canons. En 1885, l'Arsenal approvisionne les troupes déployées dans le Nord-Ouest du pays et, en 1888, on y fabrique 2 500 000 cartouches. En 1885, un chemin de fer relie l'Atlantique et le Pacifique en n'utilisant que le territoire canadien : cet instrument, avant tout commercial, est aussi un outil stratégique. En 1897, on autorise la nomination d'aumôniers honoraires pour chaque bataillon, mais il est entendu que cela ne coûtera rien au Trésor. Un service de la paie se développe très lentement : on y trouve moins de 10 officiers et, en 1898, on en centralise à Ottawa toutes les opérations qui se faisaient jusque-là au niveau des districts.
Membres du Ladies School Cadet Corps, à St- Catharines, Ontario, en 1891.
Même en 1880, quelques régiments de la milice volontaire avaient des compagnies auxiliaires de la gente féminine, telles que les membres du Ladies School Cadet Corps, à Sainte-Catharines, en Ontario, en 1891. Vues que leur fonction était informelle, il y a très peu d'information concernant ces formations.
En 1871, le Canada reste dépourvu de corps de soutien, essentiels à une armée en campagne, comme les domaines médical, du transport, de l'approvisionnement et du génie. Jusque-là, l'armée anglaise avait fourni ces éléments lors des mobilisations de la milice. Par la suite, on assiste, au moment des crises, à une improvisation précipitée plus ou moins heureuse, la campagne du Nord-Ouest de 1885 étant patente à cet effet.
En Chambre, il y a parfois d'âpres débats sur l'organisation matérielle de la Milice, surtout à propos du budget qui lui est alloué, mais jamais sur l'essentiel, c'est-à-dire la politique de défense de notre pays qui, au-delà de sa volonté d'affranchissement, reste tout de même très dépendante de l'Angleterre.
Corps cadet, Quebec City High School, 11 juin 1890. Plusieurs corps cadets furent établis dans les écoles durant les dernières années du 19e siècle. Cette photo, datant du 11 juin 1890, est du corps de l'école secondaire anglaise Quebec High School, fondée à Québec avant la Confédération. Notez le corporal (probablement de l'unité Garrison, la B Battery, Regiment of Canadian Artillery, de la ville de Québec) qui a agit en temps qu'instructeur d'exercices militaires à ce centre.
Qui sont nos volontaires ? Jean-Yves Gravel nous en trace le portrait, pour la période 1868-1898, en ce qui concerne le 5e District militaire (l'est du Québec, dont la ville de Québec). On se rend compte que les bataillons ruraux sont composés à 45 pour cent de fermiers, à 30 pour cent d'hommes d'affaires (commerçants et commis) et à 24 pour cent d'ouvriers. Le pourcentage de fermiers, valable pour 1868, est en décroissance lente, mais constante, après cette année-là. Bien sûr, l'industrialisation joue ici un rôle, mais il y a plus. En effet, presque toutes les études menées dans le monde occidental sur le recrutement concluent de la même façon : le monde rural est plus réfractaire que le milieu urbain à tout service militaire.
Les bataillons urbains sont pour leur part constitués à 62 pour cent d'ouvriers et à 27 pour cent d'hommes d'affaires. Après 1873 et l'élimination de la menace américaine, le pourcentage des ouvriers diminue, car leurs patrons sont peu favorables à leur service militaire. Le monde des affaires et celui des étudiants prennent leur place. En somme, dans un pays qui restera majoritairement rural jusqu'après la Première Guerre mondiale, c'est le milieu urbain qui donnera corps à la force de défense du Canada dès ses débuts.
Les budgets de la milice
La vie du milicien canadien est influencée par la nature des budgets qui sont dévolus à l'organisation où il s'inscrit. Ces appropriations passent de 937 513 $, en 1869, à 1 654 282 $, en 1873, puis, elles décroissent pour atteindre un creux de 580 421 $ en 1877. Entre 1878 et 1881, elles fluctuent dans une fourchette minimale de 618 136 $ (1878) et maximale de 777 698 $ (1879). À compter de 1882 jusqu'à 1886, c'est l'ascension à partir de 772 811 $ pour atteindre le sommet de 4 022 080 $, avec la campagne dans le Nord-Ouest. Les sommes totales annuelles se situent ensuite un peu au-dessus de 1 000 000 $.
Comme on le voit, les choses se sont détériorées dans la seconde moitié des années 1870. C'est qu'une crise économique frappe le monde industriel, dont le Canada. La recette bien connue des politiciens, ceux d'alors comme ceux d'aujourd'hui, est de sabrer dans la défense. D'ailleurs, ce ne sont pas les critiques qui manquent au Parlement. L'argument le plus familier s'énonce comme suit : la sécurité du Canada n'étant pas en cause, à quoi servent les dépenses militaires ? Quant aux aspects plus détaillés des reproches, ils portent sur le gaspillage pour les uniformes (qu'on avait oubliés de fournir aux volontaires jusqu'en 1876), les armes, le trop grand nombre d'officiers dans les états-majors ou, encore, après 1876, la quasi-absence de francophones au Collège militaire de Kingston.
L'impact de la coupure des budgets sur l'instruction est considérable à compter de 1876, et ce, après l'ajout aux institutions existantes du Royal Military College. Durant l'exercice financier 1871-1872, 34 414 hommes avaient effectué une période d'instruction de 16 jours. Ce sommet ne sera pas atteint de nouveau avant 1905. Alors que le nombre permis de volontaires à instruire annuellement avait été fixé à 40 000, en 1868, il a été rabaissé à 30 000, en 1873. La période d'exercice a été réduite à huit jours, en 1876 ; elle remonte à 12, en 1877, mais doit se faire aux quartiers généraux des bataillons. En 1888, l'effectif maximal permis est porté à 43 000 hommes mais, pour des raisons d'économie, on permet à 37 000 de s'enrôler. Les corps des villes en réunissent 10 000, durant 12 jours d'exercice annuel, ceux des campagnes, 27 000, avec 12 jours d'instruction tous les deux ans. Mais, entre 1877 et 1886, le nombre d'hommes ayant suivi un exercice annuellement atteint rarement plus de 20 000, la moyenne se situant dans les 18 000.
Le manque d’enthousiasme
Sergent, Hamilton Field Battery, Royal Canadian Artillery, 1894. En 1894, la Milice volontaire canadienne comprend 17 batteries de champ. Les batteries de champs se servaient surtout des canons britanniques de 9 livres qui étaient périmés dans les années 1890s et ont été remplacés avec des canons britanniques de 18 livres dès 1906. L'uniforme de l'Artillerie royale canadienne ressemblait à celui de l'Artillerie royale britannique excepté que les Canadiens préférait porter le casque colonial blanc plutôt que le casque bleu-noir britannique.
Ce chiffre ne repose pas seulement sur le budget. Le zèle des volontaires est aussi un facteur. La loi de 1868 permettait d'instruire au moins autant d'hommes que les 30 000 de l'armée régulière américaine. Mais, en 1873, les volontaires, pour la première fois, occupent moins de 75 pour cent des 40 000 postes ouverts. En modifiant la loi pour ne permettre l'entraînement que de 30 000 hommes, on retrouve, dès 1874, un taux de 97 pour cent d'occupation des postes de miliciens volontaires disponibles.
Cela dit, les variations de l'enthousiasme gouvernemental vis-à-vis de la chose militaire ont des suites peut-être plus durables que la période, somme toute limitée, des bas budgets. Durant les cycles bas, l'instruction étant limitée, l'efficacité et l'intérêt des volontaires s'étiolent, surtout au sein des régiments ruraux qui ne s'entraînent que tous les deux ans. Dans les districts, les restrictions budgétaires sont telles que l'on doit tirer au sort le nom des unités qui pourront aller au camp. Dans une telle conjoncture, la petite flamme militaire, maintenue de peine et misère chez plusieurs volontaires, s'éteint souvent pour toujours. Sans compter qu'on empêche l'apport de sang nouveau que la crise économique aurait pu amener si l'on avait permis autant d'instruction, entre 1877 et 1883, qu'auparavant. Les budgets augmentent à compter de 1882, mais la situation économique s'améliore aussi, ce qui constitue un facteur négatif par rapport au nombre de volontaires que l'on voudrait entraîner. De plus, en accroissant soudainement le nombre possible de ceux que l'on peut instruire, on fait appel à un afflux de recrues et, donc, à beaucoup d'inexpérience.
Les camps annuels d'instruction, lorsqu'ils ont lieu, se tiennent sur des sites bien précis. Au Québec, par exemple, ce sera à Laprairie, pour les unités de l'ouest de la province (incluant Montréal), et à Lauzon, pour celles de l'est, dont Québec, plus précisément à l'ancien camp établi par les ingénieurs anglais lorsqu'ils travaillaient à fortifier la pointe Lévis, entre 1865 et 1871. Nous commenterons, plus loin, la valeur réelle de ces sessions d'entraînement. Les unités elles-mêmes organisent parfois des revues, surtout dans les villes, pour souligner un événement heureux ou triste. Cela donne l'occasion à plusieurs, dont de nombreux députés de tous les partis, d'endosser leurs uniformes.
Le milicien et son instruction. Les conditions du service dans la milice
Paie journlière dans un camp par le rang. Un soldat servant dans la Milice canadienne dans les années 1870s était payé 50 cents par jour. Un journalier gagnait $ 1.00 par jour. Les hommes dans les camps étaient soumis à des barèmes quotidiens proportionnés aux grades, qui ne fluctueront guère entre 1868 et 1898.
À part ces rares moments dans une année, souvent inexistants dans un bataillon rural, le volontaire a bien peu de liens avec le militaire. La vie de tous les jours, les réorganisations nombreuses des unités dont le nombre de compagnies varie pour toutes sortes de raisons, la volonté et l'enthousiasme du capitaine de chacune étant les principaux éléments de motivation, le manque d'intérêt aux plus hauts niveaux politiques, tout, en quelque sorte, concorde pour faire du volontaire un être à part, mal soutenu par une société qui n'est pas militariste, loin de là. La campagne du Nord-Ouest vient modifier cet ordre des choses dans les unités qui y participent. Mais la grisaille de la routine reprend vite le dessus, après leur retour dans leurs quartiers.
Le milicien servant dans un quartier général est payé 1 $ par jour, s'il est officier, et 50 ¢ pour tous les autres grades. En 1876, ce dernier montant grimpe à 60 ¢. Ceux qui vont dans un camp sont soumis à des barèmes quotidiens proportionnés aux grades, qui ne fluctueront guère entre 1868 et 1898. Il est bon de rappeler qu'un journalier, au milieu des années 1870, gagne environ 1 $ par jour et même plus durant l'été et l'automne, période habituelle des camps.
Un officier au camp d'entraînements, Artillerie royale canadienne, les années 1890s. Pendant des décennies, les camps d'entraînements d'été de la 1re batterie de campagne de Québec de la milice volontaire et les batteries d'artilleries de garnison eurent lieu sur l'Île d'Orléans avec les canonniers des forces permanentes qui furent en garnison au citadel de Québec. L'artillerie de la milice volontaire de garnison fut divisée en brigades comprenant quelques brigades aussi bien qu'une seule batterie. (Musée de l'Artillerie royale canadienne.
À la suite des réductions radicales des budgets, on doit prendre des mesures restrictives qui ne plaisent pas. Les rations ont été gratuites pour tous jusqu'en 1875 : à ce moment-là, on choisit d'ajouter 10 ¢ par jour à la solde, mais chacun doit désormais payer ses repas. On ne paie plus les jours de déplacement pour aller vers les camps et en revenir, ainsi que le dimanche passer au camp. En 1883, devant le mécontentement général, on revient au paiement de ces journées. La situation économique s'améliorant, les officiers d'état-major sont dorénavant payés durant 15 jours, et ceux qui commandent les compagnies, durant 12. La même année, les soldes des militaires servant dans les quartiers généraux sont aussi ajustées aux grades.
Même si les officiers de la Milice permanente ou non permanente sont mieux payés que la troupe, il leur faut aussi une bonne dose d'abnégation pour accepter de servir leur pays. Ainsi, un aspirant officier de la Milice non permanente doit réfléchir aux aléas liés à son futur statut. Car il devra payer son uniforme, fournir ses meubles de caserne et, lorsqu'il ira suivre ses cours, pouvoir s'absenter 57 jours, pour obtenir son certificat de 2e classe, ou 72 jours, pour celui de première classe. Évidemment, on s'attend à ce qu'il sache écrire correctement à la dictée et tenir des comptes (arithmétique). Par la suite, dans plusieurs unités, sa solde ou une bonne partie de celle-ci, s'en ira au fonds régimentaire. Tout de même, en plus de sa paie de camp, le capitaine de compagnie reçoit 40 $ pour garder les armes et les uniformes de ses hommes. Le commandant d'un bataillon a 100 $ annuellement pour les dépenses encourues dans ses fonctions militaires (papeterie, poste, annonces dans les journaux pour le recrutement, etc.), 100 $ de plus s'il s'adjoint une fanfare (toujours un centre d'attraction au camp annuel), ainsi que 40 $ par compagnie pour assurer l'instruction d'avant-camp. Mais cette dernière somme sert le plus souvent à d'autres activités : fanfare, fonds du régiment ou, tout simplement, le commandant se l'approprie en retour des services rendus.
Les propositions de conscription et les problèmes de recrutement
Recensement des hommes en âge et susceptibles de servir. Ce tableau, divisé par province et par année, nous renseigne sur le nombre d'hommes qui étaient susceptibles de servir dans l'armée canadienne à cette époque.
La loi de 1868 contient le principe d'une conscription. Dans la réalité, cet aspect se transforme en un inventaire que l'on fait en 1869, 1871 et 1873, avant de l'abandonner.
Chaque recensement coûte 50 000 $ et, dans le cadre des compressions budgétaires de 1875, on décide de n'en tenir un que tous les cinq ans, le prochain devant avoir lieu en 1880. En fait, le dernier aura été celui de 1873, sauf au Nouveau-Brunswick, où l'exercice se répétera jusqu'en 1879.
Le fait que la conscription ne soit pas appliquée n'empêchera pas plusieurs de pousser dans cette direction, dont les lieutenants-colonels Irumberry de Salaberry, A.C. Lotbinière Harwood et L.G. d'Odet d'Orsonnens, tous trois pouvant être considérés comme francophones. Or, cette levée, qui avait été traditionnelle sous le Régime français, va à l'encontre de la tradition britannique. De leur côté, les officiers généraux commandants insistent pour obtenir une plus grande force régulière par rapport aux milices non permanentes. Cette demande qui n'aura qu'un succès mitigé, se moule dans la tradition britannique, fondée sur le professionnalisme de l'armée, plutôt que celle existant à l'époque sur le continent européen, avec la conscription plus ou moins longue des jeunes hommes.
Les tenants de la conscription ont plusieurs arguments à faire valoir en leur faveur. Le premier, qui apparaît dans les années où les États-Unis sont menaçants, s'appuie sur le nombre insuffisant de volontaires. En 1868-1869, le district militaire de l'est du Québec a un quota de 5 035 volontaires qu'il ne peut réaliser qu'à 59 pour cent. Le 6e District militaire (Montréal et l'ouest du Québec), a un effectif autorisé de 3 228 en 1871, dont moins de 50 pour cent (1 512) participent aux exercices : le 4e Bataillon a 4 officiers et 46 hommes, ce qui est moins que le nombre admis pour une compagnie; le 65e (de Montréal) en a respectivement 17 et 158. En décembre 1873, au moment de l'inspection du 65e Bataillon, une compagnie est absente, celle du député A. Ouimet : l'exemple vient de haut pour les 18 autres officiers et 194 sous-officiers et soldats présents. Qui plus est, 66 pour cent des francophones ne poursuivent pas après la première année, malgré leur contrat de trois ans. Chez les anglophones du Québec, ce taux de non-renouvellement est de 33 pour cent, alors qu'en Ontario il est de 25 pour cent. En 1870, bien que 88 pour cent des cadres soient remplis pour l'ensemble du Canada, ce pourcentage tombera à 73 en 1873. Un des problèmes rencontrés ici est l'extrême mobilité de la population susceptible d'être enrôlée, laquelle est constituée en grande partie de jeunes journaliers sans attaches. Toujours est-il que la conscription par tirage au sort du nombre de miliciens permis par la loi ne se produira jamais. On voit mal comment, étant donné la quasi-absence de menace contre le Canada, elle aurait pu être justifiée et, surtout, acceptée par la population.
Les problèmes de la Force permanente
Cela étant, quelle est la valeur réelle de l'entraînement que reçoivent les volontaires sur qui l'on se fie, ne l'oublions pas, pour défendre le pays en cas de danger ou encore pour maintenir ou rétablir l'ordre à l'intérieur des frontières ? Commençons par la force permanente qui se développe jusqu'à son effectif permis de 1 000, dans les années 1880. Premièrement, ces 1 000 postes ne sont jamais remplis totalement (en 1890-1891, par exemple, il n'y en a que 886). Ensuite, une large proportion est formée de recrues ou de soldats peu expérimentés qui peuvent difficilement instruire de façon professionnelle le volontaire (le général Herbert, en 1891, remarque que 54 pour cent de son armée a moins de deux ans de service). Puis, il y a tous ceux qui, en cours d'année, ne sont pas disponibles. Toujours en 1890-1891, un rapport énonce ce qui suit : 103 rachètent leur contrat et partent durant l'année ; 201 terminent leur contrat ; 41 sont renvoyés pour diverses raisons ; 8 meurent ; 152 désertent ; et 28 vont en prison pour divers termes, ce qui fait perdre des périodes de service. En cette année qui n'est pas exceptionnelle, voilà que l'armée régulière doit entraîner quelques dizaines de milliers de miliciens, dont une grande proportion de recrues.
Mais, cette instruction est également donnée par les officiers qualifiés au sein même des corps de volontaires. Dans certains cas, cela peut aller ; dans d'autres, l'instruction est de piètre qualité. Plusieurs de ces officiers sont trop âgés, un lieutenant pouvant être en place à 40 ans passés : il est courant de rencontrer des majors de plus de 50 ans et des lieutenants-colonels dépassant les 60 ans. Les moins efficaces des officiers instructeurs se trouvent dans les corps ruraux, puisque dans les villes l'instruction est souvent entre les mains des professionnels.
Les problèmes du corps rural
Les difficultés des corps ruraux sont énormes. Un bataillon pourra être constitué de plusieurs compagnies séparées les unes des autres par 30 ou 50 kilomètres de routes mal tracées, ce qui rend à peu près impossible le rassemblement du bataillon, sauf au moment du camp annuel. Ainsi, en 1869, le Bataillon provisoire de Rimouski est formé avec cinq compagnies, dont une à Matane, à 100 kilomètres de Rimouski par une route peu praticable. Les capitaines de compagnie deviennent donc les éléments importants de l'organisation. Ce sont eux qui recrutent leurs hommes, souvent grâce à un mélange de charme et de demi-vérités qui rendent à peu près impossible l'imposition de la discipline militaire. De fait, la popularité du recruteur joue fréquemment un plus grand rôle que sa compétence militaire. La loi laisse aux officiers commandants la responsabilité de l'instruction. Or, il arrive que ceux-ci « signent encore aujourd'hui [1874] un certificat de compétence pour eux-mêmes ». Ils sont naturellement payés pour donner l'instruction [de 40 $ dans l'infanterie et la cavalerie jusqu'à 200 $ pour l'artillerie de campagne]. Dans les villes, une allocation par batterie ou compagnie formée sera payée au commandant de brigade ou du bataillon, d'où le grand nombre de compagnies, chacune ayant très peu d'effectifs : à 25 $ par année et par compagnie, pour le commandant, plus les 40 $ payés au capitaine, personne n'a intérêt à les voir disparaître. Cela entraîne, bien sûr, toutes sortes de difficultés. Lotbinière Harwood, à la suite d'une inspection du 65e Bataillon (Montréal), en décembre 1873, note qu'il lui est « impossible de donner des points au mérite. Le tir à la cible n'a pas été convenablement pratiqué... le 65e Bataillon n'a consommé qu'un très petit nombre de cartouches ». Pour obtenir leur argent, les unités doivent réussir l'inspection. Dans les campagnes, on réunit les hommes en vitesse, les capitaines sortent d'un endroit imprévisible (souvent une grange ou une cave) les armes que chacun s'astreint à faire briller au dernier moment. L'officier inspecteur, mis dans une position difficile, recommande le paiement qu'au fond il ne savait pas mériter. Mais, s'il est soucieux de ses devoirs, regarde les canons, les trouve rouillés à l'intérieur, fait défaire une platine qui fonctionne mal, on lui dit que s'il est si particulier, on ne pourra jamais maintenir des corps volontaires. D'Orsonnens, désabusé, d'ajouter que ceux qui critiquent ainsi les inspecteurs sont des officiers qualifiés par la loi, et entendent bien, avec l'allocation du gouvernement, dépenser le moins possible pour l'entretien de nos armes ; ils se donnent en général peu de peine pour exercer et instruire leurs soldats.
Quelques-uns d'entre eux seulement passent par les écoles militaires ce qui, on en conviendra, n'en fait pas automatiquement des instructeurs sachant transmettre leur savoir surtout à des hommes qu'ils ont souvent enrôlés en les amadouant. D'ailleurs, plusieurs de ceux qui vont à l'école militaire se contentent d'empocher la prime d'après-cours et disparaissent. Selon Gravel, qui a étudié à fond cette question, environ 75 pour cent des officiers de la milice volontaire non permanente ignorent plus ou moins complètement la chose militaire au milieu des années 1870. Après 1883, cet état de fait s'améliore sensiblement, mais cela n'ajoute guère à l'efficacité des unités. En effet, on s'attend à ce que l'unité urbaine s'entraîne deux fois par semaine, de 19 h à 22 h, durant les deux ou trois mois précédant l'inspection annuelle. Il y a aussi une journée de tir et un ou deux défilés à l'occasion de services religieux. En pratique, les effectifs sont souvent levés au dernier moment, de sorte que plusieurs volontaires n'ont même pas été assermentés lorsque se tient l'inspection annuelle. Bien sûr, quand la désorganisation est vraiment trop criante, on refuse l'exercice à l'unité (donc, la paie à ses officiers et à ses hommes). C'est ainsi que nombre de compagnies, et même de bataillons, disparaissent durant quelques années avant de renaître sous la poigne énergique d'un nouveau commandant ambitieux.
Les camps d’instruction
En plus de l'instruction au niveau de l'unité, il y a celle offerte dans les camps. À la suite de la loi de 1868, on s'est lancé avec force dans cette direction. Mais comme les budgets sont restés à peu près stables, et que les charges se sont accrues, conséquence, entre autres, de la naissance des Batteries A et B en 1871, il a fallu couper certaines activités. C'est ainsi qu'entre le ler juillet 1873 et le 30 juin 1874, les unités sont forcées de s'entraîner à leurs quartiers généraux respectifs, plutôt qu'en brigades et en camps, comme cela avait été le cas depuis 1868, ce qui fait dire à certains que l'on a commencé par où l'on aurait dû finir. En principe, on doit y faire 16 jours d'exercice d'au moins de trois heures chacun. Le reste des années 1870 ne sera guère propice aux grands rassemblements, surtout utiles aux corps ruraux.
Même lorsqu'il y a un camp, quelle est sa valeur réelle ? Après celui de 1872, du 6e District militaire, un des plus importants à se tenir jusqu'au XXe siècle, le lieutenant-colonel A.C. Lotbinière Harwood écrit à son supérieur que, malgré le succès rencontré, « ... il est de mon devoir de vous informer que la plupart des corps volontaires actuels pourraient à peine compter sur les deux tiers de leur effectif, en cas de nécessité immédiate ; et, dans plus d'une localité, il ne serait pas prudent, à cause de la population flottante, de compter même sur la moitié des hommes régulièrement enrôlés. » La situation est souvent pire que ce que ce rapport nous laisse entendre. En effet, sur les listes d'une compagnie on comptera souvent les absents pour cause de maladie ou autres raisons. Le nombre des absents peut être relativement élevé. Ceux-ci reçoivent pourtant la même solde que les autres. Cela rend aléatoire l'étude des statistiques concernant les camps, sans compter la démotivation que cette situation peut causer parmi ceux qui y participent vraiment. Pour donner un exemple, en 1882 le district de Québec déclare 1 706 miliciens exercés alors que seulement 1 049 sont présents, soit une différence de 657 hommes ou de 38 pour cent. Or, à l'échelle du pays, ce n'est guère mieux. Pourquoi cela ? Le major de brigade perçoit 8 $ par compagnie présente, il hésite donc à licencier celles comptant moins de 30 hommes sur le terrain. Un bataillon, en 1870, compte 125 présents pour 363 exercés. Bien qu'à partir de 1878, et avec le paiement de salaires fixes aux officiers d'état-major, ce genre d'abus tende à diminuer, la différence entre le nombre d'individus présents aux camps et ceux qui s'y sont véritablement exercés restera grande durant tout le XIXe siècle.
Si, au moins, le service de trois ans existait véritablement, les miliciens « exercés » seraient d'une certaine utilité pour les années subséquentes. Mais, les miliciens ne servent vraiment que la première année, leur défection relevant de divers facteurs. Dans les villes, c'est une population très mobile qui s'enrôle. Dans les campagnes, un chef de corps, voulant conserver sa popularité auprès de ses hommes et ses relations politiques, ne fera rien face à l'abandon, après une seule année de service, d'un contrat de trois ans.
Effectifs voluntaires et miliciens « exercés » en 1880. Renseignements portant sur le nombre de miliciens exercés dans les Corps urbains et les Corps ruraux dans quelques provinces en 1880.
Gravel a compilé des chiffres révélateurs, à ce sujet, pour l'année 1880 qui est une « bonne » année. On estime qu'entre 1876 et 1898, on a instruit en moyenne 18 500 soldats annuellement. Ce chiffre doit être tempéré par les exceptions que sont les hommes payés mais non « exercés ». Parmi ceux-ci, on peut inclure les musiciens et clairons, des sous-officiers qui sont présents en surnombre et ne font rien, les signaleurs et les ambulanciers (pour les bataillons urbains). Dans les bataillons ruraux, les domestiques des officiers, valets d'écurie, garçons de table, cuisiniers, etc.ne ne le sont pas. Du coup, l'instruction est réellement prodiguée à environ 14 000 hommes par année.
Cela dit, les ordres généraux qui régissent les camps .sont de petits chefs-d'œuvre de prévision et de prévoyance, signale cyniquement le lieutenant-colonel d'Orsonnens. C'est un fait que des directives pleuvent quant à l'organisation d'un camp, au transport pour s'y rendre ou en revenir, au genre d'instruction qui sera offert, la discipline (pas d'habits civils, la question des congés ou des permissions de nuit, par exemple).
Effectifs voluntaires et miliciens « exercés » en 1880. Renseignements portant sur le nombre de miliciens exercés dans les Corps urbains et les Corps ruraux dans quelques provinces en 1880.
Gravel a compilé des chiffres révélateurs, à ce sujet, pour l'année 1880 qui est une bonne année. On estime qu'entre 1876 et 1898, on a instruit en moyenne 18 500 soldats annuellement. Ce chiffre doit être tempéré par les exceptions que sont les hommes payés mais non « exercés. Parmi ceux-ci, on peut inclure les musiciens et clairons, des sous-officiers qui sont présents en surnombre et ne font rien, les signaleurs et les ambulanciers (pour les bataillons urbains). Dans les bataillons ruraux, les domestiques des officiers, valets d'écurie, garçons de table, cuisiniers, etc.ne ne le sont pas. Du coup, l'instruction est réellement prodiguée à environ 14 000 hommes par année.
Cela dit, les ordres généraux qui régissent les camps.sont de petits chefs-d'œuvre de prévision et de prévoyance, signale cyniquement le lieutenant-colonel d'Orsonnens. C'est un fait que des directives pleuvent quant à l'organisation d'un camp, au transport pour s'y rendre ou en revenir, au genre d'instruction qui sera offert, la discipline (pas d'habits civils, la question des congés ou des permissions de nuit, par exemple).
Lieutenant du 4th Regiment of Cavalry vers les années 1880 à 1890. Le 4e Régiment de la Cavalerie était une unité de la milice de l'Est de l'Ontario. Leur quartier général se situait à Prescott. En 1892, ils devinrent le 4e Hussards. La plupart des régiments de la cavalerie canadiens portaient des uniformes semblables au 13e Hussards britannique. Pour les officiers (la photo montre un lieutenant) la tunique bleue ainsi que la culotte étaient lacées d'une bordure dorée, et d'une bordure jaune pour les autres rangs. Les parementures, de couleur chamois, étaient si pâles qu'elles paraîssaient blanches. Toutefois, la coiffe des unités canadiennes étaient restreintes au casque colonial blanc ou du calot bleu. La reconstitution par Barry Rich.
Au fond, ce qui devrait choquer le plus, dans tout ce qui précède, c'est que la défense du pays repose beaucoup sur les unités rurales, les plus faibles de toutes. En 1891, l'officier général commandant, le major général Ivor Herbert écrit encore : L'instruction des unités rurales est très défaillante, mais leur organisation l'est encore davantage. Et ce qui y est fait n'est pas toujours efficace. Ainsi, le 7e District réunit ses unités à Rimouski, du 15 au 26 septembre 1891, plutôt qu'à Lévis, comme on l'avait fait jusque-là. Cela signifie que les bataillons de Trois-Rivières et de Lévis, entre autres, se déplacent à des dizaines de kilomètres plus loin que nécessaire. De plus, le lieu retenu à Rimouski n'est pas aussi satisfaisant que celui de Lévis. Cela dit, les bataillons du Bas Saint-Laurent sont mieux desservis en ce qui a trait aux distances.
Les lacunes de la milice
Manège militaire de l'avenue University, Toronto, 1909. Au début des années 1870, le gouvernement construisait des manèges militaires pour l'entraînement des volontaires. Sur la carte postale de l'avenue University à Toronto, en 1909, le manège militaire avait comme architecture une ressemblance aux fortifications médiévales. L'édifice a ouvert ses portes en 1891 et a été démoli en 1963, pour créer de la place pour un palais de justice. Lors de sa construction, le manège militaire était le plus gros édifice du genre au Canada. Il fut utilisé pour des foires, des événements sociaux et des exercices militaires.
En 1896, c'est au tour du major général WJ. Gascoigne, qui a succédé à Herbert en 1895, d'avancer qu'aucune troupe n'est prête à entrer en campagne. On a bien fait des réformes au fil des années : par exemple, sous Herbert, les écoles militaires ont été formées en régiments, on a choisi des sites permanents pour les camps annuels, on a mis sur pied un service de santé et des camps de qualification de six semaines pour les officiers et sous-officiers. Mais, on n'a toujours pas de magasins militaires et, en général, la milice est désorganisée et démoralisée ! Pourtant, la population semble satisfaite de ses forces de défense. La solde annuelle des miliciens est devenue une allocation très favorablement acceptée, en particulier dans les districts ruraux. Déjà, la Défense joue un rôle reconnu et apprécié dans l'économie régionale.
Un des rares avantages de la milice volontaire non permanente est qu'elle permet de reconnaître les hommes de bonne volonté. Mais, nous avons déjà remarqué plusieurs désavantages, et il y en a encore plus. La force de défense manque non seulement d'arsenaux, mais elle est aussi sujette aux pertes d'uniformes et d'équipements. Par ailleurs, elle n'accorde pas assez de pouvoir à l'état-major qui pourrait entacher l'autorité de plusieurs politiciens jouant au militaire dans leur communauté, sans parler de l'abus des grades.
En outre, charges et sacrifices sont imposés au volontaire. Ainsi, s'il rejoint son unité pour maintenir l'ordre public en lieu et place d'une police inexistante ou trop faible, il attendra des mois avant d'être payé. S'il part en campagne durant des semaines ou des mois, son employeur ne lui garantira pas toujours son emploi au retour. De plus, il laissera sa famille à des agences d'aide publique formées à la hâte pour l'occasion. S'il lui arrive malheur, la pension aux siens n'est pas assurée. Sans parler des réorganisations continuelles qui font passer les bataillons d'une brigade à l'autre ou d'un district militaire à un autre, qui font disparaître ou réapparaître des grades, qui effacent ou redonnent vie à des unités sans que personne ne sache trop bien à quoi répondent ces changements.
Caserne d'infanterie canadienne, vers 1890. Aperçu rare de la vie en caserne un soir en hiver dans une caserne d'infanterie canadienne, environ 1890. Dans une caserne d'infanterie, quelques hommes nettoient soit leur trousse, le sol, ou un fusil Snider-Enfield dans une caserne d'infanterie. L'ameublement comprend un lit pliant britannique en fer, table faite avec des jambes de fer, ainsi qu'un four qui était indispensable pendant un hiver canadien.
À l'époque, ceux qui se penchent un tant soit peu sur cette question en font toujours un constat détaillé assez négatif. Lorsqu'il s'agit d'imaginer une agression à laquelle le pays devrait faire face, on ne peut pas être très optimiste. Dans la revue américaine Journal of the Military Service Institution, un correspondant étranger anonyme, à l'évidence canadien, décrit un plan de mobilisation de la Milice canadienne qui serait soudainement chargée de la défense de la frontière entre Québec et Détroit. Dans les numéros 29 et 30 (mars et juin 1887), il explique qu'il faudrait disposer de 150 000 hommes, mais que l'on est bien loin de pouvoir en mobiliser un tel nombre. Et encore faudrait-il que la cause soit populaire, aussi bien auprès des francophones que des anglophones. Bien que cette évaluation se termine sur des aspects positifs, le long article laisse entendre que Montréal, le cœur industriel et économique du pays, serait à peu près indéfendable.
Les améliorations recherchées par les officiers généraux commandants
Y a-t-il des solutions ? On en propose en effet, surtout chez les officiers généraux et commandants successifs qui, au fil des années, parviennent à améliorer lentement le tout, en fondant leurs efforts sur la force permanente autant que le leur permet leurs ministres.
Des miliciens canadiens avancent aussi des solutions. Retenons celles proposées dès 1874 par le lieutenant-colonel Gustave d'Odet d'Orsonnens, qui occupera de nombreux postes au cours de sa carrière dans la Milice volontaire permanente, dont celui de commandant de l'école militaire créée à Saint-Jean, en 1883. Selon lui, les écoles du moment (peu nombreuses en 1874) devraient être remplacées par des régiments permanents au sein desquels tout aspirant à un grade dans la Milice volontaire non permanente devrait servir trois mois, dans l'arme qu'il a choisie. Cela sera plus ou moins appliqué dans les années 1880 et 1890, par une série de réformes qui prennent racine dans la loi de 1883.
D'Orsonnens désirerait également une armée régulière de quelques corps d'armes spéciales dont les capitaines pourraient être brevetés lieutenants-colonels de milice et commandante de régiments de miliciens en service actif. L'armée serait en quelque sorte une école d'état-major, dont les officiers formeraient l'état-major de la Confédération. En temps de paix, cette armée pourrait exécuter de grands travaux publics. Quant à la milice, elle reposerait sur la conscription, sauf dans les villes où l'on pourrait avoir des corps de volontaires qui s'enrôleraient pour une durée de quatre ans, avec des périodes annuelles d'instruction de 10 à 14 jours.
Ces milices volontaires seraient divisées proportionnellement entre les différentes régions du pays, mais comme les « volontaires » seraient conscrits, les bataillons seraient complets avec un effectif total de 15 040 hommes pour le pays (en 1874). Les deux premières années de leur service, ces miliciens s'entraîneraient dans leurs quartiers généraux respectifs, la troisième, il y aurait un camp au niveau de la brigade et, la quatrième, se tiendrait un camp au niveau de la division.
D'Orsonnens avançait surtout la représentation proportionnelle, proposant 82 divisions régimentaires en Ontario (avec 6 560 hommes) et 70 au Québec, avec 5 600 hommes - et à l'avenant pour le reste du pays. Selon lui « Assurer à chaque Province ses droits à fournir son contingent serait un acte de politique juste et raisonnable... mais assurer par une constitution bien ordonnée les droits de ses concitoyens (nationaux) serait remplir de plus un devoir sacré vis-à-vis de sa nationalité. C'est pourquoi il faudra maintenir les cadres (sic) de l'armée dans les proportions ci-haut (sic) données ; c'est une garantie pour l'avenir de chaque Province.
La place des francophones. La participation des francophones dans la milice
Tunique de l'Infanterie de la Milice volontaire canadienne, 1870-1876. La tunique de grande tenue fut le seul manteau d'uniforme à être distribué aux volontaires canadiens au 19e siècle. La coupe ressemble à la tunique britannique. Vers les années 1870, l'Armée britannique à modifier leur uniforme, afin d'avoir des tenues pour les événements de campagnes divers. La décoration que l'on aperçoit sur les manchettes de ce manteau est peu commune, car la plupart des unités avaient la décoration nommée le « noeud autrichien », tandis que celui-ci a seulement un point simple. Toutefois, l'on connaissait les variantes de ces noeuds. Ce manteau se retrouve dans la collection canadienne du Musée de la guerre.
Il y a déjà, en effet, un problème francophone au sein du système de défense canadien. Avec environ 35 pour cent de la population canadienne, jusqu'en 1914, les francophones n'occupent que 20 pour cent des effectifs militaires et autour de 10 pour cent des postes d'officiers (selon les années). Entre 1876 et 1898, le RMC forme une dizaine d'officiers francophones sur les 255 qui y ont obtenu une commission (4,7 pour cent). En consultant la Militia List of the Dominion of Canada, pour 1888, on note les chiffres qui apparaissent dans le tableau ci-dessous, pour les officiers de la Milice permanente.
« Nous n'avons pas la proportion d'officiers que nous pourrions réclamer », conclut là-dessus un admirateur du ministre Adolphe Caron. Et d'ajouter : « Mais cela n'est la faute ni du ministre, ni des officiers, mais bien du fait que nos gens ne donnent pas au service militaire toute l'attention à laquelle il a droit. »
Dans le 6e District militaire (Montréal) on ne trouve, entre 1868 et 1873, aucun officier canadien-français dans l'artillerie ou le génie. Pourtant, en 1871, alors que le péril fenian est encore présent et que George Étienne Cartier est ministre de la Milice et de la Défense, le colonel Robertson Ross, adjudant général de la Milice, estime que plus de 2 000 des 5 310 hommes [officiers compris] des 5e et 6e Districts militaires, en entraînement au camp de Laprairie, sont francophones. Par la suite, les États-Unis ne sont plus aussi menaçants. Et, partout au Canada, comme on l'a vu, la milice voit sa place décroître, de même que les budgets, durant une dizaine d'années.
Soldat du 65th Battalion (Mount Royal Rifles) vers 1880 à 1885. Ce battaillon de Montréal portait un uniforme vert foncé, inspiré du régiment des armes à feu à canon britannique. Au cours des années 1880, le 65e Bataillon a retenu le shako d'inspiration française, abandonné par les régiments des carabiniers britanniques vers 1870. Le 65th Battailion (Mount Royal Rifles) n'a pu avoir le titre français qu'en 1902, alors qu'ils prirent le nouveau nom de « 65th Regiment Carabiniers Mont-Royal ». Les bataillons carabiniers portaient de l'équipement noir (au lieu des équipements blancs des autres infanteries). Sur cette photo, un homme tient une carabine courte Snider à deux anneaux de fixation « Mark II ». Cette carabine fut émise aux unités carabiniers, ainsi qu'aux sergents de l'infanterie. En 1885, le 65th Battailion combattirent avec l'« Alberta Field Force » du major-général Strange contre les Cris à Frenchmen's Butte. La reconstitution par Ronald B. Volstad.
Parallèlement, la tradition britannique s'implante avec de plus en plus de force. Après avoir refusé les unités de Zouaves durant la menace feniane (ce qui n'est guère encourageant pour les francophones qui les avaient proposées), tout est concocté en fonction du centre de l'Empire : les uniformes, les règlements militaires et les échanges d'officiers et d'instructeurs. Dans le Rapport de la Milice de 1878, Selby Smyth rappelle que le gouvernement britannique approuve, voire « désire l'assimilation sous tous les rapports de la milice canadienne avec l'armée anglaise ». Les officiers généraux commandants travaillent à faire avancer cette cause.
Dans l'armée régulière, qui fournit l'instruction aux miliciens non permanents, se trouvent beaucoup d'anciens militaires britanniques qui ont choisi le Canada à la fin de leur contrat avec l'armée britannique. La langue de travail est l'anglais. On commande en anglais et la correspondance échangée entre deux francophones est rédigée en anglais. Les exercices annuels se tiennent aussi en anglais, ce qui crée des problèmes pour les nombreux unilingues francophones. Au moment des camps, les traductions improvisées à l'intention des francophones unilingues ralentissent leurs progrès. Quant aux officiers francophones, pas plus compétents militairement que leurs collègues anglophones, ils parlent plus ou moins bien l'anglais, ce qui les frustre dans leurs efforts. Les traductions des manuels sont rares et toujours en retard. Comme la milice n'intéresse guère les gouvernements (sauf quand ils en ont besoin), chacun apprend vite à se débrouiller seul. Louis-Timothée Suzor a traduit, à ses frais, un livre d'exercices paru en 1863 et remplacé dès 1867. Ce dernier ne sera pas traduit jusqu'à ce qu'un autre Field Exercice prenne la relève, en 1877. En 1885, celui-ci est traduit par David Frève, à sa propre initiative. Mais, dès 1888, les Britanniques lancent une série de nouveaux manuels qui ne seront toujours pas accessibles en français en 1914. S'il y a traduction, l'officier francophone doit payer le livre, alors que son collègue anglophone reçoit le sien gratuitement et dans sa langue. Tout cela conduit à des difficultés ainsi qu'à l'introduction, dans le français du militaire francophone, d'une foule de termes anglais mal assimilés. Par-dessus tout, cette situation sert de repoussoir au francophone.
Au niveau des officiers de la Milice non permanente (qui deviennent des instructeurs, ne l'oublions pas), les choses se compliquent encore plus. Dans un premier temps, les cours sont en anglais. Puis, à compter des années 1880, les bataillons ouvrent souvent leurs propres écoles avec des cours obligatoires, pour les officiers, sanctionnés par des examens de district. Ainsi peut-on enseigner un peu dans la langue de l'individu les rudiments d'une profession qui, en pratique, ne s'exerce vraiment qu'en anglais.
Pourtant, entre 1867 et 1898, les ministères de la Milice et de la Défense aura trois ministres francophones (18 des 31 années). Entre 1868 et 1898, le poste de sous-ministre sera aux mains de francophones (en fait, ce sera le cas jusqu'en 1940). Il faut se poser des questions quant à la véritable volonté de ces hommes de faire avancer la cause de leur langue dans la Milice. Pour les seules traductions des livres d'exercices, cela a pris des années de pression du ministre pour obtenir de l'officier général commandant la permission de publier le travail de Frève.
Officiers de la Milice permanente en 1888. Ce tableau présente des renseignements sur les officiers francophones et anglophones dans les unités divers de la Milice permanente canadienne.
Le contexte social et économique des francophones
Selon d'Orsonnens, une autre raison, au moins, milite contre la participation des francophones. Lorsqu'il a demandé à certains des siens pourquoi ils ne formaient pas autant de compagnies de volontaires que les Canadiens d'autres origines, on lui a répondu : C'est bon pour les Anglais, ils sont riches, nous, nous sommes pauvres, nous ne pouvons perdre ainsi volontairement notre temps, on nous retrancherait nos crédits ; qu'on nous force, nous subirons la loi comme les autres ; bien plus, nous la subirons avec plaisir.
Ce que l'on retrouve dans cette réponse c'est, en résumé, le message de conscription que d'Orsonnens développe plus longuement ailleurs et, en ce sens, nous ne devrions pas la prendre au pied de la lettre. Tout de même, on peut conclure que le Canadien français, qui s'enrôle dans les conditions défavorables décrites, possède un sens du devoir militaire bien au-dessus de la moyenne. Cela dit, le problème central de la sous-représentation des francophones au sein de la défense canadienne, dès les débuts de la Confédération, aura des répercussions majeures plus tard. Personne ne semble vouloir s'attaquer à cette question pendant qu'il en est encore temps.
Menaces intérieures et extérieures
La toile de fond de la rébélion du Nord-Ouest
Entre 1871 et 1898, l'événement qui va marquer le plus fortement la jeune force de défense canadienne ne sera, sans contredit, constitué par la seconde rébellion métis qui, au printemps 1885, secoue les Territoires du Nord-Ouest. Cette crise est provoquée par des conditions à peu près semblables à celles qui prévalaient en 1870 dans la région de la rivière Rouge. Les germes du conflit sont semés dès 1872 quand, négligeant les Métis, des émissaires gouvernementaux signent un traité avec les autochtones de la région de Qu'Appelle.
Suivent bientôt des arpenteurs qui se mettent à fractionner les grands espaces libres en terres à coloniser. De 1878 à 1884, les Métis expédient à Ottawa des dizaines de requêtes réclamant la reconnaissance de leurs droits sur des terres qu'ils occupent parfois depuis plus d'une génération. Rien n'y fait. Le premier bureau d'inscription des titres dans ces territoires ouvre à Prince Albert en 1881, alors qu'au Manitoba de nombreux différends et cas de fraude entourent toujours les ententes de 1870.
Cette situation exacerbe les Métis, dont plusieurs ont reflué du Manitoba vers l'ouest devant l'envahissement des terres par des colons qui menaçaient leur mode de vie. Au mois de mai 1884, le Conseil des Métis de Batoche tient une réunion au cours de laquelle son chef, Gabriel Dumont, fait adopter une résolution invitant Louis Riel à venir se porter à la défense de ses frères.
Marié, Riel vit alors au Montana, où il enseigne à la mission Saint-Pierre. Les délégués des Métis de la Saskatchewan débarquent chez lui le 4 juin. Cinq jours plus tard, Riel démissionne de son poste et, le lendemain, il prend la direction du nord. Le Riel de 1884 est plus exalté qu'autrefois. Il croit désormais que lui incombe la mission de conduire Métis et Indiens et de faire en sorte qu'ils soient unis en un seul peuple.
Entre le moment où il arrive à Batoche et la fin de l'hiver, en 1884-1885, le silence d'Ottawa devant les réclamations des Métis a nourri un climat d'agitation qui atteint son paroxysme au moment où, de retour de Winnipeg, un employé de la Compagnie de la baie d'Hudson, annonce aux Métis que des policiers déterminés à écraser leur fronde et à mettre Riel aux fers sont en route. Le 19 mars, lors du rassemblement traditionnel soulignant la fête de saint joseph, leur saint patron, les Métis se donnent un gouvernement provisoire présidé par Louis Riel et par un adjudant général, Gabriel Dumont. Batoche devient la capitale de ce gouvernement et, bientôt, le poste que les autorités gouvernementales canadiennes voudront abattre.
L'action est au programme de ceux qu'on désigne sous le nom de rebelles et qui tentent principalement d'obtenir l'adhésion des autochtones à une cause qu'ils veulent commune. Le succès de l'opération diplomatique est mitigé puisque très peu d'Amérindiens se joindront effectivement aux Métis. Désireux d'exercer le plein contrôle du terrain géographique, le gouvernement de Riel et de Dumont réclame, de la Police montée du Nord-Ouest, la cession des forts de Carlton et de Battleford. À ce stade, les pions sont tous en place pour que survienne la tragédie.
Le gouvernement provisoire veut s’imposer
Fort Pitt, poste de la Police montée du Nord-Ouest. Fort Pitt fut construit comme un poste de commerce et d'apprivisionnement pour la compagnie de la Baie d'Hudson en 1829. Par la suite la Police montée du Nord-Ouest pris possession du fort. Finalement, en 1885, c'est un détachement de vingt-cinq policiers, dirigé par l'inspecteur Francis Dickens (fils de l'auteur Charles Dickens) qui s'installa au Fort Pitt. Fort Pitt fut assiégé, lors des hostilités entre les Cris et le gouvernement canadien, en avril. La police Garrison abandonna le poste, en se réfugiant au Fort Battleford. Cette gravure contemporaine a été tirée du « Illustrated London News ».
Les policiers ne sont évidemment pas disposés à obéir aux rebelles. Le commissaire adjoint Lief N.F (Paddy) Crozier qui commande le poste de Carlton n'est pas homme à céder. De plus, il tient au contrôle du comptoir de traite du lac au Canard, situé entre Carlton et Batoche, où sont rassemblées provisions et munitions. Si, localement, l'enjeu revêt une certaine importance, il ne vaut guère une bataille mal préparée. On conseille à Crozier de ne pas bouger avant l'arrivée de renforts mais, poussé par quelques volontaires zélés, sûr de son bon droit et de sa force, il part à la tête de 55 hommes. Cette initiative lui coûtera cher.
Le 26 mars, alors qu'il marche vers le lac au Canard, qu'il sait être déjà sous contrôle métis, un parti de Métis dirigé par Gabriel Dumont lui tend une embuscade. Le combat est bref et violent, faisant 12 morts et 11 blessés parmi les policiers. L'effusion de sang surprend et déconcerte Riel qui s'oppose à ce que Dumont poursuive les policiers qui, dans la déroute, ont abandonné une partie de leurs morts, de leurs blessés et de leur équipement sur le terrain.
Louis Riel, 1870-1871. Cette image de Louis Riel fait partie d'une photographie des membres du conseil du gouvernement provisoire des Métis, 1870-1871.
La victoire de Dumont a lancé sur le sentier de la guerre plusieurs groupes amérindiens. Divisés, les policiers auraient pu être des victimes faciles. Le 28 mars, abandonnant le fort Carlton, ils se replient donc sur Prince Albert. Plus à l'ouest, dans la région de Battleford, d'autres membres des forces de l'ordre s'enferment dans leur poste avec la population blanche, livrant les environs à des groupes de Cris et de Pieds-Noirs. Plus à l'ouest encore, au lac à la Grenouille, des Amérindiens massacrent quelques colons.
Au début d'avril 1885, au moment où Ottawa constate enfin que le contrôle des opérations sur la rivière Saskatchewan Nord lui a échappé, le leader métis comprend que ses alliés autochtones ne sont pas entièrement sous son contrôle.
Le gouvernement canadien s’organise
Si Riel a changé, la situation qui prévaut dans l'ensemble de l'Ouest canadien de 1885 n'est plus celle qu'il a connue en 1870. Bien entendu, des aventuriers américains pourraient à nouveau envenimer le conflit, mais ces éléments perturbateurs sont moins menaçants que les Fenians qui, dans l'affaire de la rivière Rouge, n'avaient joué qu'un rôle mineur. Ce qui a vraiment changé se situe au niveau des moyens dont dispose le gouvernement canadien pour réprimer la rébellion. Le plus important est sans doute le chemin de fer dont l'efficacité a amplement démontré sa valeur militaire ailleurs dans le monde, notamment au cours de la guerre civile américaine et dans le conflit franco-prussien. La voie transcontinentale va devenir un élément déterminant dans la réaction d'Ottawa où l'on sait qu'il est désormais possible d'atteindre l'Ouest en quelques jours sans devoir circuler en territoire américain.
Le 23 mars, quatre jours après la proclamation du gouvernement provisoire de Riel, le premier ministre Macdonald réagit en confiant au major général Frederick Middleton, commandant de la Milice canadienne, la tâche d'organiser la contre-attaque. La milice locale est la première à recevoir l'ordre de se tenir prête à partir. Middleton est rendu à Winnipeg quand, le 27 mars, au lendemain du combat du lac au Canard, il part vers Qu'Appelle à la tête du Winnipeg Rifles. En quelques semaines, plus de 8 000 hommes venus du Québec et de l'Ontario seront rassemblés sous son commandement. Certaines des unités de l'Ouest marcheront sous le commandement du général Thomas Strange, premier commandant de la Batterie B et de l'école d'artillerie, qui s'est retiré près de Calgary, ou sous celui du colonel William Otter.
La stratégie de Middleton est simple : distribuer ses forces sur trois colonnes qui iront vers le nord. Le commandant dirige lui-même celle qui part de Qu'Appelle vers Batoche. Otter conduit sa colonne de Swift Current en direction de Battleford, pendant que Strange quitte Calgary vers la rivière Saskatchewan Nord dont il suivra ensuite le cours vers l'est.
La force conduite par Middleton. L’avance vers batoche
Bataille de Fish Creek, le 24 avril 1885. Cette estampe de la bataille de Fish Creek, le 24 avril 1885, fut tirée d'esquisses dessinées par un milicien de Toronto, qui faisait partie de la colonne du « General Middleton ». Cent cinquante Métis et Teton Sioux, dirigés par Gabriel Dumont, ont tentés de tendre une embuscade à neuf cent Canadiens, alors qu'ils arrivaient au ravin profond de Fish Creek. La Milice, très peu expérimentée, a passée la journée à tenter de bouger Dumont de sa position, mais sans succès. Même si c'était une impasse, les Canadiens ont reculé et cessé de se diriger vers Batoche pendant deux semaines. Les personnages en vert sont du 90th Winnipeg Battalion of Rifles, tandis que ceux en rouge sont du 10th Battalion Royal Grenadiers (ils n'ont pas vraiment participés à la bataille).
La confiance entretenue par le général Middleton à l'égard de ses soldats-citoyens est limitée, sans doute parce qu'il connaît les défaillances de la formation dispensée à la plupart d'entre eux, l'expérience militaire des autres n'ayant d'assises que dans leur bonne volonté. Avant leur départ, ses troupes reçoivent donc un minimum d'entraînement obligatoire. Plusieurs miliciens exécutent dans ces circonstances leur premier tir d'exercice avec des armes souvent mal entretenues, mal entreposées ou depuis longtemps inutilisées. La compétence et l'expérience des hommes détachés auprès d'Otter et de Strange sont équivalentes et fort peu rassurantes.
Canon de 9 livres, lors de la bataille de Fish Creek, le 24 avril 1885. Cette photo, d'une arme de l'A Battery, Regiment of Canadian Artillery, fut prise lors du combat à Fish Creek, le 24 avril 1885. Le capitaine James Peters de la Batterie A, amateur de la photographie, avait apporté sa caméra dans le Nord-Ouest. Il semblerait qu'il aurait pris les premières photos de l'histoire d'une bataille.
La progression de Middleton vers Batoche est très lente. Méfiant, le général britannique a présent à la mémoire le sort réservé au lieutenant-colonel américain George Armstrong Custer, à Little Big Horn, en 1876, par des Indiens. La leçon servie tout récemment à la troupe de Crozier est bien vivante. Lorsqu'on lui rapporte que les Métis sont retranchés de chaque côté de la Saskatchewan Sud, il fait traverser le cours d'eau à près de la moitié de ses troupes, s'écartant encore plus d'un principe de guerre qu'il a déjà mis à mal avec sa formation en trois colonnes : celui de la concentration des forces. Ce n'est pas toujours une erreur d'agir comme il le fait mais, dans le cas présent, c'en est une. Le 24 avril, la troupe qui a marché du côté est de la rivière, celui où s'élève Batoche, est embusquée à l'Anse-aux-poissons. Après avoir subi quelques pertes, Middleton commande une retraite et une pause qui durera deux semaines.
La bataille de Batoche
Gabriel Dumont, commandant militaire des Métis en 1885. Gabriel Dumont (1837-1906) était une personne de tactique brillante. Les historiens concèdent, généralement, que si Dumont avait contrôlé pleinement les opérations des Métis en 1885, les volontaires canadiens auraient eu une campagne beaucoup plus difficile. Cette photo date probablement de la période où Dumont voyageait avec le spectacle « Buffalo Bill's Wild West Show », après la Rébellion.
Pendant ce temps, Riel expédie un message à ses alliés autochtones pour qu'ils le rejoignent à Batoche ou se dessine un affrontement décisif. Ceux-ci mettent peu d'empressement à répondre, si bien qu'au début du mois de mai, Middleton, qui a réuni tout son monde du côté est de la rivière, peut reprendre son avance. Son action est mieux préparée. Ses forces ont été regroupées et elles ont reçu une formation complémentaire. La logistique a été renforcée par l'utilisation d'un petit vapeur qui, posté devant Batoche, servira d'appui-feu aux miliciens qui attaqueront les positions terrestres des Métis. À compter du 10 mai, Batoche est assiégée et les troupes fédérales s'installent dans une guerre de position qui frustre beaucoup de miliciens conscients de disposer de la force du nombre et de la puissance des armes, des canons, une mitrailleuse Gatling et des centaines de fusils. Quand les coups de feu diminuent, on comprend que les Métis sont à court de munitions. Le 12, incapables de supporter plus longtemps l'inaction, deux régiments suivent leurs colonels à l'attaque : les retranchements et le village cèdent facilement. L'ensemble de l'opération a coûté 12 morts et 3 blessés aux Métis. On compte 8 morts et 46 blessés parmi les hommes de Middleton.
À l'heure des bilans, Louis Riel et Gabriel Dumont ne sont plus avec les leurs. Le 15 mai, ayant refusé de suivre Dumont dans un autre exil américain, le premier s'est rendu.
Une maison métise brûle à Batoche, le 9 mai 1885. Tôt le matin du 9 mai 1885, lorsque l'Armée canadienne se rendait vers l'église à Batoche, une attaque a eu lieu, provenant de deux maisons à l'extérieur du village. Ce fut le premier geste de la bataille, d'une durée de quatre jours, à Batoche. La Batterie A a ouvert le feu sur le Régiment de l'artillerie canadienne, tandis que les tireurs d'élite métis ont fuis. La Milice mis le feu aux maisons, afin d'éviter d'être réutilisées comme cachette par les Métis. Le commandant de la Batterie A, un photographe amateur, a capturé la fumée dans cette photo, et il l'a nommée « Opening the ball at Batoche ». Les chevaux et les artilleurs peuvent être vus, l'autre côté de la clotûre à droite.
Bataille de Cut Knife Hill, le 2 mai 1885. Trois cent cinquante milices canadiennes, dirigés par lieutenant-canadien Otter, ont attaqués un camp de Cris des plaines, à l'aube du 2 mai 1885. Surpris, les Cris ont quand même livrés une dure bataille sous le chef de guerre, Fine Day. Alors que les Canadiens se sont retirés plus tard dans la journée, les Cris ont cessé leurs poursuites envers leurs adversaires, sous l'influence du chef Poundmaker. Quelques historiens croient qu'Otter et ses hommes, peu expérimentés, aient été sauvés du massacre.
Partis de Swift Current, situé à l'ouest de Qu'Appelle, Otter et ses hommes ont pris la direction du nord. Au cours de la troisième semaine d'avril, ils atteignent Battleford où ils assurent d'abord la sécurité des Blancs du village. La colonne pivote ensuite vers le sud-ouest où des éclaireurs ont repéré des maraudeurs autochtones responsables de meurtres et d'exactions à Battleford et aux environs. Avançant de nuit vers leur camp aménagé près de la colline du Couteau-cassé, Otter est découvert avant d'attaquer, perdant ainsi l'avantage de la surprise. Le 2 mai, au terme d'une journée d'un combat indécis, les militaires se replient sur Battleford.
Conduits par le chef Faiseur d'Enclos, qui suit les directives de Louis Riel, les autochtones prennent alors la route de Batoche. Le 14 mai, ils s'emparent d'un convoi de ravitaillement destiné à Battleford. À cette date, les Métis ont été battus à Batoche et, ayant compris que l'entreprise est sans issue, la troupe de Faiseur d'Enclos commence à se disperser. Après neuf jours d'un dangereux jeu de cache-cache, le chef amérindien arrive à Battleford où il rend les armes.
La colonne Strange. La marche et la poursuite de Big bear
Strange a quitté Calgary en direction de la rivière Saskatchewan Nord qu'il compte redescendre vers Battleford, complétant ainsi le mouvement de nasse ordonné par Middleton. À la fin du mois de mai, il atteint la Butte-aux-Français où il surprend les Cris. Le groupe de Gros-Ours relève rapidement la tête et se retranche en ce lieu qui domine les points stratégiques de la région, la rivière ainsi que Fort Pitt. S'ils veulent en découdre au corps à corps avec les 600 hommes de Gros-Ours, les miliciens de Strange doivent traverser un terrain marécageux et s'exposer. Au moment où, malgré une puissance de feu très supérieure à celle de l'ennemi, l'officier décide de retraiter, les Cris s'apprêtaient à faire de même. Le 1er juin, après avoir reçu les approvisionnements qui lui manquaient, Strange remonte à l'assaut pour découvrir que la Butte-aux-Français a été abandonnée. Les Cris ayant commencé à se subdiviser, Strange n'engage pas la poursuite. Deux jours plus tard, il est rejoint à Fort Pitt par près de 900 hommes conduits par Middleton. Ce dernier organise aussitôt la battue, mais il garde près de lui tous ses hommes, y compris ceux de la cavalerie légère, et avance à nouveau lourdement. Les chariots sur lesquels 120 soldats ont pris place s'enfoncent dans la terre à peine dégelée du nord de la Saskatchewan.
Ce mouvement ne produit aucun résultat. Le 4 juin, au lac au Canard, des cavaliers du colonel Sam B. Steele échangent quelques coups de feu avec des guerriers de Gros-Ours. Ce combat sera le dernier de la campagne, les Cris ayant choisi d'abandonner la lutte. La reddition de Gros-Ours aura lieu le 2 juillet suivant, près de Fort Carlton.
Les résultats de la rébellion
Ainsi, le feu de brousse allumé par l'insurrection a-t-il été circonscrit et éteint. Temporairement éclipsées par l'activité militaire, la loi et la politique vont recouvrer leurs droits. Après un procès et un jugement très controversés, Riel sera pendu, le 16 novembre 1885. L'événement provoque le premier schisme important entre le Parti conservateur et les Canadiens français dont bon nombre ont pris fait et cause pour les Métis et pour leur chef. En 1887, les Québécois retirent aux Conservateurs le gouvernement des affaires de la province et portent au pouvoir le nationaliste Honoré Mercier.
Le bilan de la campagne. Une victoire terne
Personnel et patients, de l'hôpital de campagne à Moose Jaw, en 1885. Un groupe de religieuses anglicanes de Toronto ont travaillé dans un hôpital, de quarante lits, à Moose Jaw, durant la Rébellion de 1885. Elles prirent soin des blessés et des malades, lors des batailles à Batoche et à Fish Creek. Douze femmes ont fait partie du premier groupe organisé d'infirmières dans l'histoire canadienne militaire. Notez le groupe des patients blessés, au centre, deux d'entre eux ayants perdu un bras.
Les Métis et leurs alliés autochtones étaient mal préparés et, par conséquent, incapables de rivaliser véritablement avec la force militaire rapidement déployée contre eux. Malgré quelques batailles bien menées et quelques victoires isolées, leurs chances de vaincre étaient presque nulles dès le départ.
Si le gouvernement célèbre ce triomphe militaire, il n'ignore pourtant pas que son indécision a nourri la tragédie qui vient de prendre fin. Dès l'instant où il réagissait au soulèvement des Métis, le Canada mobilisait 8 000 hommes dont 2 648 étaient affectés à la logistique. L'Ontario en fournissait 1 929, le Québec, 1 012, et la Nouvelle-Écosse, 383. Venus de l'Ouest, 2 010 miliciens et 500 gendarmes et membres de gardes civiles locales se joignaient à eux. Le 27 mars, les Batteries A et B et le 65e Bataillon des carabiniers de Montréal, première unité de milice mobilisée dans ce conflit, étaient appelés au combat. Le lendemain, la liste des unités participantes s'allonge, couvrant bientôt toutes les régions du pays.
Quant au ministre, sir Adolphe Caron, il se dépensa sans compter pour qu'un système de logistique et de transport reposant presque exclusivement sur l'entreprise privée soit mis sur pied. Le fait que la milice ait été mal préparée aurait inspiré cette solution où patronage et politique ont pu faire le meilleur des ménages. Le gouvernement paya une note salée, soit 4,5 millions de dollars, une somme remarquablement élevée en cette fin du XIXe siècle.
Presque rien n'avait été planifié en fonction d'une telle campagne. En quatre jours, on improvise les services de santé et d'approvisionnement militaires. On ne s'inquiète pas devant un armement de base disparate. On part en guerre avec des carabines et des fusils Snider, Winchester et Martini-Henry. On emporte, à l'avenant, trois types de munitions dont la distribution, à des unités parfois très éloignées les unes des autres, est problématique. Il arrive que ces munitions soient inutilisables ou manquantes. Ainsi, Strange atteint la Butte-aux-Français avec seulement 22 obus de canons. Le leadership est des plus faibles, mais Middleton attribuera sa lenteur et ses atermoiements à l'inexpérience de ses subordonnés auxquels il a refusé sa confiance, ce que ces derniers lui ont bien rendu. D'après le général, c'est lui qui a empêché que l'engagement de Batoche se solde par un échec. Mais on ne peut oublier qu'il ne sait ni utiliser ses forces montées, ni faire manœuvrer ses troupes, et que son attitude timorée est à l'origine du manque de mordant de ceux qui obéissent à ses ordres.
La revanche des métis
Confrontés à cette machine qui, face à un ennemi vigoureux, aurait été facilement battue, on trouve à peine 1 000 insurgés, dispersés, mal armés, manquant de vivres et de munitions. Le courage de la petite troupe de Batoche, qui se bat pour une cause perdue, surprend Middleton qui est également impressionné par la force de sa position ainsi que par l'ingéniosité et le soin investis dans la construction des tranchées-abris. La faiblesse du vaincu va temporairement permettre au vainqueur de pavoiser mais, une quarantaine d'années après les événements, la Société historique métisse prédit avec justesse que « le temps n'est pas éloigné où l'Ouest canadien saluera (les Métis de 1870 et de 1885) comme des précurseurs et des libérateurs».
Middleton va rendre compte de son expédition. Témoin, en 1885, au procès de Louis Riel, il comparaît, cinq ans plus tard, devant un comité spécial de la Chambre des communes pour répondre de ses actes en rapport avec la saisie, par la Police montée du Nord-Ouest, de fourrures appartenant à un Métis qui, à sa libération après les événements de Batoche, n'a pas pu en reprendre possession puisqu'elles avaient disparu. Sur la déclaration du plaignant, on remonte la filière jusqu'à Middleton qui, prétend-il, avait le droit de faire saisir les peaux que quelqu'un d'autre avait volées. Le comité déclare les saisies injustifiées et illégales et la conduite de Middleton dans cette affaire est décrite comme étant inqualifiable. Il quitte le Canada sous la réprobation quasi générale. Il n'est pas le premier des « héros » militaires canadiens à être jugé, à la fois pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire la campagne, et pour ce qu'il n'a pas fait, voler des fourrures. En 1896, les autorités britanniques lui confient la charge prestigieuse de gardien des joyaux de la Couronne, une « belle revanche contre ceux qui l'avaient chassé du Canada comme un voleur
Le 9e bataillon et la campagne du Nord-Ouest
Plusieurs bataillons ont, sous une forme ou sous une autre, témoigné de leur participation à la campagne du Nord-Ouest. Le 9e, de Québec, est l'archétype de ces troupes. Cette unité est commandée par Guillaume Amyot. Son entourage est principalement composé de Canadiens français dont les compatriotes ne sont pas favorables au combat mené contre les Métis de Louis Riel.
L'ordre de mobilisation du bataillon est reçu le 31 mars. Le 2 avril suivant, 236 hommes, dont 28 officiers, sont prêts à partir. Or, du 13 au 25 mars, le 9e Bataillon s'est entraîné avec 22 officiers et 336 soldats. Opinions politiques, études ou emplois privent le bataillon d'une centaine de miliciens qui ne le suivront pas sur la route de l'Ouest. Par ailleurs, le nombre d'officiers augmente avec l'ajout de fils de bonne famille. Au dernier moment, l'effectif intègre donc un fils du juge Adolphe Routhier, un du député provincial Joseph Sheyn, un du député fédéral P-B. Casgrain, et deux du sénateur Jean-Baptiste Fise
Dans le journal de marche qu'il a publié plus tard, le soldat Georges Beauregard rend compte de l'ambiguïté de la situation des soldats canadiens-français. « Le gouvernement, écrit-il, a décidé de déranger notre petite vie tranquille pour nous envoyer contre Indiens et Métis : il a ses raisons qui ne nous regardent pas, car nous ne faisons pas de politique et ne discutons pas les ordres des autorités militaires. ». Il n'en demeure pas moins que les volontaires se font rappeler par plusieurs de leurs connaissances qu'ils s'en vont « faire la guerre à nos frères, à des Français (sic) comme nous ... ». Cette perspective n'est pas très gaie et la création du comité d'aide aux familles des volontaires, formé de bénévoles, rappelle que l'armée fait bien peu pour ceux qu'elle envoie au combat.
Quant au voyage vers l'Ouest, il fournit amplement matière à réflexion. Les hommes sont entassés dans des wagons parfois ouverts. Là où la voie ferrée n'a pas été complétée, on les transfère sur des chariots et, au nord du lac Supérieur, ils subissent les désagréments d'un printemps qui se cherche à travers la chaleur, le froid et de fréquentes tempêtes de neige. Le 9e Bataillon n'a pas encore vu le feu que deux de ses soldats meurent, emportés par les rigueurs du voyage. L'un d'eux laisse dans le deuil une femme et plusieurs enfants dont le comité d'aide prendra la charge avant et même après le versement de la dérisoire pension gouvernementale.
La tâche du 9e Bataillon consiste essentiellement à assurer la sécurité des lignes de communications. Subdivisés en petites escouades, les hommes sont répartis entre Calgary et Fort McLeod ; pour tout abri, ils ont des tentes où peuvent dormir six soldats. Les Compagnies 3 et 4 s'établissent à Gleichen, Crowfoot et Langdon, postes situés le long de la voie du Canadien Pacifique. Dans ce secteur, elles rencontreront maintes fois les Indiens, dont elles voudront soulager la criante misère. Cette attitude incite l'historien Jean-Yves Gravel à comparer, assez justement, le rôle de cette unité à celui accompli depuis plus de 50 ans par les soldats canadiens au titre du maintien de la paix dans le monde. Faut-il s'étonner qu'après un voyage d'un mois pour atteindre Calgary et un séjour de deux mois dans des postes isolés, il ne se soit trouvé aucun volontaire du 9e Bataillon désireux de rester en garnison sur place ? Dans la plupart des autres unités, les hommes étaient également impatients de rentrer chez eux.
La campagne du Yukon
Soldat, The Royal Canadian Regiment of Infantry, uniforme d'hiver, vers 1899. Pour complémenter les uniformes d'hiver de l'Infanterie canadienne, les soldats avaient aussi accès à des chapeaux de fourrures, des écharpes, manteau d'hiver du style de l'armée britannique, mitaines et bottes chaudes.
À la fin du XIXe siècle, la découverte de métal aurifère au Yukon force les autorités canadiennes à prendre des mesures pour le maintien de la paix sur cette partie de son territoire où, on le sait, les choses peuvent facilement dégénérer. La ruée sauvage vers l'or de l'Oregon, vers 1840, a laissé des souvenirs. Déjà présente au Yukon, la Police montée du Nord-Ouest pourrait être rapidement débordée, en particulier si la gourmandise des expansionnistes américains incitait ces derniers à débattre de questions de juridiction territoriale. Aux yeux des responsables politiques canadiens, la protection du territoire doit reposer sur la force militaire : une unité de volontaires recrutés parmi la force permanente est donc rassemblée à Vancouver.
Le 14 mai 1898, ce contingent de plus de 200 personnes, soit près du quart de la force permanente totale, quitte cette ville à destination du Yukon. Six femmes, une journaliste, quatre infirmières de l'Ordre de Victoria et l'épouse de l'un des chefs de la Police montée en service au Yukon, se sont jointes au groupe. On se déplace en bateau et à pied à travers des chemins et des sentiers mal tracés sur un sol qui, même en été, reste gelé à quelque 50 centimètres sous la surface. Escortée par des nuées de moustiques, l'unité arrive à Fort Selkirk, le 11 septembre. Quelques semaines plus tard, l'un de ses contingents est dépêché à Dawson.
Au printemps suivant, la ruée ayant pris fin et la population du Yukon étant en décroissance, la moitié des hommes reprennent le chemin de Vancouver. En 1900, tous les volontaires sauf un, retenu jusqu'en 1901 pour témoigner à un procès, sont de retour chez eux. Ils sont remplacés, l'année suivante, par une unité de milice non permanente levée à Dawson City.
Grâce à cette action énergique et malgré quelques bavures insignifiantes, la ruée vers l'or du Yukon a été très ordonnée et, surtout, elle a contribué à imposer le principe de la souveraineté canadienne dans cette région peu fréquentée avant la découverte de l'or. Par exemple, en partant de Vancouver, l'expédition a utilisé une route d'accès qui, bien que très difficile et beaucoup plus lente que celle venant de l'Alaska, avait l'avantage d'être presque entièrement en territoire canadien. Pour le retour, on simplifiera toutefois les choses en utilisant le territoire américain 10 jours entre Fort Selkirk et Vancouver, plutôt que quatre mois à l'aller.
En cette occasion, pour la première fois - et cette situation ne se renouvellera pas avant un demi-siècle -, des troupes canadiennes se sont aventurées et ont hiverné au nord du 60e parallèle, où se situe pourtant le tiers de la masse continentale canadienne
Parmi les participants à l'expédition, l'on retrouve le capitaine Harry Burstall, qui deviendra major général et chef d'état-major de l'armée, ainsi que S.B. Steele, surintendant de la Police montée, présent lors de la campagne du Nord-Ouest et dont la carrière le conduira plus tard en Afrique du Sud.
L’aide au pouvoir civil
Entre 1867 et 1898, la milice intervient à 67 reprises pour soutenir le pouvoir civil et deux fois dans des pénitenciers. Convoqués par les autorités civiles locales, les soldats répondent avec plus au moins de bonne grâce, chacun devant alors délaisser ses occupations et renoncer à son salaire pour une période indéterminée. Par surcroît, jusqu'en 1879, alors que le gouvernement canadien verse aux villes l'argent requis pour le paiement rapide et complet des coûts, les soldats-citoyens savent que certaines villes qui demandent leur aide ne seront pas en mesure de les rétribuer. Aussi longtemps que les policiers n'auront pas été formés en corps solidement structurés, les miliciens seront appelés pour rétablir l'ordre : ils n'apprécient guère ce rôle.
Le rapport annuel de la milice de 1878 énumère les difficultés liées à ces interventions ponctuelles. « Des désordres se présentent souvent chaque année. La milice n'a pas les connaissances nécessaires, la police est trop faible, les miliciens sont obligés de combattre les gens du même coin du pays ; il faut une force militaire permanente. »
À elle seule, la formule du vote électoral à main levée provoque, entre 1867 et 1883, 13 émeutes réelles ou appréhendées, dont 11 au Québec seulement. Des modifications à la Loi électorale vont mettre un terme aux interventions de la Milice dans ce champ d'activité. Les querelles linguistiques, religieuses et scolaires, ainsi que les défilés annuels des Orangistes constituent autant de prétextes à un appel des troupes. Les événements les plus difficiles à gérer sont les grèves. Levée sur place, la force de contrôle est souvent formée d'hommes qui vivent à proximité du lieu des manifestations ou qui sont apparentés à ceux qu'ils doivent combattre. Généralement, les miliciens sont appelés après un premier assaut violent perpétré contre la personne où contre la propriété. Dans plus de 90 pour cent des cas, leur seule présence réussit à empêcher les débordements. L'absence de véritables corps policiers est à la base de la plupart de ces interventions.
L’expédition du Nil 1884-1885
L'aptitude des Forces armées canadiennes à agir à l'extérieur du territoire national se dessine en 1884, au moment où le major général C.G. Gordon est assiégé à Khartoum dans le Haut-Nil soudanais.
La Grande-Bretagne organise une expédition de secours dirigée par le général Garnet Wolseley. En 1881 et 1882, alors chef d'état-major de l'armée, il s'était farouchement opposé au vieux projet de construction d'un tunnel sous la Manche relancé avec force par des hommes d'affaires français et britanniques. Cette prise de position n'atteint en rien son aura de vainqueur de Ter-et-Kebir ou son titre de lord Wolseley du Caire. Au Canada, Wolseley a dirigé la campagne de la rivière Rouge. Il a gardé un bon souvenir des Canadiens qui ont permis aux troupes britanniques d'être approvisionnées durant la marche et le conflit de 1870.
Dès son déclenchement et pendant l'année qui suit, l'affaire soudanaise a des échos au Canada où des colonels se disent prêts à lever leurs régiments de milice pour aller combattre dans ce Haut-Nil lointain. Prudent, le gouvernement britannique prend le pouls du Canada par rapport aux heureuses dispositions des volontaires, mais il fait savoir que la Nouvelle-Galles, un État du sud de l'Australie, a offert un contingent. Le premier ministre John A. Macdonald peut facilement résister aux quelques zélés pressés d'aller à Khartoum même si, ce faisant, il déçoit les autorités britanniques et froisse quelques-uns de ses compatriotes.
Cependant, dès 1884, il consent à ce que les Britanniques recrutent au Canada quelques centaines de « voyageurs » qui aideront à la logistique des combattants remontant le Nil. Autrement dit, Wolseley, qui a été favorablement impressionné par ses Canadiens, entend leur faire jouer un rôle similaire à celui de 1870, mais sur une scène étrangère, sous un autre climat et pour une cause qui ne les regarde en rien.
Près de 400 Canadiens, dont un grand nombre ignore tout de la tâche qui les attend, vont signer un engagement de six mois : c'est que l'époque des voyageurs est déjà presque révolue en Amérique du Nord. Les volontaires qui iront là-bas ne porteront pas l'uniforme. Ils n'auront pas d'armes et ne participeront pas aux rares combats conduits par Wolseley. Quant à Gordon et ses troupes, ils seront anéantis avant même que les secours leur parviennent.
Quelques personnalités dignes d'intérêt se glissent parmi ces volontaires. L'une d'entre elles est le lieutenant-colonel Fred C. Denison, l'aide de camp de Wolseley, en 1869-1870. Il appartient à une famille qui, depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, alors que certains de ses membres sont encore dans la Réserve, a été de toutes les affaires militaires canadiennes. On remarque également la présence d'un aumônier catholique, le capitaine A. Bouchard, qui, ayant déjà été missionnaire à Khartoum, est disposé à y retourner pour servir d'interprète et veiller sur l'âme des soldats canadiens. Le sergent d'hôpital Gaston P Labat qui, un an plus tard environ, sera sur le Saskatchewan avec un frère de Fred C. Denison, accompagne le major T.L.H. Neilson, chirurgien-major de la Batterie B, lui-même vétéran de l'affaire de la rivière Rouge.
Les 386 Canadiens quittent Halifax le 14 septembre 1884. Quinze jours plus tard, ils débarquent à Gibraltar. En mer, l'un des hommes a succombé à la maladie. Le groupe atteint Alexandrie le 7 octobre puis, en train et en bateau à vapeur, dépassant Luxor et Assouan, ils parviennent enfin aux premières cataractes. En novembre 1884, nos hommes sont au travail. Le 1er décembre, l'expédition est à mi-chemin entre Khartoum et Alexandrie. À chacune des 14 cataractes, qui s'étendent sur 15 kilomètres et créent une dénivellation d'environ 40 mètres, les voyageurs canadiens sont en place, attendant l'arrivée de nouvelles troupes britanniques auxquelles ils font franchir ces obstacles. L'Iroquois Louis Capitaine et quelques autres perdront la vie dans ces épreuves de courage et d'endurance.
Un nouvel engagement de six mois, à compter du 6 mars 1885, a été proposé aux voyageurs, mais seulement 86 hommes, sous les ordres de Denison, l'acceptent. Pour les autres, la mission prend fin avant d'avoir véritablement commencé. Le 10 janvier, peu avant l'expiration de leur contrat, la plupart des Canadiens reprennent le chemin du retour et se dirigent vers Alexandrie où leur embarquement débutera en février.
L'expérience a permis aux volontaires canadiens d'observer ce que d'autres participants aux guerres britanniques remarqueront à leur tour : chez les Britanniques, le traitement réservé aux officiers et aux hommes de troupe est très différent. Comme les soldats anglais, ils ont été moins bien nourris que les officiers. Réagissant à cette injustice, un Canadien qui a osé ouvrir une boîte de fromage a eu droit à trois mois de prison. On prétend, parmi les Canadiens, que si un soldat anglais avait commis la même faute, il aurait pu écoper de cinq ans de travaux forcés.
En avril 1885, dans une lettre au Gouverneur général du Canada, Wolseley félicite les Canadiens. Au mois d'août, la Chambre des lords et les Communes britanniques appuient un vote de remerciement à leur intention. Tous les volontaires recevront la médaille spéciale britannique immortalisant cette expédition. Ceux qui auront renouvelé leur contrat y ajouteront l'agrafe de la bataille de Kirbekan, bien qu'ils n'y aient pas combattu.
Le Vénézuela et le Canada
L'appartenance du Canada à l'Empire britannique peut avoir d'autres répercussions. Ainsi en est-il du différend qui surgit, en 1895, entre l'Angleterre et le Venezuela, au sujet des frontières de la Guyane Britannique. Or, en 1895, Grover Cleveland, le président des États-Unis, semble disposé à prendre fait et cause pour le Venezuela, contre l'Angleterre. Poussée au pied du mur dans cette affaire, l'Angleterre pourrait décider d'entrer en guerre contre les Vénézuéliens. Pour le Canada, cette perspective signifie un possible affrontement avec les États-Unis qui pourraient bien être tentés d'envahir cette partie de l'Empire britannique.
Le gouvernement canadien réagit aussitôt en fonction de cette éventualité en investissant trois millions de dollars dans le réarmement. Les fusils Snider à un coup sont remplacés par 40 000 Lee Enfield .303 à répétition. On achète quelques mitrailleuses modernes et on refait l'armement de l'artillerie.
Même si cette crise n'a eu aucune conséquence violente, elle a pourtant incité les autorités gouvernementales à agir sous l'effet de la panique. Mauvaise conseillère en matière de gestion de crise et d'administration des affaires militaires du pays, la panique sera de plusieurs autres rendez-vous.
En 1897, pour la première fois depuis 1876, une période d'instruction annuelle de tous les régiments de volontaires devient obligatoire. Déjà, en 1896, les premiers plans de mobilisation des forces canadiennes en cas de guerre sont publiés. La Milice est organisée en divisions, brigades, détachements, etc., chaque unité se voyant assigner un centre de mobilisation. La composition des unités est secrète et la nomination des états-majors doit se faire au tout dernier moment, ce qui pourrait facilement causer de la confusion en cas d'urgence. Mais ce premier plan, malgré ses faiblesses, est important par son existence même.
Soldat, The Royal Canadian Regiment of Infantry, uniforme d'hiver, vers 1899. Pour complémenter les uniformes d'hiver de l'Infanterie canadienne, les soldats avaient aussi accès à des chapeaux de fourrures, des écharpes, manteau d'hiver du style de l'armée britannique, mitaines et bottes chaudes.
À la fin du XIXe siècle, la découverte de métal aurifère au Yukon force les autorités canadiennes à prendre des mesures pour le maintien de la paix sur cette partie de son territoire où, on le sait, les choses peuvent facilement dégénérer. La ruée sauvage vers l'or de l'Oregon, vers 1840, a laissé des souvenirs. Déjà présente au Yukon, la Police montée du Nord-Ouest pourrait être rapidement débordée, en particulier si la gourmandise des expansionnistes américains incitait ces derniers à débattre de questions de juridiction territoriale. Aux yeux des responsables politiques canadiens, la protection du territoire doit reposer sur la force militaire : une unité de volontaires recrutés parmi la force permanente est donc rassemblée à Vancouver.
Le 14 mai 1898, ce contingent de plus de 200 personnes, soit près du quart de la force permanente totale, quitte cette ville à destination du Yukon. Six femmes, une journaliste, quatre infirmières de l'Ordre de Victoria et l'épouse de l'un des chefs de la Police montée en service au Yukon, se sont jointes au groupe. On se déplace en bateau et à pied à travers des chemins et des sentiers mal tracés sur un sol qui, même en été, reste gelé à quelque 50 centimètres sous la surface. Escortée par des nuées de moustiques, l'unité arrive à Fort Selkirk, le 11 septembre. Quelques semaines plus tard, l'un de ses contingents est dépêché à Dawson.
Au printemps suivant, la ruée ayant pris fin et la population du Yukon étant en décroissance, la moitié des hommes reprennent le chemin de Vancouver. En 1900, tous les volontaires sauf un, retenu jusqu'en 1901 pour témoigner à un procès, sont de retour chez eux. Ils sont remplacés, l'année suivante, par une unité de milice non permanente levée à Dawson City.
Grâce à cette action énergique et malgré quelques bavures insignifiantes, la ruée vers l'or du Yukon a été très ordonnée et, surtout, elle a contribué à imposer le principe de la souveraineté canadienne dans cette région peu fréquentée avant la découverte de l'or. Par exemple, en partant de Vancouver, l'expédition a utilisé une route d'accès qui, bien que très difficile et beaucoup plus lente que celle venant de l'Alaska, avait l'avantage d'être presque entièrement en territoire canadien. Pour le retour, on simplifiera toutefois les choses en utilisant le territoire américain 10 jours entre Fort Selkirk et Vancouver, plutôt que quatre mois à l'aller.
En cette occasion, pour la première fois - et cette situation ne se renouvellera pas avant un demi-siècle -, des troupes canadiennes se sont aventurées et ont hiverné au nord du 60e parallèle, où se situe pourtant le tiers de la masse continentale canadienne
Parmi les participants à l'expédition, l'on retrouve le capitaine Harry Burstall, qui deviendra major général et chef d'état-major de l'armée, ainsi que S.B. Steele, surintendant de la Police montée, présent lors de la campagne du Nord-Ouest et dont la carrière le conduira plus tard en Afrique du Sud.
L’aide au pouvoir civil
Entre 1867 et 1898, la milice intervient à 67 reprises pour soutenir le pouvoir civil et deux fois dans des pénitenciers. Convoqués par les autorités civiles locales, les soldats répondent avec plus au moins de bonne grâce, chacun devant alors délaisser ses occupations et renoncer à son salaire pour une période indéterminée. Par surcroît, jusqu'en 1879, alors que le gouvernement canadien verse aux villes l'argent requis pour le paiement rapide et complet des coûts, les soldats-citoyens savent que certaines villes qui demandent leur aide ne seront pas en mesure de les rétribuer. Aussi longtemps que les policiers n'auront pas été formés en corps solidement structurés, les miliciens seront appelés pour rétablir l'ordre : ils n'apprécient guère ce rôle.
Le rapport annuel de la milice de 1878 énumère les difficultés liées à ces interventions ponctuelles. « Des désordres se présentent souvent chaque année. La milice n'a pas les connaissances nécessaires, la police est trop faible, les miliciens sont obligés de combattre les gens du même coin du pays ; il faut une force militaire permanente. »
À elle seule, la formule du vote électoral à main levée provoque, entre 1867 et 1883, 13 émeutes réelles ou appréhendées, dont 11 au Québec seulement. Des modifications à la Loi électorale vont mettre un terme aux interventions de la Milice dans ce champ d'activité. Les querelles linguistiques, religieuses et scolaires, ainsi que les défilés annuels des Orangistes constituent autant de prétextes à un appel des troupes. Les événements les plus difficiles à gérer sont les grèves. Levée sur place, la force de contrôle est souvent formée d'hommes qui vivent à proximité du lieu des manifestations ou qui sont apparentés à ceux qu'ils doivent combattre. Généralement, les miliciens sont appelés après un premier assaut violent perpétré contre la personne où contre la propriété. Dans plus de 90 pour cent des cas, leur seule présence réussit à empêcher les débordements. L'absence de véritables corps policiers est à la base de la plupart de ces interventions.
L’expédition du Nil 1884-1885
L'aptitude des Forces armées canadiennes à agir à l'extérieur du territoire national se dessine en 1884, au moment où le major général C.G. Gordon est assiégé à Khartoum dans le Haut-Nil soudanais.
La Grande-Bretagne organise une expédition de secours dirigée par le général Garnet Wolseley. En 1881 et 1882, alors chef d'état-major de l'armée, il s'était farouchement opposé au vieux projet de construction d'un tunnel sous la Manche relancé avec force par des hommes d'affaires français et britanniques. Cette prise de position n'atteint en rien son aura de vainqueur de Ter-et-Kebir ou son titre de lord Wolseley du Caire. Au Canada, Wolseley a dirigé la campagne de la rivière Rouge. Il a gardé un bon souvenir des Canadiens qui ont permis aux troupes britanniques d'être approvisionnées durant la marche et le conflit de 1870.
Dès son déclenchement et pendant l'année qui suit, l'affaire soudanaise a des échos au Canada où des colonels se disent prêts à lever leurs régiments de milice pour aller combattre dans ce Haut-Nil lointain. Prudent, le gouvernement britannique prend le pouls du Canada par rapport aux heureuses dispositions des volontaires, mais il fait savoir que la Nouvelle-Galles, un État du sud de l'Australie, a offert un contingent. Le premier ministre John A. Macdonald peut facilement résister aux quelques zélés pressés d'aller à Khartoum même si, ce faisant, il déçoit les autorités britanniques et froisse quelques-uns de ses compatriotes.
Cependant, dès 1884, il consent à ce que les Britanniques recrutent au Canada quelques centaines de « voyageurs » qui aideront à la logistique des combattants remontant le Nil. Autrement dit, Wolseley, qui a été favorablement impressionné par ses Canadiens, entend leur faire jouer un rôle similaire à celui de 1870, mais sur une scène étrangère, sous un autre climat et pour une cause qui ne les regarde en rien.
Près de 400 Canadiens, dont un grand nombre ignore tout de la tâche qui les attend, vont signer un engagement de six mois : c'est que l'époque des voyageurs est déjà presque révolue en Amérique du Nord. Les volontaires qui iront là-bas ne porteront pas l'uniforme. Ils n'auront pas d'armes et ne participeront pas aux rares combats conduits par Wolseley. Quant à Gordon et ses troupes, ils seront anéantis avant même que les secours leur parviennent.
Quelques personnalités dignes d'intérêt se glissent parmi ces volontaires. L'une d'entre elles est le lieutenant-colonel Fred C. Denison, l'aide de camp de Wolseley, en 1869-1870. Il appartient à une famille qui, depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, alors que certains de ses membres sont encore dans la Réserve, a été de toutes les affaires militaires canadiennes. On remarque également la présence d'un aumônier catholique, le capitaine A. Bouchard, qui, ayant déjà été missionnaire à Khartoum, est disposé à y retourner pour servir d'interprète et veiller sur l'âme des soldats canadiens. Le sergent d'hôpital Gaston P Labat qui, un an plus tard environ, sera sur le Saskatchewan avec un frère de Fred C. Denison, accompagne le major T.L.H. Neilson, chirurgien-major de la Batterie B, lui-même vétéran de l'affaire de la rivière Rouge.
Les 386 Canadiens quittent Halifax le 14 septembre 1884. Quinze jours plus tard, ils débarquent à Gibraltar. En mer, l'un des hommes a succombé à la maladie. Le groupe atteint Alexandrie le 7 octobre puis, en train et en bateau à vapeur, dépassant Luxor et Assouan, ils parviennent enfin aux premières cataractes. En novembre 1884, nos hommes sont au travail. Le 1er décembre, l'expédition est à mi-chemin entre Khartoum et Alexandrie. À chacune des 14 cataractes, qui s'étendent sur 15 kilomètres et créent une dénivellation d'environ 40 mètres, les voyageurs canadiens sont en place, attendant l'arrivée de nouvelles troupes britanniques auxquelles ils font franchir ces obstacles. L'Iroquois Louis Capitaine et quelques autres perdront la vie dans ces épreuves de courage et d'endurance.
Un nouvel engagement de six mois, à compter du 6 mars 1885, a été proposé aux voyageurs, mais seulement 86 hommes, sous les ordres de Denison, l'acceptent. Pour les autres, la mission prend fin avant d'avoir véritablement commencé. Le 10 janvier, peu avant l'expiration de leur contrat, la plupart des Canadiens reprennent le chemin du retour et se dirigent vers Alexandrie où leur embarquement débutera en février.
L'expérience a permis aux volontaires canadiens d'observer ce que d'autres participants aux guerres britanniques remarqueront à leur tour : chez les Britanniques, le traitement réservé aux officiers et aux hommes de troupe est très différent. Comme les soldats anglais, ils ont été moins bien nourris que les officiers. Réagissant à cette injustice, un Canadien qui a osé ouvrir une boîte de fromage a eu droit à trois mois de prison. On prétend, parmi les Canadiens, que si un soldat anglais avait commis la même faute, il aurait pu écoper de cinq ans de travaux forcés.
En avril 1885, dans une lettre au Gouverneur général du Canada, Wolseley félicite les Canadiens. Au mois d'août, la Chambre des lords et les Communes britanniques appuient un vote de remerciement à leur intention. Tous les volontaires recevront la médaille spéciale britannique immortalisant cette expédition. Ceux qui auront renouvelé leur contrat y ajouteront l'agrafe de la bataille de Kirbekan, bien qu'ils n'y aient pas combattu.
Le Vénézuela et le Canada
L'appartenance du Canada à l'Empire britannique peut avoir d'autres répercussions. Ainsi en est-il du différend qui surgit, en 1895, entre l'Angleterre et le Venezuela, au sujet des frontières de la Guyane Britannique. Or, en 1895, Grover Cleveland, le président des États-Unis, semble disposé à prendre fait et cause pour le Venezuela, contre l'Angleterre. Poussée au pied du mur dans cette affaire, l'Angleterre pourrait décider d'entrer en guerre contre les Vénézuéliens. Pour le Canada, cette perspective signifie un possible affrontement avec les États-Unis qui pourraient bien être tentés d'envahir cette partie de l'Empire britannique.
Le gouvernement canadien réagit aussitôt en fonction de cette éventualité en investissant trois millions de dollars dans le réarmement. Les fusils Snider à un coup sont remplacés par 40 000 Lee Enfield .303 à répétition. On achète quelques mitrailleuses modernes et on refait l'armement de l'artillerie.
Même si cette crise n'a eu aucune conséquence violente, elle a pourtant incité les autorités gouvernementales à agir sous l'effet de la panique. Mauvaise conseillère en matière de gestion de crise et d'administration des affaires militaires du pays, la panique sera de plusieurs autres rendez-vous.
En 1897, pour la première fois depuis 1876, une période d'instruction annuelle de tous les régiments de volontaires devient obligatoire. Déjà, en 1896, les premiers plans de mobilisation des forces canadiennes en cas de guerre sont publiés. La Milice est organisée en divisions, brigades, détachements, etc., chaque unité se voyant assigner un centre de mobilisation. La composition des unités est secrète et la nomination des états-majors doit se faire au tout dernier moment, ce qui pourrait facilement causer de la confusion en cas d'urgence. Mais ce premier plan, malgré ses faiblesses, est important par son existence même.