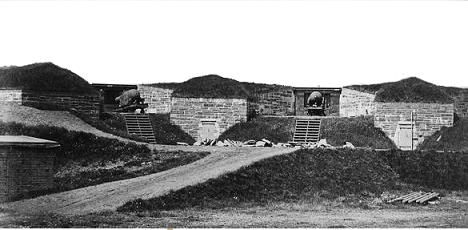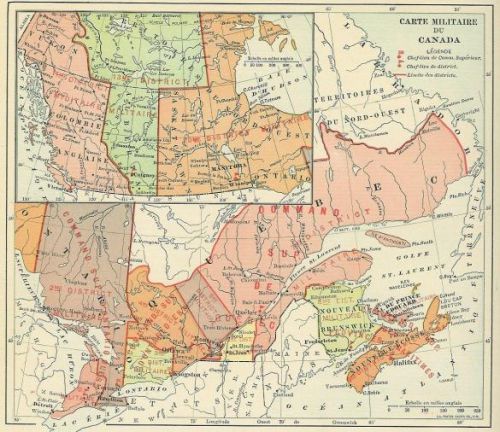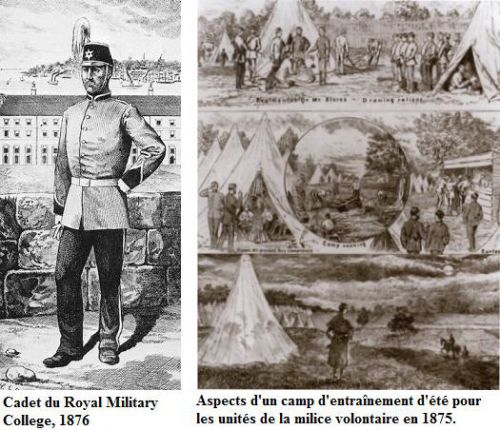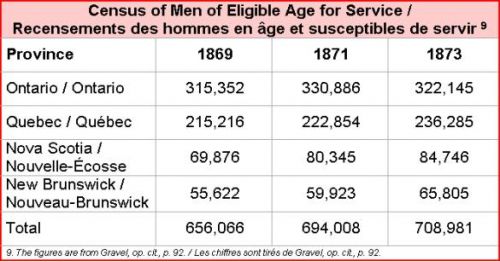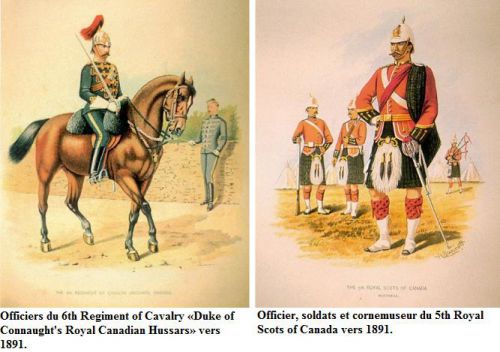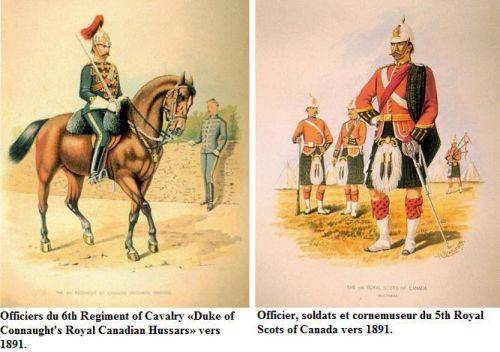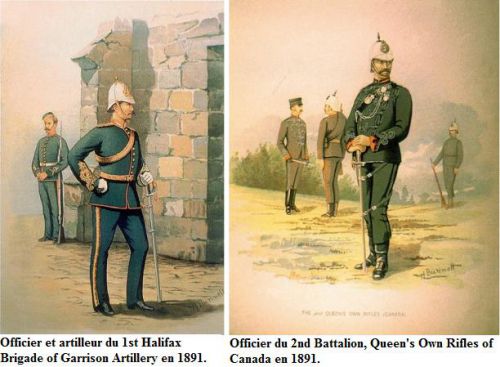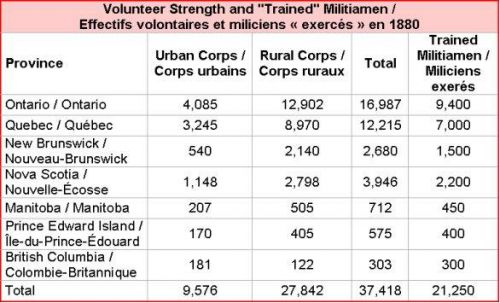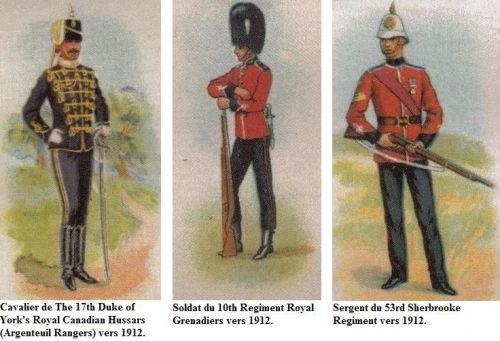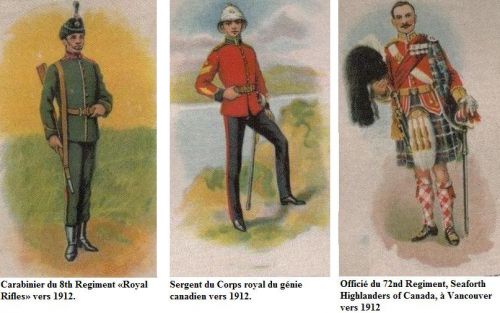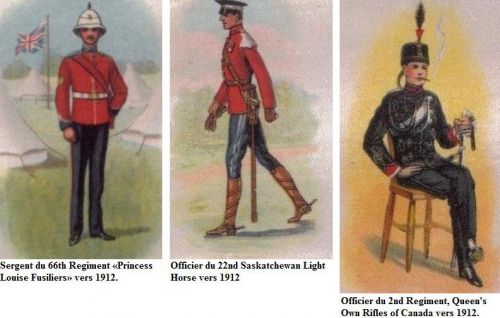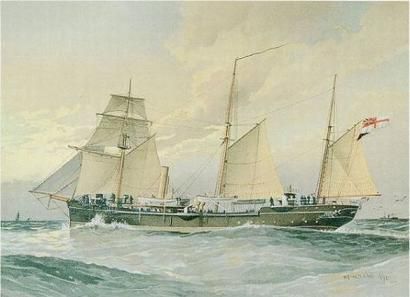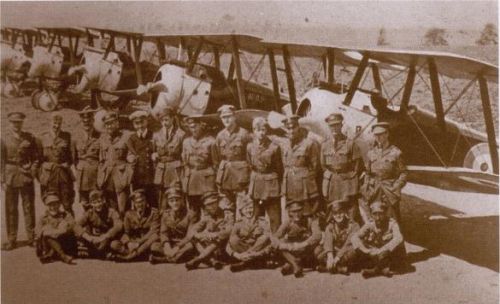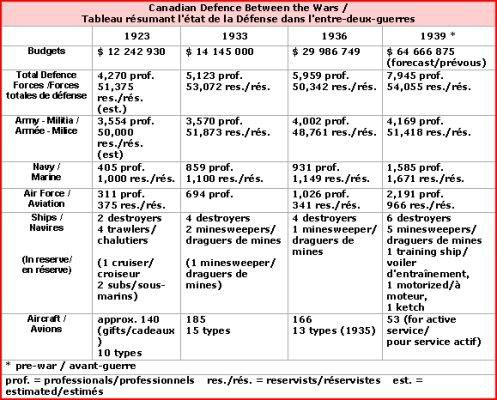1872-2000
Une défense quasi autonome (1871-1898)
La situation géopolitique du Canada en 1871
Au cours du XIXe siècle, le monde occidental, plus particulièrement l'Europe, est secoué par de profonds bouleversements géopolitiques. On assiste en effet à l'effritement progressif des grands empires et à leur remplacement par une foule d'États-nations. Lente au début, cette montée des nationalismes s'accélère à compter de 1871. À cette date, l'Italie et l'Allemagne viennent tout juste de compléter leur unification, de sorte que l'Europe de l'Ouest ressemble déjà à celle que nous connaissons aujourd'hui. Il en va tout autrement par ailleurs pour l'Europe du centre et de l'Est. Mises à part, la Grèce ainsi que les trois minuscules principautés de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, les empires austro-hongrois, ottoman et russe se partagent cet immense territoire où vivent plusieurs groupes ethniques qui aspirent à l'autonomie politique.
Toujours à compter de 1871, on remarque aussi un regain d'intérêt pour les explorations et les découvertes, de sorte que, partant de leurs établissements côtiers échelonnés tout autour de l'Afrique, les Européens se ruent vers l'intérieur. Ce mouvement d'expansion coloniale lié à la montée des nationalismes, crée des hostilités nouvelles ou en ranime d'anciennes.
En Amérique du Nord, l'unification territoriale des États-Unis et du Canada se poursuit. Le Colorado va se joindre à l'Union américaine en 1876, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Montana et l'État de Washington en 1889, l'Idaho et le Wyoming l'année suivante, l'Utah en 1896, l'Oklahoma en 1907 et l'Arizona ainsi que le Nouveau-Mexique en 1912. Enfin, au Canada, les immenses Territoires du Nord-Ouest demeurent inorganisés. Acquis de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1870, mais ne représentant qu'une infime parcelle de cette possession, le Manitoba en a alors été détaché pour former la cinquième province. Puis, en 1871, c'est au tour de la Colombie-Britannique d'adhérer à la Confédération canadienne. D'un côté, l'Angleterre relâche peu à peu son emprise sur ses colonies d'Amérique du Nord. De l'autre, le Canada naissant se solidifie lentement d'un océan à l'autre.
La croissance d’un empire
Officier et canonniers, Royal Regiment of Artillery, 1889. Des officiers et canonniers du Royal Regiment of Artillery sont envoyés en détachement à Halifax afin de servir auprès de la défense côtière qui protège leur base navale depuis 1905.
L'influence de l'Angleterre impériale ne disparaît pas au Canada au moment où le gros de ses troupes le quittent, en 1871. Au contraire, dans cette seconde partie du XIXe siècle, elle s'incruste et imprègne notre pays, en particulier nos élites politiques, économiques et militaires. Elle connaît même un certain crescendo au moment du soixantième anniversaire de l'accession au trône de la reine Victoria, en 1897.
Cet impérialisme florissant est difficile à définir avec précision. Il comporte un aspect économique qui pousse les Anglais et d'autres Européens à la conquête de nouveaux marchés dans le monde. Il est aussi raciste, reconnaissant la supériorité de la race blanche. Ce sentiment de supériorité est nuancé par une volonté de changement social en Angleterre, y compris en faveur des « inférieurs », dont « l'homme blanc » porte le fardeau de la rédemption. Parmi les Blancs, les Anglo-Saxons seraient sur la plus haute marche. Ces grandes tendances sont certainement importantes, mais elles comprennent, on l'imagine, une part de contradictions et de non-dits. Ainsi, au Canada, la partie du sentiment impérial faisant des Anglo-Saxons de la terre une race unie et supérieure se frappe à trois écueils. Le premier est formé de tous ceux qui ne sont pas anglo-saxons, surtout les autochtones, les Métis et les Canadiens de langue française, ce qui représente plus de 35 pour cent de la population. Le deuxième est constitué des États-Unis, dont la population, tout en étant en grande partie anglo-saxonne, a son propre rêve impérial d'expansion qui est un danger pour le Canada. Le bloc anglo-saxon n'est donc pas aussi monolithique que certains le souhaiteraient. Le troisième repose sur le sentiment national canadien qui se développe, en partie contre la « destinée manifeste » des États-Unis, en partie contre l'emprise qu'exerce encore l'Angleterre sur le Canada.
L'impérialisme tel qu'on l'entend parfois à Londres et dans certaines couches canadiennes est fait d'un renforcement de l'Empire britannique grâce à une coopération économique, militaire et navale accrue entre les différents territoires qui composent ce dernier. Or, pour beaucoup de Canadiens, ce resserrement des liens est porteur de changements qui donneront à terme aux colonies une influence dans la mise en place de la politique étrangère de l'Empire et, ce faisant, contribueront à l'affirmation du nationalisme canadien. Quant au commerce impérial, il est en voie d'être dépassé par les échanges canado-américains.
Deux faits se situant l'un en 1871 et l'autre en 1897 illustrent mieux que toutes les tendances divergentes en ce qui concerne l'Empire. Le traité de Washington de 1871 démontre sans l'ombre d'un doute au premier ministre canadien John A. Macdonald, présent lors des discussions anglo-américaines, que les intérêts canadiens peuvent souffrir de la stratégie prônée par les Anglais visant à neutraliser la menace américaine afin de mieux se dépenser ailleurs dans le monde. Un petit exemple : le Canada est appelé à rembourser les dégâts causés durant la guerre de Sécession aux banques de St. Albans lors d'un raid monté contre elles, à partir du Canada, par les Sudistes. Mais l'Angleterre refuse de réclamer aux Américains les dommages résultant des incursions fenianes dont la dernière vient d'avoir lieu. Dans l'entente de 1871, le Canada perdra sur les plans économique, politique et géographique, sans parler de la blessure faite à l'amour-propre anglais et canadien.
Un partenariat impérial
Armstong RML guns à Ives Point Battery, Halifax, 1873. C'était l'un des plusiers batteries gardant le port d'Halifax dont les canons traversent des plates-formes en acier.
D'autre part, à l'occasion des réjouissances entourant le long règne de Victoria, en 1897, le secrétaire d'État anglais aux Colonies, Joseph Chamberlain, organise une conférence coloniale où de grandioses cérémonies protocolaires enrobent le fond de la pensée de l'hôte. « Les discussions informelles sur des questions d'un grand intérêt impérial 1 » auxquelles Chamberlain convie ses invités portent, en fait, sur un lien impérial qui serait resserré à l'aide d'un grand conseil de l'Empire, centralisé à Londres, où les problèmes seraient étudiés et les décisions prises. Chamberlain aborde aussi la question d'un vrai partenariat qui reposerait sur un partage des droits et des responsabilités au niveau de la défense. Que répond le premier ministre canadien Wilfrid Laurier ? Plus ou moins que l'état des choses actuelles lui sied très bien. Il admet que les Puissances (Dominions) voudront participer aux décisions impériales. Mais il se montre peu réceptif à l'idée que cela se fasse en contrepartie d'une plus grande participation militaire aux missions mondiales de l'Angleterre. Pourtant, cet homme aime les institutions anglaises. Il le clame d'ailleurs un peu partout, aussi bien au Canada qu'à l'étranger, dans des discours où il glorifie l'Empire. Mais pas au point de s'engager à le défendre coûte que coûte, ni d'abandonner des parcelles du nationalisme canadien naissant. Laurier se montre donc plus nationaliste qu'impérialiste. En cela, il représente une bonne partie de la population, surtout les Canadiens français. Car, dans la fièvre impérialiste qui prévaut, des voix s'élèvent ici et là au Canada, dont celle d'Honoré Mercier, premier ministre du Québec (1887-1891), avertissant qu'un jour ou l'autre, le fanatisme de certains, dont celui de la puissante Ligue de la fédération impériale, conduira les jeunes Canadiens à aller mourir en terre étrangère pour une cause qui leur sera tout aussi étrangère.
La conférence coloniale de 1897 aboutit tout de même à quelques décisions qui, tout en étant vagues, ont leur importance du côté militaire. On prévoit une coopération de plus en plus grande entre le War Office et les différents ministères chargés de la défense dans les dominions, un principe général que l'on désire rendre vivant par une organisation, un entraînement et un équipement similaires pour les armées de l'Empire.
En cette fin de XIXe siècle, l'expression « peindre la mappemonde en rouge », que l'on entend alors souvent, est devenue une impossibilité reconnue depuis longtemps par nombre d'impérialistes. Mais le romantisme s'entretient de mythes et celui de l'Angleterre impériale se maintiendra vaille que vaille, jusqu'à la Première Guerre mondiale, entraînant dans son sillage bon nombre de jeunes Canadiens et Canadiennes, sans doute plus attirés par la possibilité d'aventure que leur offre le rêve impérial que par le rêve lui-même.
La défense du Canada par les Canadiens. Les troupes britanniques se retirent du Canada
L'année charnière 1871 est marquée, sur le plan militaire canadien, par la pacification, jusqu'à ce jour, de notre frontière avec les États-Unis. De cette nouvelle situation résulte un assainissement des finances anglaises causé aussi bien par l'abandon de projets de construction de fortifications, au Canada, prévues contre d'éventuelles invasions américaines, que par le départ de notre sol des troupes anglaises, sauf en ce qui concerne la place d'Halifax, qui joue un rôle important dans la stratégie navale anglaise.
À compter de 1871, et à son corps défendant, le Canada doit assumer entièrement sa défense. Il s'y emploie de plus en plus depuis 1855, comme nous l'avons déjà signalé, et sa loi constitutive de 1867 comprend un article sur la Défense et la Milice (terrestre et navale). Quelle est l'urgence ? En 1867, la possibilité d'une attaque de l'extérieur, donc des États-Unis, est assez sérieuse et doit donc être prise en compte. La menace de mouvements violents intérieurs doit aussi être envisagée ainsi que celle pouvant peser contre l'Empire anglais tentaculaire dont, en définitive, le Canada fait partie. Ce sont ces deux dernières options qui seront prédominantes jusqu'en 1945, même si la vision des stratèges de 1867 ne s'étend pas jusqu'à cet horizon.
Une milice de volontaires
Carte militaire du Canada, vers 1910.Le ministère de la Milice et de la Défense canadien naît en 1868. Le pays fut divisé en 9 zones militaires et de nouvelles zones se sont ajoutées plus tard.
L'analyse de la situation, des contraintes de nature économique et sociale ainsi que le mythe de l'invincibilité du milicien (le citoyen-soldat) vont faire, dans un premier temps, que l'organisation de la défense reposera sur les troupes régulières britanniques renforcées de 40 000 volontaires de la milice active enrôlés pour une période de trois à cinq ans. Bien que l'on fasse mention d'une milice navale, dans cette loi adoptée en 1868, les volontaires de la milice active sont essentiellement chargés de la défense terrestre, jusqu'au XXe siècle. Notons également que le principe du service obligatoire est maintenu, même s'il ne sera pas utilisé.
La Milice active non permanente peut accueillir les hommes âgés entre 18 et 60 ans, qui sont subdivisés en quatre classes : ceux de 18 à 30 ans, célibataires ou veufs sans enfants ; de 30 à 45 ans, possédant ces mêmes particularités ; de 18 à 45 ans, mariés et veufs avec enfants ; et, enfin, de 45 à 60 ans. Le Canada est séparé en neuf districts et en 200 divisions régimentaires, chacune commandée par un lieutenant-colonel. Un exercice annuel, d'une durée de 8 à 16 jours, est prévu. Chaque milicien doit se procurer un fusil Enfield-Snider moyennant 12 $, le gouvernement payant la différence. Sont exempts de l'enrôlement : les juges, les religieux, les policiers, les gardes de pénitenciers ou d'asiles d'aliénés, les personnes handicapées, les fils uniques ou soutiens de famille.
Avec un budget initial de 900 000 $, le ministère de la Milice et de la Défense canadienne naît officiellement en 1868. Les anciennes milices provinciales ou canadiennes sont dissoutes en 1869 et, aussitôt, l'enrôlement débute dans les nouveaux districts militaires. Les officiers ne sont pas obligés de se réengager, mais, s'ils le font, ils doivent prêter un nouveau serment d'allégeance. L'opération permet de se débarrasser d'une partie du bois mort qui existait dans les milices d'avant 1867.
Les districts ontariens sont les premiers à être officiellement acceptés mais, dès avril 1869, 10 bataillons plus quelques compagnies indépendantes, constitués surtout de Canadiens français, ne font leur apparition au Québec. La Milice active comptera rapidement 37 170 volontaires, à moins de 3 000 de l'effectif permis. Quant à la milice sédentaire - qui se résume à la constitution de la liste des noms de tous les hommes susceptibles de servir -, elle comprendra 618 896 noms.
Les premiers soldats professionnels canadiens
B Battery Garrison Artillery en 1873. La B battery fut l'une des premières unités permanente de l'Armée canadienne : l'artillerie Garrison. Formée à Québec en 1870, la B battery fut considérée une école d'artillerie de la milice canadienne. Cette photo du Canadian Illustrated News, du 19 avril 1873, démontre une compétition de tir sur la glace de la rivière Saint-Charles. Les armes chargeurs à muselière de canon à âme lisse sont montées sur des carrioles de transport utilisées durant l'hiver. Les artilleurs sont vêtus de leurs uniformes d'hiver.
La loi de 1868 ne veut pas effaroucher les Canadiens, anglophones ou francophones, qui ne sont guère favorables à l'armée de métier. En temps et lieu, la Milice viendra appuyer les troupes anglaises pour chasser tout envahisseur, se dit-on. Mais, ce postulat est remis en cause par le départ des militaires britanniques, à l'automne 1871. Pour les remplacer, le Canada prend aussitôt une mesure modérée, probablement justifiable dans les circonstances, puisque les États-Unis ne sont plus aussi menaçants qu'ils l'étaient quatre ans plus tôt. En octobre 1871 donc, avant même que la garnison britannique quitte Québec, le pays met sur pied deux batteries d'artillerie de campagne qui auront pour tâches, entre autres, de protéger les fortifications de Québec et de Kingston. Ces quelques centaines d'hommes fourniront aussi l'instruction aux artilleurs et aux fantassins de la Milice active non permanente. Les Batteries A (Kingston) et B (Québec) forment le premier noyau de l'armée régulière canadienne ou Milice active permanente, comme on l'appelait à l'époque. Le premier commandant de la Batterie B est le lieutenant-colonel Thomas Bland Strange. Il parle français et possède des états de service impressionnants, ayant servi en Inde, en Angleterre, en Irlande, à Gibraltar et aux Antilles avant de venir à Québec. Ce choix est bon, puisque la Batterie B (6 officiers et 153 sous-officiers et hommes) inclut plusieurs francophones venus de la Milice volontaire de Québec. Cette batterie s'occupe des fortifications de Québec, de Lévis et de l'île Sainte-Hélène. En 1874, un détachement est envoyé à Grosse-Isle pour se transformer en artillerie de garnison. Les Batteries A et B inter-changera leurs positions une première fois, en 1880, et encore en 1885. En 1883, la nouvelle Batterie C, sera créée et stationnée à Esquimalt, chargée de la défense de cette partie de la côte ouest. Les trois batteries formeront désormais un régiment. En 1893, celui-ci est réorganisé en trois batteries de campagne et deux compagnies de garnison. Les batteries de campagne seront amalgamées plus tard au sein de la Royal Canadian Field Artillery qui, en 1905, deviendra la Royal Canadian Horse Artillery : pour leur part, les compagnies de garnison donneront la Royal Canadian Garrison Artillery.
La cavalerie et l’infanterie régulière.
Mais, entre-temps, la loi de la Milice aura été modifiée en plusieurs occasions. Le changement de 1883 sera le plus important. Citonsen un article central.
Étant donné qu'il est nécessaire, par suite du départ des troupes régulières impériales d'assurer la protection et l'entretien des forts, des magasins, de l'armement, des dépôts de matériel de guerre et services assimilés, et d'assurer la création d'écoles d'instruction militaire relativement aux Corps recrutés pour le service permanent, il est légitime pour Sa Majesté de lever... une troupe de cavalerie, trois batteries d'artillerie (dont les deux Batteries A et B déjà organisées) et pas plus de trois compagnies d'infanterie, le total des effectifs de toutes ces unités ne devant pas dépasser 750 hommes.
C'est ainsi qu'un corps école de cavalerie apparaît à Québec (qui deviendra le Royal Canadian Dragoons) et un autre d'infanterie (Royal Canadian Régiment), qui aura des compagnies à Fredericton, Saint-Jean et Toronto. Celles-ci auront approximativement l'effectif suivant : 1 commandant, 3 officiers et 150 sous-officiers instructeurs et hommes. En 1885, une école d'infanterie à cheval est mise sur pied à Winnipeg (qui prendra plus tard le nom de Lord Strathcona's Horse).
Cette réorganisation donne un solide noyau à la force permanente, un fait que le ministre de l'époque, Adolphe Caron, tente d'atténuer, insistant plutôt sur la vocation d'instruction qu'auront ces soldats réguliers. Caron explique que le gouvernement civil sera ainsi renforcé, qu'il pourra faire exécuter ses lois, prévenir des troubles intérieurs et repousser d'éventuelles attaques. Comme on le voit, entre 1867 et 1883, la préoccupation première de l'effort de défense est passée de la menace venue de l'extérieur à celle venant de l'intérieur.
En 1886, après les troubles dans le Nord-Ouest, avec Louis Riel, la Loi de la Milice est à nouveau changée faisant passer le nombre de compagnies d'infanterie de trois à cinq et celui de l'effectif total de la force régulière de 750 à 1 000 hommes.
Le commandement de la milice
Cette machine militaire doit être commandée. Entre 1867 et 1874, le commandant, un officier fourni par l'armée anglaise, portera le titre d'adjudant général. À compter de 1874, et jusqu'en 1904, on créera le nouveau poste d'officier général commandant, qui sera aussi rempli par un professionnel britannique détenant au moins le grade de colonel bien qu'au Canada il puisse devenir major général, voire lieutenant général. L'adjudant général reste dans l'organigramme, le poste étant dorénavant rempli par un Canadien.
On peut espérer une certaine objectivité de l'officier anglais prenant charge de notre appareil de défense par rapport aux deux grands partis politiques qui gouverneront successivement le pays. En principe, son professionnalisme le fera agir en faveur d'une meilleure milice, plutôt qu'en fonction d'intérêts partisans limités. Malheureusement, l'objectivité que l'officier général commandant applique face aux politiciens canadiens ressemble très souvent à de l'asservissement quant aux grands objectifs impériaux des politiciens britanniques. Cela, on l'imagine bien, aboutit à certaines collisions avec le nationalisme des ministres canadiens, aussi timoré soit-il en cette fin de siècle. Dans son rapport annuel, l'officier général commandant livre fréquemment des considérations qui ont peu à voir avec le Canada. Ainsi, le général Edward Selby Smyth, écrit-il en 1877 : nous ne devons pas permettre un instant que le communisme fasse impunément quelque grande expérience dans le moindre coin de l'Empire britannique» Le bon général nous entretient de notre autonomie, qu'il faut bien sûr protéger, et d'un autre ennemi, bien plus éloigné que notre voisin immédiat, auquel il fait alors référence de façon subtile mais qui inquiète déjà, la Russie, avec laquelle l'Angleterre a souvent maille à partir.
Ces hommes que nous envoie l'Angleterre, qui affrontent, souvent avec raison, nos ministres concernant le patronage lié à certaines nominations, sont-ils les meilleurs dans leur profession ? Comme nous aurons l'occasion de le constater, ce n'est pas toujours le cas. Qui plus est, le système de défense canadien leur est en général à peu près incompréhensible. Comme ils aimeraient le mettre à leur main et en faire un instrument entièrement dévoué à la volonté anglaise !
Au milieu de l'apathie à peu près générale des Canadiens, de la fluctuation des budgets au gré de l'évolution de l'économie et d'une certaine animosité des ministres titulaires, les officiers généraux commandants essaient de faire bouger les choses. Entre 1890 et 1895, par exemple, le major général I.J.C. Herbert réorganise la milice en ajoutant du personnel à son quartier général, où ne se trouvaient que trois officiers et un aide de camp, et en diminuant le nombre d'officiers dans les districts. Du côté des forces permanentes, il organise en régiment les écoles d'infanterie et de cavalerie apparues au fil des années, expédie plusieurs de leurs officiers en entraînement en Angleterre, améliore les critères de recrutement et de sélection des hommes et s'attache à moderniser le matériel.
L’instruction et l’évolution de la milice
Les efforts de chacun des généraux britanniques combinés à l'intérêt intermittent des ministres, souvent allumé par des raisons politiques ou des crises intérieures qui ont démontré la faiblesse du système existant, donnent cependant peu à peu des résultats. On l'a noté, le nombre de soldats réguliers s'accroît entre 1871 et 1898. Mais il y a plus. En 1876, on ouvre le Royal Military College of Canada (RMC), qui sera une pépinière d'officiers pour les unités permanentes et non permanentes ainsi que pour la Police montée du Nord-Ouest. La politique nationale du Parti conservateur amène le Canada à construire une cartoucherie, la Dominion Arsenal, à Québec, dont la production commence en 1882 et s'étend aux boulets et aux obus de canons. En 1885, l'Arsenal approvisionne les troupes déployées dans le Nord-Ouest du pays et, en 1888, on y fabrique 2 500 000 cartouches. En 1885, un chemin de fer relie l'Atlantique et le Pacifique en n'utilisant que le territoire canadien : cet instrument, avant tout commercial, est aussi un outil stratégique. En 1897, on autorise la nomination d'aumôniers honoraires pour chaque bataillon, mais il est entendu que cela ne coûtera rien au Trésor. Un service de la paie se développe très lentement : on y trouve moins de 10 officiers et, en 1898, on en centralise à Ottawa toutes les opérations qui se faisaient jusque-là au niveau des districts.
Membres du Ladies School Cadet Corps, à St- Catharines, Ontario, en 1891.
Même en 1880, quelques régiments de la milice volontaire avaient des compagnies auxiliaires de la gente féminine, telles que les membres du Ladies School Cadet Corps, à Sainte-Catharines, en Ontario, en 1891. Vues que leur fonction était informelle, il y a très peu d'information concernant ces formations.
En 1871, le Canada reste dépourvu de corps de soutien, essentiels à une armée en campagne, comme les domaines médical, du transport, de l'approvisionnement et du génie. Jusque-là, l'armée anglaise avait fourni ces éléments lors des mobilisations de la milice. Par la suite, on assiste, au moment des crises, à une improvisation précipitée plus ou moins heureuse, la campagne du Nord-Ouest de 1885 étant patente à cet effet.
En Chambre, il y a parfois d'âpres débats sur l'organisation matérielle de la Milice, surtout à propos du budget qui lui est alloué, mais jamais sur l'essentiel, c'est-à-dire la politique de défense de notre pays qui, au-delà de sa volonté d'affranchissement, reste tout de même très dépendante de l'Angleterre.
Corps cadet, Quebec City High School, 11 juin 1890. Plusieurs corps cadets furent établis dans les écoles durant les dernières années du 19e siècle. Cette photo, datant du 11 juin 1890, est du corps de l'école secondaire anglaise Quebec High School, fondée à Québec avant la Confédération. Notez le corporal (probablement de l'unité Garrison, la B Battery, Regiment of Canadian Artillery, de la ville de Québec) qui a agit en temps qu'instructeur d'exercices militaires à ce centre.
Qui sont nos volontaires ? Jean-Yves Gravel nous en trace le portrait, pour la période 1868-1898, en ce qui concerne le 5e District militaire (l'est du Québec, dont la ville de Québec). On se rend compte que les bataillons ruraux sont composés à 45 pour cent de fermiers, à 30 pour cent d'hommes d'affaires (commerçants et commis) et à 24 pour cent d'ouvriers. Le pourcentage de fermiers, valable pour 1868, est en décroissance lente, mais constante, après cette année-là. Bien sûr, l'industrialisation joue ici un rôle, mais il y a plus. En effet, presque toutes les études menées dans le monde occidental sur le recrutement concluent de la même façon : le monde rural est plus réfractaire que le milieu urbain à tout service militaire.
Les bataillons urbains sont pour leur part constitués à 62 pour cent d'ouvriers et à 27 pour cent d'hommes d'affaires. Après 1873 et l'élimination de la menace américaine, le pourcentage des ouvriers diminue, car leurs patrons sont peu favorables à leur service militaire. Le monde des affaires et celui des étudiants prennent leur place. En somme, dans un pays qui restera majoritairement rural jusqu'après la Première Guerre mondiale, c'est le milieu urbain qui donnera corps à la force de défense du Canada dès ses débuts.
Les budgets de la milice
La vie du milicien canadien est influencée par la nature des budgets qui sont dévolus à l'organisation où il s'inscrit. Ces appropriations passent de 937 513 $, en 1869, à 1 654 282 $, en 1873, puis, elles décroissent pour atteindre un creux de 580 421 $ en 1877. Entre 1878 et 1881, elles fluctuent dans une fourchette minimale de 618 136 $ (1878) et maximale de 777 698 $ (1879). À compter de 1882 jusqu'à 1886, c'est l'ascension à partir de 772 811 $ pour atteindre le sommet de 4 022 080 $, avec la campagne dans le Nord-Ouest. Les sommes totales annuelles se situent ensuite un peu au-dessus de 1 000 000 $.
Comme on le voit, les choses se sont détériorées dans la seconde moitié des années 1870. C'est qu'une crise économique frappe le monde industriel, dont le Canada. La recette bien connue des politiciens, ceux d'alors comme ceux d'aujourd'hui, est de sabrer dans la défense. D'ailleurs, ce ne sont pas les critiques qui manquent au Parlement. L'argument le plus familier s'énonce comme suit : la sécurité du Canada n'étant pas en cause, à quoi servent les dépenses militaires ? Quant aux aspects plus détaillés des reproches, ils portent sur le gaspillage pour les uniformes (qu'on avait oubliés de fournir aux volontaires jusqu'en 1876), les armes, le trop grand nombre d'officiers dans les états-majors ou, encore, après 1876, la quasi-absence de francophones au Collège militaire de Kingston.
L'impact de la coupure des budgets sur l'instruction est considérable à compter de 1876, et ce, après l'ajout aux institutions existantes du Royal Military College. Durant l'exercice financier 1871-1872, 34 414 hommes avaient effectué une période d'instruction de 16 jours. Ce sommet ne sera pas atteint de nouveau avant 1905. Alors que le nombre permis de volontaires à instruire annuellement avait été fixé à 40 000, en 1868, il a été rabaissé à 30 000, en 1873. La période d'exercice a été réduite à huit jours, en 1876 ; elle remonte à 12, en 1877, mais doit se faire aux quartiers généraux des bataillons. En 1888, l'effectif maximal permis est porté à 43 000 hommes mais, pour des raisons d'économie, on permet à 37 000 de s'enrôler. Les corps des villes en réunissent 10 000, durant 12 jours d'exercice annuel, ceux des campagnes, 27 000, avec 12 jours d'instruction tous les deux ans. Mais, entre 1877 et 1886, le nombre d'hommes ayant suivi un exercice annuellement atteint rarement plus de 20 000, la moyenne se situant dans les 18 000.
Le manque d’enthousiasme
Sergent, Hamilton Field Battery, Royal Canadian Artillery, 1894. En 1894, la Milice volontaire canadienne comprend 17 batteries de champ. Les batteries de champs se servaient surtout des canons britanniques de 9 livres qui étaient périmés dans les années 1890s et ont été remplacés avec des canons britanniques de 18 livres dès 1906. L'uniforme de l'Artillerie royale canadienne ressemblait à celui de l'Artillerie royale britannique excepté que les Canadiens préférait porter le casque colonial blanc plutôt que le casque bleu-noir britannique.
Ce chiffre ne repose pas seulement sur le budget. Le zèle des volontaires est aussi un facteur. La loi de 1868 permettait d'instruire au moins autant d'hommes que les 30 000 de l'armée régulière américaine. Mais, en 1873, les volontaires, pour la première fois, occupent moins de 75 pour cent des 40 000 postes ouverts. En modifiant la loi pour ne permettre l'entraînement que de 30 000 hommes, on retrouve, dès 1874, un taux de 97 pour cent d'occupation des postes de miliciens volontaires disponibles.
Cela dit, les variations de l'enthousiasme gouvernemental vis-à-vis de la chose militaire ont des suites peut-être plus durables que la période, somme toute limitée, des bas budgets. Durant les cycles bas, l'instruction étant limitée, l'efficacité et l'intérêt des volontaires s'étiolent, surtout au sein des régiments ruraux qui ne s'entraînent que tous les deux ans. Dans les districts, les restrictions budgétaires sont telles que l'on doit tirer au sort le nom des unités qui pourront aller au camp. Dans une telle conjoncture, la petite flamme militaire, maintenue de peine et misère chez plusieurs volontaires, s'éteint souvent pour toujours. Sans compter qu'on empêche l'apport de sang nouveau que la crise économique aurait pu amener si l'on avait permis autant d'instruction, entre 1877 et 1883, qu'auparavant. Les budgets augmentent à compter de 1882, mais la situation économique s'améliore aussi, ce qui constitue un facteur négatif par rapport au nombre de volontaires que l'on voudrait entraîner. De plus, en accroissant soudainement le nombre possible de ceux que l'on peut instruire, on fait appel à un afflux de recrues et, donc, à beaucoup d'inexpérience.
Les camps annuels d'instruction, lorsqu'ils ont lieu, se tiennent sur des sites bien précis. Au Québec, par exemple, ce sera à Laprairie, pour les unités de l'ouest de la province (incluant Montréal), et à Lauzon, pour celles de l'est, dont Québec, plus précisément à l'ancien camp établi par les ingénieurs anglais lorsqu'ils travaillaient à fortifier la pointe Lévis, entre 1865 et 1871. Nous commenterons, plus loin, la valeur réelle de ces sessions d'entraînement. Les unités elles-mêmes organisent parfois des revues, surtout dans les villes, pour souligner un événement heureux ou triste. Cela donne l'occasion à plusieurs, dont de nombreux députés de tous les partis, d'endosser leurs uniformes.
Le milicien et son instruction. Les conditions du service dans la milice
Paie journlière dans un camp par le rang. Un soldat servant dans la Milice canadienne dans les années 1870s était payé 50 cents par jour. Un journalier gagnait $ 1.00 par jour. Les hommes dans les camps étaient soumis à des barèmes quotidiens proportionnés aux grades, qui ne fluctueront guère entre 1868 et 1898.
À part ces rares moments dans une année, souvent inexistants dans un bataillon rural, le volontaire a bien peu de liens avec le militaire. La vie de tous les jours, les réorganisations nombreuses des unités dont le nombre de compagnies varie pour toutes sortes de raisons, la volonté et l'enthousiasme du capitaine de chacune étant les principaux éléments de motivation, le manque d'intérêt aux plus hauts niveaux politiques, tout, en quelque sorte, concorde pour faire du volontaire un être à part, mal soutenu par une société qui n'est pas militariste, loin de là. La campagne du Nord-Ouest vient modifier cet ordre des choses dans les unités qui y participent. Mais la grisaille de la routine reprend vite le dessus, après leur retour dans leurs quartiers.
Le milicien servant dans un quartier général est payé 1 $ par jour, s'il est officier, et 50 ¢ pour tous les autres grades. En 1876, ce dernier montant grimpe à 60 ¢. Ceux qui vont dans un camp sont soumis à des barèmes quotidiens proportionnés aux grades, qui ne fluctueront guère entre 1868 et 1898. Il est bon de rappeler qu'un journalier, au milieu des années 1870, gagne environ 1 $ par jour et même plus durant l'été et l'automne, période habituelle des camps.
Un officier au camp d'entraînements, Artillerie royale canadienne, les années 1890s. Pendant des décennies, les camps d'entraînements d'été de la 1re batterie de campagne de Québec de la milice volontaire et les batteries d'artilleries de garnison eurent lieu sur l'Île d'Orléans avec les canonniers des forces permanentes qui furent en garnison au citadel de Québec. L'artillerie de la milice volontaire de garnison fut divisée en brigades comprenant quelques brigades aussi bien qu'une seule batterie. (Musée de l'Artillerie royale canadienne.
À la suite des réductions radicales des budgets, on doit prendre des mesures restrictives qui ne plaisent pas. Les rations ont été gratuites pour tous jusqu'en 1875 : à ce moment-là, on choisit d'ajouter 10 ¢ par jour à la solde, mais chacun doit désormais payer ses repas. On ne paie plus les jours de déplacement pour aller vers les camps et en revenir, ainsi que le dimanche passer au camp. En 1883, devant le mécontentement général, on revient au paiement de ces journées. La situation économique s'améliorant, les officiers d'état-major sont dorénavant payés durant 15 jours, et ceux qui commandent les compagnies, durant 12. La même année, les soldes des militaires servant dans les quartiers généraux sont aussi ajustées aux grades.
Même si les officiers de la Milice permanente ou non permanente sont mieux payés que la troupe, il leur faut aussi une bonne dose d'abnégation pour accepter de servir leur pays. Ainsi, un aspirant officier de la Milice non permanente doit réfléchir aux aléas liés à son futur statut. Car il devra payer son uniforme, fournir ses meubles de caserne et, lorsqu'il ira suivre ses cours, pouvoir s'absenter 57 jours, pour obtenir son certificat de 2e classe, ou 72 jours, pour celui de première classe. Évidemment, on s'attend à ce qu'il sache écrire correctement à la dictée et tenir des comptes (arithmétique). Par la suite, dans plusieurs unités, sa solde ou une bonne partie de celle-ci, s'en ira au fonds régimentaire. Tout de même, en plus de sa paie de camp, le capitaine de compagnie reçoit 40 $ pour garder les armes et les uniformes de ses hommes. Le commandant d'un bataillon a 100 $ annuellement pour les dépenses encourues dans ses fonctions militaires (papeterie, poste, annonces dans les journaux pour le recrutement, etc.), 100 $ de plus s'il s'adjoint une fanfare (toujours un centre d'attraction au camp annuel), ainsi que 40 $ par compagnie pour assurer l'instruction d'avant-camp. Mais cette dernière somme sert le plus souvent à d'autres activités : fanfare, fonds du régiment ou, tout simplement, le commandant se l'approprie en retour des services rendus.
Les propositions de conscription et les problèmes de recrutement
Recensement des hommes en âge et susceptibles de servir. Ce tableau, divisé par province et par année, nous renseigne sur le nombre d'hommes qui étaient susceptibles de servir dans l'armée canadienne à cette époque.
La loi de 1868 contient le principe d'une conscription. Dans la réalité, cet aspect se transforme en un inventaire que l'on fait en 1869, 1871 et 1873, avant de l'abandonner.
Chaque recensement coûte 50 000 $ et, dans le cadre des compressions budgétaires de 1875, on décide de n'en tenir un que tous les cinq ans, le prochain devant avoir lieu en 1880. En fait, le dernier aura été celui de 1873, sauf au Nouveau-Brunswick, où l'exercice se répétera jusqu'en 1879.
Le fait que la conscription ne soit pas appliquée n'empêchera pas plusieurs de pousser dans cette direction, dont les lieutenants-colonels Irumberry de Salaberry, A.C. Lotbinière Harwood et L.G. d'Odet d'Orsonnens, tous trois pouvant être considérés comme francophones. Or, cette levée, qui avait été traditionnelle sous le Régime français, va à l'encontre de la tradition britannique. De leur côté, les officiers généraux commandants insistent pour obtenir une plus grande force régulière par rapport aux milices non permanentes. Cette demande qui n'aura qu'un succès mitigé, se moule dans la tradition britannique, fondée sur le professionnalisme de l'armée, plutôt que celle existant à l'époque sur le continent européen, avec la conscription plus ou moins longue des jeunes hommes.
Les tenants de la conscription ont plusieurs arguments à faire valoir en leur faveur. Le premier, qui apparaît dans les années où les États-Unis sont menaçants, s'appuie sur le nombre insuffisant de volontaires. En 1868-1869, le district militaire de l'est du Québec a un quota de 5 035 volontaires qu'il ne peut réaliser qu'à 59 pour cent. Le 6e District militaire (Montréal et l'ouest du Québec), a un effectif autorisé de 3 228 en 1871, dont moins de 50 pour cent (1 512) participent aux exercices : le 4e Bataillon a 4 officiers et 46 hommes, ce qui est moins que le nombre admis pour une compagnie; le 65e (de Montréal) en a respectivement 17 et 158. En décembre 1873, au moment de l'inspection du 65e Bataillon, une compagnie est absente, celle du député A. Ouimet : l'exemple vient de haut pour les 18 autres officiers et 194 sous-officiers et soldats présents. Qui plus est, 66 pour cent des francophones ne poursuivent pas après la première année, malgré leur contrat de trois ans. Chez les anglophones du Québec, ce taux de non-renouvellement est de 33 pour cent, alors qu'en Ontario il est de 25 pour cent. En 1870, bien que 88 pour cent des cadres soient remplis pour l'ensemble du Canada, ce pourcentage tombera à 73 en 1873. Un des problèmes rencontrés ici est l'extrême mobilité de la population susceptible d'être enrôlée, laquelle est constituée en grande partie de jeunes journaliers sans attaches. Toujours est-il que la conscription par tirage au sort du nombre de miliciens permis par la loi ne se produira jamais. On voit mal comment, étant donné la quasi-absence de menace contre le Canada, elle aurait pu être justifiée et, surtout, acceptée par la population.
Les problèmes de la Force permanente
Cela étant, quelle est la valeur réelle de l'entraînement que reçoivent les volontaires sur qui l'on se fie, ne l'oublions pas, pour défendre le pays en cas de danger ou encore pour maintenir ou rétablir l'ordre à l'intérieur des frontières ? Commençons par la force permanente qui se développe jusqu'à son effectif permis de 1 000, dans les années 1880. Premièrement, ces 1 000 postes ne sont jamais remplis totalement (en 1890-1891, par exemple, il n'y en a que 886). Ensuite, une large proportion est formée de recrues ou de soldats peu expérimentés qui peuvent difficilement instruire de façon professionnelle le volontaire (le général Herbert, en 1891, remarque que 54 pour cent de son armée a moins de deux ans de service). Puis, il y a tous ceux qui, en cours d'année, ne sont pas disponibles. Toujours en 1890-1891, un rapport énonce ce qui suit : 103 rachètent leur contrat et partent durant l'année ; 201 terminent leur contrat ; 41 sont renvoyés pour diverses raisons ; 8 meurent ; 152 désertent ; et 28 vont en prison pour divers termes, ce qui fait perdre des périodes de service. En cette année qui n'est pas exceptionnelle, voilà que l'armée régulière doit entraîner quelques dizaines de milliers de miliciens, dont une grande proportion de recrues.
Mais, cette instruction est également donnée par les officiers qualifiés au sein même des corps de volontaires. Dans certains cas, cela peut aller ; dans d'autres, l'instruction est de piètre qualité. Plusieurs de ces officiers sont trop âgés, un lieutenant pouvant être en place à 40 ans passés : il est courant de rencontrer des majors de plus de 50 ans et des lieutenants-colonels dépassant les 60 ans. Les moins efficaces des officiers instructeurs se trouvent dans les corps ruraux, puisque dans les villes l'instruction est souvent entre les mains des professionnels.
Les problèmes du corps rural
Les difficultés des corps ruraux sont énormes. Un bataillon pourra être constitué de plusieurs compagnies séparées les unes des autres par 30 ou 50 kilomètres de routes mal tracées, ce qui rend à peu près impossible le rassemblement du bataillon, sauf au moment du camp annuel. Ainsi, en 1869, le Bataillon provisoire de Rimouski est formé avec cinq compagnies, dont une à Matane, à 100 kilomètres de Rimouski par une route peu praticable. Les capitaines de compagnie deviennent donc les éléments importants de l'organisation. Ce sont eux qui recrutent leurs hommes, souvent grâce à un mélange de charme et de demi-vérités qui rendent à peu près impossible l'imposition de la discipline militaire. De fait, la popularité du recruteur joue fréquemment un plus grand rôle que sa compétence militaire. La loi laisse aux officiers commandants la responsabilité de l'instruction. Or, il arrive que ceux-ci « signent encore aujourd'hui [1874] un certificat de compétence pour eux-mêmes ». Ils sont naturellement payés pour donner l'instruction [de 40 $ dans l'infanterie et la cavalerie jusqu'à 200 $ pour l'artillerie de campagne]. Dans les villes, une allocation par batterie ou compagnie formée sera payée au commandant de brigade ou du bataillon, d'où le grand nombre de compagnies, chacune ayant très peu d'effectifs : à 25 $ par année et par compagnie, pour le commandant, plus les 40 $ payés au capitaine, personne n'a intérêt à les voir disparaître. Cela entraîne, bien sûr, toutes sortes de difficultés. Lotbinière Harwood, à la suite d'une inspection du 65e Bataillon (Montréal), en décembre 1873, note qu'il lui est « impossible de donner des points au mérite. Le tir à la cible n'a pas été convenablement pratiqué... le 65e Bataillon n'a consommé qu'un très petit nombre de cartouches ». Pour obtenir leur argent, les unités doivent réussir l'inspection. Dans les campagnes, on réunit les hommes en vitesse, les capitaines sortent d'un endroit imprévisible (souvent une grange ou une cave) les armes que chacun s'astreint à faire briller au dernier moment. L'officier inspecteur, mis dans une position difficile, recommande le paiement qu'au fond il ne savait pas mériter. Mais, s'il est soucieux de ses devoirs, regarde les canons, les trouve rouillés à l'intérieur, fait défaire une platine qui fonctionne mal, on lui dit que s'il est si particulier, on ne pourra jamais maintenir des corps volontaires. D'Orsonnens, désabusé, d'ajouter que ceux qui critiquent ainsi les inspecteurs sont des officiers qualifiés par la loi, et entendent bien, avec l'allocation du gouvernement, dépenser le moins possible pour l'entretien de nos armes ; ils se donnent en général peu de peine pour exercer et instruire leurs soldats.
Quelques-uns d'entre eux seulement passent par les écoles militaires ce qui, on en conviendra, n'en fait pas automatiquement des instructeurs sachant transmettre leur savoir surtout à des hommes qu'ils ont souvent enrôlés en les amadouant. D'ailleurs, plusieurs de ceux qui vont à l'école militaire se contentent d'empocher la prime d'après-cours et disparaissent. Selon Gravel, qui a étudié à fond cette question, environ 75 pour cent des officiers de la milice volontaire non permanente ignorent plus ou moins complètement la chose militaire au milieu des années 1870. Après 1883, cet état de fait s'améliore sensiblement, mais cela n'ajoute guère à l'efficacité des unités. En effet, on s'attend à ce que l'unité urbaine s'entraîne deux fois par semaine, de 19 h à 22 h, durant les deux ou trois mois précédant l'inspection annuelle. Il y a aussi une journée de tir et un ou deux défilés à l'occasion de services religieux. En pratique, les effectifs sont souvent levés au dernier moment, de sorte que plusieurs volontaires n'ont même pas été assermentés lorsque se tient l'inspection annuelle. Bien sûr, quand la désorganisation est vraiment trop criante, on refuse l'exercice à l'unité (donc, la paie à ses officiers et à ses hommes). C'est ainsi que nombre de compagnies, et même de bataillons, disparaissent durant quelques années avant de renaître sous la poigne énergique d'un nouveau commandant ambitieux.
Les camps d’instruction
En plus de l'instruction au niveau de l'unité, il y a celle offerte dans les camps. À la suite de la loi de 1868, on s'est lancé avec force dans cette direction. Mais comme les budgets sont restés à peu près stables, et que les charges se sont accrues, conséquence, entre autres, de la naissance des Batteries A et B en 1871, il a fallu couper certaines activités. C'est ainsi qu'entre le ler juillet 1873 et le 30 juin 1874, les unités sont forcées de s'entraîner à leurs quartiers généraux respectifs, plutôt qu'en brigades et en camps, comme cela avait été le cas depuis 1868, ce qui fait dire à certains que l'on a commencé par où l'on aurait dû finir. En principe, on doit y faire 16 jours d'exercice d'au moins de trois heures chacun. Le reste des années 1870 ne sera guère propice aux grands rassemblements, surtout utiles aux corps ruraux.
Même lorsqu'il y a un camp, quelle est sa valeur réelle ? Après celui de 1872, du 6e District militaire, un des plus importants à se tenir jusqu'au XXe siècle, le lieutenant-colonel A.C. Lotbinière Harwood écrit à son supérieur que, malgré le succès rencontré, « ... il est de mon devoir de vous informer que la plupart des corps volontaires actuels pourraient à peine compter sur les deux tiers de leur effectif, en cas de nécessité immédiate ; et, dans plus d'une localité, il ne serait pas prudent, à cause de la population flottante, de compter même sur la moitié des hommes régulièrement enrôlés. » La situation est souvent pire que ce que ce rapport nous laisse entendre. En effet, sur les listes d'une compagnie on comptera souvent les absents pour cause de maladie ou autres raisons. Le nombre des absents peut être relativement élevé. Ceux-ci reçoivent pourtant la même solde que les autres. Cela rend aléatoire l'étude des statistiques concernant les camps, sans compter la démotivation que cette situation peut causer parmi ceux qui y participent vraiment. Pour donner un exemple, en 1882 le district de Québec déclare 1 706 miliciens exercés alors que seulement 1 049 sont présents, soit une différence de 657 hommes ou de 38 pour cent. Or, à l'échelle du pays, ce n'est guère mieux. Pourquoi cela ? Le major de brigade perçoit 8 $ par compagnie présente, il hésite donc à licencier celles comptant moins de 30 hommes sur le terrain. Un bataillon, en 1870, compte 125 présents pour 363 exercés. Bien qu'à partir de 1878, et avec le paiement de salaires fixes aux officiers d'état-major, ce genre d'abus tende à diminuer, la différence entre le nombre d'individus présents aux camps et ceux qui s'y sont véritablement exercés restera grande durant tout le XIXe siècle.
Si, au moins, le service de trois ans existait véritablement, les miliciens « exercés » seraient d'une certaine utilité pour les années subséquentes. Mais, les miliciens ne servent vraiment que la première année, leur défection relevant de divers facteurs. Dans les villes, c'est une population très mobile qui s'enrôle. Dans les campagnes, un chef de corps, voulant conserver sa popularité auprès de ses hommes et ses relations politiques, ne fera rien face à l'abandon, après une seule année de service, d'un contrat de trois ans.
Effectifs voluntaires et miliciens « exercés » en 1880. Renseignements portant sur le nombre de miliciens exercés dans les Corps urbains et les Corps ruraux dans quelques provinces en 1880.
Gravel a compilé des chiffres révélateurs, à ce sujet, pour l'année 1880 qui est une « bonne » année. On estime qu'entre 1876 et 1898, on a instruit en moyenne 18 500 soldats annuellement. Ce chiffre doit être tempéré par les exceptions que sont les hommes payés mais non « exercés ». Parmi ceux-ci, on peut inclure les musiciens et clairons, des sous-officiers qui sont présents en surnombre et ne font rien, les signaleurs et les ambulanciers (pour les bataillons urbains). Dans les bataillons ruraux, les domestiques des officiers, valets d'écurie, garçons de table, cuisiniers, etc.ne ne le sont pas. Du coup, l'instruction est réellement prodiguée à environ 14 000 hommes par année.
Cela dit, les ordres généraux qui régissent les camps .sont de petits chefs-d'œuvre de prévision et de prévoyance, signale cyniquement le lieutenant-colonel d'Orsonnens. C'est un fait que des directives pleuvent quant à l'organisation d'un camp, au transport pour s'y rendre ou en revenir, au genre d'instruction qui sera offert, la discipline (pas d'habits civils, la question des congés ou des permissions de nuit, par exemple).
Effectifs voluntaires et miliciens « exercés » en 1880. Renseignements portant sur le nombre de miliciens exercés dans les Corps urbains et les Corps ruraux dans quelques provinces en 1880.
Gravel a compilé des chiffres révélateurs, à ce sujet, pour l'année 1880 qui est une bonne année. On estime qu'entre 1876 et 1898, on a instruit en moyenne 18 500 soldats annuellement. Ce chiffre doit être tempéré par les exceptions que sont les hommes payés mais non « exercés. Parmi ceux-ci, on peut inclure les musiciens et clairons, des sous-officiers qui sont présents en surnombre et ne font rien, les signaleurs et les ambulanciers (pour les bataillons urbains). Dans les bataillons ruraux, les domestiques des officiers, valets d'écurie, garçons de table, cuisiniers, etc.ne ne le sont pas. Du coup, l'instruction est réellement prodiguée à environ 14 000 hommes par année.
Cela dit, les ordres généraux qui régissent les camps.sont de petits chefs-d'œuvre de prévision et de prévoyance, signale cyniquement le lieutenant-colonel d'Orsonnens. C'est un fait que des directives pleuvent quant à l'organisation d'un camp, au transport pour s'y rendre ou en revenir, au genre d'instruction qui sera offert, la discipline (pas d'habits civils, la question des congés ou des permissions de nuit, par exemple).
Lieutenant du 4th Regiment of Cavalry vers les années 1880 à 1890. Le 4e Régiment de la Cavalerie était une unité de la milice de l'Est de l'Ontario. Leur quartier général se situait à Prescott. En 1892, ils devinrent le 4e Hussards. La plupart des régiments de la cavalerie canadiens portaient des uniformes semblables au 13e Hussards britannique. Pour les officiers (la photo montre un lieutenant) la tunique bleue ainsi que la culotte étaient lacées d'une bordure dorée, et d'une bordure jaune pour les autres rangs. Les parementures, de couleur chamois, étaient si pâles qu'elles paraîssaient blanches. Toutefois, la coiffe des unités canadiennes étaient restreintes au casque colonial blanc ou du calot bleu. La reconstitution par Barry Rich.
Au fond, ce qui devrait choquer le plus, dans tout ce qui précède, c'est que la défense du pays repose beaucoup sur les unités rurales, les plus faibles de toutes. En 1891, l'officier général commandant, le major général Ivor Herbert écrit encore : L'instruction des unités rurales est très défaillante, mais leur organisation l'est encore davantage. Et ce qui y est fait n'est pas toujours efficace. Ainsi, le 7e District réunit ses unités à Rimouski, du 15 au 26 septembre 1891, plutôt qu'à Lévis, comme on l'avait fait jusque-là. Cela signifie que les bataillons de Trois-Rivières et de Lévis, entre autres, se déplacent à des dizaines de kilomètres plus loin que nécessaire. De plus, le lieu retenu à Rimouski n'est pas aussi satisfaisant que celui de Lévis. Cela dit, les bataillons du Bas Saint-Laurent sont mieux desservis en ce qui a trait aux distances.
Les lacunes de la milice
Manège militaire de l'avenue University, Toronto, 1909. Au début des années 1870, le gouvernement construisait des manèges militaires pour l'entraînement des volontaires. Sur la carte postale de l'avenue University à Toronto, en 1909, le manège militaire avait comme architecture une ressemblance aux fortifications médiévales. L'édifice a ouvert ses portes en 1891 et a été démoli en 1963, pour créer de la place pour un palais de justice. Lors de sa construction, le manège militaire était le plus gros édifice du genre au Canada. Il fut utilisé pour des foires, des événements sociaux et des exercices militaires.
En 1896, c'est au tour du major général WJ. Gascoigne, qui a succédé à Herbert en 1895, d'avancer qu'aucune troupe n'est prête à entrer en campagne. On a bien fait des réformes au fil des années : par exemple, sous Herbert, les écoles militaires ont été formées en régiments, on a choisi des sites permanents pour les camps annuels, on a mis sur pied un service de santé et des camps de qualification de six semaines pour les officiers et sous-officiers. Mais, on n'a toujours pas de magasins militaires et, en général, la milice est désorganisée et démoralisée ! Pourtant, la population semble satisfaite de ses forces de défense. La solde annuelle des miliciens est devenue une allocation très favorablement acceptée, en particulier dans les districts ruraux. Déjà, la Défense joue un rôle reconnu et apprécié dans l'économie régionale.
Un des rares avantages de la milice volontaire non permanente est qu'elle permet de reconnaître les hommes de bonne volonté. Mais, nous avons déjà remarqué plusieurs désavantages, et il y en a encore plus. La force de défense manque non seulement d'arsenaux, mais elle est aussi sujette aux pertes d'uniformes et d'équipements. Par ailleurs, elle n'accorde pas assez de pouvoir à l'état-major qui pourrait entacher l'autorité de plusieurs politiciens jouant au militaire dans leur communauté, sans parler de l'abus des grades.
En outre, charges et sacrifices sont imposés au volontaire. Ainsi, s'il rejoint son unité pour maintenir l'ordre public en lieu et place d'une police inexistante ou trop faible, il attendra des mois avant d'être payé. S'il part en campagne durant des semaines ou des mois, son employeur ne lui garantira pas toujours son emploi au retour. De plus, il laissera sa famille à des agences d'aide publique formées à la hâte pour l'occasion. S'il lui arrive malheur, la pension aux siens n'est pas assurée. Sans parler des réorganisations continuelles qui font passer les bataillons d'une brigade à l'autre ou d'un district militaire à un autre, qui font disparaître ou réapparaître des grades, qui effacent ou redonnent vie à des unités sans que personne ne sache trop bien à quoi répondent ces changements.
Caserne d'infanterie canadienne, vers 1890. Aperçu rare de la vie en caserne un soir en hiver dans une caserne d'infanterie canadienne, environ 1890. Dans une caserne d'infanterie, quelques hommes nettoient soit leur trousse, le sol, ou un fusil Snider-Enfield dans une caserne d'infanterie. L'ameublement comprend un lit pliant britannique en fer, table faite avec des jambes de fer, ainsi qu'un four qui était indispensable pendant un hiver canadien.
À l'époque, ceux qui se penchent un tant soit peu sur cette question en font toujours un constat détaillé assez négatif. Lorsqu'il s'agit d'imaginer une agression à laquelle le pays devrait faire face, on ne peut pas être très optimiste. Dans la revue américaine Journal of the Military Service Institution, un correspondant étranger anonyme, à l'évidence canadien, décrit un plan de mobilisation de la Milice canadienne qui serait soudainement chargée de la défense de la frontière entre Québec et Détroit. Dans les numéros 29 et 30 (mars et juin 1887), il explique qu'il faudrait disposer de 150 000 hommes, mais que l'on est bien loin de pouvoir en mobiliser un tel nombre. Et encore faudrait-il que la cause soit populaire, aussi bien auprès des francophones que des anglophones. Bien que cette évaluation se termine sur des aspects positifs, le long article laisse entendre que Montréal, le cœur industriel et économique du pays, serait à peu près indéfendable.
Les améliorations recherchées par les officiers généraux commandants
Y a-t-il des solutions ? On en propose en effet, surtout chez les officiers généraux et commandants successifs qui, au fil des années, parviennent à améliorer lentement le tout, en fondant leurs efforts sur la force permanente autant que le leur permet leurs ministres.
Des miliciens canadiens avancent aussi des solutions. Retenons celles proposées dès 1874 par le lieutenant-colonel Gustave d'Odet d'Orsonnens, qui occupera de nombreux postes au cours de sa carrière dans la Milice volontaire permanente, dont celui de commandant de l'école militaire créée à Saint-Jean, en 1883. Selon lui, les écoles du moment (peu nombreuses en 1874) devraient être remplacées par des régiments permanents au sein desquels tout aspirant à un grade dans la Milice volontaire non permanente devrait servir trois mois, dans l'arme qu'il a choisie. Cela sera plus ou moins appliqué dans les années 1880 et 1890, par une série de réformes qui prennent racine dans la loi de 1883.
D'Orsonnens désirerait également une armée régulière de quelques corps d'armes spéciales dont les capitaines pourraient être brevetés lieutenants-colonels de milice et commandante de régiments de miliciens en service actif. L'armée serait en quelque sorte une école d'état-major, dont les officiers formeraient l'état-major de la Confédération. En temps de paix, cette armée pourrait exécuter de grands travaux publics. Quant à la milice, elle reposerait sur la conscription, sauf dans les villes où l'on pourrait avoir des corps de volontaires qui s'enrôleraient pour une durée de quatre ans, avec des périodes annuelles d'instruction de 10 à 14 jours.
Ces milices volontaires seraient divisées proportionnellement entre les différentes régions du pays, mais comme les « volontaires » seraient conscrits, les bataillons seraient complets avec un effectif total de 15 040 hommes pour le pays (en 1874). Les deux premières années de leur service, ces miliciens s'entraîneraient dans leurs quartiers généraux respectifs, la troisième, il y aurait un camp au niveau de la brigade et, la quatrième, se tiendrait un camp au niveau de la division.
D'Orsonnens avançait surtout la représentation proportionnelle, proposant 82 divisions régimentaires en Ontario (avec 6 560 hommes) et 70 au Québec, avec 5 600 hommes - et à l'avenant pour le reste du pays. Selon lui « Assurer à chaque Province ses droits à fournir son contingent serait un acte de politique juste et raisonnable... mais assurer par une constitution bien ordonnée les droits de ses concitoyens (nationaux) serait remplir de plus un devoir sacré vis-à-vis de sa nationalité. C'est pourquoi il faudra maintenir les cadres (sic) de l'armée dans les proportions ci-haut (sic) données ; c'est une garantie pour l'avenir de chaque Province.
La place des francophones. La participation des francophones dans la milice
Tunique de l'Infanterie de la Milice volontaire canadienne, 1870-1876. La tunique de grande tenue fut le seul manteau d'uniforme à être distribué aux volontaires canadiens au 19e siècle. La coupe ressemble à la tunique britannique. Vers les années 1870, l'Armée britannique à modifier leur uniforme, afin d'avoir des tenues pour les événements de campagnes divers. La décoration que l'on aperçoit sur les manchettes de ce manteau est peu commune, car la plupart des unités avaient la décoration nommée le « noeud autrichien », tandis que celui-ci a seulement un point simple. Toutefois, l'on connaissait les variantes de ces noeuds. Ce manteau se retrouve dans la collection canadienne du Musée de la guerre.
Il y a déjà, en effet, un problème francophone au sein du système de défense canadien. Avec environ 35 pour cent de la population canadienne, jusqu'en 1914, les francophones n'occupent que 20 pour cent des effectifs militaires et autour de 10 pour cent des postes d'officiers (selon les années). Entre 1876 et 1898, le RMC forme une dizaine d'officiers francophones sur les 255 qui y ont obtenu une commission (4,7 pour cent). En consultant la Militia List of the Dominion of Canada, pour 1888, on note les chiffres qui apparaissent dans le tableau ci-dessous, pour les officiers de la Milice permanente.
« Nous n'avons pas la proportion d'officiers que nous pourrions réclamer », conclut là-dessus un admirateur du ministre Adolphe Caron. Et d'ajouter : « Mais cela n'est la faute ni du ministre, ni des officiers, mais bien du fait que nos gens ne donnent pas au service militaire toute l'attention à laquelle il a droit. »
Dans le 6e District militaire (Montréal) on ne trouve, entre 1868 et 1873, aucun officier canadien-français dans l'artillerie ou le génie. Pourtant, en 1871, alors que le péril fenian est encore présent et que George Étienne Cartier est ministre de la Milice et de la Défense, le colonel Robertson Ross, adjudant général de la Milice, estime que plus de 2 000 des 5 310 hommes [officiers compris] des 5e et 6e Districts militaires, en entraînement au camp de Laprairie, sont francophones. Par la suite, les États-Unis ne sont plus aussi menaçants. Et, partout au Canada, comme on l'a vu, la milice voit sa place décroître, de même que les budgets, durant une dizaine d'années.
Soldat du 65th Battalion (Mount Royal Rifles) vers 1880 à 1885. Ce battaillon de Montréal portait un uniforme vert foncé, inspiré du régiment des armes à feu à canon britannique. Au cours des années 1880, le 65e Bataillon a retenu le shako d'inspiration française, abandonné par les régiments des carabiniers britanniques vers 1870. Le 65th Battailion (Mount Royal Rifles) n'a pu avoir le titre français qu'en 1902, alors qu'ils prirent le nouveau nom de « 65th Regiment Carabiniers Mont-Royal ». Les bataillons carabiniers portaient de l'équipement noir (au lieu des équipements blancs des autres infanteries). Sur cette photo, un homme tient une carabine courte Snider à deux anneaux de fixation « Mark II ». Cette carabine fut émise aux unités carabiniers, ainsi qu'aux sergents de l'infanterie. En 1885, le 65th Battailion combattirent avec l'« Alberta Field Force » du major-général Strange contre les Cris à Frenchmen's Butte. La reconstitution par Ronald B. Volstad.
Parallèlement, la tradition britannique s'implante avec de plus en plus de force. Après avoir refusé les unités de Zouaves durant la menace feniane (ce qui n'est guère encourageant pour les francophones qui les avaient proposées), tout est concocté en fonction du centre de l'Empire : les uniformes, les règlements militaires et les échanges d'officiers et d'instructeurs. Dans le Rapport de la Milice de 1878, Selby Smyth rappelle que le gouvernement britannique approuve, voire « désire l'assimilation sous tous les rapports de la milice canadienne avec l'armée anglaise ». Les officiers généraux commandants travaillent à faire avancer cette cause.
Dans l'armée régulière, qui fournit l'instruction aux miliciens non permanents, se trouvent beaucoup d'anciens militaires britanniques qui ont choisi le Canada à la fin de leur contrat avec l'armée britannique. La langue de travail est l'anglais. On commande en anglais et la correspondance échangée entre deux francophones est rédigée en anglais. Les exercices annuels se tiennent aussi en anglais, ce qui crée des problèmes pour les nombreux unilingues francophones. Au moment des camps, les traductions improvisées à l'intention des francophones unilingues ralentissent leurs progrès. Quant aux officiers francophones, pas plus compétents militairement que leurs collègues anglophones, ils parlent plus ou moins bien l'anglais, ce qui les frustre dans leurs efforts. Les traductions des manuels sont rares et toujours en retard. Comme la milice n'intéresse guère les gouvernements (sauf quand ils en ont besoin), chacun apprend vite à se débrouiller seul. Louis-Timothée Suzor a traduit, à ses frais, un livre d'exercices paru en 1863 et remplacé dès 1867. Ce dernier ne sera pas traduit jusqu'à ce qu'un autre Field Exercice prenne la relève, en 1877. En 1885, celui-ci est traduit par David Frève, à sa propre initiative. Mais, dès 1888, les Britanniques lancent une série de nouveaux manuels qui ne seront toujours pas accessibles en français en 1914. S'il y a traduction, l'officier francophone doit payer le livre, alors que son collègue anglophone reçoit le sien gratuitement et dans sa langue. Tout cela conduit à des difficultés ainsi qu'à l'introduction, dans le français du militaire francophone, d'une foule de termes anglais mal assimilés. Par-dessus tout, cette situation sert de repoussoir au francophone.
Au niveau des officiers de la Milice non permanente (qui deviennent des instructeurs, ne l'oublions pas), les choses se compliquent encore plus. Dans un premier temps, les cours sont en anglais. Puis, à compter des années 1880, les bataillons ouvrent souvent leurs propres écoles avec des cours obligatoires, pour les officiers, sanctionnés par des examens de district. Ainsi peut-on enseigner un peu dans la langue de l'individu les rudiments d'une profession qui, en pratique, ne s'exerce vraiment qu'en anglais.
Pourtant, entre 1867 et 1898, les ministères de la Milice et de la Défense aura trois ministres francophones (18 des 31 années). Entre 1868 et 1898, le poste de sous-ministre sera aux mains de francophones (en fait, ce sera le cas jusqu'en 1940). Il faut se poser des questions quant à la véritable volonté de ces hommes de faire avancer la cause de leur langue dans la Milice. Pour les seules traductions des livres d'exercices, cela a pris des années de pression du ministre pour obtenir de l'officier général commandant la permission de publier le travail de Frève.
Officiers de la Milice permanente en 1888. Ce tableau présente des renseignements sur les officiers francophones et anglophones dans les unités divers de la Milice permanente canadienne.
Le contexte social et économique des francophones
Selon d'Orsonnens, une autre raison, au moins, milite contre la participation des francophones. Lorsqu'il a demandé à certains des siens pourquoi ils ne formaient pas autant de compagnies de volontaires que les Canadiens d'autres origines, on lui a répondu : C'est bon pour les Anglais, ils sont riches, nous, nous sommes pauvres, nous ne pouvons perdre ainsi volontairement notre temps, on nous retrancherait nos crédits ; qu'on nous force, nous subirons la loi comme les autres ; bien plus, nous la subirons avec plaisir.
Ce que l'on retrouve dans cette réponse c'est, en résumé, le message de conscription que d'Orsonnens développe plus longuement ailleurs et, en ce sens, nous ne devrions pas la prendre au pied de la lettre. Tout de même, on peut conclure que le Canadien français, qui s'enrôle dans les conditions défavorables décrites, possède un sens du devoir militaire bien au-dessus de la moyenne. Cela dit, le problème central de la sous-représentation des francophones au sein de la défense canadienne, dès les débuts de la Confédération, aura des répercussions majeures plus tard. Personne ne semble vouloir s'attaquer à cette question pendant qu'il en est encore temps.
Menaces intérieures et extérieures
La toile de fond de la rébélion du Nord-Ouest
Entre 1871 et 1898, l'événement qui va marquer le plus fortement la jeune force de défense canadienne ne sera, sans contredit, constitué par la seconde rébellion métis qui, au printemps 1885, secoue les Territoires du Nord-Ouest. Cette crise est provoquée par des conditions à peu près semblables à celles qui prévalaient en 1870 dans la région de la rivière Rouge. Les germes du conflit sont semés dès 1872 quand, négligeant les Métis, des émissaires gouvernementaux signent un traité avec les autochtones de la région de Qu'Appelle.
Suivent bientôt des arpenteurs qui se mettent à fractionner les grands espaces libres en terres à coloniser. De 1878 à 1884, les Métis expédient à Ottawa des dizaines de requêtes réclamant la reconnaissance de leurs droits sur des terres qu'ils occupent parfois depuis plus d'une génération. Rien n'y fait. Le premier bureau d'inscription des titres dans ces territoires ouvre à Prince Albert en 1881, alors qu'au Manitoba de nombreux différends et cas de fraude entourent toujours les ententes de 1870.
Cette situation exacerbe les Métis, dont plusieurs ont reflué du Manitoba vers l'ouest devant l'envahissement des terres par des colons qui menaçaient leur mode de vie. Au mois de mai 1884, le Conseil des Métis de Batoche tient une réunion au cours de laquelle son chef, Gabriel Dumont, fait adopter une résolution invitant Louis Riel à venir se porter à la défense de ses frères.
Marié, Riel vit alors au Montana, où il enseigne à la mission Saint-Pierre. Les délégués des Métis de la Saskatchewan débarquent chez lui le 4 juin. Cinq jours plus tard, Riel démissionne de son poste et, le lendemain, il prend la direction du nord. Le Riel de 1884 est plus exalté qu'autrefois. Il croit désormais que lui incombe la mission de conduire Métis et Indiens et de faire en sorte qu'ils soient unis en un seul peuple.
Entre le moment où il arrive à Batoche et la fin de l'hiver, en 1884-1885, le silence d'Ottawa devant les réclamations des Métis a nourri un climat d'agitation qui atteint son paroxysme au moment où, de retour de Winnipeg, un employé de la Compagnie de la baie d'Hudson, annonce aux Métis que des policiers déterminés à écraser leur fronde et à mettre Riel aux fers sont en route. Le 19 mars, lors du rassemblement traditionnel soulignant la fête de saint joseph, leur saint patron, les Métis se donnent un gouvernement provisoire présidé par Louis Riel et par un adjudant général, Gabriel Dumont. Batoche devient la capitale de ce gouvernement et, bientôt, le poste que les autorités gouvernementales canadiennes voudront abattre.
L'action est au programme de ceux qu'on désigne sous le nom de rebelles et qui tentent principalement d'obtenir l'adhésion des autochtones à une cause qu'ils veulent commune. Le succès de l'opération diplomatique est mitigé puisque très peu d'Amérindiens se joindront effectivement aux Métis. Désireux d'exercer le plein contrôle du terrain géographique, le gouvernement de Riel et de Dumont réclame, de la Police montée du Nord-Ouest, la cession des forts de Carlton et de Battleford. À ce stade, les pions sont tous en place pour que survienne la tragédie.
Le gouvernement provisoire veut s’imposer
Fort Pitt, poste de la Police montée du Nord-Ouest. Fort Pitt fut construit comme un poste de commerce et d'apprivisionnement pour la compagnie de la Baie d'Hudson en 1829. Par la suite la Police montée du Nord-Ouest pris possession du fort. Finalement, en 1885, c'est un détachement de vingt-cinq policiers, dirigé par l'inspecteur Francis Dickens (fils de l'auteur Charles Dickens) qui s'installa au Fort Pitt. Fort Pitt fut assiégé, lors des hostilités entre les Cris et le gouvernement canadien, en avril. La police Garrison abandonna le poste, en se réfugiant au Fort Battleford. Cette gravure contemporaine a été tirée du « Illustrated London News ».
Les policiers ne sont évidemment pas disposés à obéir aux rebelles. Le commissaire adjoint Lief N.F (Paddy) Crozier qui commande le poste de Carlton n'est pas homme à céder. De plus, il tient au contrôle du comptoir de traite du lac au Canard, situé entre Carlton et Batoche, où sont rassemblées provisions et munitions. Si, localement, l'enjeu revêt une certaine importance, il ne vaut guère une bataille mal préparée. On conseille à Crozier de ne pas bouger avant l'arrivée de renforts mais, poussé par quelques volontaires zélés, sûr de son bon droit et de sa force, il part à la tête de 55 hommes. Cette initiative lui coûtera cher.
Le 26 mars, alors qu'il marche vers le lac au Canard, qu'il sait être déjà sous contrôle métis, un parti de Métis dirigé par Gabriel Dumont lui tend une embuscade. Le combat est bref et violent, faisant 12 morts et 11 blessés parmi les policiers. L'effusion de sang surprend et déconcerte Riel qui s'oppose à ce que Dumont poursuive les policiers qui, dans la déroute, ont abandonné une partie de leurs morts, de leurs blessés et de leur équipement sur le terrain.
Louis Riel, 1870-1871. Cette image de Louis Riel fait partie d'une photographie des membres du conseil du gouvernement provisoire des Métis, 1870-1871.
La victoire de Dumont a lancé sur le sentier de la guerre plusieurs groupes amérindiens. Divisés, les policiers auraient pu être des victimes faciles. Le 28 mars, abandonnant le fort Carlton, ils se replient donc sur Prince Albert. Plus à l'ouest, dans la région de Battleford, d'autres membres des forces de l'ordre s'enferment dans leur poste avec la population blanche, livrant les environs à des groupes de Cris et de Pieds-Noirs. Plus à l'ouest encore, au lac à la Grenouille, des Amérindiens massacrent quelques colons.
Au début d'avril 1885, au moment où Ottawa constate enfin que le contrôle des opérations sur la rivière Saskatchewan Nord lui a échappé, le leader métis comprend que ses alliés autochtones ne sont pas entièrement sous son contrôle.
Le gouvernement canadien s’organise
Si Riel a changé, la situation qui prévaut dans l'ensemble de l'Ouest canadien de 1885 n'est plus celle qu'il a connue en 1870. Bien entendu, des aventuriers américains pourraient à nouveau envenimer le conflit, mais ces éléments perturbateurs sont moins menaçants que les Fenians qui, dans l'affaire de la rivière Rouge, n'avaient joué qu'un rôle mineur. Ce qui a vraiment changé se situe au niveau des moyens dont dispose le gouvernement canadien pour réprimer la rébellion. Le plus important est sans doute le chemin de fer dont l'efficacité a amplement démontré sa valeur militaire ailleurs dans le monde, notamment au cours de la guerre civile américaine et dans le conflit franco-prussien. La voie transcontinentale va devenir un élément déterminant dans la réaction d'Ottawa où l'on sait qu'il est désormais possible d'atteindre l'Ouest en quelques jours sans devoir circuler en territoire américain.
Le 23 mars, quatre jours après la proclamation du gouvernement provisoire de Riel, le premier ministre Macdonald réagit en confiant au major général Frederick Middleton, commandant de la Milice canadienne, la tâche d'organiser la contre-attaque. La milice locale est la première à recevoir l'ordre de se tenir prête à partir. Middleton est rendu à Winnipeg quand, le 27 mars, au lendemain du combat du lac au Canard, il part vers Qu'Appelle à la tête du Winnipeg Rifles. En quelques semaines, plus de 8 000 hommes venus du Québec et de l'Ontario seront rassemblés sous son commandement. Certaines des unités de l'Ouest marcheront sous le commandement du général Thomas Strange, premier commandant de la Batterie B et de l'école d'artillerie, qui s'est retiré près de Calgary, ou sous celui du colonel William Otter.
La stratégie de Middleton est simple : distribuer ses forces sur trois colonnes qui iront vers le nord. Le commandant dirige lui-même celle qui part de Qu'Appelle vers Batoche. Otter conduit sa colonne de Swift Current en direction de Battleford, pendant que Strange quitte Calgary vers la rivière Saskatchewan Nord dont il suivra ensuite le cours vers l'est.
La force conduite par Middleton. L’avance vers batoche
Bataille de Fish Creek, le 24 avril 1885. Cette estampe de la bataille de Fish Creek, le 24 avril 1885, fut tirée d'esquisses dessinées par un milicien de Toronto, qui faisait partie de la colonne du « General Middleton ». Cent cinquante Métis et Teton Sioux, dirigés par Gabriel Dumont, ont tentés de tendre une embuscade à neuf cent Canadiens, alors qu'ils arrivaient au ravin profond de Fish Creek. La Milice, très peu expérimentée, a passée la journée à tenter de bouger Dumont de sa position, mais sans succès. Même si c'était une impasse, les Canadiens ont reculé et cessé de se diriger vers Batoche pendant deux semaines. Les personnages en vert sont du 90th Winnipeg Battalion of Rifles, tandis que ceux en rouge sont du 10th Battalion Royal Grenadiers (ils n'ont pas vraiment participés à la bataille).
La confiance entretenue par le général Middleton à l'égard de ses soldats-citoyens est limitée, sans doute parce qu'il connaît les défaillances de la formation dispensée à la plupart d'entre eux, l'expérience militaire des autres n'ayant d'assises que dans leur bonne volonté. Avant leur départ, ses troupes reçoivent donc un minimum d'entraînement obligatoire. Plusieurs miliciens exécutent dans ces circonstances leur premier tir d'exercice avec des armes souvent mal entretenues, mal entreposées ou depuis longtemps inutilisées. La compétence et l'expérience des hommes détachés auprès d'Otter et de Strange sont équivalentes et fort peu rassurantes.
Canon de 9 livres, lors de la bataille de Fish Creek, le 24 avril 1885. Cette photo, d'une arme de l'A Battery, Regiment of Canadian Artillery, fut prise lors du combat à Fish Creek, le 24 avril 1885. Le capitaine James Peters de la Batterie A, amateur de la photographie, avait apporté sa caméra dans le Nord-Ouest. Il semblerait qu'il aurait pris les premières photos de l'histoire d'une bataille.
La progression de Middleton vers Batoche est très lente. Méfiant, le général britannique a présent à la mémoire le sort réservé au lieutenant-colonel américain George Armstrong Custer, à Little Big Horn, en 1876, par des Indiens. La leçon servie tout récemment à la troupe de Crozier est bien vivante. Lorsqu'on lui rapporte que les Métis sont retranchés de chaque côté de la Saskatchewan Sud, il fait traverser le cours d'eau à près de la moitié de ses troupes, s'écartant encore plus d'un principe de guerre qu'il a déjà mis à mal avec sa formation en trois colonnes : celui de la concentration des forces. Ce n'est pas toujours une erreur d'agir comme il le fait mais, dans le cas présent, c'en est une. Le 24 avril, la troupe qui a marché du côté est de la rivière, celui où s'élève Batoche, est embusquée à l'Anse-aux-poissons. Après avoir subi quelques pertes, Middleton commande une retraite et une pause qui durera deux semaines.
La bataille de Batoche
Gabriel Dumont, commandant militaire des Métis en 1885. Gabriel Dumont (1837-1906) était une personne de tactique brillante. Les historiens concèdent, généralement, que si Dumont avait contrôlé pleinement les opérations des Métis en 1885, les volontaires canadiens auraient eu une campagne beaucoup plus difficile. Cette photo date probablement de la période où Dumont voyageait avec le spectacle « Buffalo Bill's Wild West Show », après la Rébellion.
Pendant ce temps, Riel expédie un message à ses alliés autochtones pour qu'ils le rejoignent à Batoche ou se dessine un affrontement décisif. Ceux-ci mettent peu d'empressement à répondre, si bien qu'au début du mois de mai, Middleton, qui a réuni tout son monde du côté est de la rivière, peut reprendre son avance. Son action est mieux préparée. Ses forces ont été regroupées et elles ont reçu une formation complémentaire. La logistique a été renforcée par l'utilisation d'un petit vapeur qui, posté devant Batoche, servira d'appui-feu aux miliciens qui attaqueront les positions terrestres des Métis. À compter du 10 mai, Batoche est assiégée et les troupes fédérales s'installent dans une guerre de position qui frustre beaucoup de miliciens conscients de disposer de la force du nombre et de la puissance des armes, des canons, une mitrailleuse Gatling et des centaines de fusils. Quand les coups de feu diminuent, on comprend que les Métis sont à court de munitions. Le 12, incapables de supporter plus longtemps l'inaction, deux régiments suivent leurs colonels à l'attaque : les retranchements et le village cèdent facilement. L'ensemble de l'opération a coûté 12 morts et 3 blessés aux Métis. On compte 8 morts et 46 blessés parmi les hommes de Middleton.
À l'heure des bilans, Louis Riel et Gabriel Dumont ne sont plus avec les leurs. Le 15 mai, ayant refusé de suivre Dumont dans un autre exil américain, le premier s'est rendu.
Une maison métise brûle à Batoche, le 9 mai 1885. Tôt le matin du 9 mai 1885, lorsque l'Armée canadienne se rendait vers l'église à Batoche, une attaque a eu lieu, provenant de deux maisons à l'extérieur du village. Ce fut le premier geste de la bataille, d'une durée de quatre jours, à Batoche. La Batterie A a ouvert le feu sur le Régiment de l'artillerie canadienne, tandis que les tireurs d'élite métis ont fuis. La Milice mis le feu aux maisons, afin d'éviter d'être réutilisées comme cachette par les Métis. Le commandant de la Batterie A, un photographe amateur, a capturé la fumée dans cette photo, et il l'a nommée « Opening the ball at Batoche ». Les chevaux et les artilleurs peuvent être vus, l'autre côté de la clotûre à droite.
Bataille de Cut Knife Hill, le 2 mai 1885. Trois cent cinquante milices canadiennes, dirigés par lieutenant-canadien Otter, ont attaqués un camp de Cris des plaines, à l'aube du 2 mai 1885. Surpris, les Cris ont quand même livrés une dure bataille sous le chef de guerre, Fine Day. Alors que les Canadiens se sont retirés plus tard dans la journée, les Cris ont cessé leurs poursuites envers leurs adversaires, sous l'influence du chef Poundmaker. Quelques historiens croient qu'Otter et ses hommes, peu expérimentés, aient été sauvés du massacre.
Partis de Swift Current, situé à l'ouest de Qu'Appelle, Otter et ses hommes ont pris la direction du nord. Au cours de la troisième semaine d'avril, ils atteignent Battleford où ils assurent d'abord la sécurité des Blancs du village. La colonne pivote ensuite vers le sud-ouest où des éclaireurs ont repéré des maraudeurs autochtones responsables de meurtres et d'exactions à Battleford et aux environs. Avançant de nuit vers leur camp aménagé près de la colline du Couteau-cassé, Otter est découvert avant d'attaquer, perdant ainsi l'avantage de la surprise. Le 2 mai, au terme d'une journée d'un combat indécis, les militaires se replient sur Battleford.
Conduits par le chef Faiseur d'Enclos, qui suit les directives de Louis Riel, les autochtones prennent alors la route de Batoche. Le 14 mai, ils s'emparent d'un convoi de ravitaillement destiné à Battleford. À cette date, les Métis ont été battus à Batoche et, ayant compris que l'entreprise est sans issue, la troupe de Faiseur d'Enclos commence à se disperser. Après neuf jours d'un dangereux jeu de cache-cache, le chef amérindien arrive à Battleford où il rend les armes.
La colonne Strange. La marche et la poursuite de Big bear
Strange a quitté Calgary en direction de la rivière Saskatchewan Nord qu'il compte redescendre vers Battleford, complétant ainsi le mouvement de nasse ordonné par Middleton. À la fin du mois de mai, il atteint la Butte-aux-Français où il surprend les Cris. Le groupe de Gros-Ours relève rapidement la tête et se retranche en ce lieu qui domine les points stratégiques de la région, la rivière ainsi que Fort Pitt. S'ils veulent en découdre au corps à corps avec les 600 hommes de Gros-Ours, les miliciens de Strange doivent traverser un terrain marécageux et s'exposer. Au moment où, malgré une puissance de feu très supérieure à celle de l'ennemi, l'officier décide de retraiter, les Cris s'apprêtaient à faire de même. Le 1er juin, après avoir reçu les approvisionnements qui lui manquaient, Strange remonte à l'assaut pour découvrir que la Butte-aux-Français a été abandonnée. Les Cris ayant commencé à se subdiviser, Strange n'engage pas la poursuite. Deux jours plus tard, il est rejoint à Fort Pitt par près de 900 hommes conduits par Middleton. Ce dernier organise aussitôt la battue, mais il garde près de lui tous ses hommes, y compris ceux de la cavalerie légère, et avance à nouveau lourdement. Les chariots sur lesquels 120 soldats ont pris place s'enfoncent dans la terre à peine dégelée du nord de la Saskatchewan.
Ce mouvement ne produit aucun résultat. Le 4 juin, au lac au Canard, des cavaliers du colonel Sam B. Steele échangent quelques coups de feu avec des guerriers de Gros-Ours. Ce combat sera le dernier de la campagne, les Cris ayant choisi d'abandonner la lutte. La reddition de Gros-Ours aura lieu le 2 juillet suivant, près de Fort Carlton.
Les résultats de la rébellion
Ainsi, le feu de brousse allumé par l'insurrection a-t-il été circonscrit et éteint. Temporairement éclipsées par l'activité militaire, la loi et la politique vont recouvrer leurs droits. Après un procès et un jugement très controversés, Riel sera pendu, le 16 novembre 1885. L'événement provoque le premier schisme important entre le Parti conservateur et les Canadiens français dont bon nombre ont pris fait et cause pour les Métis et pour leur chef. En 1887, les Québécois retirent aux Conservateurs le gouvernement des affaires de la province et portent au pouvoir le nationaliste Honoré Mercier.
Le bilan de la campagne. Une victoire terne
Personnel et patients, de l'hôpital de campagne à Moose Jaw, en 1885. Un groupe de religieuses anglicanes de Toronto ont travaillé dans un hôpital, de quarante lits, à Moose Jaw, durant la Rébellion de 1885. Elles prirent soin des blessés et des malades, lors des batailles à Batoche et à Fish Creek. Douze femmes ont fait partie du premier groupe organisé d'infirmières dans l'histoire canadienne militaire. Notez le groupe des patients blessés, au centre, deux d'entre eux ayants perdu un bras.
Les Métis et leurs alliés autochtones étaient mal préparés et, par conséquent, incapables de rivaliser véritablement avec la force militaire rapidement déployée contre eux. Malgré quelques batailles bien menées et quelques victoires isolées, leurs chances de vaincre étaient presque nulles dès le départ.
Si le gouvernement célèbre ce triomphe militaire, il n'ignore pourtant pas que son indécision a nourri la tragédie qui vient de prendre fin. Dès l'instant où il réagissait au soulèvement des Métis, le Canada mobilisait 8 000 hommes dont 2 648 étaient affectés à la logistique. L'Ontario en fournissait 1 929, le Québec, 1 012, et la Nouvelle-Écosse, 383. Venus de l'Ouest, 2 010 miliciens et 500 gendarmes et membres de gardes civiles locales se joignaient à eux. Le 27 mars, les Batteries A et B et le 65e Bataillon des carabiniers de Montréal, première unité de milice mobilisée dans ce conflit, étaient appelés au combat. Le lendemain, la liste des unités participantes s'allonge, couvrant bientôt toutes les régions du pays.
Quant au ministre, sir Adolphe Caron, il se dépensa sans compter pour qu'un système de logistique et de transport reposant presque exclusivement sur l'entreprise privée soit mis sur pied. Le fait que la milice ait été mal préparée aurait inspiré cette solution où patronage et politique ont pu faire le meilleur des ménages. Le gouvernement paya une note salée, soit 4,5 millions de dollars, une somme remarquablement élevée en cette fin du XIXe siècle.
Presque rien n'avait été planifié en fonction d'une telle campagne. En quatre jours, on improvise les services de santé et d'approvisionnement militaires. On ne s'inquiète pas devant un armement de base disparate. On part en guerre avec des carabines et des fusils Snider, Winchester et Martini-Henry. On emporte, à l'avenant, trois types de munitions dont la distribution, à des unités parfois très éloignées les unes des autres, est problématique. Il arrive que ces munitions soient inutilisables ou manquantes. Ainsi, Strange atteint la Butte-aux-Français avec seulement 22 obus de canons. Le leadership est des plus faibles, mais Middleton attribuera sa lenteur et ses atermoiements à l'inexpérience de ses subordonnés auxquels il a refusé sa confiance, ce que ces derniers lui ont bien rendu. D'après le général, c'est lui qui a empêché que l'engagement de Batoche se solde par un échec. Mais on ne peut oublier qu'il ne sait ni utiliser ses forces montées, ni faire manœuvrer ses troupes, et que son attitude timorée est à l'origine du manque de mordant de ceux qui obéissent à ses ordres.
La revanche des métis
Confrontés à cette machine qui, face à un ennemi vigoureux, aurait été facilement battue, on trouve à peine 1 000 insurgés, dispersés, mal armés, manquant de vivres et de munitions. Le courage de la petite troupe de Batoche, qui se bat pour une cause perdue, surprend Middleton qui est également impressionné par la force de sa position ainsi que par l'ingéniosité et le soin investis dans la construction des tranchées-abris. La faiblesse du vaincu va temporairement permettre au vainqueur de pavoiser mais, une quarantaine d'années après les événements, la Société historique métisse prédit avec justesse que « le temps n'est pas éloigné où l'Ouest canadien saluera (les Métis de 1870 et de 1885) comme des précurseurs et des libérateurs».
Middleton va rendre compte de son expédition. Témoin, en 1885, au procès de Louis Riel, il comparaît, cinq ans plus tard, devant un comité spécial de la Chambre des communes pour répondre de ses actes en rapport avec la saisie, par la Police montée du Nord-Ouest, de fourrures appartenant à un Métis qui, à sa libération après les événements de Batoche, n'a pas pu en reprendre possession puisqu'elles avaient disparu. Sur la déclaration du plaignant, on remonte la filière jusqu'à Middleton qui, prétend-il, avait le droit de faire saisir les peaux que quelqu'un d'autre avait volées. Le comité déclare les saisies injustifiées et illégales et la conduite de Middleton dans cette affaire est décrite comme étant inqualifiable. Il quitte le Canada sous la réprobation quasi générale. Il n'est pas le premier des « héros » militaires canadiens à être jugé, à la fois pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire la campagne, et pour ce qu'il n'a pas fait, voler des fourrures. En 1896, les autorités britanniques lui confient la charge prestigieuse de gardien des joyaux de la Couronne, une « belle revanche contre ceux qui l'avaient chassé du Canada comme un voleur
Le 9e bataillon et la campagne du Nord-Ouest
Plusieurs bataillons ont, sous une forme ou sous une autre, témoigné de leur participation à la campagne du Nord-Ouest. Le 9e, de Québec, est l'archétype de ces troupes. Cette unité est commandée par Guillaume Amyot. Son entourage est principalement composé de Canadiens français dont les compatriotes ne sont pas favorables au combat mené contre les Métis de Louis Riel.
L'ordre de mobilisation du bataillon est reçu le 31 mars. Le 2 avril suivant, 236 hommes, dont 28 officiers, sont prêts à partir. Or, du 13 au 25 mars, le 9e Bataillon s'est entraîné avec 22 officiers et 336 soldats. Opinions politiques, études ou emplois privent le bataillon d'une centaine de miliciens qui ne le suivront pas sur la route de l'Ouest. Par ailleurs, le nombre d'officiers augmente avec l'ajout de fils de bonne famille. Au dernier moment, l'effectif intègre donc un fils du juge Adolphe Routhier, un du député provincial Joseph Sheyn, un du député fédéral P-B. Casgrain, et deux du sénateur Jean-Baptiste Fise
Dans le journal de marche qu'il a publié plus tard, le soldat Georges Beauregard rend compte de l'ambiguïté de la situation des soldats canadiens-français. « Le gouvernement, écrit-il, a décidé de déranger notre petite vie tranquille pour nous envoyer contre Indiens et Métis : il a ses raisons qui ne nous regardent pas, car nous ne faisons pas de politique et ne discutons pas les ordres des autorités militaires. ». Il n'en demeure pas moins que les volontaires se font rappeler par plusieurs de leurs connaissances qu'ils s'en vont « faire la guerre à nos frères, à des Français (sic) comme nous ... ». Cette perspective n'est pas très gaie et la création du comité d'aide aux familles des volontaires, formé de bénévoles, rappelle que l'armée fait bien peu pour ceux qu'elle envoie au combat.
Quant au voyage vers l'Ouest, il fournit amplement matière à réflexion. Les hommes sont entassés dans des wagons parfois ouverts. Là où la voie ferrée n'a pas été complétée, on les transfère sur des chariots et, au nord du lac Supérieur, ils subissent les désagréments d'un printemps qui se cherche à travers la chaleur, le froid et de fréquentes tempêtes de neige. Le 9e Bataillon n'a pas encore vu le feu que deux de ses soldats meurent, emportés par les rigueurs du voyage. L'un d'eux laisse dans le deuil une femme et plusieurs enfants dont le comité d'aide prendra la charge avant et même après le versement de la dérisoire pension gouvernementale.
La tâche du 9e Bataillon consiste essentiellement à assurer la sécurité des lignes de communications. Subdivisés en petites escouades, les hommes sont répartis entre Calgary et Fort McLeod ; pour tout abri, ils ont des tentes où peuvent dormir six soldats. Les Compagnies 3 et 4 s'établissent à Gleichen, Crowfoot et Langdon, postes situés le long de la voie du Canadien Pacifique. Dans ce secteur, elles rencontreront maintes fois les Indiens, dont elles voudront soulager la criante misère. Cette attitude incite l'historien Jean-Yves Gravel à comparer, assez justement, le rôle de cette unité à celui accompli depuis plus de 50 ans par les soldats canadiens au titre du maintien de la paix dans le monde. Faut-il s'étonner qu'après un voyage d'un mois pour atteindre Calgary et un séjour de deux mois dans des postes isolés, il ne se soit trouvé aucun volontaire du 9e Bataillon désireux de rester en garnison sur place ? Dans la plupart des autres unités, les hommes étaient également impatients de rentrer chez eux.
La campagne du Yukon
Soldat, The Royal Canadian Regiment of Infantry, uniforme d'hiver, vers 1899. Pour complémenter les uniformes d'hiver de l'Infanterie canadienne, les soldats avaient aussi accès à des chapeaux de fourrures, des écharpes, manteau d'hiver du style de l'armée britannique, mitaines et bottes chaudes.
À la fin du XIXe siècle, la découverte de métal aurifère au Yukon force les autorités canadiennes à prendre des mesures pour le maintien de la paix sur cette partie de son territoire où, on le sait, les choses peuvent facilement dégénérer. La ruée sauvage vers l'or de l'Oregon, vers 1840, a laissé des souvenirs. Déjà présente au Yukon, la Police montée du Nord-Ouest pourrait être rapidement débordée, en particulier si la gourmandise des expansionnistes américains incitait ces derniers à débattre de questions de juridiction territoriale. Aux yeux des responsables politiques canadiens, la protection du territoire doit reposer sur la force militaire : une unité de volontaires recrutés parmi la force permanente est donc rassemblée à Vancouver.
Le 14 mai 1898, ce contingent de plus de 200 personnes, soit près du quart de la force permanente totale, quitte cette ville à destination du Yukon. Six femmes, une journaliste, quatre infirmières de l'Ordre de Victoria et l'épouse de l'un des chefs de la Police montée en service au Yukon, se sont jointes au groupe. On se déplace en bateau et à pied à travers des chemins et des sentiers mal tracés sur un sol qui, même en été, reste gelé à quelque 50 centimètres sous la surface. Escortée par des nuées de moustiques, l'unité arrive à Fort Selkirk, le 11 septembre. Quelques semaines plus tard, l'un de ses contingents est dépêché à Dawson.
Au printemps suivant, la ruée ayant pris fin et la population du Yukon étant en décroissance, la moitié des hommes reprennent le chemin de Vancouver. En 1900, tous les volontaires sauf un, retenu jusqu'en 1901 pour témoigner à un procès, sont de retour chez eux. Ils sont remplacés, l'année suivante, par une unité de milice non permanente levée à Dawson City.
Grâce à cette action énergique et malgré quelques bavures insignifiantes, la ruée vers l'or du Yukon a été très ordonnée et, surtout, elle a contribué à imposer le principe de la souveraineté canadienne dans cette région peu fréquentée avant la découverte de l'or. Par exemple, en partant de Vancouver, l'expédition a utilisé une route d'accès qui, bien que très difficile et beaucoup plus lente que celle venant de l'Alaska, avait l'avantage d'être presque entièrement en territoire canadien. Pour le retour, on simplifiera toutefois les choses en utilisant le territoire américain 10 jours entre Fort Selkirk et Vancouver, plutôt que quatre mois à l'aller.
En cette occasion, pour la première fois - et cette situation ne se renouvellera pas avant un demi-siècle -, des troupes canadiennes se sont aventurées et ont hiverné au nord du 60e parallèle, où se situe pourtant le tiers de la masse continentale canadienne
Parmi les participants à l'expédition, l'on retrouve le capitaine Harry Burstall, qui deviendra major général et chef d'état-major de l'armée, ainsi que S.B. Steele, surintendant de la Police montée, présent lors de la campagne du Nord-Ouest et dont la carrière le conduira plus tard en Afrique du Sud.
L’aide au pouvoir civil
Entre 1867 et 1898, la milice intervient à 67 reprises pour soutenir le pouvoir civil et deux fois dans des pénitenciers. Convoqués par les autorités civiles locales, les soldats répondent avec plus au moins de bonne grâce, chacun devant alors délaisser ses occupations et renoncer à son salaire pour une période indéterminée. Par surcroît, jusqu'en 1879, alors que le gouvernement canadien verse aux villes l'argent requis pour le paiement rapide et complet des coûts, les soldats-citoyens savent que certaines villes qui demandent leur aide ne seront pas en mesure de les rétribuer. Aussi longtemps que les policiers n'auront pas été formés en corps solidement structurés, les miliciens seront appelés pour rétablir l'ordre : ils n'apprécient guère ce rôle.
Le rapport annuel de la milice de 1878 énumère les difficultés liées à ces interventions ponctuelles. « Des désordres se présentent souvent chaque année. La milice n'a pas les connaissances nécessaires, la police est trop faible, les miliciens sont obligés de combattre les gens du même coin du pays ; il faut une force militaire permanente. »
À elle seule, la formule du vote électoral à main levée provoque, entre 1867 et 1883, 13 émeutes réelles ou appréhendées, dont 11 au Québec seulement. Des modifications à la Loi électorale vont mettre un terme aux interventions de la Milice dans ce champ d'activité. Les querelles linguistiques, religieuses et scolaires, ainsi que les défilés annuels des Orangistes constituent autant de prétextes à un appel des troupes. Les événements les plus difficiles à gérer sont les grèves. Levée sur place, la force de contrôle est souvent formée d'hommes qui vivent à proximité du lieu des manifestations ou qui sont apparentés à ceux qu'ils doivent combattre. Généralement, les miliciens sont appelés après un premier assaut violent perpétré contre la personne où contre la propriété. Dans plus de 90 pour cent des cas, leur seule présence réussit à empêcher les débordements. L'absence de véritables corps policiers est à la base de la plupart de ces interventions.
L’expédition du Nil 1884-1885
L'aptitude des Forces armées canadiennes à agir à l'extérieur du territoire national se dessine en 1884, au moment où le major général C.G. Gordon est assiégé à Khartoum dans le Haut-Nil soudanais.
La Grande-Bretagne organise une expédition de secours dirigée par le général Garnet Wolseley. En 1881 et 1882, alors chef d'état-major de l'armée, il s'était farouchement opposé au vieux projet de construction d'un tunnel sous la Manche relancé avec force par des hommes d'affaires français et britanniques. Cette prise de position n'atteint en rien son aura de vainqueur de Ter-et-Kebir ou son titre de lord Wolseley du Caire. Au Canada, Wolseley a dirigé la campagne de la rivière Rouge. Il a gardé un bon souvenir des Canadiens qui ont permis aux troupes britanniques d'être approvisionnées durant la marche et le conflit de 1870.
Dès son déclenchement et pendant l'année qui suit, l'affaire soudanaise a des échos au Canada où des colonels se disent prêts à lever leurs régiments de milice pour aller combattre dans ce Haut-Nil lointain. Prudent, le gouvernement britannique prend le pouls du Canada par rapport aux heureuses dispositions des volontaires, mais il fait savoir que la Nouvelle-Galles, un État du sud de l'Australie, a offert un contingent. Le premier ministre John A. Macdonald peut facilement résister aux quelques zélés pressés d'aller à Khartoum même si, ce faisant, il déçoit les autorités britanniques et froisse quelques-uns de ses compatriotes.
Cependant, dès 1884, il consent à ce que les Britanniques recrutent au Canada quelques centaines de « voyageurs » qui aideront à la logistique des combattants remontant le Nil. Autrement dit, Wolseley, qui a été favorablement impressionné par ses Canadiens, entend leur faire jouer un rôle similaire à celui de 1870, mais sur une scène étrangère, sous un autre climat et pour une cause qui ne les regarde en rien.
Près de 400 Canadiens, dont un grand nombre ignore tout de la tâche qui les attend, vont signer un engagement de six mois : c'est que l'époque des voyageurs est déjà presque révolue en Amérique du Nord. Les volontaires qui iront là-bas ne porteront pas l'uniforme. Ils n'auront pas d'armes et ne participeront pas aux rares combats conduits par Wolseley. Quant à Gordon et ses troupes, ils seront anéantis avant même que les secours leur parviennent.
Quelques personnalités dignes d'intérêt se glissent parmi ces volontaires. L'une d'entre elles est le lieutenant-colonel Fred C. Denison, l'aide de camp de Wolseley, en 1869-1870. Il appartient à une famille qui, depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, alors que certains de ses membres sont encore dans la Réserve, a été de toutes les affaires militaires canadiennes. On remarque également la présence d'un aumônier catholique, le capitaine A. Bouchard, qui, ayant déjà été missionnaire à Khartoum, est disposé à y retourner pour servir d'interprète et veiller sur l'âme des soldats canadiens. Le sergent d'hôpital Gaston P Labat qui, un an plus tard environ, sera sur le Saskatchewan avec un frère de Fred C. Denison, accompagne le major T.L.H. Neilson, chirurgien-major de la Batterie B, lui-même vétéran de l'affaire de la rivière Rouge.
Les 386 Canadiens quittent Halifax le 14 septembre 1884. Quinze jours plus tard, ils débarquent à Gibraltar. En mer, l'un des hommes a succombé à la maladie. Le groupe atteint Alexandrie le 7 octobre puis, en train et en bateau à vapeur, dépassant Luxor et Assouan, ils parviennent enfin aux premières cataractes. En novembre 1884, nos hommes sont au travail. Le 1er décembre, l'expédition est à mi-chemin entre Khartoum et Alexandrie. À chacune des 14 cataractes, qui s'étendent sur 15 kilomètres et créent une dénivellation d'environ 40 mètres, les voyageurs canadiens sont en place, attendant l'arrivée de nouvelles troupes britanniques auxquelles ils font franchir ces obstacles. L'Iroquois Louis Capitaine et quelques autres perdront la vie dans ces épreuves de courage et d'endurance.
Un nouvel engagement de six mois, à compter du 6 mars 1885, a été proposé aux voyageurs, mais seulement 86 hommes, sous les ordres de Denison, l'acceptent. Pour les autres, la mission prend fin avant d'avoir véritablement commencé. Le 10 janvier, peu avant l'expiration de leur contrat, la plupart des Canadiens reprennent le chemin du retour et se dirigent vers Alexandrie où leur embarquement débutera en février.
L'expérience a permis aux volontaires canadiens d'observer ce que d'autres participants aux guerres britanniques remarqueront à leur tour : chez les Britanniques, le traitement réservé aux officiers et aux hommes de troupe est très différent. Comme les soldats anglais, ils ont été moins bien nourris que les officiers. Réagissant à cette injustice, un Canadien qui a osé ouvrir une boîte de fromage a eu droit à trois mois de prison. On prétend, parmi les Canadiens, que si un soldat anglais avait commis la même faute, il aurait pu écoper de cinq ans de travaux forcés.
En avril 1885, dans une lettre au Gouverneur général du Canada, Wolseley félicite les Canadiens. Au mois d'août, la Chambre des lords et les Communes britanniques appuient un vote de remerciement à leur intention. Tous les volontaires recevront la médaille spéciale britannique immortalisant cette expédition. Ceux qui auront renouvelé leur contrat y ajouteront l'agrafe de la bataille de Kirbekan, bien qu'ils n'y aient pas combattu.
Le Vénézuela et le Canada
L'appartenance du Canada à l'Empire britannique peut avoir d'autres répercussions. Ainsi en est-il du différend qui surgit, en 1895, entre l'Angleterre et le Venezuela, au sujet des frontières de la Guyane Britannique. Or, en 1895, Grover Cleveland, le président des États-Unis, semble disposé à prendre fait et cause pour le Venezuela, contre l'Angleterre. Poussée au pied du mur dans cette affaire, l'Angleterre pourrait décider d'entrer en guerre contre les Vénézuéliens. Pour le Canada, cette perspective signifie un possible affrontement avec les États-Unis qui pourraient bien être tentés d'envahir cette partie de l'Empire britannique.
Le gouvernement canadien réagit aussitôt en fonction de cette éventualité en investissant trois millions de dollars dans le réarmement. Les fusils Snider à un coup sont remplacés par 40 000 Lee Enfield .303 à répétition. On achète quelques mitrailleuses modernes et on refait l'armement de l'artillerie.
Même si cette crise n'a eu aucune conséquence violente, elle a pourtant incité les autorités gouvernementales à agir sous l'effet de la panique. Mauvaise conseillère en matière de gestion de crise et d'administration des affaires militaires du pays, la panique sera de plusieurs autres rendez-vous.
En 1897, pour la première fois depuis 1876, une période d'instruction annuelle de tous les régiments de volontaires devient obligatoire. Déjà, en 1896, les premiers plans de mobilisation des forces canadiennes en cas de guerre sont publiés. La Milice est organisée en divisions, brigades, détachements, etc., chaque unité se voyant assigner un centre de mobilisation. La composition des unités est secrète et la nomination des états-majors doit se faire au tout dernier moment, ce qui pourrait facilement causer de la confusion en cas d'urgence. Mais ce premier plan, malgré ses faiblesses, est important par son existence même.
Soldat, The Royal Canadian Regiment of Infantry, uniforme d'hiver, vers 1899. Pour complémenter les uniformes d'hiver de l'Infanterie canadienne, les soldats avaient aussi accès à des chapeaux de fourrures, des écharpes, manteau d'hiver du style de l'armée britannique, mitaines et bottes chaudes.
À la fin du XIXe siècle, la découverte de métal aurifère au Yukon force les autorités canadiennes à prendre des mesures pour le maintien de la paix sur cette partie de son territoire où, on le sait, les choses peuvent facilement dégénérer. La ruée sauvage vers l'or de l'Oregon, vers 1840, a laissé des souvenirs. Déjà présente au Yukon, la Police montée du Nord-Ouest pourrait être rapidement débordée, en particulier si la gourmandise des expansionnistes américains incitait ces derniers à débattre de questions de juridiction territoriale. Aux yeux des responsables politiques canadiens, la protection du territoire doit reposer sur la force militaire : une unité de volontaires recrutés parmi la force permanente est donc rassemblée à Vancouver.
Le 14 mai 1898, ce contingent de plus de 200 personnes, soit près du quart de la force permanente totale, quitte cette ville à destination du Yukon. Six femmes, une journaliste, quatre infirmières de l'Ordre de Victoria et l'épouse de l'un des chefs de la Police montée en service au Yukon, se sont jointes au groupe. On se déplace en bateau et à pied à travers des chemins et des sentiers mal tracés sur un sol qui, même en été, reste gelé à quelque 50 centimètres sous la surface. Escortée par des nuées de moustiques, l'unité arrive à Fort Selkirk, le 11 septembre. Quelques semaines plus tard, l'un de ses contingents est dépêché à Dawson.
Au printemps suivant, la ruée ayant pris fin et la population du Yukon étant en décroissance, la moitié des hommes reprennent le chemin de Vancouver. En 1900, tous les volontaires sauf un, retenu jusqu'en 1901 pour témoigner à un procès, sont de retour chez eux. Ils sont remplacés, l'année suivante, par une unité de milice non permanente levée à Dawson City.
Grâce à cette action énergique et malgré quelques bavures insignifiantes, la ruée vers l'or du Yukon a été très ordonnée et, surtout, elle a contribué à imposer le principe de la souveraineté canadienne dans cette région peu fréquentée avant la découverte de l'or. Par exemple, en partant de Vancouver, l'expédition a utilisé une route d'accès qui, bien que très difficile et beaucoup plus lente que celle venant de l'Alaska, avait l'avantage d'être presque entièrement en territoire canadien. Pour le retour, on simplifiera toutefois les choses en utilisant le territoire américain 10 jours entre Fort Selkirk et Vancouver, plutôt que quatre mois à l'aller.
En cette occasion, pour la première fois - et cette situation ne se renouvellera pas avant un demi-siècle -, des troupes canadiennes se sont aventurées et ont hiverné au nord du 60e parallèle, où se situe pourtant le tiers de la masse continentale canadienne
Parmi les participants à l'expédition, l'on retrouve le capitaine Harry Burstall, qui deviendra major général et chef d'état-major de l'armée, ainsi que S.B. Steele, surintendant de la Police montée, présent lors de la campagne du Nord-Ouest et dont la carrière le conduira plus tard en Afrique du Sud.
L’aide au pouvoir civil
Entre 1867 et 1898, la milice intervient à 67 reprises pour soutenir le pouvoir civil et deux fois dans des pénitenciers. Convoqués par les autorités civiles locales, les soldats répondent avec plus au moins de bonne grâce, chacun devant alors délaisser ses occupations et renoncer à son salaire pour une période indéterminée. Par surcroît, jusqu'en 1879, alors que le gouvernement canadien verse aux villes l'argent requis pour le paiement rapide et complet des coûts, les soldats-citoyens savent que certaines villes qui demandent leur aide ne seront pas en mesure de les rétribuer. Aussi longtemps que les policiers n'auront pas été formés en corps solidement structurés, les miliciens seront appelés pour rétablir l'ordre : ils n'apprécient guère ce rôle.
Le rapport annuel de la milice de 1878 énumère les difficultés liées à ces interventions ponctuelles. « Des désordres se présentent souvent chaque année. La milice n'a pas les connaissances nécessaires, la police est trop faible, les miliciens sont obligés de combattre les gens du même coin du pays ; il faut une force militaire permanente. »
À elle seule, la formule du vote électoral à main levée provoque, entre 1867 et 1883, 13 émeutes réelles ou appréhendées, dont 11 au Québec seulement. Des modifications à la Loi électorale vont mettre un terme aux interventions de la Milice dans ce champ d'activité. Les querelles linguistiques, religieuses et scolaires, ainsi que les défilés annuels des Orangistes constituent autant de prétextes à un appel des troupes. Les événements les plus difficiles à gérer sont les grèves. Levée sur place, la force de contrôle est souvent formée d'hommes qui vivent à proximité du lieu des manifestations ou qui sont apparentés à ceux qu'ils doivent combattre. Généralement, les miliciens sont appelés après un premier assaut violent perpétré contre la personne où contre la propriété. Dans plus de 90 pour cent des cas, leur seule présence réussit à empêcher les débordements. L'absence de véritables corps policiers est à la base de la plupart de ces interventions.
L’expédition du Nil 1884-1885
L'aptitude des Forces armées canadiennes à agir à l'extérieur du territoire national se dessine en 1884, au moment où le major général C.G. Gordon est assiégé à Khartoum dans le Haut-Nil soudanais.
La Grande-Bretagne organise une expédition de secours dirigée par le général Garnet Wolseley. En 1881 et 1882, alors chef d'état-major de l'armée, il s'était farouchement opposé au vieux projet de construction d'un tunnel sous la Manche relancé avec force par des hommes d'affaires français et britanniques. Cette prise de position n'atteint en rien son aura de vainqueur de Ter-et-Kebir ou son titre de lord Wolseley du Caire. Au Canada, Wolseley a dirigé la campagne de la rivière Rouge. Il a gardé un bon souvenir des Canadiens qui ont permis aux troupes britanniques d'être approvisionnées durant la marche et le conflit de 1870.
Dès son déclenchement et pendant l'année qui suit, l'affaire soudanaise a des échos au Canada où des colonels se disent prêts à lever leurs régiments de milice pour aller combattre dans ce Haut-Nil lointain. Prudent, le gouvernement britannique prend le pouls du Canada par rapport aux heureuses dispositions des volontaires, mais il fait savoir que la Nouvelle-Galles, un État du sud de l'Australie, a offert un contingent. Le premier ministre John A. Macdonald peut facilement résister aux quelques zélés pressés d'aller à Khartoum même si, ce faisant, il déçoit les autorités britanniques et froisse quelques-uns de ses compatriotes.
Cependant, dès 1884, il consent à ce que les Britanniques recrutent au Canada quelques centaines de « voyageurs » qui aideront à la logistique des combattants remontant le Nil. Autrement dit, Wolseley, qui a été favorablement impressionné par ses Canadiens, entend leur faire jouer un rôle similaire à celui de 1870, mais sur une scène étrangère, sous un autre climat et pour une cause qui ne les regarde en rien.
Près de 400 Canadiens, dont un grand nombre ignore tout de la tâche qui les attend, vont signer un engagement de six mois : c'est que l'époque des voyageurs est déjà presque révolue en Amérique du Nord. Les volontaires qui iront là-bas ne porteront pas l'uniforme. Ils n'auront pas d'armes et ne participeront pas aux rares combats conduits par Wolseley. Quant à Gordon et ses troupes, ils seront anéantis avant même que les secours leur parviennent.
Quelques personnalités dignes d'intérêt se glissent parmi ces volontaires. L'une d'entre elles est le lieutenant-colonel Fred C. Denison, l'aide de camp de Wolseley, en 1869-1870. Il appartient à une famille qui, depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, alors que certains de ses membres sont encore dans la Réserve, a été de toutes les affaires militaires canadiennes. On remarque également la présence d'un aumônier catholique, le capitaine A. Bouchard, qui, ayant déjà été missionnaire à Khartoum, est disposé à y retourner pour servir d'interprète et veiller sur l'âme des soldats canadiens. Le sergent d'hôpital Gaston P Labat qui, un an plus tard environ, sera sur le Saskatchewan avec un frère de Fred C. Denison, accompagne le major T.L.H. Neilson, chirurgien-major de la Batterie B, lui-même vétéran de l'affaire de la rivière Rouge.
Les 386 Canadiens quittent Halifax le 14 septembre 1884. Quinze jours plus tard, ils débarquent à Gibraltar. En mer, l'un des hommes a succombé à la maladie. Le groupe atteint Alexandrie le 7 octobre puis, en train et en bateau à vapeur, dépassant Luxor et Assouan, ils parviennent enfin aux premières cataractes. En novembre 1884, nos hommes sont au travail. Le 1er décembre, l'expédition est à mi-chemin entre Khartoum et Alexandrie. À chacune des 14 cataractes, qui s'étendent sur 15 kilomètres et créent une dénivellation d'environ 40 mètres, les voyageurs canadiens sont en place, attendant l'arrivée de nouvelles troupes britanniques auxquelles ils font franchir ces obstacles. L'Iroquois Louis Capitaine et quelques autres perdront la vie dans ces épreuves de courage et d'endurance.
Un nouvel engagement de six mois, à compter du 6 mars 1885, a été proposé aux voyageurs, mais seulement 86 hommes, sous les ordres de Denison, l'acceptent. Pour les autres, la mission prend fin avant d'avoir véritablement commencé. Le 10 janvier, peu avant l'expiration de leur contrat, la plupart des Canadiens reprennent le chemin du retour et se dirigent vers Alexandrie où leur embarquement débutera en février.
L'expérience a permis aux volontaires canadiens d'observer ce que d'autres participants aux guerres britanniques remarqueront à leur tour : chez les Britanniques, le traitement réservé aux officiers et aux hommes de troupe est très différent. Comme les soldats anglais, ils ont été moins bien nourris que les officiers. Réagissant à cette injustice, un Canadien qui a osé ouvrir une boîte de fromage a eu droit à trois mois de prison. On prétend, parmi les Canadiens, que si un soldat anglais avait commis la même faute, il aurait pu écoper de cinq ans de travaux forcés.
En avril 1885, dans une lettre au Gouverneur général du Canada, Wolseley félicite les Canadiens. Au mois d'août, la Chambre des lords et les Communes britanniques appuient un vote de remerciement à leur intention. Tous les volontaires recevront la médaille spéciale britannique immortalisant cette expédition. Ceux qui auront renouvelé leur contrat y ajouteront l'agrafe de la bataille de Kirbekan, bien qu'ils n'y aient pas combattu.
Le Vénézuela et le Canada
L'appartenance du Canada à l'Empire britannique peut avoir d'autres répercussions. Ainsi en est-il du différend qui surgit, en 1895, entre l'Angleterre et le Venezuela, au sujet des frontières de la Guyane Britannique. Or, en 1895, Grover Cleveland, le président des États-Unis, semble disposé à prendre fait et cause pour le Venezuela, contre l'Angleterre. Poussée au pied du mur dans cette affaire, l'Angleterre pourrait décider d'entrer en guerre contre les Vénézuéliens. Pour le Canada, cette perspective signifie un possible affrontement avec les États-Unis qui pourraient bien être tentés d'envahir cette partie de l'Empire britannique.
Le gouvernement canadien réagit aussitôt en fonction de cette éventualité en investissant trois millions de dollars dans le réarmement. Les fusils Snider à un coup sont remplacés par 40 000 Lee Enfield .303 à répétition. On achète quelques mitrailleuses modernes et on refait l'armement de l'artillerie.
Même si cette crise n'a eu aucune conséquence violente, elle a pourtant incité les autorités gouvernementales à agir sous l'effet de la panique. Mauvaise conseillère en matière de gestion de crise et d'administration des affaires militaires du pays, la panique sera de plusieurs autres rendez-vous.
En 1897, pour la première fois depuis 1876, une période d'instruction annuelle de tous les régiments de volontaires devient obligatoire. Déjà, en 1896, les premiers plans de mobilisation des forces canadiennes en cas de guerre sont publiés. La Milice est organisée en divisions, brigades, détachements, etc., chaque unité se voyant assigner un centre de mobilisation. La composition des unités est secrète et la nomination des états-majors doit se faire au tout dernier moment, ce qui pourrait facilement causer de la confusion en cas d'urgence. Mais ce premier plan, malgré ses faiblesses, est important par son existence même.
La cristalisation des enjeux
La guerre des Boërs et les raisons d’y participer
Moins de 15 ans se sont écoulés depuis la rébellion du Nord-Ouest lorsqu'une crise sévissant aux confins de l'hémisphère sud vient encore une fois ébranler les relations entre Canadiens d'origines anglaise et française.
Depuis trop longtemps sans doute, l'Angleterre est à couteau tiré avec les républiques du Transvaal et d'Orange, toutes deux situées dans l'actuelle Afrique du Sud. À la fin de l'été 1899, tous les dominions britanniques, à l'exception du Canada, se sont montrés disposés à prêter main-forte à leur commune mère patrie. Au Canada, une coalition formée par une portion de la population d'origine britannique, par leurs députés et par la petite, mais non moins influente Ligue de la fédération impériale, demande au gouvernement de Wilfrid Laurier de prendre position. La coalition est dominée par la voix du gouverneur général, lord Minto, qui fait savoir au premier ministre canadien que l'appui du Canada pourrait inciter Londres à soutenir le point de vue canadien lors des discussions visant à fixer les frontières entre l'Alaska américain et le Canada. Il importe de souligner maintenant que cette question ne sera soumise à un tribunal d'arbitrage qu'en 1904 et que ses conclusions seront plutôt défavorables au Canada.
Les Canadien en Afrique du Sud. Le Canada décide pour la première fois de participer à un conflit
Malgré les pressions et les tensions que l'affaire provoque à l'intérieur de son parti, Laurier gagne du temps, craignant une crise semblable à celle qui a suivi la pendaison de Riel. Pendant qu'il temporise, l'affrontement entre l'Angleterre et les républiques boers semble devenir inévitable. Le major général Edward H. Hutton, officier général commandant les forces canadiennes, met tout son poids dans la balance en faveur d'un engagement ferme du Canada aux côtés de l'Angleterre. Ainsi, le 5 septembre, il adresse au major Oscar Pelletier, de la Milice permanente, une lettre « privée et confidentielle ». Il l'assure que, dans le cas très probable où le Canada offrirait des troupes à l'Angleterre, il proposera Pelletier pour commander l'un des bataillons d'infanterie qu'il compte former. En fait, il laisse entendre que l'annonce canadienne viendra deux jours plus tard. Laurier continue toutefois de tergiverser et, pour le pousser dans ses derniers retranchements, Hutton imagine un stratagème qui lui coûtera son poste.
Le 3 octobre, il fait publier, dans la Gazette militaire canadienne, des plans de mobilisation pour d'éventuels contingents destinés à l'Afrique du Sud. Le même jour, la presse britannique reproduit un communiqué de Joseph Chamberlain, ministre des Colonies, indiquant que l'engagement du Canada a déjà été étudié : l'Angleterre prendrait les troupes en charge dès leur débarquement en Afrique du Sud et c'est elle qui acquitterait la solde des hommes. Laurier élude encore les questions des journalistes. Son malaise s'accroît quand, le 11 octobre, les deux républiques boers déclarent la guerre à l'Angleterre. Deux jours plus tard, agissant contre ses convictions personnelles, Laurier cède, mais à sa façon. Bien que la proposition n'ait fait l'objet d'aucun débat parlementaire, son gouvernement annonce qu'il est prêt à équiper un maximum de 1 000 volontaires et à les faire voyager à ses frais jusqu'en Afrique du Sud. Ainsi, Laurier n'aura pas à répondre à des questions cruciales de ce genre : « Cette guerre est-elle juste ? Est-ce que l'Angleterre est vraiment menacée ? »
L'ordre de mobilisation des volontaires est émis le 14. Comme il n'y aura d'abord qu'un seul bataillon et qu'il sera confié au colonel William Otter, Pelletier commandera une compagnie. Ici encore, le Canada fait preuve d'un peu de particularisme. L'Angleterre aurait voulu qu'on lui envoie des compagnies dont elle aurait pu disposer à sa guise. À la place, on forme le 2e Bataillon du Royal Canadian Regiment qui rassemblera des volontaires recrutés au sein des Milices permanentes et non permanentes, ainsi que des hommes qui n'ont jamais côtoyé la Milice. Ces militaires recevront une solde équivalente à celle des membres de la Milice permanente, plus élevée que celle versée aux troupes anglaises.
Le 20 octobre, on désigne les six compagnies : la « A », sera attachée à la Colombie-Britannique et au Manitoba ; la « B », à London ; la « C », à Toronto ; la « D », à Ottawa et Kingston ; la « E », à Montréal ; la « F », à Québec ; la « G », au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ; et la « H », à la Nouvelle-Écosse.
Les dissidences politiques
Les opposants à la décision du premier ministre, des Canadiens français pour la plupart, ne tardent pas à exprimer leur désaccord et à se rassembler autour du journaliste Henri Bourassa. Sa forte personnalité et ses idées lui permettent de reprocher publiquement à Laurier - qu'il a toujours supporté - d'avoir cédé. Il prédit même que le geste qu'il vient de poser n'est rien comparé à ce qui va suivre. Si le Canada peut envoyer 1 000 hommes en Afrique du Sud, combien en enverrait-il s'il s'agissait d'une guerre européenne, demande Bourassa ? Car, selon lui, l'impérialisme à l'anglaise c'est « la participation des colonies aux guerres de l'Angleterre ». En 1903, le Canadien anglais Goldwin Smith, prenant le parti de Bourassa, rappellera que la guerre en Afrique du Sud visait à obtenir l'égalité pour les uitlanders blancs, des Britanniques surtout, auxquels les Boers refusaient, entre autres, le droit de vote. « C'est là une doctrine étrange dans un empire dont la population se compose pour les cinq-sixièmes, de races de couleurs, et qui fait alliance avec le Japon. » Le 29 avril 1910, au moment de la discussion d'un autre grand projet à résonance impérialiste, celui de la loi navale, le sénateur Raoul Dandurand, rappellera que la cause officielle de la guerre en Afrique, c'est-à-dire le redressement des torts infligés aux résidents anglais, ne l'avait guère stimulé :
« J'avoue bien candidement que cette dispute n’a soulevé en moi aucun enthousiasme, mais nous n n’avions rien à dire avant l'affaire, et lorsque la guerre fut déclarée, le temps de la discussion était passé. »
Malgré la puissance du courant d'opposition chez les Canadiens français, les Libéraux de Wilfrid Laurier sont réélus, le 7 novembre 1900, avec un fort appui des électeurs du Québec. Faut-il y voir l'approbation de la politique impérialiste ? Dans un autre contexte, les Canadiens français auraient peut-être exprimé leur désapprobation, mais l'engagement mi-figue, mi-raisin de Laurier leur a semblé préférable à celui des Conservateurs de Charles Tupper, inféodés à la politique britannique. En définitive, c'est l'hostilité à cette guerre qui a profité aux Libéraux. Ceux-ci devront cependant compter avec Henri Bourassa et les nationalistes du Québec élus au Parlement fédéral, qui poursuivent leur action contre la participation du pays, aussi mitigée soit-elle.
Au Québec, à Montréal surtout, la situation ravive les tensions ethniques. Ainsi, les ler et 2 mars 1900, des anglophones, dont plusieurs étudiants de l'Université McGill, célèbrent par un défilé la victoire canadienne de Paardeberg. Au passage, ils détruisent les vitrines de plusieurs journaux francophones dont celles de La Presse, de La Patrie et du Journal et ils saccagent certains locaux de l'Université Laval de Montréal. Ces tensions diminueront après les élections fédérales de 1900, mais resteront latentes jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Les Canadiens au combat. Les Canadiens arrivent en Afrique du Sud
Permanente ou non-permanente, la Milice canadienne, n'est pas prête à partir en guerre, ni à faire l'expérience du climat sud-africain. Entre les 12 et 31 octobre, il faut recruter, habiller, entraîner (mais si peu), organiser et expédier le 2e Bataillon du RCR. Malgré les nombreuses difficultés, dont l'amateurisme d'à peu près tous les participants, le minimum nécessaire est obtenu en moins de trois semaines. Bravo pour l'énergie et la volonté ! Quant à l'efficacité de l'organisation, il n'est pas certain qu'elle ait été au rendez-vous. Cela devient évident dès que les hommes mettent le pied sur le bien nommé Sardinia, le 31 octobre. Des modifications devaient permettre à ce cargo d'abriter et de transporter près de 700 personnes. Au nombre de 1 039, les volontaires vont s'y entasser avec l'équipage, les infirmières du contingent, des chevaux et des chiens. Quant à l'équipement, qui n'a fait l'objet d'aucun inventaire, il est casé n'importe où. Le voyage s'effectue sur une mer souvent difficile qui met à dure épreuve l'endurance du matelot qu'a déjà été Oscar Pelletier. Pour ceux qui n'ont jamais vu la mer, cette étape tourne au cauchemar.
L'entraînement des Canadiens débute dès leur arrivée à Cape Town, le 29 novembre. À la mi-février 1900, ils sont prêts à entrer en action. Au début des hostilités, les Boers ont enfermé les Anglais à l'intérieur de trois villes, Kimberley, Mafeking et Ladysmith. À la fin de février, les Britanniques tentent de faire sauter le verrou de Kimberley, dans le secteur de Paardeberg. Les Canadiens connaîtront là leur première bataille importante outre-mer, à l'intérieur de la 19e Brigade du major général Horace Smith-Dorrien qui, en 1915, dirigera les opérations de la 1re Division canadienne en Belgique.
Majuba Day
2nd (Special Service) Battalion, Royal Canadian Regiment of Infantry, à Paardeberg Drift, le 27 février 1900. Le 27 février 1900, à Paardeberg, le 2nd (Special Service) Battalion, Royal Canadian Regiment of Infantry, ont aidé à la première victoire britannique, lors de la 2e Guerre d'Afrique du Sud (1899 à 1902). La victoire canadienne réalisée par leur heureux hasard, leur entêtement, de même que leur entraînement et leur habileté, a remonté le moral et la confiance des troupes. Cette peinture, « Dawn of Majuba » (L'Aube de Majuba), du très connu peintre militaire britannique, R. Caton Woodville, démontre le moment où les Canadiens apprennent la nouvelle, que l'ennemi s'est livré. La défaite Boer a eu lieu, lors du 19e anniversaire du désastre britannique, à Majuba Hill, durant la 1ère Guerre Sud-Africaine de 1880 à 1881.
Le 13 février, l'armée anglaise a lancé un grand mouvement de balayage qui a rapidement conduit à l'encerclement des Boers, dirigés par Cronje. Le 18, une charge imprudente des Canadiens, à travers un espace désert, est arrêtée court par le feu ennemi, après moins de 200 mètres. Le 26, les Canadiens relèvent un bataillon anglais dans une ligne de tranchées situées à environ 600 mètres des positions des Boers. Le 27 février, on leur commande d'avancer. Au cours de leur progression, ils sont sérieusement pris à partie. Quatre des six compagnies refluent, alors que les deux autres s'accrochent aux positions prises. Démoralisés depuis plusieurs jours, leurs opposants n'ont cependant d'autre issue que la reddition aux mains des Canadiens qui a lieu au petit matin. À Majuba, 19 ans plus tôt, jour pour jour, les Anglais essuyaient la défaite aux mains des Boers provoquant, entre autres conséquences, la création, au nord du Cap, des républiques de l'État libre d'Orange et du Transvaal.
Les Canadiens sont félicités pour ce succès qui n'a pourtant exigé d'eux ni stratégie, ni organisation préalable, ni la participation d'un grand nombre d'hommes. L'exploit prend des proportions mythiques encore entretenues un siècle plus tard.
Les membres du contingent initial sont rarement au centre de l'action, même quand ils participent à la prise de Bloemfontein, capitale de l'État libre d'Orange, et à des échauffourées au cours desquelles Otter est blessé. Leur contrat d'un an est à la veille de se terminer quand, pour plaire à ses maîtres impériaux, leur chef laisse entendre à ces derniers que les Canadiens sont prêts à participer à la guerre jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Or, les hommes n'ont pas été consultés et, en prenant connaissance de cette rumeur, ils se rebiffent. Redoublant d'efforts, Otter obtient la participation de 261 Canadiens dont la plupart, avant de se porter volontaires pour l'Afrique du Sud, ont fait partie de la force permanente ou sont membres de groupes de renfort récemment arrivés et dont le contrat débute à peine. Peu sont satisfaits de leur sort ou d'Otter. Plusieurs des officiers offrent cependant de rester. Quant à Oscar Pelletier, encore une fois blessé, il monte à bord du SS Idaho, le ler octobre 1900, à la tête de plus de 400 hommes qui rentrent au Canada, 11 mois après l'avoir quitté. Le 2 novembre, ils débarquent à Halifax où règne l'euphorie. Le 3e Bataillon du RCR, qui a été levé pour remplacer, à Halifax, les soldats britanniques que la mère patrie a décidé d'utiliser en Afrique du Sud (autre partie de l'effort canadien consenti en faveur de la Grande-Bretagne) accueille le 2e Bataillon qui défile, la Compagnie H (celle d'Halifax) en tête.
Le reste du premier contingent quitte l'Afrique du Sud le 7 novembre. Après 22 jours de navigation vers la Grande-Bretagne, les hommes ont droit à 10 jours de permission et sont reçus par la reine Victoria. Les volontaires rembarquent ensuite pour traverser l'Atlantique en direction d'Halifax qu'ils atteignent le 23 décembre 1900. Le 31, le 2e Bataillon du RCR est démembré.
À ce stade, la victoire totale est plus ou moins assurée aux Britanniques. Mais nombre de Boers, malgré la prise de leurs deux capitales, continuent les combats. Ils mènent de nombreuses actions de guérilla contre les longues lignes de communication britanniques difficiles à protéger.
L’augmentation des effectifs du contingent canadien
Dès le 2 novembre 1899, le Canada a offert un deuxième contingent à la Grande-Bretagne. Ce n'est que le 16 décembre, après des revers subis à Stormberg, Magersfontein et Colenso, que celle-ci accepte la proposition canadienne. Le nouveau contingent, contrairement au premier qui était lourd et peu mobile, se caractérisera par sa mobilité et sa force de frappe. Cette fois-ci, on recourt à des volontaires entraînés. On forme donc une brigade d'artillerie de campagne composée, tous grades confondus, de 539 hommes commandés par le lieutenant-colonel C.W. Drury. On constitue également deux bataillons de carabiniers montés comptant chacun un effectif de 371 officiers et soldats. Le premier, qui deviendra plus tard le Royal Canadian Dragoons (aujourd'hui un régiment blindé), est dirigé par le lieutenant-colonel François Lessard, et l'autre, par le lieutenant-colonel L.W. Herchmer. Les conditions liées au paiement de la solde et à la fourniture d'équipement, sont les mêmes que pour le 2e Bataillon du RCR.
La brigade d'artillerie est divisée en batteries « C », « D » et « E », qui se déplacent en appui d'unités différentes, parfois canadiennes. Des trois batteries, c'est la « C », commandée par le major J. A. Hudon, qui connaît le plus d'action en chassant de petits groupes de Boers vindicatifs, surtout dans le nord-ouest du Transvaal. Le 16 mai 1900, après une approche longue et difficile, la Batterie C ouvre le chemin de Mafeking. Quand cette dernière quitte le Cap pour le Canada, le 13 décembre 1900, sa région d'opération n'est pas encore pacifiée. Des habitations et du bétail « ennemis » ont bien été détruits, rarement par les Canadiens, il faut le dire, mais les guérilleros boers résistent toujours.
La Batterie D va se trouver au milieu d'une importante échauffourée près de Leliefontein. Alors qu'elle est en arrière-garde, accompagnée d'une poignée de membres du Royal Canadian Dragoons, 200 Boers à cheval se ruent sur la batterie. Les Canadiens tiennent leurs attaquants en échec en livrant un combat courageux, bien coordonné et mené avec souplesse. L'infanterie britannique les a laissés seuls, en nombre inférieur, ce qui n'a pas empêché les Canadiens d'utiliser les ressources du terrain pour prendre les Boers à leur propre jeu. Même si le site de cette bataille n'avait ni la valeur stratégique ou symbolique de Paardeberg, les Canadiens ont sauvé canons et bagages, tout en empêchant que les Britanniques subissent des pertes humaines. Cela vaudra à trois des Dragoons la Croix de Victoria : les lieutenants H.Z.C. Cockburn et R.E.W. Turner, ainsi que le sergent E.J. Holland. D'autres Canadiens seront décorés pour ce fait d'armes. Pendant quelque temps, au cours de la Première Guerre mondiale, Turner aura l'occasion de commander l'une des divisions canadiennes au combat.
Commandée par le major W .G. Hurdman, la Batterie D est la première à entrer en action. Elle fera campagne pendant 41 jours, passant le reste de l'année à occuper des avant-postes, à garder des chemins de fer ou à se déplacer. Son plus grand ennemi sera la fièvre entérique. La Batterie E sera plus ou moins vouée au même sort dans cette guerre d'escarmouches.
Quant aux deux bataillons de carabiniers montés, ils parcourent de très grandes distances pour des missions quasi policières qui ne manquent pas de leur sembler futiles. En avril 1900, ces deux unités sont incorporées à la 1re Division de fusiliers montés commandée par le major général Hutton. Après avoir souligné l'absurdité de compter sur l'efficacité au combat de miliciens qui n'ont pas bénéficié d'une instruction préalable, Hutton abandonne le poste de major général de la Milice canadienne. En Afrique du Sud, c'est donc avec précaution qu'il introduit les Canadiens dans sa force. Les troupes montées canadiennes participent à l'avance vers Pretoria. Par la suite, elles sont presque toujours en contact avec les patrouilles boers lors d'opérations dans l'est du Transvaal.
Lord Strathcona’s Horse
L'ensemble des Canadiens présents en Afrique du Sud au printemps de 1900 ne représente pas encore - et de loin - la totalité de l'effort humain consenti par le Canada pendant cette guerre. D'autres unités, dont certaines ne sont pas levées par le gouvernement canadien, s'y rendront. Ainsi, Lord Strathcona and Mount Royal, haut-commissaire du Canada à Londres, recrute à ses frais, au Manitoba, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, une unité de carabiniers montés de 537 officiers et soldats. Le Lord Strathcona’s Horse sera placé sous le commandement du lieutenant-colonel S. B. Steele, de la Police montée. Strathcona paie pour lever, organiser, équiper et transporter les hommes jusqu'en Afrique du Sud. En outre, il comble l'écart entre la paie des militaires britanniques, assumée par la Grande-Bretagne, et la solde versée par le Canada à ses professionnels. Sur place, l'unité se rend jusqu'au Mozambique afin de couper, sans succès, les communications des Boers qui s'étendent jusqu'à la baie Delagoa. Elle rejoint ensuite sir Redvers Buller en campagne au Natal. Lors d'une escarmouche et sous un feu nourri, le sergent A.H.L. Richardson s'expose audacieusement en retournant sur ses pas pour récupérer des blessés. Ce geste héroïque lui vaudra la Croix de Victoria.
Les restrictions sur le recrutement des Canadiens
Leur recrutement ne plaît pas à tous. Les anti-impérialistes n'ont pas changé leur façon de voir les choses et plusieurs impérialistes sont offensés de constater que l'identité canadienne naissante est complètement occultée dès que les gendarmes sont enrôlés.
Le succès des troupes montées incite cependant d'autres Canadiens à offrir leurs services pour aller en première ligne. Le lieutenant-colonel A. Denison et le major William Hamilton Merritt proposent tous deux de former un nouveau contingent monté pour l'Afrique du Sud. Le War Office accueille avec enthousiasme ces propositions qu'il veut soumettre aux conditions habituelles. Finalement, celle de Merritt, du 29 décembre 1900, reçoit l'accord anglais. Présumant de l'appui de son gouvernement, Merritt amorce la mise sur pied de son unité. C'était sans compter avec les traces laissées par l'affaire des gendarmes dans l'esprit des politiciens. Ceux-ci l'empêchent d'aller plus loin aussi longtemps qu'une politique précise n'aura pas été adoptée au sujet de la participation canadienne. Le 13 mai 1901, on aboutit enfin à un ensemble de conditions qui peuvent se résumer ainsi : toute demande de recrutement de Canadiens sera adressée au gouvernement du Canada ; le ministre de la Milice et de la Défense sera le seul à lever des troupes dont il sélectionnera les officiers, même dans le cas d'unités temporaires du type de celles combattant en Afrique du Sud ; en général, ces officiers seront issus de la force permanente ; il est défendu à quiconque de recruter des policiers au Canada.
Les autres contributions du Canada
Pour prouver son sérieux, le Canada offre aussitôt de mettre sur pied un nouveau contingent recruté d'après ces critères. Il crée le Canadian Yeomanry, une unité d'un peu moins de 600 hommes, réclamée le 25 novembre 1901 par la Grande-Bretagne et qui recevra plus tard le nom de 2nd Regiment Canadian Mounted Rifles ; comme le veut la coutume, à son arrivée en Afrique du Sud, elle ne répondra à aucune autorité canadienne.
Le 2nd Regiment Canadian Mounted Rifles sert pendant trois mois, au cours desquels il se distingue par la qualité de ses reconnaissances. On le retrouve dans le sud-ouest du Transvaal et participant aux dernières poussées d'invasion de ce pays jusqu'à Vrybierg, à l'ouest. Quatre de ses soldats s'illustrent à Honing Sprint, en tenant 50 Boers en échec, mais avant qu'ils ne soient secourus, deux perdent la vie et deux autres sont blessés. Tous les quatre, écrit le général Hutton, pourtant avare de compliments pour ses Canadiens, « étaient de Pincher Creek... Au pied des Rocheuses, région bien connue pour l'excellence, l'audace et la hardiesse de ses cavaliers ».
Citons d'autres aspects de la contribution canadienne. Environ 2 000 hommes organisés en quatre régiments de carabiniers montés arrivent en Afrique du Sud après le 31 mai 1902 et la fin des hostilités. Pour eux, c'est l'occasion d'un aller-retour sans combat. Par ailleurs, 64 hommes formant un hôpital canadien de campagne desserviront certaines troupes britanniques. Les Canadiens fourniront aussi 16 infirmières. Avec cet engagement en Afrique du Sud, le moment est jugé propice à la création du Service canadien des soins infirmiers. L'effort du Canada s'étend jusqu'à l'envoi de 5 commis de poste, de 23 artisans (cordonniers et forgerons, par exemple) et d'environ 300 Canadiens qui rejoignent des troupes irrégulières britanniques, soit directement, soit à la fin d'un contrat avec l'unité qui les a conduits en Afrique du Sud.
Plus de 100 autres Canadiens se retrouvent au sein des troupes régulières britanniques, sans compter la centaine de diplômés du Royal Military College qui ont reçu une commission britannique. Parmi ceux-ci, le lieutenant-colonel Édouard Percy Girouard, le major H.G. Joly de Lotbinière, des Royal Engineers, et Philippe-Henri Duperron Casgrain, l'adjudant général adjoint au quartier général de l'armée britannique en Afrique du Sud. Certains, tels les Howard's Canadian Scouts, sont restés légendaires. Howard est un Américain arrivé au Canada en 1885, où il a enseigné le fonctionnement de la mitrailleuse Gatling. Devenu sujet britannique, il s'est porté volontaire pour l'Afrique du Sud. À l'expiration de son contrat, il a offert une unité d'environ 125 aventuriers d'origine canadienne recrutés parmi les gens en fin de contrat. Ces éclaireurs, acceptés par les Britanniques, seront de toutes les actions audacieuses, au prix de pertes énormes toutefois.
Pour s'ajuster à la guerre de raids qui, vers la seconde moitié de 1900, caractérise les combats en Afrique du Sud, les Forces britanniques s'appuient fréquemment sur de petits groupes d'hommes à cheval. Chaque fois que la Grande-Bretagne sollicite le recrutement de gendarmes à cheval auxquels elle veut confier le maintien de la paix dans divers secteurs du pays, le Canada acquiesce. Plus de 1 000 hommes sont donc engagés pour une période de trois ans, pour être ensuite réunis dans 12 escadrons de la gendarmerie sud-africaine. Certaines de ces recrues ont fait partie des contingents canadiens précédents et reprennent du service pour la Grande-Bretagne à la fin de leur contrat initial. De toute façon, ils présentent tous une excellente condition physique et savent monter à cheval lors de l'enrôlement.
Le bilan. L’opignion des Canadsiens à l’égard de l’Armée britannique
Rudyard Kipling et J.H.M. Abbott (dans Tommy Cornstalk) feront du Canadien le champion du pillage et du vol de chevaux (les Canadiens appellent ça, entre eux, le sens de l'initiative, un don particulièrement utile face aux carences du système britannique de logistique et de remontes). Les chefs militaires britanniques, pour leur part, de Redvers Buller à Smith-Dorrien n'ont que de bons mots pour les braves et vaillants Canadiens. Hutton, qui ne se contredit pas facilement, est plus réservé. À son avis, les Canadiens ont bien réussi grâce à des chefs ayant du panache (lui-même, sans doute) et parce qu'ils ont servi auprès d'unités de la cavalerie professionnelle britannique. D'ailleurs, ajoute-t-il, il est impossible à des cavaliers de la milice de s'élever au niveau des troupes régulières.
Les Canadiens ont, eux aussi, une opinion sur leurs grands frères anglais. Le lieutenant-colonel S.B. Steele, par exemple, réprouve l'absence d'initiatives : sans ordres, les Britanniques ne bougent pas, laissant parfois passer de belles occasions. À mesure que son séjour se prolonge, Steele est plus critique à l'égard des généraux britanniques, de leurs tactiques et, surtout, de certains de leurs ordres qui créent des problèmes et épuisent inutilement les hommes. Il fournit l'exemple du choix de bivouacs installés juste sous les canons de petits groupes de Boers, qui entourent bientôt d'obus les feux de camp. Alors seulement, se décide-t-on à déménager. On marche souvent sans s'assurer des hauteurs qui, aussitôt, sont contrôlées par des ennemis. Pour les déloger, il faut livrer une bataille inutile. Les témoignages fourmillent d'exemples de ce genre. Dans une situation où des troupes impériales passent la nuit dans une dépression, Sam Hughes sera réveillé par une sentinelle qui a repéré des Boers dévalant la pente et prêts à ajuster leur tir sur les soldats anglais. Hughes et son groupe, qui sont sur les hauteurs et n'ont pas été détectés, prennent dans une souricière ces Boers qui s'évaderont dans la nuit. Le futur ministre de la Défense du Canada ne ménagera pas ses commentaires à ce propos et il ne pardonnera jamais aux Britanniques une erreur encore plus grande, celle de ne pas l'avoir décoré pour son action.
D'autres aspects de la coopération impériale sont déstabilisants pour plusieurs Canadiens. Comme les troupes sont fréquemment subdivisées en groupuscules, il arrive que des Canadiens fassent l'objet de mesures disciplinaires de la part des Britanniques sans qu'un officier canadien en soit avisé. Ainsi, le lieutenant-colonel Lessard apprendra-t-il que deux de ses hommes sont passés en cour martiale sous l'accusation d'avoir tenté de revendre à des Boers des armes qu'ils leur avaient arrachées. Quand Lessard a vent de l'affaire, il apprend du même coup que ses deux soldats avaient été entraînés dans leur forfait par un sergent britannique.
Le nationalisme en pleine croissance
Retenons les conclusions suivantes sur la participation du Canada à la guerre d'Afrique du Sud : elle a provoqué la socio-politique dans notre pays ; les hommes qui y ont participé en sont revenus avec le sentiment d'être plus canadiens qu'ils ne l'étaient avant leur départ ; la réputation du professionnalisme militaire britannique, tant vanté par les officiers anglais servant au Canada, a été fortement érodée. La différence évidente existant entre Canadiens et Britanniques n'a pas échappé aux quelques milliers d'hommes et de femmes qui se sont rendus en Afrique du Sud. L'eau et la nourriture, distribuées d'après la logistique anglaise, leur ont souvent manqué. Dans les hôpitaux militaires, malades et blessés étaient davantage soignés en fonction de leur grade plutôt que de leurs besoins. La réponse canadienne à ces constatations n'aura pas nécessairement que des effets positifs. Ainsi, des choix « nationaux » seront faits par la suite et coûteront cher.
Au plan sociologique, on verra s'accentuer la tendance des Canadiens à vouloir servir sous les ordres de leurs officiers, ce qui favorisera le maintien de liens entre ces derniers et les hommes politiques. D'autant plus que, sur le terrain, les commandants canadiens en opération risquent d'avoir comme chefs directs des Britanniques. La subdivision de la loyauté est porteuse de nombreuses difficultés qui s'étaleront jusqu'à la fin réelle du régime néo-colonial sous lequel les militaires du Canada évolueront durant la première moitié du XXe siècle.
Ainsi, contrairement à ce que plusieurs ont d'abord cru, la centralisation impériale ne progresse pas entre 1899 et 1902 et, à bien des égards, le nationalisme canadien est stimulé par l'expérience. Cela ne signifie pas que les débats entre nationalistes et impérialistes soit terminé, d'autant plus que la Ligue nationaliste de Bourassa trouve son origine dans cette guerre.
Plus de 8 000 hommes et femmes, incluant le bataillon d'Halifax, ont directement participé à l'effort de guerre canadien en Afrique du Sud. Au moins 270 d'entre eux sont morts, soit au combat (89), soit de maladie (181), et 252 ont subi des blessures légères ou graves, comme la perte d'un membre. À la suite du conflit, 16 veuves, 24 orphelins et 72 personnes à charge des disparus ont sollicité la contribution du Fonds patriotique (Patriotic Fund). De plus, cet organisme a reçu 712 demandes d'hommes dont le gagne-pain avait été réduit à cause des blessures subies ou des maladies contractées là-bas : 612 d'entre eux recevront une compensation en argent. Il faut souligner que la maladie a été un ennemi plus efficace que les Boers eux-mêmes, car, même si la fièvre entérique ne tuait pas toujours, elle affaiblissait le corps et l'âme de ceux qui en étaient atteints.
À leur retour, la plupart de ces hommes portaient le souvenir de l'horreur de leurs combats, de la maladie, de la fatigue, des privations, de la monotonie et de la discipline. Ceux du premier contingent ajoutèrent à ce souvenir l'inexpérience, la confusion et la désorganisation des premières semaines alors qu'ils durent participer à pied à une campagne très mobile et négligemment dirigée par le haut commandement. Longtemps après, leur mémoire substituera à ces images troublantes celles d'aventures faites d'endurance, de courage et d'éternelles amitiés forgées sur le théâtre des combats. Les quatre Croix de Victoria décernées à des Canadiens ont récompensé la valeur des efforts de tous les participants.
La vie militaire canadienne après l’Afrique du Sud. Les leçons militaires de la guerre
Les leçons apprises en Afrique du Sud vont être utiles et l'expérience va raviver l'intérêt des Canadiens pour leur milice et la fierté de plusieurs pour leur armée. Quant au Canada, il se détournera du concept de défense territoriale pour s'engager progressivement dans les affaires mondiales.
Rien ne laissait présager que le conflit pouvait être le prélude à la participation du Canada à une guerre européenne, mais, à certains égards, il l'avait été, y compris au chapitre de l'opposition entre Canadiens français et Canadiens anglais. En 1914-1918, les chefs, leurs arguments et les tactiques politiques seront très semblables à ceux de 1899-1902.
Les principales déficiences observées dans la Milice canadienne pendant cette guerre touchaient la planification et l'intendance, notamment le remplacement, dans les unités, des hommes perdus ou en fin de contrat. Il y avait aussi les services de santé improvisés. Certains de ces aspects ont été corrigés à compter de 1899, avec la création du Service de santé de la milice puis, en 1904, avec la naissance du Corps de santé de l'armée canadienne. En 1903, le Corps du génie royal canadien apparaît sous l'égide d'un ancien élève-officier du RMC, le lieutenant-colonel Paul Weatherbe. Puis, la même année, sont successivement créés le Service de l'intendance, le Corps canadien des magasins militaires, puis celui des guides et des transmissions. Le Corps des commis militaires d'état-major naît en 1905 et celui de la Trésorerie de l'armée canadienne, en 1906, bien qu'il n'entre officiellement en opération que le ler juillet 1907, avec 33 membres, tous grades confondus. En 1913, dans diverses unités du pays, le Corps-école d'officiers canadiens fait ses premiers pas.
Pendant cette période, les budgets croissent, ainsi que le nombre maximal des miliciens volontaires et la solde par jour de camp. On achète aussi d'immenses terrains pour l'entraînement, dont celui de Petawawa, où les exercices de formation reprennent. Dès 1899, on s'est procuré de nouveaux fusils et canons. Les normes d'instruction et celles à la base des promotions des officiers sont revues alors que l'on adopte des uniformes de campagne plus pratiques.
Le conseil de la milice. La mainmise impériale est rompue
Batterie de Belmont à Fort Rodd Hill, Colombie-Britannique. Construit en 1898-1900 afin de protéger la base de la Marine Royale sur le Pacifique, la réplique de cette batterie a été reconstruite de façon identique pour la Deuxième guerre mondiale.
Après 1902, le mouvement s'accélère pour faire de la Milice un bras du gouvernement fédéral de plus en plus canadien. Déjà, en janvier 1900, le ministre responsable, Frederick Borden, a pu faire adopter l'idée d'un corps, qu'il qualifie de provisoire, de plus de 1 000 hommes, soit un bataillon de huit compagnies, le 3rd (Special Service Battalion) Royal Canadian Regiment of Infantry, pour relever la garnison britannique d'Halifax, dont on a besoin en Afrique du Sud. Mais, en 1905 et 1906, les garnisons britanniques d'Halifax et d'Esquimalt sont remplacées définitivement par des Canadiens. Ainsi, le plafond de la force permanente passe-t-il d'abord de 1 000 à 2 000 hommes, pour atteindre 4 000, avant 1914. En 1904 encore, le Conseil de la milice est créé et le commandement de la Milice est confié à des Canadiens. C'est le signal de la disparition de la préséance des officiers britanniques sur les Canadiens de même grade. La confiance des Canadiens en leurs talents et aptitudes en matière militaire les incitera à choisir un fusil différent de celui des troupes impériales et un uniforme quelque peu distinct.
La remise en question du commandement de la milice
Dans la plupart des pays du globe, les relations des civils et des militaires sont au centre de difficultés. Au Canada, en particulier depuis les débuts de la Confédération, cette coexistence a été exacerbée par la présence de Britanniques à la tête du système de défense. Un exemple de cela est l'intervention de Hutton, s'immisçant dans le processus politique pour pousser le Canada à s'impliquer dans la guerre de l'Afrique du Sud. Pendant son séjour au Canada, Hutton avait également suggéré certaines mesures qui auraient réduit les pouvoirs du sous-ministre et des autorités civiles en général. Ces propositions qui lui auraient permis notamment de s'adresser directement au Ministre sans passer par le sous-ministre ont été accueillies avec d'autant plus de réserve que Hutton manquait souvent de tact. On savait qu'il sélectionnait les officiers à envoyer en cours et qu'il intervenait dans les contrats de remonte et dans plusieurs secteurs où ministre et patronage régnaient généralement sans partage. L'officier général commandant n'a pas hésité à souligner ouvertement les défauts et les faiblesses de la Milice. Au fil de ces tracasseries, ses relations avec Frederick Borden se sont tendues au point d'éclater sur la question du plan de Hutton pour la mobilisation de la Milice en faveur de l'Afrique du Sud.
Le fait que Laurier en soit venu à appliquer, à quelques détails près, la proposition de Hutton, n'a pas atténué la rancœur que le premier ministre et Borden ont continué de nourrir contre l'officier général commandant. Lorsque Hutton formera une commission chargée d'acheter les chevaux destinés au deuxième contingent, Laurier exigera son rappel. Lord Minto tentera bien de protéger Hutton, mais il s'inclinera bientôt devant l'insistance de Laurier. Hutton n'a jamais semblé comprendre - et il n'a pas été le seul dans ce cas - qu'il était le conseiller de son ministre et du gouvernement en affaires militaires. Il s'est comporté en commandant de milice, presque complètement indépendant de toute politique.
Les demandes exprimées en Chambre pour que l'officier général commandant soit un Canadien seront plus nombreuses et plus fermes. De 1900 à 1902, le major général britannique R.H. O'Grady Haly occupe cette charge avec toute la diplomatie requise dans les circonstances et implante certaines des réformes suggérées par Hutton. En 1902, il est remplacé par le major général comte de Dundonald, un cavalier dont la renommée s'est construite en Afrique du Sud grâce à son panache, à son audace, à sa jovialité et à sa modestie. Les amis de Dundonald lui ont conseillé de refuser ce poste devenu de plus en plus malsain pour ses occupants. Finalement, malgré des réticences évidentes, il accepte. À Londres, on le prépare à éviter les impairs. En arrivant au Canada, il prend bien en main le système de défense considéré comme un mal nécessaire par les politiciens locaux.
Le plan de Lord Dundonald
Son analyse de la situation l'amène à proposer une force de première ligne de 100 000 hommes fondée en réalité sur une milice de 40 000 à 50 000 hommes prêts à réagir en cas de menace contre le territoire national. La deuxième ligne de défense reposerait sur les épaules de 100 000 autres hommes qui pourraient être enrôlés et entraînés rapidement par des cadres qui seraient en supplément dans les unités de temps de paix. D'où l'acquisition des grands camps d'entraînement signalée plus tôt. Il désire également rééquilibrer les armes et mettre sur pied les services nécessaires, toutes réformes qu'on lui permet d'entreprendre. C'est lui qui propose les commandements régionaux existant toujours dans l'armée de terre malgré des modifications et une éclipse d'une vingtaine d'années. Bien sûr, le sérieux qu'il met dans son travail entraîne des coûts. Si son plan est accepté, il exigera des dépenses initiales de 12 à 13 millions de dollars et un investissement annuel de 5 millions de dollars pour son maintien. Le tollé soulevé dans la presse, n'empêche pas le ministre d'implanter certaines des propositions tout en cachant l'ensemble à la population. Deux des recommandations ne verront pas le jour : le passage obligatoire de tous les jeunes garçons dans les corps de cadets et l'enrôlement d'un surplus d'officiers et de soldats, mesure qui aurait doublé les effectifs de la Milice en cas d'urgence.
Entre 1902 et 1904, la Milice est tout de même soumise à une vaste réorganisation qui a été amorcée par les prédécesseurs de Dundonald. On assiste donc à la naissance d'un Service du renseignement, d'un Bureau central des dossiers et à la construction d'arsenaux et de salles de tir. La Loi des pensions de la Milice vient soutenir la Force permanente qui accueille de plus en plus de diplômés du RMC.
La suprémathie du Canada sur la milice
Depuis Wolseley, Dundonald est le premier à soulever l'enthousiasme des miliciens. Mais, très tôt, le courant passe mal entre lui et Frederick Borden. Dundonald a adopté l'une des habitudes de Hutton, soit celle de parler en public de la Milice et de ses difficultés. Même si son grand rapport de 1902 n'a pas été rendu public, il a été largement entériné, alors que celui de 1903 a été remanié par le ministre. Dundonald s'irrite des retards, en particulier de ceux qui touchent la création du camp central, et des interventions continuelles du politique dans son univers.
Dundonald, qui cultive des relations avec l'opposition conservatrice, termine lamentablement sa carrière sur une affaire de patronage. En juin 1904, il a été choqué par l'initiative du ministre par intérim, Sidney Fisher, qui a rayé le nom d'un Conservateur que Dundonald désignait pour le commandement d'un nouveau régiment des Cantons de l'Est. Le major général proteste publiquement et, le 14 juin, un décret du Conseil le démet de ses fonctions. Avant de quitter le pays, il profite de la campagne électorale pour monter sur toutes les tribunes où on l'invite et se livrer à une attaque en règle du gouvernement libéral sortant. Ces activités ne nuiront pas à l'équipe de Wilfrid Laurier qui est réélue, mais elles ont permis au public de comprendre que Dundonald a sans doute eu raison dans l'affaire qui a conduit à son renvoi.
Mieux que jamais, le contexte se prête à la réforme qui est en gestation depuis des années, réforme qui confierait au ministre canadien de la Milice et de la Défense, plutôt qu'à l'officier général commandant, le rôle de conseiller du gouvernement en affaires militaires. Borden, qui a déjà mis en branle une révision de la Loi de la Milice, la fait voter et elle entre en vigueur au mois de novembre 1904. Un décret du Cabinet établit aussitôt le Conseil de la Milice (semblable au Conseil de l'Armée britannique) où siègent le ministre, son sous-ministre, le comptable du ministère ainsi que le chef de l'état-major général, l'adjudant général, le quartier-maître général et le maître général de l'artillerie. Moins puissant que l'officier général commandant, le Conseil aura néanmoins plus d'influence. Le ministre en est le chef incontesté. Il peut faire le tri des sujets à débattre et il est mieux informé des besoins de son ministère. Quant aux militaires, ils sont enfin sensibilisés aux problèmes du ministre. Le premier chef d'état-major, le brigadier général PH. N. Blake, est britannique d'origine. D'autres suivront dans cette foulée, mais, très rapidement, la fonction sera dévolue à des Canadiens de souche.
Le Canada et le lien impérial. La contribution du Canada àl’empire
Face à la montée de l'Allemagne en Europe, l'Angleterre est amenée a concentrer plus d'efforts autour du centre de son Empire. Les défaites initiales qu'elle a subies en Afrique du Sud ont ramené à de plus justes proportions l'admiration que lui vouaient ses colonies. Il y a eu des réformes à Londres comme ailleurs aux confins de l'Empire. On rappelle la marine britannique dans les eaux européennes et le Canada accepte de prendre à sa charge la défense d'Halifax (1er juillet 1905). Il fait de même pour Esquimalt en 1906, ne serait-ce que pour assurer les approvisionnements de la Royal Navy lorsqu'elle se déplace. Halifax devient canadienne dès 1906, alors qu'Esquimalt ne le sera qu'en 1910. Les décrets du Cabinet britannique autorisant officiellement ce transfert d'autorité ne seront signés qu'en octobre 1910 et en mai 1911.
Malgré l'augmentation de la solde de base de 40 ¢ à 50 ¢ par jour, les Canadiens sont peu portés à s'enrôler dans la force élargie à 4 000 hommes. Au début, plusieurs des Britanniques ayant terminé leur contrat au Canada feront partie des nouvelles troupes de garnisons canadiennes d'Halifax et d'Esquimalt, mais leur nombre est inférieur aux besoins. En 1908, seulement 2 730 des 4 000 postes de l'armée permanente sont remplis.
Plus que jamais, la Grande-Bretagne a besoin d'alliés. L'entente cordiale avec la France est un exemple de ce qu'elle recherche pour faire face à l'Allemagne. Un rapprochement sensible avec les colonies est aussi au programme. En 1902, lors de la Conférence coloniale de Londres, Joseph Chamberlain demande aux dominions d'assigner une partie de leurs troupes à une réserve impériale spéciale qui serait placée sous les ordres du gouvernement anglais pour servir n'importe où dans le monde. Le Canada, comme l'Australie, refuse d'être dessaisi de son autorité. Peu diplomates, les Britanniques reprochent au Canada la faiblesse de sa défense et de sa participation à l'effort commun.
Ce refus n'empêchera pas l'Angleterre de revenir à la charge, cinq ans plus tard, avec une idée différente qui, avec un gouvernement libéral moins centralisateur et sans Chamberlain dans la politique coloniale, cherche à uniformiser, autant que possible, les forces armées de l'Empire sur lesquelles régnerait un état-major général impérial. Il n'y aurait, cependant, qu'une seule marine sous un commandement unique et l'uniformisation proprement dite viserait précisément l'entraînement, l'organisation, l'équipement, l'approvisionnement et les munitions.
Les gouvernements présents à cette conférence de 1907 adoptent une résolution peu engageante, favorisant la création de l'état-major impérial qui, sans se mêler des questions nationales, conseillera les gouvernements de l'Empire « qui le demandent, en matière de formation, d'instruction et d'organisation pour la guerre des forces militaires de la Couronne ». Cet organisme recueillera les renseignements qu'il rediffusera aux divers gouvernements en plus de préparer les plans de défense fondés sur un principe commun. Le chef de l'état-major impérial, à Londres, dirigera l'état-major central. Ce début d'alliance formelle à l'intérieur de l'Empire ressemble de près aux engagements que prendra le Canada, à compter de 1950, au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
Les concepts de la défense de l’Empire
En 1909, une conférence spéciale sur la défense de l'Empire traite de problèmes navals et militaires ayant pour principe de base l'uniformisation. Dans la mesure du possible, cette uniformité doit aller de la composition des unités jusqu'aux armes utilisées, en passant par leur transport. D'une part, on trouve une autonomie canadienne totale et, d'autre part, l'intégration rapide et facile de nos forces si elles devaient se porter à la défense de l'Angleterre.
Moins évidente qu'au tournant du siècle, la centralisation impériale est pourtant en voie de réalisation. Après la réunion de 1909, des officiers britanniques vient au Canada pour participer aux travaux de la section canadienne de l'état-major général dont la création a été approuvée en 1907. Des officiers canadiens vont en Grande-Bretagne se familiariser avec les méthodes anglaises. Des plans de mobilisation sont préparés, soit pour défendre le Canada, soit pour envoyer un corps expéditionnaire outre-mer, à la rescousse de Londres. Ni la résistance de Laurier à toute centralisation, ni les cris sans grande suite en vue d'une fédération impériale n'empêcheront cette tranquille intégration qui conduit à une seule école de pensée. Malgré les avantages de ce développement, les éléments qui risquent de priver le soldat canadien de son caractère distinctif sont déjà en place. Plutôt que de se préparer à défendre son pays, en faisant des manœuvres d'hiver, par exemple, le milicien canadien s'exerce à devenir aussi anglais que possible.
La conférence impériale de 1911 se réunit autour du couronnement d'un roi. Reléguées au second rang, les discussions militaires se concentrent sur des détails découlant de l'implantation des décisions de 1907 et, surtout, de 1909. À compter de 1912, l'état-major général impérial intègre des officiers canadiens et australiens au sein de sa section des dominions, une initiative qui engage le Canada plus à fond dans la défense de l'Empire britannique. En 1914, sans en être pleinement conscient, le Canada est prêt à fournir un effort qui dépassera de loin les vues des plus ardents impérialistes. D'un côté, il marche vers une plus grande autonomie, de l'autre, les différentes conférences coloniales ou impériales, qui ont eu lieu depuis 1902, ont contribué au resserrement anglo-canadien.
La loi navale. Les origines du Naval Bill de 1910
De nombreux Canadiens croient que la Loi navale est brusquement apparue en 1909-1910. En fait, les principes de la défense maritime du Canada figuraient déjà dans la première Loi de la Milice, en 1868, au moment où George Étienne Cartier en était le ministre en titre. Cet embryon de défense navale n'a abouti qu'à la construction de quelques chaloupes canonnières et de cotres pour la défense des Grands Lacs et de nos côtes ainsi que pour la protection de nos pêcheries. Notre véritable force navale est britannique. Après 1871, il n'existe guère de problèmes importants avec notre seul voisin et le gouvernement canadien laisse rapidement à l'abandon ses minces efforts navals, certains ayant été consentis avant la Confédération par des colonies comme la Nouvelle-Écosse. Dès 1867, faute de moyens et à la suite du décès de B. Weir, son créateur et protecteur, la brigade navale néo-écossaise se détériore. Au Québec, les compagnies navales créées en 1868 à Bonaventure et New-Carlisle, et celle de Carleton, après 1869, sont peu équipées et sont perçues comme des anomalies par les responsables de la Milice. Moins d'une décennie plus tard, elles auront disparu ainsi que celle de Bonaventure qui est démantelée en 1878. Quant à la police des pêches sur la face atlantique, supervisée par l'Angleterre, son utilité est remise en question après la ratification par le Congrès américain du traité de Washington en 1873.
En 1871, avec l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, Peter Mitchell, ministre de la Marine et des Pêches, et Hector Langevin, ministre des Travaux publics, suggèrent que le Canada défraye les coûts liés au maintien du navire armé britannique rattaché à Esquimalt depuis des années. La suggestion des deux ministres est écartée sitôt que le Canada cesse d'être hanté par la perspective de raids fenians.
En 1886, des zones de pêche entre le Canada et les États-Unis sont à nouveau contestées. La Grande-Bretagne, voulant éviter les problèmes diplomatiques qu'entraînerait une intervention de la Royal Navy auprès de pêcheurs américains fautifs, rétablit un Service canadien de protection des pêches. L'organisme civil canadien a des responsabilités limitées, affirmant principalement la présence et le bon droit du Canada, tout en évitant les confrontations directes avec les États-Unis. En 1892, le pays renforce le Service avec trois navires : un sur les Grands Lacs, un dans la baie de Fundy et un dans le Bas-Saint-Laurent. Ses membres portent un uniforme presque identique à celui des marins britanniques. Les navires, qui arborent le White Ensign avec les armes canadiennes, sont commandés par des officiers britanniques. La vraie force navale reste toujours l'escadre britannique d'Amérique du Nord et des Antilles occidentales, basée à Halifax.
Les craintes navales de 1870
HMS Thrush en 1892. Le HMS Thrush (lancé 1889) était une cannonière de la Marine royale. Elle est le modèle typique des navires de patrouille britannique basé à Halifax et à Esquimalt au cours des années 1870 et 1880. Le Thrush était un membre de la classe « Goldfinch » qui pouvait déplacer 818 tonnes métrique (805 tonnes), armé de six canons de 4 pouces (10.2 cm) et équipé du genre d'une goélette à trois mâts au surplus de ses turbines à vapeur. HRH prince George (plus tard, roi George V) était le commandant du navire en 1891 alors qu'il était stationné à Halifax (stationné antérieurement en Amérique du Nord et aux Antilles).
Entre-temps, un vent de panique souffle. En 1878, un vapeur russe, le Cimbria, avec à son bord 60 officiers et 600 hommes, accoste à Ellsworth, dans le Maine. Plusieurs croient que sa mission consiste à acheter aux Américains de petits vapeurs rapides qui pourraient s'attaquer au commerce britannique. La crise appréhendée n'a pas lieu mais le major général Edward Selby Smyth continue de croire qu'en cas de guerre anglo-russe, les armes et les canons qui sont peut-être à bord du Cimbria pourraient servir aussi bien à terre qu'en mer. C'est en fonction d'une telle éventualité que, dans une lettre adressée à son ministre le 3 mai 1878, il propose de former une petite armada de vapeurs dans le golfe du Saint-Laurent.
En février 1879, l'alarme est chose du passé. Smyth penche en faveur d'une réserve navale dont l'entraînement reposerait sur un ou deux vieux navires anglais qui, même amarrés, permettraient aux nombreux marins canadiens inactifs l'hiver de s'entraîner, et à la milice navale de l'intérieur des terres d'y venir l'été.
L'Amirauté britannique n'exprime d'abord aucun intérêt puis, en 1880, dans une de ses volte-face auxquelles les Canadiens devront s'habituer, elle se montre disposée à céder au Canada le Charybes, un navire juste bon pour ce que les Canadiens veulent en faire. Mais le gouvernement canadien a déjà d'autres préoccupations et confie le Charybes au ministère de la Marine qui le retape en y investissant plus de 20 000 $. Ensuite, ne sachant trop comment en disposer, on le remorque à Halifax où il est confié à l'Amirauté. Ce fiasco entraînera la mise à l'écart de la force navale durant un bon moment.
Si le Canada se cherche en matière de défense navale, il n'est guère plus avancé quant à sa perspective générale des affaires maritimes. En 1868, un ministère de la Marine et des Pêches a été créé. En 1884, il est scindé en deux ministères distincts et, en 1892, on reconstitue un seul ministère comme il était au moment de sa création. Il sera redivisé en 1930 puis, en 1936, la Marine sera transférée au ministère des Transports. En 1995, la section Marine, des Transports, passera au ministère des Pêches et Océans.
Cette indécision ne nuira pas aux projets de création d'une marine militaire canadienne qui continuent de germer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Presque tous ces projets reposent sur des données qui sont encore valables en 1995 (dont l'immensité des côtes canadiennes) ou qui resteront importantes durant des décennies, parfois même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Au cours des années 1880, les craintes s'expriment à peu près comme suit. Faute de batteries navales ou de navires, les côtes canadiennes sont laissées sans défenses. L'escadre britannique la plus proche s'occupe aussi des Bermudes et, en cas de guerre en Europe, elle serait aussitôt rappelée.
Des rivages sans défense
Le port de Halifax, vu de la Citadelle vers 1875. Bien que l'Angleterre ait retirée ces troupes du Canada en 1871, elle a maintenue ses deux bases navales: Esquimalt en Colombie-Britannique, et de façon plus importante à Halifax. Halifax devenait le domicile d'un bataillon d'infanterie britannique et quelques batteries du Royal Regiment of Artillery jusqu'en 1905. Dans cette photo, l'on voit les artilleurs à côté de leur arme chargeurs à muselière de canon (au surnom de « bottle gun » par la forme du canon) à la citadelle d'Halifax.
Dans ces conditions, un Canada qui voudrait s'armer en vitesse verrait ses contrats d'armement entrer en compétition avec ceux de la Marine britannique. Cette marine, la plus puissante du monde, est tout de même moins dominante en cette fin de XIXe siècle qu'elle ne l'était un demi-siècle auparavant. Le Canada pourrait même être menacé par un petit navire postal armé qui, en lançant une attaque contre le commerce maritime, pourrait causer d'importants dommages, le pays ne disposant d'aucun moyen pour le poursuivre et le détruire.
Parmi les projets soumis pour parer à de telles éventualités, citons ceux de Colin Campbell et d'Andrew Gordon. Le premier vise à créer une réserve navale formée de marins de la pêche hauturière. Ces hommes disposeraient des meilleurs navires de pêche armés de canons de la Royal Navy et ils seraient instruits par des Britanniques prêtés au Canada et invités à s'y installer. Coût approximatif de l'opération : 150 000 $. De son côté, entre 1888 et 1891, Gordon soumettra plusieurs propositions à l'honorable Charles Tupper. Celle de 1888 repose principalement sur de meilleures batteries côtières, sur l'acquisition de torpilles pour défendre les ports et de navires de moyen tonnage. En 1891, Gordon préconise à son tour le recours aux nombreux marins canadiens pour former une réserve navale. Dans la perspective d'un conflit armé, ces miliciens seraient intégrés aux hommes de la Marine impériale. Il veut tout de même pouvoir compter sur deux navires de moyen tonnage construit en Grande-Bretagne, dont l'un servirait dans les zones de pêche et l'autre à l'instruction.
Malgré l'intérêt exprimé par plusieurs personnalités, ces projets n'aboutissent pas. Cela s'explique par la présence de la Royal Navy et par le fait que la Milice terrestre canadienne accapare le peu de fonds réservés à la défense du Canada. Somme toute, à l'approche du XXe siècle, l'éventualité d'un Canada menacé est d'autant plus improbable que la navigation à la vapeur et son pendant, le blindage des navires de guerre, ont accentué la dépendance des forces navales aux ressources et à l'approvisionnement en combustible. Par conséquent, ce phénomène freine l'ardeur des ennemis de la Grande-Bretagne qui, contrairement à celle-ci, n'ont pas de bases partout dans le monde. Or, les bases en sol canadien sont accessibles aux Britanniques, éloignées des pays européens et à peu près invulnérables, sauf si l'attaque était menée à partir des États-Unis, ce qui est de moins en moins probable. Quant aux navires en bois ou à voile, ils seraient arrêtés par des batteries d'artillerie côtière, dont le nombre augmente lentement sur les côtes canadiennes vers la fin du XIXe siècle.
La ligue navale du Canada
En 1895, les pressions s'accentuent pourtant. En Grande-Bretagne, la compétition avec l'Allemagne pour le nombre et la qualité de nouveaux navires, dont les fameux cuirassés, extrêmement coûteux à construire, amène le lobby naval à donner naissance à la Navy League, qui veut aider le gouvernement à influencer la population des îles Britanniques pour qu'elle consente aux sacrifices nécessaires au maintien de sa supériorité navale. En fondant des sections dans les colonies, la Navy League espère pousser les gouvernements locaux, y compris celui du Canada, à adhérer à la vision britannique.
La branche no6 de la Navy League est créée à Toronto, en 1895. Le 20 juin 1896, soit trois jours avant la tenue du scrutin fédéral qui portera Wilfrid Laurier au pouvoir, le plan de défense navale de H.S. Wickham, secrétaire d'honneur de cette branche, est publié dans le Globe and Mail. Étant donné les circonstances, cela ne peut guère aller loin, mais la proposition présente quelque intérêt, Wickham avançant l'idée d'une milice navale qui côtoierait la milice terrestre, avec l'équivalent d'un officier général commandant, une force permanente et de réserve, des écoles sur les deux côtes et, enfin, l'adaptation du Service de protection des pêches aux exigences de la défense côtière.
Au mois de décembre de la même année, Wickham soumet une autre idée au gouverneur général et au premier ministre. Il s'agit, cette fois, de fournir des Canadiens à la Royal Naval Reserve, à l'intérieur d'un programme que l'Amirauté a mis sur pied pour aider de petits navires marchands à se transformer en navires de guerre en cas de crise. Cette suggestion ne sera pas acceptée, mais, jusqu'en 1910, Wickham persistera à presser le gouvernement d'agir dans ce domaine.
Comme pour le reste de la vie politico-militaire canadienne, les conférences impériales et coloniales ont un impact sur l'évolution de la défense navale du Canada. Lors des rencontres de 1887, 1894 et 1897, les ministres canadiens ont rejeté toute idée de participer à celle-ci, même si la Royal Navy n'est plus ce qu'elle était 40 ans plus tôt.
La stratégie navale de l’Empire
En 1902, l'Amirauté soutient l'idée d'une marine impériale centralisée, prête à frapper l'adversaire où qu'il se trouve. Cette vue s'oppose aux projets précédents qui visent prioritairement à défendre le Canada et, ce faisant, l'Empire. Le Canada étudie de plus en plus sérieusement le schéma d'une réserve navale d'appui à l'effort anglais. D'autres colonies préfèrent voter des fonds que la Grande-Bretagne consacrera à l'entretien des navires affectés à leur défense. Dans l'un ou l'autre cas, on s'oppose à l'idée d'une marine impériale centralisée et dirigée par Londres. En 1904, au moment de réviser sa Loi de la Milice, le gouvernement canadien prépare une ébauche de loi de Milice navale qui en restera cependant à cet état. Pourtant, les négociations touchant les frontières de l'Alaska se sont terminées au détriment du Canada, notamment parce qu'il était absent de la zone en litige.
Pourquoi une loi de Milice navale ne voit-elle pas le jour à ce moment crucial ? Plusieurs raisons peuvent être invoquées. À cette époque, le gouvernement a l'affaire Dundonald sur les bras et d'influents ministres, dont Clifford Sifton, se font entendre pour exprimer l'opinion que le peuplement de l'Ouest devrait passer avant l'augmentation de la force de protection des pêches. De son côté, le ministère de la Milice et de la Défense, qui doute de l'utilité de défendre les Grands Lacs, préconise le statu quo sur la question des côtes. C'est que le contrôle total de la défense maritime du Canada entraînerait des coûts importants au moment où la prise en main d'Esquimalt et d'Halifax, qui fait augmenter le budget de la défense de 40 pour cent, est déjà annoncée. Enfin, cette question qui semblait pouvoir faire l'unanimité excite les dissensions nationalistes et impérialistes qui viennent de s'affronter sur l'Afrique du Sud.
Le ministère de la Marine et des Pêches acquiert cependant deux petits navires de surveillance armés construits en Grande-Bretagne sur le modèle de torpilleurs. Dès 1905, l'un d'eux, le Canada, participe à des exercices d'ordre militaire avec l'escadre britannique déployée aux Bermudes.
À la conférence coloniale d'avril-mai 1907, l'Amirauté assouplit sa position quant à « une seule marine » : disposée à accepter une certaine participation coloniale, elle exige néanmoins d'en conserver le contrôle total. Durant cette conférence, le Canada, encore une fois accusé de ne pas consacrer assez d'énergie à sa défense navale, dresse un long réquisitoire qui évoque sa contribution, depuis 1871, à l'effort total militaire britannique en Amérique du Nord. Parmi les initiatives dont il voudrait être crédité, il mentionne : la prise en charge de sa défense terrestre et des bases d'Halifax et d'Esquimalt, ainsi que la surveillance de ses pêcheries, depuis 1885. À la fin de ces échanges, les Britanniques admettent que notre pays a contribué de façon substantielle aux affaires navales de la Grande-Bretagne.
En 1907, même si l'on décide de faire certaines réfections au navire Canada, la défense navale ne tient toujours pas beaucoup de place dans les intérêts du pays. Mais, en décembre, la flotte américaine entreprend un tour du monde dont un des buts est d'impressionner le Japon, un allié de la Grande-Bretagne. Même de loin, le Canada se sent à nouveau menacé, de sorte qu'en 1908, il analyse l'état de sa défense navale. L.P. Brodeur, ministre de la Marine et des Pêches, dirige l'étude qui est disponible dès les premières semaines de l'année. Alors qu'à l'intérieur de son ministère, le sous-ministre et le commandant de la Marine prennent une retraite anticipée et que les tensions américano-nippones s'amenuisent, Brodeur désigne Georges Desbarats pour occuper le poste de sous-ministre. Le contre-amiral Charles E. Kingsmill, un Canadien qui a servi avec la Royal Navy, est mis à la disposition de son pays d'origine, à compter du 15 mai 1908. Aux yeux des observateurs avertis, cette nomination surprenante est l'indice qu'après de multiples faux départs, la Milice navale canadienne pourrait bien enfin voir le jour. C'est d'autant plus probable qu'en 1908, on célèbre en grand, en présence de navires français et anglais, le 300e anniversaire de Québec.
Vers une marine canadienne
Au cours de l'automne 1908 et de l'hiver qui suit, alors que l'Australie crée sa milice navale, il est question de doter également le Canada d'un tel instrument, un projet qui n'est toutefois pas débattu lors de l'élection fédérale de 1908 qui reporte les Libéraux de Laurier au pouvoir. Pendant la session de 1909, une résolution des Conservateurs propose que le Canada prenne en charge une partie du fardeau de sa défense navale. Pendant les deux mois au cours desquels les francophones du Parti conservateur s'opposent à ce que cette résolution soit soumise à l'étude parlementaire, Kingsmill réalise le plan d'une milice navale qui, sans être trop ambitieux, suggère la formation d'une école à Halifax où des équipages seraient préparés à servir à bord des navires militaires que le Canada acquerrait au fil des ans.
Rien n'a encore été rendu public quand éclate en Grande-Bretagne ce qu'on a appelé la crise des cuirassés. La Grande-Bretagne, qui domine pourtant toutes les autres marines, vient de constater qu'elle ne pourra plus compter autant d'unités navales que le total de celles qui pourraient être réunies par deux puissances continentales européennes. L'Allemagne progresse vite. Un débat sur ce sujet, lancé à Londres le 16 mars 1909, précède de 13 jours la discussion déjà prévue aux Communes canadiennes sur la résolution du Conservateur George Foster. Les échanges parlementaires débutent donc au Canada à la lumière de la question que les Britanniques sont déjà en train de traiter et qui, au départ, devait rester une affaire interne.
Chez nous, les débats suivent deux axes complémentaires : il faut aider la mère patrie (impérialisme) et, pour ce faire, une marine canadienne serait la bienvenue (sentiment national). Sous les ordres de Brodeur, Kingsmill peaufine donc son plan de milice navale que Brodeur et Borden apportent à Londres, en juillet 1909. Les autorités britanniques organisent à l'improviste une conférence spéciale impériale sur la défense « militaire » et navale. Deux propositions sont avancées au sujet de la marine. La participation coloniale pourrait prendre la forme de contributions financières ou, encore, se concentrer autour de la création de forces navales locales qui pourraient s'ajouter à l'effort de la Marine impériale en temps de guerre. L'Australie, qui a offert de défrayer le coût d'un cuirassé, s'est fait répondre par l'Amirauté que la création d'une marine australienne serait plus acceptable pour la Grande-Bretagne. Or, cette option convient parfaitement au Canada. Cependant, puisqu'il s'agit d'avoir des destroyers et des cuirassés, on ne parle plus d'une milice navale, mais bel et bien d'une marine, d'où la Loi navale du printemps 1910.
La création de la marine Royale du Canada
La Loi navale est claire en ce sens qu'elle permet au gouverneur en conseil de mettre la force navale en service actif en raison de circonstances critiques. Il peut aussi le placer à la disposition de Sa Majesté pour servir dans la Royal Navy. D'où les craintes nationalistes justifiées par une déclaration de Wilfrid Laurier, en plein cœur du débat, à l'effet que, quand la Grande-Bretagne est en guerre, le Canada l'est aussi. En fait, il n'y a pas d'espace pour une politique étrangère canadienne indépendante. Plusieurs des menaces adressées à la Grande-Bretagne, celle du Soudan, en 1884-1885, par exemple, n'en sont absolument pas pour le Canada. D'autre part, les nationalistes, dirigés par Henri Bourassa, qui va fonder Le Devoir en 1910, disent que les États-Unis sont le seul véritable ennemi potentiel du Canada. Or, la Grande-Bretagne est prête, afin d'éviter quelque conflit que ce soit avec ce pays, à tous les accommodements, lesquels ont déjà fait perdre au Canada de vastes territoires lors de litiges avec les Américains « Exception faite d'une agression asiatique qui ne sera possible qu'avec le consentement des États-Unis, nous n'avons à craindre que les guerres que l'Angleterre voudra bien nous faire retomber sur le dos.»
La Loi navale ne fait donc pas l'unanimité. La région de l'Atlantique préconise le statu quo alors que celle du Pacifique serait favorable à une aide monétaire à l'Amirauté. L'Ontario, toutefois, soutient Laurier. La loi est aussi attaquée pour son coût trop élevé, que les nationalistes estiment à 20 millions de dollars. Pour leur part, les impérialistes soutiennent qu'un déboursé annuel d'environ 18 millions de dollars est excessif par rapport à ce que le Canada obtient en contrepartie. Il serait donc plus utile de donner ces 18 millions à la Grande-Bretagne qui en retirerait plus que deux vieux navires inutiles et quelques centaines de marins. Cette solution est d'ailleurs celle que préfèrent désormais les Britanniques. Cela dit, le gouvernement maintient le cap qu'il a choisi et tout est fait, durant l'été 1910, avant que les deux croiseurs soient officiellement remis au Canada (21 octobre 1910), pour que ceux-ci et leurs équipages puissent être intégrés à la Royal Navy en cas de nécessité.
Les conséquences du Naval Bill
À l'été 1911, Laurier déclenche une élection qui doit avoir lieu le 21 septembre. Le mécontentement à propos du soutien à la Grande-Bretagne et de la forme qu'il doit prendre est généralisé. La Loi navale devient un enjeu, quoique mineur, de la campagne électorale que les Libéraux perdent au profit des Conservateurs. Ces derniers, qui l'ont pourtant appuyée, rejettent maintenant son application. En arrivant au pouvoir, ils suspendent la construction des nouveaux navires ainsi que l'instruction des marins, tout en permettant au Rainbow de poursuivre ses patrouilles de pêche.
En juillet 1912, le premier ministre conservateur Robert Borden assiste en Grande-Bretagne à une revue navale formée de 315 navires. On ne manque pas de lui noter que les colonies, à l'exception du Canada, participent à cette démonstration de puissance. Après discussion avec Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté depuis octobre 1911, Borden revient au Canada. En décembre 1912, son gouvernement dépose un projet de loi qui autorise le pays à verser jusqu'à 35 millions de dollars à la Grande-Bretagne pour aider sa marine. C'est un autre revirement du gouvernement britannique qui, trois ans plus tôt, soutenait la création de marines locales dans les dominions. Malgré une forte opposition, dont celle d'une partie des nationalistes du Québec, alliés des Conservateurs en Chambre, le projet de loi est voté par les Communes, le 15 mai 1913, mais rejeté par le Sénat, dominé par les Libéraux.
La seule loi reconnue reste donc celle du 4 mai 1910. Cependant, l'abandon pratique de son application par les Conservateurs a conduit le Service naval au bord de la disparition. En effet, en août 1912, les marins anglais prêtés au Canada retournent chez eux. Devant l'incertitude entourant leur sort, les recrues canadiennes désertent en grand nombre. En octobre 1912, les deux croiseurs sont immobilisés et le recrutement est interrompu. Les quelques marins de tous grades qui restent sont transférés à la Royal Navy. En 1913, le Service naval devient le Service de protection des pêches, bien que Kingsmill s'assure qu'une instruction navale de base soit maintenue au Canada. Deux petits navires datant des années 1880, le Constance et le Pebel, dragueurs de mines peu utiles, même pour l'instruction, restent en service.
Au moment où l'affaire a pris des dimensions politiques, la plupart des Canadiens n'étaient pas en mesure d'évaluer l'importance militaire de la force navale projetée. La question n'a guère été modifiée par l'entrée du Canada en guerre, au mois d'août 1914. La marine canadienne est alors si faible qu'elle ne peut ni soutenir la Royal Navy, ni protéger les côtes canadiennes. Qui plus est, la base de l'industrie navale canadienne que l'on avait projetée est restée à l'état de projet.
Les Canadiens français dans les forces de défense
Politiquement, juste avant l'entrée en guerre, le Canada se divise âprement sur la question navale. Socialement, il n'a encore rien entrepris de sérieux pour rapprocher les Canadiens français des forces de défense du pays malgré les leçons évidentes servies aux gouvernants, tant au moment de la guerre en Afrique du Sud, qu'à celui de l'étude de la loi navale.
Lors du conflit de 1899 à 1902, on estime que les francophones du Canada n'ont rempli que 3 pour cent des cadres de l'ensemble des contingents. Dans le premier, cependant, qui avait été tiré de la force permanente, ils représentaient 5,4 pour cent des effectifs. Dès son arrivée, en août 1898, le major général Hutton, avait vu un problème dans l'absence des Canadiens français. Parmi ses interventions de tous ordres, il avait publié, en février 1899, une directive préconisant que les officiers d'état-major et les instructeurs puissent dorénavant diriger et entraîner, dans leur langue, les miliciens d'expression française. Apparemment, Hutton avait compris l'évidence, à savoir que pour les amener à participer aux entreprises militaires impériales, il fallait aller au-devant des Canadiens français. Hutton, qui parlait français, dut défendre son règlement à Toronto. Durant l'été 1899, deux autres directives établissant les conditions relatives à des examens linguistiques sont publiées.
La guerre de l'Afrique du Sud a interrompu cet élan et Hutton a payé chère certaine erreur. Néanmoins, un de ses officiers, Oscar Pelletier, lui a toujours conservé un « sentiment de vif attachement, d'admiration et de gratitude». Est-ce parce qu'il lui avait promis un bataillon ou pour son approche de la question francophone ? Après son départ, et alors qu'on réaménage la milice à la faveur de quelques leçons apprises en Afrique du Sud, le fait français est laissé dans l'ombre. « Seule la langue anglaise est employée officiellement, bien que deux unités d'artillerie sur 18 et 27 des 166 régiments (bataillons) d'infanterie, à la veille de la Grande Guerre, soient francophones. »
Au moment de la création du Service naval canadien, malgré la présence du sous-ministre Desbarats et de Brodeur, remplacé entre août et octobre 1911 à la tête du ministère par Rodolphe Lemieux, la question du français est ignorée. La majorité des officiers britanniques servant au Canada n'accorde aucune attention à cette langue. On leur rappelle alors ce qu'est le Canada, « un pays bilingue (où) le français et l'anglais sont sur le même pied ». Selon Brodeur, qui écrit à Desbarats, en août 1910, l'instruction devrait être disponible dans les deux langues, ce qui exige que les instructeurs soit bilingue. Autrement, les francophones unilingues seraient mis hors jeu. Cette vision n'ira pas plus loin dans cette marine sans âme et sans corps. À partir de 1911, le ministre conservateur de la Milice, Sam Hughes, n'est pas, et de loin, un ami des francophones et de leur langue. De fait, un an après l'arrivée de Hughes, le seul francophone important au sein de l'état-major, le colonel François-Louis Lessard, adjudant général depuis le let avril 1907, est remplacé par un anglophone. Au moment d'entrer en guerre, alors qu'à peine 9 pour cent de francophones sont présents dans la milice, 20 pour cent de ses officiers sont britanniques. En conclusion, personne ne semble être sensible au fait français. Aucune affinité ne semble s'être créée entre les deux peuples majoritaires d'origine européenne dans ce Canada où l'on affirme pourtant qu'il s'est édifié sur deux langues, deux cultures et deux peuples.
Le Canada en 1914
La Première Guerre mondiale
Hôpital de campagne, 1914. Au début des hostilités, l'armée française portait encore l'uniforme bleu et le pantalon rouge. Déployés ainsi habillés dans les plaines de la Champagne et de la Flandre, les soldats subirent des pertes terribles face aux mitrailleuses modernes, l'artillerie rapide et les 'bolt action rifles.' Depuis, toutes les armées portent des tenues aux couleurs ternes.
En juillet et août 1914, de nombreux pays, dont la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Belgique et leurs colonies, partent au combat contre les empires centraux allemand et austro-hongrois. L'Italie les rejoint en mai 1915. En décembre 1917, la Russie signe une paix séparée, mais les États-Unis ont déjà commencé à la remplacer sur les champs de bataille, étant en guerre auprès des alliés depuis avril 1917.
À la suite de cette tourmente guerrière, des empires vont disparaître, de nouveaux pays vont être créés, une Société des Nations viendra relancer l'idéal de paix universelle. La grande énigme de cette guerre des peuples n'a jamais trouvé de réponse satisfaisante. Comment a-t-on pu main tenir sur les champs de bataille des millions de combattants qui, d'un côté comme de l'autre, étaient si peu guerriers et n'aimaient pas la guerre ? Un tourbillon de mort les écrasera au combat et les entraînera dans ces grands mouvements collectifs qui, après 1918, conduiront à un autre cataclysme.
La participation du Canada
En août 1914, lorsque l'Angleterre entre en guerre, l'économie canadienne n'est toujours pas remise de la dure dépression économique qui a débuté à la fin de 1912, dans un contexte de surproduction industrielle. Le chômage a augmenté et le resserrement du crédit est sévère. Des cultivateurs ont abandonné leurs terres avec l'espoir de trouver, dans les villes, des emplois qui n'existaient pas. Au mieux, la chance leur a souri sous forme d'un certain secours matériel. En 1914, les compagnies possédant les deux chemins de fer transcontinentaux sont dans une position difficile.
Par son statut colonial, le Canada est automatiquement en guerre lui aussi. Clausewitz n'avait-il pas déjà écrit, dans la première moitié du XIXC siècle, que la guerre est la poursuite, par d'autres moyens, de la politique étrangère ? Pour sa part, le Canada fait la guerre sans aucune politique étrangère digne de ce nom. En 1914, la plupart espèrent que ce conflit, dont peu de gens mesurent la véritable envergure, prenne fin rapidement. Néanmoins, le gouvernement veut se donner des pouvoirs exceptionnels. Dès le 18 août, il soumet donc au Parlement un projet de loi des mesures de guerre qui lui permettrait de gouverner par décrets : cette loi sera adoptée le mois suivant.
Lorsqu'il entre en guerre, l'Empire britannique n'est pas aussi uni qu'on pourrait le croire. Déjà en action en Irlande, le Sinn Fein entend bien saisir l'occasion pour faire progresser sa cause. En Afrique du Sud, les Afrikanders, aussi blancs que leurs compatriotes anglais, sont divisés sur une attaque contre la colonie du Sud-Ouest allemand. Au Canada, ils seront principalement soutenus par les francophones du Québec qui refuseront pour eux-mêmes une participation à outrance aux combats.
Dès les premières semaines du conflit, ici et là dans l'Empire, les Blancs expriment leur loyauté à la cause britannique. Mais un fond de divisions subsiste. Il s'atténuera sans disparaître quand, en 1915, le paquebot Lusitania sera coulé. Dès lors, une unanimité presque totale tourne l'Empire contre l'Allemagne et ses alliés qui incluent initialement l'Autriche-Hongrie, à laquelle s'ajouteront au fil des mois la Turquie et la Bulgarie. Presque partout, on se pose la même question : à quel prix ce combat doit-il être mené ?
En général, les colonies britanniques entrent en guerre en comptant sur l'expérience de l'Empire en cette matière. Plus tard, le match se transformera en boucherie et les colonies y participeront de leur mieux. En 1918, la fin du jeu de massacres apportera un grand soulagement.
La scène politique au Canada
Au Canada, on est loin de l'impression de guerre totale qui est ressentie à travers le continent européen et la Grande-Bretagne. Au contraire, rien n'empêche les gens de s'adonner à une existence paisible. Depuis 1912, l'Ontario continue de débattre du fameux règlement 17 qui vise à écarter le français comme langue d'enseignement dans ses écoles séparées, tout en reprochant aux francophones du Québec de ne pas se battre pour l'Empire. Les nationalistes québécois se disent prêts à se battre pour les victimes franco-ontariennes du règlement 17, plutôt que de fournir trop d'efforts outre-mer.
La poursuite de grands objectifs politiques ne se fait pas sans contradictions internes. Loin du champ de bataille, ces dernières sont encore plus criantes aux yeux des nationalistes du Québec. Pourquoi serait-il si important, en 1914, d'aller se battre pour la France, alors qu'un siècle plus tôt c'était plutôt le contraire, et qu'il y a moins de 50 ans, lors de la guerre de 1870, cela ne l'était guère ?
La marine du Canada en guerre
Tout n'est pas négatif, loin de là. Sans doute, la Grande-Bretagne aurait-elle voulu un plus grand resserrement de son empire. Mais, il n'en demeure pas moins vrai qu'en 1914, même si le Canada reste indépendant, une très grande collaboration existe entre les forces britanniques et canadiennes. Cela dit, les Anglais ne font pas entièrement confiance aux soldats citoyens du Canada et à leur embryon de force naval qui s'est enrichie de deux sous-marins, achetés des Américains, pour les patrouilles côtières. C'est un ajout aux deux croiseurs dépassés que le Canada possède depuis 1910 et qui tombent sous commandement britannique. Malgré sa quasi-insignifiance, la marine canadienne est la première des deux armées canadiennes à se présenter au combat. Le NCSM Rainbow part dans les eaux du Pacifique, à la recherche de raiders allemands, qu'heureusement pour lui il ne rencontrera pas.
Avec sa Loi navale, le premier ministre Wilfrid Laurier avait entrevu un Canada autonome, se donnant une marine complémentaire à une marine britannique sur laquelle le pays ne pouvait guère s'appuyer en cas de coup dur. Il avait raison et la Première Guerre mondiale allait lui donner, ainsi qu'à des centaines de milliers de Canadiens de tous horizons, le goût d'un pays totalement indépendant.
Les eaux territoriales canadiennes ne sont pas protégées contre les dangers provoqués par la guerre. Pour contrer l'activité des sous-marins allemands, le Canada se dote d'une flotte de 134 petits bateaux de surveillance qui navigueront principalement le long de la côte est. Les Britanniques en assumeront le commandement.
Le Canada devrait-il se donner une véritable marine, demande-t-on aux Anglais ? La réponse est non ! Mieux vaut concentrer les efforts canadiens du côté terrestre. C'est ainsi que moins de 5 000 hommes feront partie des forces navales canadiennes pendant la Première Guerre mondiale.
L’armée du Canada en guerre
Au mois d'août 1914, avec environ 3 000 soldats professionnels et 60 000 hommes de la Milice active non permanente, l'armée est loin de représenter une menace pour les puissances centrales. Le pays peut fabriquer des munitions pour des armes individuelles, des obus de canons, ainsi que certaines petites armes. Son armement utile pourrait à peine suffire pour deux divisions alors que l'aviation militaire est inexistante.
Si le Canada est automatiquement en guerre, il lui revient de décider de l'effort qu'il consentira dans la pratique. Les précédents, depuis 1867, indiquent la voie à suivre. Ainsi, le volontariat sera-t-il à la base du recrutement des forces que l'on compte envoyer outre-mer. Mais, dans un élan impérial mal calculé, on enverra tous les volontaires au combat, créant au cours des mois de nouvelles divisions plutôt que des troupes de réserve qui servirait à combler les pertes. Dès la fin de 1915, l'enthousiasme pour le front bat de l'aile et, à compter de 1917, le nombre de volontaires inscrits chaque mois ne suffit plus à combler les pertes. Viendra donc la conscription, source de blessures profondes qui n'ont jamais totalement guéri.
Les divisions politiques
En 1917, Canadiens français et Canadiens anglais sont déjà bien ancrés dans leurs positions. Les premiers sont à peu près indifférents à cette guerre qui se déroule loin de chez eux et dont les conclusions ne risquent pas de les affecter. Selon eux, c'est ici, en terre d'Amérique, qu'un combat de tous les instants pour leur survie doit se poursuivre.
De leur côté, les Canadiens d'origine britannique se portent massivement volontaires, accusant les francophones du Québec de ne pas faire leur part. En réagissant ainsi, ils ne tiennent pas compte de plusieurs éléments importants. Par exemple, près de 70 pour cent du premier contingent de volontaires est formé de jeunes gens nés dans les îles Britanniques. Sans la conscription de 1917-1918, il est probable que plus de 50 pour cent des volontaires qu'envoie le Canada outre-mer auraient été des personnes nées hors du Canada. Enfin, et ce n'est pas négligeable, les États-Unis qui ne font pas partie de l'Empire vont se tenir à l'écart du jeu mortel de la guerre jusqu'au printemps 1917. Enracinés depuis des générations en Amérique du Nord, les Canadiens français ont un réflexe de non-engagement semblable à celui de leurs voisins du sud, une singularité que trop de leurs compatriotes refuse de voir.
À l'annonce de la conscription, les Conservateurs du Québec ne manquent pas d'affirmer que cette politique va leur coûter cher, ainsi qu'au Parti conservateur. Le projet de loi est présenté le 29 août 1917. Le gouvernement écarte du revers de la main la demande de Wilfrid Laurier qui veut un référendum sur la question. Devant le mouvement de résistance qui déferle sur le pays, et principalement au Québec francophone, le premier ministre canadien, Robert Laird Borden, propose à Laurier de former un gouvernement de coalition. Malgré l'opinion de certains Libéraux disposés à accepter cette offre, l'ex-premier ministre canadien refuse. Un gouvernement d'union sera finalement formé avec 15 Conservateurs, neuves Libérales proconscriptions et un représentant des milieux ouvriers.
Ce gouvernement d'union est élu lors du scrutin général du 17 décembre 1917. Il remporte 153 sièges, n'en laissant que 82 à ses opposants. Le Québec s'isole en accordant aux Libéraux 62 de ses 65 sièges. Borden compense ce résultat en accueillant dans son nouveau cabinet un sénateur canadien-français. Le Canada échappera peut-être aux ravages de la guerre, mais le conflit l'aura politiquement divisé.
Entre 1914 et 1918, il est allé aux limites de ses forces matérielles. Ses territoires agricoles en exploitation ont doublé et sa production industrielle s'est remarquablement accru grâce, entre autres, à l'essor des industries du bois et du papier, ainsi qu'à ses usines de munitions, à ses chantiers maritimes ou à l'aéronautique. L'effort financier du Canada est considérable : la dette du pays passe de 336 millions à 3 milliards de dollars. Les dépenses de guerre se chiffrent à 1,5 milliard de dollars.
La mobilisation. La première phase de la guerre et la mobilisation au Canada
Bombardement allemand d'Arras, en 1914. Arras, située au nord-ouest de la France près de la frontière belge, est une ville au patrimoine architectural inestimable. En 1914, la destruction d'Arras contribua grandement à la propagande alliée assimilant l'Allemagne à la barbarie. Cette peinture de l'artiste belge Gustave Fraipont, montre l'Hôtel de Ville d'Arras avec son campanile Belfoi qui ont été détruit durant la guerre. Plusieurs villes historiques belges et françaises ont connu un destin semblable.
Selon les plans de l'Allemagne, l'attaque qui s'appuie sur un large mouvement d'enveloppement des armées françaises, doit sceller le sort de la France en six semaines. Après avoir envahi la Belgique, l'aile marchante allemande progresse dans le nord-est de la France. Objectif : prendre Paris et enfermer les combattants français entre cette aile et le mur à peu près immobile constitué en Alsace-Lorraine. Le plan ne se déroule pas comme prévu. La retraite des Français a lieu, mais dans l'ordre et ponctuée de coûteuses contre-attaques. Les Allemands rétrécissent donc la zone d'envahissement en passant à l'est de Paris. Ainsi découvert, le flanc allemand est la cible d'une attaque restée célèbre, la bataille de la Marne, qui oblige les Allemands à céder une partie du terrain conquis. S'ensuivent de mutuelles tentatives de débordement qui ne font pas de vainqueur immédiat, mais qui permettent de libérer une grande partie de la France envahie et un petit secteur de la Belgique. Bientôt, entre la frontière suisse et la mer du Nord, deux lignes de tranchées s'affrontent.
La guerre de mouvement, amorcée au mois d'août, se transforme, vers la mi-octobre, en une guerre de siège, au cours de laquelle les puissances centrales sont les places fortes à investir.
Le Canada, qui n'a pas eu le temps d'intervenir au cours du premier épisode du conflit, a néanmoins jeté les bases de sa participation aux événements qui vont suivre. La Loi de la Milice de 1904 prévoyait que le gouverneur en conseil pouvait mettre en service actif une partie ou la totalité de la milice, soit au Canada, soit hors du pays. Préparés en conformité avec les vues britanniques, les plans de mobilisation de 1911 prévoyaient que, dans des circonstances jugées critiques par son gouvernement, le Canada pouvait envoyer un contingent composé d'une division d'infanterie et d'une brigade montée se battre dans un pays du monde civilisé, comme on disait à l'époque, et ayant un climat tempéré.
Ces plans sont toutefois enveloppés de tant de mystère que Sam Hughes, ministre de la Milice et de la Défense depuis 1911, en ignore l'existence jusqu'en 1913.
À cette époque, la milice active est la plus considérable que le Canada ait pu former en temps de paix : 59 000 hommes se sont entraînés et on prévoit hausser leur nombre à 64 000, en 1915. Acheté par le gouvernement canadien, le camp de Petawawa accueille près de 34 000 hommes au cours de l'été 1914. Les exercices d'entraînement ont souvent lieu devant un parterre de belles dames qui ont répondu à l'invitation d'officiers.
Que pensaient du cirque des camps d'entraînement les huit millions de Canadiens ? Évoquant, en 1943, la faune de miliciens réunis au camp de Lévis avant 1914, l'abbé Alphonse Fortin raconte qu'à son avis, comme à celui de plusieurs, les miliciens s'entraînaient à « des exercices indéterminés qui ne rappelaient rien aux hommes mûrs de ce temps-là. Les Canadiens avaient vécu si longtemps dans la paix qu'ils avaient même perdu le souvenir d'une tradition militaire Nous avions l'impression d'une milice sur le papier, de cadres fantaisistes - pour tout dire : une sorte de gaspillage.
La création du corps expéditionnaire canadien
C'est avec ces miliciens et cette population mal préparée, mais en général enthousiaste, que le Canada s'engage dans le conflit. Le let août 1914, trois jours avant que la Grande-Bretagne entre en guerre, le Canada lui offre une aide qui est acceptée le 6 août. Sam Hughes a déjà déclenché le processus de mobilisation, mais sans égards aux plans de 1911.
Le 10 août, un décret autorise officiellement la création d'une force expéditionnaire.
Mais déjà, le quartier général de la milice s'est mis à communiquer directement avec les unités. Les hommes recrutés par celles-ci sont envoyés à Valcartier qui sera le centre de rassemblement de la force expéditionnaire. Les volontaires sont redistribués dans de nouveaux bataillons identifiés par des numéros. Ces bataillons ont peu ou rien à voir avec la tradition. Les volontaires du 89e Régiment de Témiscouata et Rimouski, par exemple, sont dispersés dans les nouvelles unités. Malgré tout, le résultat est impressionnant, car, le 8 septembre, 32 000 hommes sont déjà rassemblés. Le 3 octobre, la 1re Division quitte Gaspé pour l'Angleterre. On dénombre alors 33 000 hommes et femmes et 7 000 chevaux répartis sur 31 navires, un convoi protégé par sept croiseurs britanniques. Quand ils débarquent en Grande-Bretagne, le 14 octobre, les Canadiens sont encore loin du champ de bataille.
Le 30 octobre 1915, le nombre des Canadiens passés de l'autre côté de l'Atlantique atteint 250 000. L'enthousiasme est si grand que, le 30 décembre suivant, Borden et Hughes, qui participent à une conférence à Londres, promettent un demi-million d'hommes aux Britanniques. Aujourd'hui encore, on ignore s'ils parlaient de 500 000 en première ligne, ce que le Canada n'a pu fournir, ou d'un effort total de 500 000 hommes, comprenant l'ensemble des lignes de communications, les garnisons canadiennes, la marine et divers autre service. Dans ce cas, le Canada a amplement exécuté sa promesse puisqu'il a mobilisé plus de 600 000 personnes.
En 1916, les forces canadiennes déployées dans le nord-ouest de l'Europe sont composées d'un corps d'armée de quatre divisions, comprenant chacune trois brigades de quatre bataillons formés d'environ 3 000 hommes. Pour un pays dont la population est légèrement inférieure à 8 000 000 d'habitants, cette présence en Europe est remarquable, tout comme est significatif le bilan des pertes enregistrées : 59 544 morts et 172 950 blessés. Le coût humain de cette guerre est bien plus grand que son coût financier.
Le Princess Patricia's Canadian Light Infantry (PPCLI)
L'effort militaire initial du Canada, qui se voulait tous azimuts, reflète bien l'esprit original et même excentrique de Sam Hughes, ministre responsable de l'époque.
Le Royal Canadian Regiment, (RCR), le seul régiment professionnel d'infanterie canadien, est envoyé aux Bermudes pour relayer une unité anglaise rappelée en Europe, où se concentre la véritable action. À son tour remplacé par des unités de miliciens sans grande expérience levés au Canada, le RCR ira plus tard rejoindre la force combattante professionnelle.
La création du Princess Patriciâs Canadian Light Infantry est une singularité par rapport aux méthodes de recrutement appliquées par Hughes. Le 1er août 1914, l'industriel montréalais Hamilton Gault offre à Hughes un régiment de cavalerie. À 15 ans de distance, Gault semble s'inspirer de l'initiative de Strathcona mais, à la différence du précédent, il veut se battre avec le régiment qu'il aura acheté.
Le 2 août, le ministre accepte en exigeant que la formation soit un régiment d'infanterie. Son premier commandant sera Francis Farquhar, secrétaire militaire du duc de Connaught, gouverneur général du Canada et frère du roi d’Angleterre. Le duc est le père de la princesse Patricia, qui prêtera son nom au bataillon. Gault injecte donc les 100 000 $ nécessaires à la mise sur pied du régiment qui recrute surtout des vétérans, en particulier ceux de l’Afrique du Sud. On croit alors que l'instruction de ces hommes expérimentés sera plus brève et que le fait qu'ils soient issus d'un petit segment de la population ne nuira pas au recrutement du reste du Corps expéditionnaire canadien.
Le rassemblement du PPCLI a lieu à Ottawa et, le 24 août, les hommes prennent le train vers Montréal où un navire les attend. On ordonne au régiment de s'arrêter à Québec en attendant le convoi dont le départ pour l’Angleterre doit avoir lieu au début d'octobre. Entre-temps, le PPCLI s'entraîne à Lévis, non pas à Valcartier, faisant ainsi montre d'une indépendance qui s'accorde mal avec la volonté d'avoir une force canadienne exprimée par Hughes.
Intégré au sein de la 27e Division britannique, le PPCLI est la première unité d'origine canadienne à monter au front et à subir d'affreuses pertes. À l'automne 1915, la division est appelée en Salonique, avec des brigades de quatre plutôt que de cinq bataillons. Le PPCLI, qui doit choisir entre une nouvelle brigade britannique ou une formation canadienne équivalente, opte pour cette dernière possibilité, car cela simplifiera le remplacement de ses pertes. Le 25 novembre 1915, le transfert est complété. Le PPCLI compte alors beaucoup plus déjeunes recrues d'origine canadienne qu au moment de son arrivée en première ligne. À Londres, le 21 février 1919, la princesse Patricia, procédant à l'inspection de son régiment, n'y reconnaîtra que 44 hommes des 1 000 miliciens quelle avait vus à Ottawa en 1914. Parmi eux, Hamilton Gault, amputé d'une jambe.
La méthode Hughes et le camp Valcartier
En 1912, le ministère de la Milice et de la Défense veut acquérir un camp central pour l'instruction des miliciens du Québec. Cinq sites différents sont évalués. En novembre, le dossier est confié à un agent des terres, William McBain. Au mois de juin de l'année suivante, ce dernier acquiert un terrain de 4 931 acres situés à plus de 20 kilomètres au nord-ouest de Québec. Pour éviter la spéculation, la transaction est enregistrée au nom de l'agent fédéral. On prévoit y entraîner 5 000 hommes chaque été.
Au début de la guerre, c'est une zone pouvant accueillir de 25 000 à 30 000 hommes qui est nécessaire. Le ministère négocie donc l'expropriation de 125 cultivateurs auxquels il verse 40 000 $, ajoutant ainsi 10 116 arpents aux terrains de McBain. En 1918, le camp de Valcartier aura une étendue de 12 428 acres et il en aura coûté 428 131 $, y compris la commission de McBain. Le 10 août 1914, généreux dans l'attribution de grades honorifiques à lui-même et à ceux qui lui plaisent, Sam Hughes accordera le grade de lieutenant-colonel (honoraire) avec solde à William McBain.
Au moment où la guerre débute, des champs de tirs d'armes individuelles sont en chantier dans la région d'Ottawa. À la demande du ministère, l'entreprise abandonne momentanément les travaux en cours pour aller à Valcartier où un champ de tir de 15 000 cibles est nécessaire. Les travaux débutent le 8 août et, cinq jours plus tard, 1 000 cibles sont déjà prêtes. Le plus important et le plus réussi des champs de tir au monde, comprenant abris, positions de tir et affiches, est complété le 22 août suivant.
L'enthousiasme du ministre a triomphé, mais il veut davantage et, pour obtenir ce qu'il convoite, il se tourne vers les hommes d'affaires fortunés. William Price accepte la responsabilité d'approvisionner le camp en eau potable. Il fera installer une pompe d'une capacité de 500 000 gallons d'eau par jour et une autre d'un million de gallons. Ces pompes sont reliées à un réservoir de 50 000 gallons enserré dans une structure d'acier de 16 mètres de hauteur. Grâce à Price, il est désormais possible d'acheminer l'eau simultanément à 200 tables d'ablutions de quatre mètres de long chacune et à 80 douches cloisonnées. Comme McBain avant lui, Price est vite récompensé pour sa générosité. Dès 1914, le grade de lieutenant-colonel honoraire lui est décerné et, le 1er janvier 1915, il reçoit le titre de chevalier.
L'éclairage des routes du camp est assuré par la Quebec Light and Power Company. Des réseaux télégraphique et téléphonique relient Valcartier à Québec et une voie ferrée est posée sur des ponts surveillés par des piquets de gardes armés qui vivent sous les tentes dressées non loin du rivage.
L'ensemble n'aura coûté que 185 000 $pour sa mise en place et pour son entretien jusqu'à l’Armistice. Pendant toute la durée de la guerre, les portes de camp de Valcartier se refermeront pour l'hiver. À côté des abris temporaires, les immeubles permanents sont rares : la résidence du ministre, le bâtiment abritant les pompes et le dispositif de chloration de l'eau. Le camp accueillera 33 644 hommes en 1914. Mais l'entraînement de base ayant été décentralisé, par la suite, on n'en trouvera que 8 737 en 1915, 14 924 en 1916 et 1 811 en 1917. Son coût total d'opération, entre 1914 et 1918 sera de 590 278,24 $. Dès le printemps 1915, la presque totalité des renforts sont conduits à Halifax d'où ils peuvent prendre la mer à l'année longue, au contraire de Québec.
Ration quotidienne d'un soldat s'entraînant à Valcartier
Poivre et sel 2 onces de beurre Les fruits sont en supplément.
1 1/4 livre de pain 2 onces de sucre La ration quotidienne des chevaux est de 19 livres de foin, 10 livres d'avoine et 2 livres de paille.
1 once de thé 6 onces de légumes frais
1/3 once de café 1 livre de viande fraîche
1 once de fromage 1 livre de pommes de terre
2 onces de confitures 1 once d huile
2 onces de feues 1 pied cube de bois
L’instruction du fantassin au Canada
Depuis la guerre de l'Afrique du Sud, l'entraînement des Canadiens et celui des membres des autres forces impériales a été modifié. Si le terrain d'exercice est essentiel, on a fractionné les bataillons, créé des demi-compagnies et des pelotons divisés en sections de 10 hommes. Les sous-officiers sont devenus importants dans la conduite de la bataille. Au Canada, où le mythe du milicien supérieur au professionnel continue de fleurir, on prétend recourir plus qu'ailleurs à l'initiative et à l'intelligence du soldat. À partir de 1906, on lui enseigne les rudiments du métier, après quoi il s'entraîne en sections, pelotons et compagnies.
En 1911, la force permanente tient un grand exercice à Petawawa. Ce sera le dernier, l'apôtre du soldat citoyen, Sam Hughes, étant persuadé que le Canadien pourra éventuellement s'en passer. Résultat : l'amateurisme réel de la milice et les moyens déficients dont disposent les professionnels sont les deux grandes faiblesses du Canada qui entre en guerre.
L'enthousiasme du volontaire est aussitôt confronté à une donnée incontournable qui lui fait perdre un temps précieux : la pénurie d'instructeurs qualifiés au Canada. Ce n'est qu'en 1917, à un moment où le flot des volontaires est tari, qu'on met sur pied un stage de formation de base d'une durée de 14 semaines.
Jusque-là, le quotidien du volontaire ne le prépare guère à l'action. On le réveille à 6 heures. Il déjeune après la période consacrée à la gymnastique, aux ablutions et à l'inspection. L'instruction débute à 8 h 30 pour prendre fin à 16 h 30, avec une pause d'une heure pour le déjeuner. Pendant cette journée type, la recrue apprend à défiler et s'exerce à charger à la baïonnette, un des exercices préférés de Sam Hughes qui aime en faire la démonstration. Surtout, les hommes marchent beaucoup, portant entre 60 et 80 livres d'équipement. Ils utilisent peu leur arme et ils assistent à de nombreux cours théoriques ayant peu de rapport avec le contexte réel des combats tel qu'ils se déroulent en 1914.
Le combattant canadien L’uniforme,l’équipement et l’arme du fantassin
Fantassin du Corps expéditionnaire canadien en France, en 1915-1916
Durant les premières années de la guerre, les soldats du Corps expéditionnaire canadien portaient la tunique kaki du modèle canadien adopté en 1903. Les insignes sur la casquette et le col prenaient la forme d'une feuille d'érable. Le fusil canadien Ross armait les soldats. Cette arme était longue et pesante et ne fonctionnait pas bien lors qu'elle devenait sale ou mouillée. Une bonne partie de ces distinctions disparurent en 1916 quand le CEC fut doté de casques en fer, de fusils Lee-Enfield et d'uniformes selon le modèle britannique.
Quel est l'accoutrement du volontaire ? Une casquette à visière ornée d'une feuille d'érable en bronze ; une veste ajustée en serge de couleur kaki à col droit rigide, fermée par sept boutons en bronze, des pantalons de même tissu et couleur ; des bottines brunes avec de longues bandes molletières de laine enroulées à partir de la cheville jusqu'à mi-jambe - les cavaliers commencent cette opération par le haut ; une chemise grise sans col ; d'épaisses chaussettes de laine ; des sous-vêtements en laine ; un maillot avec manches ; un long et épais manteau protégeant du froid et de la pluie ainsi que deux rugueuses couvertures grises.
L'armée fournit au volontaire un rasoir avec blaireau, trois brosses, l'une pour les dents, l'autre pour les cheveux et la troisième pour les bottes, une gamelle, des ustensiles, deux serviettes, une paire de gants de laine et une cagoule. S'ajoute à cela l'équipement Oliver, un ensemble compliqué de ceintures en cuir auxquelles sont attachées différentes poches pouvant contenir des munitions, de la nourriture, une gourde d'eau et permettant de transporter certains vêtements. C'est un médecin de l'armée britannique en garnison à Halifax, vers 1890, qui a convaincu le gouvernement de fournir l'Oliver aux miliciens. Comme la poche réservée aux munitions est à la hauteur de l'estomac, cet équipement est bien peu pratique pour ramper. Mais, ce n'est pas son seul défaut. Les ceintures d'épaules irritent les aisselles, la gourde et plusieurs des poches sont minuscules, les bandes pour les balles se déforment, entraînant la perte des munitions. Quand il a été mouillé, tout ce fatras se fendille en séchant.
Pour attaquer ou pour se défendre, le fantassin reçoit un fusil Ross, une baïonnette, une bouteille d'huile et un nécessaire pour nettoyer l'intérieur du canon de l'arme. Le fusil Ross n'est pas sans faiblesses : son magasin ne tient que cinq balles, la tige que le soldat tire pour extraire la cartouche devient rapidement brûlante et il arrive que la baïonnette fixée au canon tombe au moment des tirs. Le Ross est aussi très long (50 pouces et demi), mais il pèse 450 grammes de moins que le Lee-Enfield britannique qui, plus court et, surtout, plus sûr, remplacera le Ross.
L’instruction de l’infanterie et les conditions de service en Angleterre
Voilà pour l'entraînement, la somme des connaissances acquises et l'équipement de la jeune recrue quand elle part pour l'Angleterre. Là, dans la plaine de Salisbury, sous la gouverne de militaires expérimentés, on va la préparer au véritable choc du combat. Le jeune homme ne tarde pas à découvrir que ce n'est pas seulement sa formation qui est bâclée. Sa tunique se découd, son manteau de coton et de laine ne le protège ni de la pluie ni du froid. Fabriquées en vitesse pour les besoins d'une armée qui grossit à folle allure, ses bottines se défont dans la boue. Pour pallier leur fragilité, il enfile des couvre-chaussures en caoutchouc qui, pendant un certain temps, sont expédiés par les soins du ministère.
On va combler la plupart des carences. L'équipement Oliver des Canadiens, que les Britanniques avaient déjà écarté en Afrique du Sud, est remplacé par le Webb, plus pratique pour le fantassin surchargé. La Grande-Bretagne devient donc un fournisseur de sa colonie canadienne, qui a négligé de faire l'effort requis pour soutenir adéquatement sa volonté de conduire elle-même ses affaires militaires. En plus du Webb, les Britanniques procurent des bottes résistantes et des tuniques moins ajustées.
Dans une division d'infanterie de l'époque, on trouve 6 000 chevaux, dont la plupart servent à tirer des chariots. Une fois en Angleterre, les Canadiens ont la surprise de constater que les attelages fournis pas leurs alliés anglais (prévus pour que les chevaux blessés ou morts en course puissent être facilement détachés) ne s'adaptent pas à leurs wagons-bains. Même ces wagons ne conviennent pas, le bois utilisé au Canada pour les construire étant trop vert. Il se fend, casse et pourrit facilement. Les chariots servant au transport de l'eau ne peuvent être drainés ou nettoyés. Quant aux véhicules à moteurs canadiens, ils sont bientôt hors d'usage, les pièces de rechange n'étant pas disponibles en Angleterre.
Dans tous ces cas, la Grande-Bretagne vient en aide à ses colonies. Elle-même aux prises avec un problème de réarmement, elle est quelquefois confrontée à l'intransigeance parfois pitoyable des politiciens canadiens qui refusent de remplacer le fusil Ross ou la mitrailleuse Colt. La pelle MacAdam devait servir de bouclier contre les balles et, grâce à un orifice percé dans un coin du haut, permettre au soldat d'observer le champ de bataille. Trop lourde (près de 5 livres et demie) et à peu près inutile pour creuser, surtout dans la boue, elle est abandonnée.
Les Canadiens formés dans la plaine de Salisbury se régalent-ils ? Chaque matin, on leur sert du gruau et du thé. À midi, une portion de ragoût, le « stew » dont ils se souviendront longtemps. Au repas du soir, leur menu, pain, confiture et thé, a des allures de petit déjeuner canadien. Les petites fantaisies comestibles sont rares et difficiles à obtenir.
Les règles d'ordre et de discipline auxquelles le militaire canadien en sol britannique est soumis sont celles de la Loi militaire canadienne. Tant qu'ils n'ont pas quitté le sol anglais, ses confrères britanniques sont soumis au code de droit qui s'applique à l'ensemble de la population britannique. Hors du territoire, ceux-ci observent un code militaire identique à celui qui prévaut parmi les troupes canadiennes.
Ce code régit officiers et soldats, mais il ne semble pas être appliqué aussi équitablement qu'il le devrait. Ainsi, entre 1914 et 1918, 25,4 pour cent des officiers jugés par la cour martiale ont été acquittés pendant que 10,2 pour cent des sans-grades ont eu droit à la clémence de ce tribunal militaire. Parmi les nombreux officiers jugés pour lâcheté, désertion face à l’ennemie et autre offense punissable par la peine de mort, aucun n'a connu le feu du peloton d'exécution.
Les officiers canadiens
Pour devenir officier, un volontaire doit détenir une commission de la milice et obtenir la permission de son colonel ou l'approbation d'un officier commandant dans la milice. Les officiers d'infanterie ont reçu une formation moins complète que leurs collègues artilleurs. La partie théorique a été plus déficiente quand leur entraînement s'est déroulé dans les manèges militaires de petites localités, leurs collègues des villes étant plus favorisés à ce chapitre.
Parmi les 44 officiers supérieurs des deux premiers contingents partis du Canada en 1914 et 1915, neuf seulement appartenaient à la Milice permanente. Parmi les 1 100 officiers qui partirent, plus de 200 n'avaient pas de qualifications connues et 186, dont 27 lieutenants-colonels - ceux qui commandaient les unités combattantes - n'étaient pas qualifiés pour le grade qu'ils détenaient.
Le portrait de l'officier de la Première Guerre mondiale est encore flou. Grâce aux renseignements recueillis et analysés pendant et depuis cette guerre, on peut observer quelques traits communs. La majorité d'entre eux serait des professionnels et des employés de banque. On remarque cependant d'importantes concentrations de fermiers, d'ouvriers et d'étudiants. Une mince majorité d'officiers serait originaire du Canada.
Pour devenir officier, des critères élémentaires s'imposent. Par exemple, il faut une taille minimum de 5 pi 4 pc et avoir atteint l'âge de 18 ans. Le volontaire doit pouvoir résister aux dures conditions de vie imposées par la guerre. Le futur lieutenant reçoit des cours devant lui permettre de conduire son peloton avec confiance. Il est initié au droit militaire et formé, autant pour diriger l'orientation pendant la marche ou pendant une patrouille, que pour réagir en cas de problèmes de santé de ses hommes. Le lieutenant connaît bien les armes utilisées (y compris la mitrailleuse) et les différents types de tranchées. Il peut évaluer les distances avec précision, veiller sur l'alimentation de ses hommes ou organiser des piquets de garde. Pour assimiler l'ensemble de ces connaissances et les mettre un jour en pratique sur les champs de bataille dans des conditions presque toujours complexes, dangereuses et pénibles, le lieutenant reçoit une solde de 2,60 $ par jour.
Les pertes
L'infirmière Blanche Lavallée, Service de santé de l'armée canadienne, 26 juin 1916.
Un dessin de craie de l'infirmière Blanche Lavallée (1891- ?) à l'hôpital militaire canadienne à St. Cloud, le 16 juin 1916. Surnommées par les soldats blessés «les Oiseaux bleus» à cause de leur uniforme bleu ciel, plus de 2 500 infirmières canadiennes servirent outre-mer. Dès 1899, nos infirmières détenaient le rang d'officier confirmant leur statut professionnel. Ce n'était pas le cas des infirmières militaires américaines et l'énergique Blanche Lavallée milita avec elles jusqu'à leur obtention de ce principe en 1920. Elle demanda aussi l'équité salariale avec les hommes du même rang, ce qui fut finalement accordé durant la Deuxième Guerre mondiale.
Les Canadiens n'ont pas produit d'études approfondies pour connaître la cause des décès ou la nature des blessures infligées aux soldats sur le champ de bataille pendant la guerre 1914-1918. Les conclusions des Britanniques à ce sujet indiquent ce qui suit : 59 pour cent des décès ont été causés par les tirs de mortier et de canon ; 39 pour cent par des balles de fusils et 2 pour cent sont attribués à une myriade d'autres facteurs. Les pertes de vie dues à l'artillerie semblent avoir été plus élevées chez les Allemands où elles auraient atteint 85 pour cent entre 1916 et 1918, périodes au cours de laquelle la coalition des pays alliés a bénéficié d'une supériorité matérielle croissante. On peut penser que les Canadiens qui se sont battus sous le commandement et dans les secteurs où opéraient les Anglais ont subi des pertes comparables aux leurs.
Si ces pourcentages indiquent que l'expérience du combat réduit les pertes, les chiffres soulignent également que celles-ci ont été affreuses et que le roulement au front a été considérable, surtout parmi les unités d'infanterie les plus durement frappées en nombre et en pourcentage.
En arrivant au front, un bataillon de fantassins rassemble entre 800 et 1 000 hommes. Or, entre 4 500 et 5 500 hommes passeront dans chacune des unités engagées, ce qui donne une idée de l'ampleur des remplacements constants qui ont cours. Dans la 4e Division, le 44e Bataillon, en deux ans de combats, reçoit 5 640 hommes dont 1 193 seront tués. Par contre, le 38e Bataillon, en voit défiler 3 512 et subit 691 décès. Il en passera 5 584 dans le 22e, qui aura 1 147 tués.
On comprend, à la vue de ces chiffres, que le Corps médical de l'armée canadienne, créé en 1901, a eu plus d'une occasion pour se faire valoir. Composé de 13 médecins et de 5 infirmières avant 1914, l'équipe compte 1 525 médecins, 1 901 infirmières et 15 624 sous officiers et soldats, au plus fort de la guerre. Particularité canadienne : les infirmières ont droit au rang et aux privilèges des officiers. Au niveau supérieur, le major Margaret Clothilde MacDonald avait déjà servi en Afrique du Sud.
Première Guerre Mondiale: pertes par battaille. Ce tableau fournit une comparaison des pertes soutenues dans quelques batailles dont le Corps expéditionnaire canadien était impliqué durant la Première Guerre mondiale.
Les fardeaux de la guerre
Parmi les 59 544 morts du Corps expéditionnaire canadien, 6 767 ont été emportés par la maladie et 13 289 ont succombé à des blessures subies au combat ou à la suite d'accidents divers. À ces quelque 20 000 militaires soignés puis décédés s'ajoutent les 154 361 blessés ayant survécu. Impressionnant, le taux de succès des interventions pratiquées sur ces blessés se situe autour de 90 pour cent. Un phénomène observé dans la plupart des armées impliquées dans le conflit mérite d'être souligné : cette guerre d'importance a été la première au cours de laquelle les maladies se sont avérées moins meurtrières que les combats...
En 1916, lorsque les Canadiens sont engagés dans les vastes offensives sur la Somme, le fantassin porte une charge, proportionnellement à son poids, plus lourde que celle qu'on ferait porter à une mule. Il a 220 cartouches, quatre bombes, un pic ou une pelle (parfois les deux), des rations pour 24 heures, un manteau d'hiver ou un poncho imperméabilisé, des sacs pour le sable, de l'équipement de signalisation et un fusil. Il lui est difficile de marcher et, encore plus, de courir sus à l'ennemi. Si en plus, comme ce fut souvent le cas, la boue adhère à ses bottes, il est quasi paralysé. Le fantassin peut transporter jusqu’à 120 livres de vêtements et d'équipement. Les officiers et les hommes admettent que ce n'est pas raisonnable et les initiatives pour se débarrasser du superflu sont nombreuses.
Lors de la bataille de la crête de Vimy en 1917, on a réduit à environ 40 livres, le poids des effets à transporter. On a sauvé le poncho, un masque à gaz, l'arme, les munitions, les pinces, les gants de protection pour couper les barbelés, les fusées de signalisation, les sacs pour le sable, les pics ou les pelles. Certains soldats emportent également avec eux de larges pièces de cuir rigide avec lesquelles ils peuvent se jeter sur les barbelés pour faire un pont que leurs collègues franchissent. Les unités ont prévu, derrière les premières vagues légères qui peuvent maintenant courir, des arrivages de pics et de pelles qui permettront aux hommes de consolider les positions conquises.
Au mois d'août 1918, à Amiens, chacun transporte des rations pour une journée, le fusil, 250 balles, le masque à gaz, une gourde, deux grenades et deux sacs pour le sable, un pic ou une pelle. S'il se compare à son collègue de 1915-1916, le fantassin de 1918 est léger comme l'air. Un caprice de la nature a voulu que le sol soit sec ! À Amiens, pas de boue.
Du Canada à la Grande-Bretagne et à la France. Les Canadiens sur la plaine de Salisbury Pour les Canadiens, l'apprentissage de la guerre et la guerre elle-même se sont déroulés sous tutelle britannique, du moins au cours des deux premières années. Ainsi, en 1915, un tiers des officiers d'état-major, dont le travail consiste à penser et à préparer le combat, sont britanniques. Il faudra plusieurs années avant que les Canadiens occupent la presque totalité de ces postes. Arrivé en Angleterre, le premier contingent s'est dirigé vers le camp de Bustard, dans la plaine de Salisbury. Ce territoire de 200 milles carrés est, depuis longtemps, presque exclusivement réservé aux manœuvres militaires. C'est aussi un haut lieu du tourisme, puisqu'on y trouve Stonehenge. Certains des hommes y vivent sous la tente, les autres en caserne. Les Canadiens n'y sont pas seuls, une partie de « l'armée de Kitchener » - expression servant à définir les « levées en masse » des Britanniques - s'y entraîne aussi. L'entraînement se fait au niveau de la compagnie. La première étape de la formation dure cinq semaines. Viennent ensuite deux semaines à l'échelon du bataillon et deux autres semaines au niveau de la brigade. Enfin, le 11 décembre 1914, pour la première fois, la division s'exerce en formation.
Deux événements ont retenu l'attention des Canadiens qui ont séjourné à Salisbury. Ils ont vu le roi d'Angleterre lors des deux inspections auxquelles il a procédé et... la pluie est tombée pendant 89 des 123 jours que dura leur séjour.
En janvier 1915, les leçons apprises sur les champs de bataille par les Britanniques sont transmises aux Canadiens. Leur allocation de mitrailleuse Colt passe de deux à quatre par bataillon : les 30 hommes chargés de les servir reçoivent un entraînement spécial.
En route vers le front
Le 6 février 1915, un premier groupe de Canadiens traverse la Manche. Quittant Bristol, ils débarquent en France, à Saint-Nazaire, pour se diriger vers les cantonnements d'Hazebrouck, au nord-est de la France. La 2e Division arrive au front en septembre 1915 et, avec la 1re Division, forme le Corps d'armée canadien. Peu après, celles-ci sont rejointes par la 3e Division dans laquelle se trouvent le PPCLI et le Royal Canadian Regiment, ce dernier revenant d'un séjour d'une année de garnison aux Bermudes. La 4e Division arrivera en 1916. Chacune de ces divisions est constituée de trois brigades de quatre bataillons. Jusqu'en 1917, le corps d'armée sera commandé par des Britanniques : les lieutenants généraux E.A.H. Alderson (de septembre 1915 à la fin mai 1916) et sir Julian Byng (jusqu'au 23 juin 1917). Puis, jusqu'à la fin de la guerre, le commandement sera placé entre les mains d'un Canadien, le lieutenant-général sir Arthur Currie.
Les 18 000 hommes de la 1re Division sont progressivement initiés au combat. Entre le 17 février et le 2 mars, chacune des trois brigades est détachée durant une semaine auprès d'une division britannique où elle est mise au fait de la routine entourant un siège, ce qu'est déjà devenue la Première Guerre mondiale sur son front ouest. Les procédures britanniques, adoptées par les Canadiens, vont faire qu'environ 2 000 hommes d'une même division pourront être sur le front en même temps. Un bataillon se retrouve en première ligne pendant quatre jours, puis il passe en appui direct pendant quatre autres. Viennent ensuite, à l'écart du front, quatre jours de repos, une période consacrée, en réalité, au travail et à l'entraînement. Au fur et à mesure qu'ils iront au combat, les Canadiens connaîtront la tension et l'ennui, l'action et la terreur.
Du 10 au 12 mars 1915, à Neuve-Chapelle, la 11e Division participe à son premier engagement. En position d'appui à une attaque anglo-française, l'artillerie canadienne joue le rôle qu'on attend d'elle, mais les fantassins, paralysés par un fusil Ross qui s'enraye trop souvent, sont incapables d'adopter un rythme de tir rapide. Leur sens inné de l'initiative parvient à combler cette lacune du système : en effet, plusieurs d'entre eux se saisissent des Lee-Enfield abandonnés sur le champ de bataille par les blessés et les morts anglais. Au mois d'août 1915, on modifie le Ross Mark III en adaptant à celui-ci la « chambre » du Lee-Enfield. Les 2e, 3e, 4e et 5e (cette dernière sera dissoute pour fournir des renforts aux quatre autres) Divisions recevront ce fusil modifié. Mais, en 1916, le Lee-Enfield remplacera le Ross, qui ne sera ensuite utilisé que par les tireurs d'élite qui sauront profiter de sa grande précision.
Ypres et la défense
La guerre de siège est ponctuée d'attaques menées par les assiégés désireux de briser leur carcan, et d'attaques conduites par les assiégeants pressés de vaincre.
La 1re Division se voit confier, en avril, environ deux mille de front, à l'extrême gauche du corps expéditionnaire britannique, et au contact, sur sa gauche, d'une division coloniale française. Entre le 20 avril et le 4 mai 1915, les Allemands tenteront de percer à ce point de rencontre entre les coloniaux algériens et canadiens.
En plus de bombarder sérieusement le secteur, les Allemands utilisent les gaz pour la première fois. Les troupes n'y sont pas préparées. Les Algériens vont fuir et les Canadiens se replier en ordre : malgré la souffrance (3 058 pertes dans la seule journée du 24 avril) et en engageant leurs réserves, ils parviennent à rétablir un front continu. Au total, dans ce rôle strictement défensif et en l'espace de deux semaines, les Canadiens subissent 5 975 pertes, dont plus de 1 000 tués, les autres ayant été blessés, capturés par l'ennemi ou portés disparus. Du nombre total des pertes, 5 026 sont des fantassins.
Givenchy et Festubert
Lors d'une offensive qui a lieu au cours de l'été 1915, les Britanniques utilisent les Canadiens. Les conditions ne sont pourtant pas propices, en particulier parce qu'il ne sera pas possible de surprendre l'ennemi. Le major général Arthur Currie, qui commande la division canadienne ne l'ignore pas, mais les ordres sont clairs. L'attaque, qui durera cinq jours, va donner aux Britanniques le contrôle d'un terrain mesurant approximativement 600 mètres de profondeur par 1,5 km de largeur. Prix de cette parcelle : 2 323 pertes canadiennes. Plus tard, quand les Britanniques demanderont d'autres troupes aux Canadiens, Sam Hughes, qui ne manque aucune occasion de souligner l'incompétence des professionnels, commentera les événements de Givenchy en disant que c'est à des bœufs du Texas plutôt qu'à des êtres humains qu'il faudrait faire appel pour de tels combats.
Reste qu'à Givenchy, 3 000 Canadiens ont opté pour le matériel de la mère patrie, en échangeant leurs Ross, dont la supériorité, vis-à-vis du Lee-Enfield, a toujours été défendue par Sam Hughes, même quand il était dans l'opposition.
Le 2e Division subit son baptême du feu lors d'une attaque dans le secteur de Saint-Éloi, au tout début d'avril 1916. Après quelques gains initiaux, une vigoureuse contre-attaque allemande ramène les brigades canadiennes presque à leur point de départ. L'action a causé 2 000 pertes à nos troupes.
Au mont Sorrel, du 2 au 13 juin, c'est un peu le scénario inverse qui se joue. Les Allemands attaquent la 3e Division. Les bombardements d'artillerie préliminaires tuent l'avocat et major général M.S. Mercer. Les Allemands s'avancent ensuite et se saisissent de positions qu'ils se contentent de consolider. Une contre-attaque canadienne échoue et une autre est annulée le 6 juin quand l'offensive allemande reprend pour s'arrêter en vue d'Ypres. Byng, le nouveau commandant du corps, profite de ce répit pour organiser la riposte. Le 13 juin, les troupes canadiennes reprennent à peu près tout le terrain cédé depuis le 2 juin. Mais, entre le début et la fin des hostilités, les Canadiens a subi 9 383 pertes.
La terrible Sommes
Sergent du Fort Garry Horse, Corps expéditionnaire canadien, 1916. Ce régiment servit avec la Brigade canadienne de cavalerie en France et en Belgique entre 1916 et 1918, se préparant pour un type de combat qui avait pratiquement disparu en Europe occidentale. La cavalerie tenta de s’adapter aux nouvelles réalités tactiques et, sur d’autres fronts, sa mobilité la rendait très utile pour les reconnaissances et les mouvements rapides. Cependant, sur le front ouest, la cavalerie eut un rôle statique jusqu’aux dernières semaines avant la fin de la guerre.
Les très coûteuses attaques lancées par les Britanniques sur la Somme vont s'échelonner sur la période qui va du ler juillet jusqu'à la fin du mois de septembre 1916. Les Alliés vont y perdre, en morts et en blessés, 350 000 hommes et les Puissances centrales subiront des pertes à peu près équivalentes. Lorsque les Canadiens arrivent dans ce secteur, il y a déjà plusieurs semaines que l'offensive a été lancée. À l'issue de ce « bain de sang » comme les Allemands qualifieront toute l'affaire, les attaquants auront conquis quelques malheureux kilomètres carrés de terrain.
Jusqu'à ce moment dans la guerre, les Canadiens ont plus ou moins bien répondu aux attentes à leur égard. Le 4 septembre 1916, ils prennent position devant le village de Courcelette où, durant deux semaines, le seul fait d'occuper et de défendre les tranchées du front leur coûte 2 600 hommes. Puis, le 15, les Britanniques, incluant les Canadiens, reprennent leur offensive sur toute la largeur du front. Les troupes canadiennes ont comme objectif une sucrerie des faubourgs de Courcelette, dont ils s'emparent aisément. Jusque-là, d'un côté comme de l'autre, on s'arrêtait après avoir saisi l'objectif et on renforçait les positions conquises. Cette fois-ci, les Canadiens décident de continuer. Le 22e Bataillon du Québec et le 25e, de la Nouvelle-Écosse, suivis du 26e, du Nouveau-Brunswick, traversent donc le village. Le lendemain, plus de 1 000 prisonniers ont été faits et beaucoup de matériel a été pris. Ce sont les Canadiens qui se sont illustrés lors de ce vaste mouvement de troupes alliées. Cela dit, leur élan est bientôt brisé et on retourne à la guerre bien connue. Du 15 au 20 septembre, la prise de Flers-Courcelette, de Fabeck Graben et de Zollern Graben, a causé 7 230 pertes aux Canadiens.
Du 26 au 28 septembre, les Canadiens participent à la prise de l'arête de Thiepval. Les contre-attaques locales allemandes qui suivent font mal. À la mi-octobre, trois des quatre divisions canadiennes sont ramenées vers le nord, pendant que la 4e subit la dure expérience de la Somme dans des attaques, souvent infructueuses, qui se succèdent du 21 octobre au 11 novembre 1916, jusqu'à ce que, finalement, elle se saisisse d'un système de tranchées nommées Regina. Puis, la 4e Division rejoint le reste du corps canadien pour préparer un combat qui est encore célébré de nos jours.
Sur la Somme, les Canadiens auront mérité un titre qui les suivra jusqu'à la fin de la guerre : celui de troupes de choc du Corps expéditionnaire britannique. Avec leurs quatre divisions et sous la conduite éclairée et minutieuse de Byng, futur gouverneur général du Canada, les Canadiens, malgré leurs souffrances, semblent désormais destinés à de grandes choses.
La Crête de Vimy et la stratégie Allemande
En 1917, les Français ont remplacé joseph Joffre par Robert Nivelle, qui prétend pouvoir enfin pénétrer le mur allemand au sud, entre Soissons et Reims. Au nord des armées françaises, les Britanniques acceptent la mission de monter de puissantes attaques de diversion, qui retiendront dans ce secteur des dizaines de divisions de réserve allemandes. Une de ces attaques anglaises, qui est confiée au corps canadien, visera la crête de Vimy.
Cet objectif, dont le point culminant est situé à près de 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'étire sur plusieurs kilomètres entre Lens, au nord, et Arras, au sud. Sa conquête ne changera pas la face de la guerre, mais elle arrachera aux Allemands un plateau qui, dans cette plaine des Flandres, permet de dominer la région avoisinante sur des kilomètres. Après leur défaite sur la Marne, les Allemands se sont retranchés sur ce point que les Français ont maintes fois essayé de leur reprendre. Seules des troupes coloniales marocaines sont montées sur le plateau en 1915, mais, laissées sans appui, elles ont cédé à la contre-attaque allemande.
À ce stade, soit au printemps 1917, les Allemands voient cet endroit comme l'un des pivots de la défense de leur forteresse tranchées, barbelés, redoutes en béton, abris secs, chemins de fer, etc. Procurent aux troupes occupantes l'illusion qu'elles ne pourront pas être vaincues. Les Canadiens ont une pente assez facile à grimper, alors que les défenseurs ont souvent derrière eux des falaises abruptes. La stratégie de défense allemande d'alors admet la perte de premières tranchées un peu partout sur son front, car elle en prévoit la reprise dans de vigoureuses contre-attaques menées par des réserves placées en profondeur. Cette tactique est inapplicable sur ce secteur. C'est donc la défense au maximum des premières lignes, quitte à tout perdre sans retour si cela tourne mal, puisqu'il serait difficile, à maints endroits, de chercher à reconquérir les falaises que l'on viendrait d'abandonner.
Les préparatifs des canadiens à l’assaut de la Crête
Estafette en motocyclette du Corps canadien des signaleurs, 1917. Avant le développement des radios sans fil, les estafettes en motocyclette offraient la façon la plus rapide de transmettre des messages du champ de bataille, particulièrement quand les fils de téléphone ou de télégraphe devenaient impossibles à installer. Ce tableau de 1917 réalisé par Inglis Sheldon-Williams, artiste de guerre canadien, montre une estafette montée sur sa moto avec un insigne blanc et bleu porté au bras. Il s’agit de l’insigne des signaleurs, originairement porté sous forme de brassard, qui annonçait qu’ils avaient la priorité du passage sur les chemins. Ces couleurs étaient également utilisées pour les fanions de signaux.
Les Canadiens préparent de façon minutieuse leur grand assaut initial de 1917 qui doit, pour la première fois, impliquer simultanément leurs quatre divisions. L'attaque va profiter des leçons apprises auprès des Français qui ont développé l'art d'utiliser leurs fantassins en petits groupes pour s'occuper de certains points de résistance ennemis dépassés par leurs premières vagues d'assaut, en particulier les nids de mitrailleuse bétonnés, résistant aux obus et entourés de tranchées et de barbelés. Des Britanniques, ils empruntent l'utilisation judicieuse de l'artillerie de barrage précise ouvrant la route aux fantassins. Ils renforceront ces techniques par un travail de contrebatterie qui leur permettra de repérer 176 des 212 canons allemands qui pourraient briser l'offensive canadienne. Dans tous les domaines d'ailleurs, les Canadiens se prépareront avec précision.
On fera « voir » le terrain aux troupes grâce à des montages préparés à l'arrière et on les préparera à reconnaître et à prendre les objectifs assignés. Tous les progrès techniques apportés par la guerre depuis 1914 seront mis à contribution. Cela ira des grenades tirées par des fusils jusqu'aux obus à fusée à combustion (amélioration d'une invention française) qui explosent en touchant le sol et qui détruisent les barbelés, en passant par le repérage aérien des batteries ennemies et par l'approche et la destruction de positions bien défendues grâce à des tunnels creusés dans le calcaire particulier à cette région.
L'ouverture de l'attaque a lieu le 20 mars 1917, avec le début d'un bombardement des positions allemandes qui s'intensifie jusqu'au 2 avril, pour se stabiliser ensuite. À Vimy, les Canadiens disposent de 480 canons de 18 livres, de 138 obusiers de 4,5 pouces, ainsi que de 245 canons lourds et obusiers : de plus, ils ont tous les obus nécessaires, ce qui n'était pas le cas pour les troupes britanniques qui, un an plus tôt, se battaient sur la Somme. Les Britanniques mettent à leur disposition 234 autres canons, dont 132 lourds. Ainsi, les Canadiens ont une pièce d'artillerie lourde tous les 20 mètres de front, une couverture bien supérieure à celle de la Somme. Raids terrestres et vols au-dessus des lignes allemandes se multiplient sur les six kilomètres et plus de la largeur du front. Avant l'aube du dimanche de Pâques du 9 avril 1917, sous un blizzard poussé dans les yeux des Allemands, l'offensive débute. À cause des caractéristiques du front, les attaquants auront presque quatre kilomètres à franchir sur la droite avant d'atteindre leur objectif et 650 mètres seulement sur la gauche où, cependant, se trouvent les hauteurs les plus importantes et où le combat s'annonce le plus difficile.
Au bombardement, stationnaire depuis le 2 avril, succède un barrage roulant, appuyé de tirs ininterrompus de mitrailleuses sur les lignes allemandes. Les fantassins collent si bien au barrage qu'ils sont sur les premières positions allemandes avant que les défenseurs soient sortis de leurs abris. Les points de résistance qui n'ont pas cédé sont dépassés pour être traités par les unités prévues à cet effet, dont le 22e bataillon. L'artillerie ennemie voit son action habituelle largement contrecarrée par la contrebatterie canadienne, très efficace. Dès 8 heures, la 3e Division a atteint son objectif, juste en face de Vimy. Les 1re et 2e Divisions assureront leurs positions aussi rapidement. Seule la 4e, face à la cote 145, piétinera jusqu'au 12 avril, avant de se saisir de cette hauteur. Dans la nuit du 12 au 13 avril, les Allemands qui restent se replient enfin.
Sur le sommet de Crête
Du haut de la crête, au matin, les Canadiens observent l'ennemi se retirer à travers des pâturages qui contrastent avec les boues où ils pataugeaient depuis des semaines de leur côté de l'arête. Ils viennent surtout de remporter une très grande victoire. Leurs trophées : 4 000 prisonniers, 54 canons, 104 mortiers et 124 mitrailleuses. Quatre Croix de Victoria sont décernées. Les succès de Vimy démontrent qu'artilleurs, sapeurs, signaleurs et fantassins sont parvenus, en travaillant de façon très concertée, à résoudre les nombreux problèmes tactiques du champ de bataille. La planification de l'action, la coordination des armes et les nombreuses répétitions faites à l'arrière a illustré la maîtrise dont le Corps canadien était désormais capable. Mais, à travers les joies de la victoire, ils sont frappés par la lourdeur du bilan : 10 602 pertes - morts ou blessés -, soit un homme sur huit, dont 3 598 morts. Que le plus éloquent des monuments canadiens commémoratifs des deux guerres mondiales se trouve à Vimy n'étonnera personne.
Tous reconnaissent qu'ils ne doivent pas s'asseoir sur leurs lauriers. Entre le 16 avril et le 9 mai, Nivelle et les Français ont progressé de six kilomètres seulement et les pertes qu'ils ont enregistrées bouleversent la sérénité des armées françaises, dont certains éléments se mutineront. Ces mouvements locaux seront jugulés par Philippe Pétain, qui remplace Nivelle et prétend attendre les Américains entrés en guerre en avril 1917. Pendant que ceux-ci rassemblent leurs forces et que, d'autre part, la Russie s'apprête à se retirer de la guerre, il ne reste guère plus que les Britanniques, passablement épargnés sur le front ouest, si l'on exclut la Somme, pour lancer des assauts. Au cours de l'été, des brigades canadiennes prennent Arleux-en-Gobelle et Fresnoy, au nord et au sud d'Arras, au prix de 1 259 pertes dans le cas de Fresnoy.
La colline 70 et lens
Canadiens seront désormais dirigés par l'un des leurs. Parmi les offensives organisées dans les Flandres par les Britanniques, celle contre la ville charbonnière de Lens sera menée par les Canadiens. Le plan prévoit d'attaquer Lens directement. Currie propose une alternative qui sera acceptée : on prendra la cote 70, une petite hauteur dominant Lens, que les Allemands tentera vraisemblablement de reprendre. L'artillerie canadienne devra briser ces contre-attaques, provoquer des pertes coûteuses et forcer l'ennemi à abandonner le terrain.
Le 15 août, l'assaut est donné par les 1re et 2e Divisions, derrière un puissant barrage d'artillerie roulant, soutenu par un travail de contrebatterie et de bombardement en profondeur de positions désignées. La colline est prise et, comme prévu, jusqu'au 18, les Allemands contre-attaquent, subissant 20 000 pertes, contre 9 000 chez les Canadiens. Pour la première fois, une grande victoire canadienne est attribuable à la vision d'un Canadien.
Passchendaele
Artillerie de campagne montant au front, vers 1916-1918. Durant la Première Guerre mondiale, les chevaux étaient encore essentiels, même sur le front occidental. Les camions avec des moteurs à gaz ou à vapeur commençaient à être pratiques et fiables sur les bons chemins mais le déplacement des objets lourds à travers les champs nécessitait un équipage de chevaux. Dans cette aquarelle, deux équipages de chevaux tirent deux canons de campagnes britanniques par-dessus un terrain vallonné. Notez que les hommes portent des casques de fer, qui indique que cette peinture date plus tard que 1916.
Depuis la fin juillet 1917, le secteur de Passchendaele avait été la cible d'attaques sanglantes de la part des Anglais qui en avaient tiré peu de gains. À l'automne, des troupes britanniques déprimées pataugent toujours dans un champ de boue immonde alors que les hauteurs sont encore contrôlées par les Allemands. Il est urgent de s'emparer de ce petit plateau ou de reculer pour aller cantonner plus loin. Les Canadiens reçoivent l'ordre de retourner dans ce secteur où ils sont passés en 1915 et d'y prendre la côte devenue méconnaissable. Le système d'écoulement des eaux a été détruit. Les canons s'enfoncent dans la boue jusqu'aux essieux. Dans la plaine bouleversée, couverte d'armes inutiles, pourrissent des milliers de cadavres d'hommes et d'animaux. L'air est putride et les pluies qui s'abattent sur la région confèrent à l'ensemble l'atmosphère d'un cauchemar. Les vétérans de la Somme revivent ici une situation qu'ils ont bien connue.
Au plan stratégique, la conquête de Passchendaele ne sera pas significative dans la marche des Alliés vers la victoire. Tactiquement réalisable, la mission sera très onéreuse. Currie informe ses supérieurs que l'opération peut entraîner jusqu'à 16 000 pertes. Passchendaele vaut-elle ce sacrifice ? Les Britanniques répondent oui, car il permettra d'accentuer la pression au nord du front, et de donner aux Français le répit dont ils ont besoin.
Les Canadiens reprennent donc ces minutieux préparatifs qui leur ont valu ces succès enregistrés depuis le début de l'année. Pour éviter aux artilleurs de rajuster constamment leur tir, on construit des bases pouvant supporter les canons et, pour assurer l'approvisionnement des troupes, on fait en sorte que, sur les 15 kilomètres de marécages qui séparent Ypres du front, les routes soient carrossables.
Le 18 octobre, les 3e et 4e Divisions canadiennes prennent place devant l'objectif. Sous la pluie froide qui, le 26 octobre, mouille ce bourbier large de près de trois kilomètres, l'attaque débute. N'ayant pas pu surprendre l'ennemi, deux bataillons se lancent contre le piton de Bellevue. Les hommes sont décimés par les mitrailleurs abrités allemands. Finalement, un petit groupe du 43e Bataillon parvient à prendre pied et à s'accrocher. Ceux du 52e bataillon, stimulés par l'exploit de leurs collègues, s'emparent de six blockhaus.
La demi-victoire de ce 26 octobre a coûté cher aux Canadiens qui dénombrent 2 500 pertes, mais Passchendaele est encore hors de portée. Le 30 octobre, une nouvelle progression de 800 mètres est entreprise au coût de 2 300 pertes. Il reste encore 400 mètres à parcourir pour occuper les restes du malheureux village. Les artilleries lourde et de campagne sont avancées lorsque les 11e et 2e Divisions remplacent les 3e et 4e. Le 6 novembre, les opérations sont terminées, elles ont occasionné 16 041 pertes, dont 3 042 tués.
Tout cela pour avancer de cinq kilomètres dans un saillant arrosé sur trois côtés à la fois. Quelques mois plus tard, les Britanniques abandonneront Passchendaele. Sur la Somme, les Canadiens ont mérité huit Croix de Victoria ; à Passchendaele, ils en recevront neuf. Quant à savoir lequel de ces deux secteurs d'opérations a été le plus exécrable, cela demeure une question sans réponse définitive de la part des acteurs canadiens des deux combats.
La dernière année. Le dernier souffle
Depuis la fin juillet 1917, le secteur de Passchendaele avait été la cible d'attaques sanglantes de la part des Anglais qui en avaient tiré peu de gains. À l'automne, des troupes britanniques déprimées pataugent toujours dans un champ de boue immonde alors que les hauteurs sont encore contrôlées par les Allemands. Il est urgent de s'emparer de ce petit plateau ou de reculer pour aller cantonner plus loin. Les Canadiens reçoivent l'ordre de retourner dans ce secteur où ils sont passés en 1915 et d'y prendre la côte devenue méconnaissable. Le système d'écoulement des eaux a été détruit. Les canons s'enfoncent dans la boue jusqu'aux essieux. Dans la plaine bouleversée, couverte d'armes inutiles, pourrissent des milliers de cadavres d'hommes et d'animaux. L'air est putride et les pluies qui s'abattent sur la région confèrent à l'ensemble l'atmosphère d'un cauchemar. Les vétérans de la Somme revivent ici une situation qu'ils ont bien connue.
Au plan stratégique, la conquête de Passchendaele ne sera pas significative dans la marche des Alliés vers la victoire. Tactiquement réalisable, la mission sera très onéreuse. Currie informe ses supérieurs que l'opération peut entraîner jusqu'à 16 000 pertes. Passchendaele vaut-elle ce sacrifice ? Les Britanniques répondent oui, car il permettra d'accentuer la pression au nord du front, et de donner aux Français le répit dont ils ont besoin.
Les Canadiens reprennent donc ces minutieux préparatifs qui leur ont valu ces succès enregistrés depuis le début de l'année. Pour éviter aux artilleurs de rajuster constamment leur tir, on construit des bases pouvant supporter les canons et, pour assurer l'approvisionnement des troupes, on fait en sorte que, sur les 15 kilomètres de marécages qui séparent Ypres du front, les routes soient carrossables.
Le 18 octobre, les 3e et 4e Divisions canadiennes prennent place devant l'objectif. Sous la pluie froide qui, le 26 octobre, mouille ce bourbier large de près de trois kilomètres, l'attaque débute. N'ayant pas pu surprendre l'ennemi, deux bataillons se lancent contre le piton de Bellevue. Les hommes sont décimés par les mitrailleurs abrités allemands. Finalement, un petit groupe du 43e Bataillon parvient à prendre pied et à s'accrocher. Ceux du 52e bataillon, stimulés par l'exploit de leurs collègues, s'emparent de six blockhaus.
La demi-victoire de ce 26 octobre a coûté cher aux Canadiens qui dénombrent 2 500 pertes, mais Passchendaele est encore hors de portée. Le 30 octobre, une nouvelle progression de 800 mètres est entreprise au coût de 2 300 pertes. Il reste encore 400 mètres à parcourir pour occuper les restes du malheureux village. Les artilleries lourde et de campagne sont avancées lorsque les 11e et 2e Divisions remplacent les 3e et 4e. Le 6 novembre, les opérations sont terminées, elles ont occasionné 16 041 pertes, dont 3 042 tués.
Tout cela pour avancer de cinq kilomètres dans un saillant arrosé sur trois côtés à la fois. Quelques mois plus tard, les Britanniques abandonneront Passchendaele. Sur la Somme, les Canadiens ont mérité huit Croix de Victoria ; à Passchendaele, ils en recevront neuf. Quant à savoir lequel de ces deux secteurs d'opérations a été le plus exécrable, cela demeure une question sans réponse définitive de la part des acteurs canadiens des deux combats.
La contre-offensive en mars 1917
C'est qu'à compter du 21 mars 1918, dans leur hâte d'en finir qui s'apparente à un espoir ultime, les Allemands ont attaqué juste à la jonction des armées anglo-françaises. La tactique utilisée est assez simple : s'infiltrer audacieusement en profondeur, en perturbant les centres de communication et en ignorant délibérément les noyaux de résistance qui, dans la confusion qui s'instaure, abandonnent le terrain. La 5e Armée britannique recule en effet, mais parvient à rétablir son front. Ces attaques se répètent à plusieurs endroits dans les Flandres et en Champagne. En quelques semaines, la majeure partie du terrain repris depuis 1915, au prix de centaines de milliers de pertes, retombe aux mains des Allemands. Devant la menace, les Alliés acceptent enfin de se rallier derrière un général en chef commun, le maréchal Ferdinand Foch.
Heureusement, les Canadiens ont pu rester à l'écart de ces combats qui, au 15 juillet 1918, ont atteint leurs limites. Déjà, les Alliés repartent à l'assaut, la supériorité numérique leur étant largement assurée grâce aux arrivées massives d'Américains. Les Allemands ont subi 1 000 000 de pertes, soit l'équivalent du nombre que le front russe avait libéré. Les contre-attaques alliées ont rétabli les lignes du siège en date du 7 août.
Amiens. Une duperie canadienne
La table est maintenant mise pour abattre le militarisme allemand qui, sous diverses formes depuis plus de 50 ans, fait trembler l'Europe. Pendant les longues et pénibles semaines vécues par les Alliés au printemps 1918, les Canadiens ont appris. Ils ont également eu tout le loisir de reconstituer leurs forces après les attaques coûteuses, mais réussies, de 1917.
Le secteur qu'on leur réserve maintenant est celui d'Amiens. Pour qu'ils puissent profiter de l'effet de surprise, on conduit les Canadiens à 60 kilomètres au nord de ce lieu. Habitués aux Australiens qui sont demeurés en face d'Amiens, les Allemands connaissent aussi les Canadiens qu'ils ont observés combattant à la pointe des attaques britanniques. Deux bataillons et deux postes de secours sont installés devant Kemmel où une incessante circulation de messages divers est mise en marche et captée par les Allemands. Entre le 30 juillet et le 4 août, dans le plus grand secret, le reste du Corps canadien descend vers le sud. Leur discrétion est facilitée par la température maussade qui raréfie les sorties aériennes allemandes et par le fait que seuls les commandants des divisions connaissent la cible de l'attaque. Ce secret provoque de nombreux problèmes logistiques, comme, par exemple, l'artillerie qui n'aura presque pas le temps de se préparer. En face d'Amiens, les officiers canadiens chargés d'étudier le terrain trompent les Allemands en se coiffant du chapeau mou caractéristique des soldats australiens.
Le bruit causé par la préparation de la plus grande bataille mécanisée jamais vue jusque-là, ne dévoile toutefois rien de précis à l'ennemi. Certaines de ses unités s'interrogent néanmoins sur les mouvements qu'elles ont détectés malgré toutes les précautions prises. Il faut dire que 604 chars de toutes sortes et des milliers de chevaux vont donner à la bataille des allures à la fois modernes et anciennes.
Un jour sombre de l’armée Allemande
Juste avant l'aube du 8 août, l'attaque s'ouvre par le tir de 2 000 canons. En plus des chars, les soldats peuvent s'appuyer sur deux brigades de mitrailleuses motorisées, un bataillon de cyclistes pour servir le corps et une section de mortiers lourds, montés sur des camions. Un millier d'avions français et 800 avions britanniques sillonnent les airs. Pendant ce brillant assaut, qui va sérieusement hypothéquer le moral des troupes allemandes, les Canadiens progressent de 13 kilomètres, à la pointe d'un vaste front de plus de 30 kilomètres. Australiens, Britanniques et Français font aussi partie de l'attaque : leur rôle consiste à respecter l'avance des Canadiens qui ont le plus de terrain à conquérir pour atteindre leurs objectifs. Les Canadiens se font tuer 1 036 hommes, 2 803 sont blessés et 29 sont capturés, des pertes largement compensées par la remarquable avance, la plus imposante sur le front ouest, depuis 1914. Quant aux Allemands, ils ont dû assumer 27 000 pertes, dont 16 000 prisonniers, 5 033 d'entre eux ayant été capturés par les Canadiens. Ces derniers se saisissent en outre de 161 pièces d'artillerie, d'un grand nombre de mitrailleuses et de canons anti-char. Même s'il ne reste que 132 chars aux Alliés pour repartir le lendemain, les Allemands ont perdu sept divisions. Constatant que sa machine de guerre n'est plus efficace, la confiance du haut commandement allemand est entamée.
Une expérience intéressante a été tentée le 8 août. Elle consistait à utiliser 30 chars Mark V pour transporter des troupes de la 4e Division jusqu'aux tranchées adverses. Mais beaucoup d'hommes sont incommodés par la chaleur et par l'échappement d'une partie des gaz des moteurs à l'intérieur des habitacles. Quelques hommes s'évanouissent. D'autres descendent et marchent. Les inconvénients liés à l'utilisation de ces chars dans cette fonction sont pour le moment incontournables et on n'y recourra plus au cours de cette guerre.
Les avances du corps canadiens
Dans la nuit du 8 au 9, le haut commandement britannique décide de prêter sa 32e Division aux Canadiens qui veulent retirer du front leur 3e Division. Les Canadiens de la 3e Division ont déjà marché vers l'arrière sur environ 10 kilomètres quand ils sont rappelés, les Britanniques étant revenus sur leur décision. Au retour, les hommes de la 3e Division sont épuisés. On décide donc de n'utiliser qu'une de ses brigades au front, ce qui exige des 1er et 2e Divisions qu'elles élargissent le secteur à couvrir. Dans ces conditions, l'attaque du 9 ne peut se déclencher que vers 11 heures, sans l'effet de surprise escompté la veille. Au prix de 2 574 pertes, les Canadiens prennent 6,5 kilomètres de terrain aux Allemands.
La poussée alliée s'étalera sur plusieurs jours, mais l'élan des 8 et 9 août est bien cassé. De plus, le nombre de chars disponibles diminue au point que, le 12 août, on n'en compte plus que six. Malgré 11 725 pertes, entre les 8 et 20 août, les Canadiens ont sonné le début de la fin de l'armée allemande en avançant de près de 30 kilomètres et en assurant le terrain conquis. Dans toute l'opération, 75 000 pertes allemandes sont enregistrées.
Un mois auparavant, les Français avaient déjà arraché l'initiative aux Allemands. Dans ce contexte, l'engagement d'Amiens aura une portée décisive. Il a brisé les derniers espoirs du grand état-major allemand et, surtout, la certitude que ses troupes voulaient encore se battre. Le succès des troupes canadiennes repose, entre autres, sur la surprise, la concentration de leurs effectifs et la coordination de différentes armes (avions, chars, canons, mitrailleuses).
La citadelle tombe. Les dernières batailles
En ce mois d'août 1918, c'est dans tous les secteurs que la défensive allemande a été mise à dure épreuve. Dans la portion somme toute limitée qu'il occupe sur le front, le puissant Corps canadien n'a pas encore complété sa tâche. Le 26 août, il est à nouveau le fer de lance de la 2e Armée britannique, qui lance une autre attaque vers Cambrai. Le 28, les Canadiens ont progressé de huit kilomètres, faisant 3 000 prisonniers, saisissant 50 canons et 500 mitrailleuses. Cette action les conduit à portée de la ligne Hindenburg.
Même si l'artillerie continue de jouer sa partition, les fantassins canadiens font une pause. Le 2 septembre, chars et fantassins reprennent leur avance derrière un feu roulant d'artillerie. À l'issue d'une difficile progression de 3,5 kilomètres, les Canadiens comptent leurs pertes qui s'élèvent à 5 500. Ils auront la consolation d'avoir mérité sept Croix de Victoria. Un des résultats de ce combat d'une importance plutôt mineure est de permettre aux Alliés du front ouest de parvenir sans encombre à la ligne Hindenburg. Prévoyant les difficultés à venir, les Allemands commencent à consolider une nouvelle ligne de repli qui, entre Anvers et la Meuse, prend le nom de Herman. Arras étant libérée, on prépare l'étape suivante qui consistera à traverser le Canal du Nord et à prendre Cambrai, événements qui se dérouleront entre le 27 septembre et le 11 octobre.
Valencienne
5ème Bataillon d’infanterie « (Western Cavalry) », CEC, Valenciennes, le 9 novembre 1918.
Valenciennes était une ville industrielle au nord de la France, près de la frontière belge, où se déroula la dernière grande bataille du Corps canadien en 1918. Cette aquarelle par l’artiste de guerre canadien Inglis Sheldon-Williams montre un groupe de fantassins canadiens qui avancent le long d’une route. Grâce à l’insigne qu’ils portent, le rectangle rouge de la première division surmonté par un cercle rouge du premier bataillon de la seconde brigade, l’unité se révèle être le 5ème bataillon d’infanterie (« Western Cavalry ») du Corps expéditionnaire canadien. Le bataillon portait le sous-titre de « Western Cavalry » ayant été formé avec des hommes provenant de régiments de cavalerie de milice dans l’ouest.
Les autres participants canadiens
Soldat, 2nd Construction Battalion, Corps expéditionnaire canadien, vers 1917.
Cette unité fut la première dans les forces armées à recruter des Canadiens d'origine africaine. Ils ne pouvaient pas se joindre à d’autres unités dues au racisme. La Construction Battalion fut formée en 1916 et en grande partie les volontaires provenaient de la Nouvelle-Écosse. L'unité a servi en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour un an et a été envoyé en France par la suite pour construire des chemins et des chemins de fer. La 2nd Construction Battalion suivit les unités d'avant la confédération telles que Captain Runchey's Company of Colored Men (1812-1815), Colored Infantry Company (1838-1850), and the Victoria Pioneer Rifle Corps (1860-1866).
Des dizaines de milliers d'autres Canadiens ont servi hors du Corps d'armée canadien. La Brigade de cavalerie canadienne, par exemple, travaillait au sein de la Division de cavalerie britannique. Il lui faut attendre le printemps 1918 et l'arrivée d'un début de guerre de mouvement, pour entrer en scène et poser les actes de courage qui, en très peu de temps, lui vaudront deux Croix de Victoria.
Ailleurs, à l'arrière, des milliers d'hommes étaient au combat dans les troupes ferroviaires. En 1918, un grand nombre de ceux-ci deviendront fantassins. Près de 2 000 morts décimeront leurs rangs entre l'attaque contre la crête de Vimy et l'Armistice. Par ailleurs, on aura trois compagnies de sapeurs auprès d'unités anglaises du génie qui, sur la fin de la guerre, reviendront auprès de leurs concitoyens canadiens au front. Le Corps forestier canadien comprendra jusqu'à 12 000 hommes en France et 10 000 en Grande-Bretagne. Plusieurs Canadiens - dont des infirmières et médecins - seront dans des unités de service en Palestine, en Égypte ou ailleurs contre les Turcs.
Pour contenir la Révolution bolchevique, environ 5 000 Canadiens séjourneront pendant quelques mois en Sibérie, où les Alliés entretiennent un corps expéditionnaire. Entre octobre 1918 et juin 1919, moment où ils quittent la Russie, les Canadiens ne se sont engagés dans aucune grande bataille. Leurs pertes se chiffrent alors à huit morts et 16 blessés.
L’évolution tactique durant la guerre
Entre février 1915 et novembre 1918, la tactique de guerre subite l'influence des armes. En 1918, les fantassins sont engagés dans des attaques passablement fluides sous un parapluie fourni par l'artillerie, les mitrailleuses lourdes, les chars et les avions. Depuis 1915, le nombre de canons par tranche de 1 000 fantassins a tout simplement doublé. De plus, le rationnement des munitions, strictement observé jusqu'à la fin de 1916, est pratiquement levé.
En trois ans de progrès, la guerre a beaucoup changé. En 1918, l'artillerie est plus présente, mais également les compagnies de transport motorisées, les bataillons d'ingénieurs, une compagnie antiaérienne équipée de projecteurs. Bien que l'armée soit encore tributaire des lignes de transmission souvent coupées dans les combats, les systèmes de communications se sont renouvelés.
Les ingénieurs, par exemple, sont devenus des acteurs très mobiles et présents sous le feu. Pour la traversée du Canal du Nord, le 27 septembre 1918, ils arrivent juste derrière les premières troupes ayant franchi le Canal. Sous le tir de nids de mitrailleuses ennemies qui ont été dépassés, ils construisent des ponts légers pour que la tête de pont soit renforcée en troupes et approvisionnée en munitions. En même temps, de plus gros ponts sont fabriqués afin de permettre aux chars de se joindre à la bataille et à une partie de l'artillerie de venir couvrir les troupes les plus avancées. Pour les ingénieurs, cette guerre de mouvement ressemble déjà beaucoup à ce que leurs successeurs vivront en Italie à compter de 1943.
Les aviateurs canadiens

Le chasseur britannique Bristol F2B et le chasseur allemand Albatros D.III au combat.
De nombreux canadiens se distinguèrent dans l’aviation britannique durant la Première Grande guerre. Les détails de cette illustration de l’époque sont imprécis mais c’était le type d’image qui captivait l’attention du public d’alors. La légende du pilote de combat perçu comme un « chevalier du ciel » est d’ailleurs encore tenace de nos jours. Néanmoins, les humbles escadrons de reconnaissance qui prenaient les photographies et dirigeaient les bombardements de l’artillerie eurent probablement un plus grand impact sur le déroulement de la guerre que les as de l’aviation.
Au cours de la Première Guerre mondiale, le Canada n'a pas d'aviation militaire qui lui soit propre, ce qui n'empêche pas environ 24 000 Canadiens de servir dans le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service, avant que ces deux éléments soient combinés en Royal Air Force, au mois d'avril 1918. À ce niveau, le Canada subira 1 500 pertes. Unquart des officiers aviateurs britanniques sont des Canadiens et ils sont, en général, parmi les meilleurs.
Des représentations en faveur de la création d'une aviation militaire avaient été faites auprès des autorités militaires en 1911 et 1912, mais elles ne leur avaient enseigné que deux choses les appareils sont dangereux et chers et leur utilité douteuse. Dans ce vide stratégique, le Canada n'est pas si isolé qu'on pourrait le croire. En effet, personne n'était en mesure de prévoir que, 11 ans après le premier vol du « plus lourd que l'air » et malgré les bonds techniques importants accomplis depuis, l'avion deviendraient une formidable arme de guerre. Personne ne pouvait alors prédire que le Canada était à la veille de s'engager dans une guerre comme celle de 1914-1918.
Commandant d'escadron Raymond Collishaw et des pilotes du 203è escadron, Royal Air Force, juillet 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Canadiens composaient environ un quart de la Royal Air Force (RAF) formée en avril 1918. Plus de 8 000 Canadiens servirent dans la RAF et dans les corps qui la précédèrent, le Royal Flying Corps (RFC) et le Royal Naval Air Service (RNAS). Cette photographie montre un célèbre pilote canadien, le commandant d’escadrille Raymond Collishaw (1893-1975) en compagnie de pilotes britanniques à Allonville, en France, en juillet 1918. Les avions à l’arrière-plan sont des chasseurs Sopwith F. 1 « Camel ».
Au Canada, Alexander Graham Bell est l'un des pionniers de l'aviation. Un des hommes qu'il a alors côtoyés, J.A.D. McCurdy, essaie plus tard, mais sans succès, de vendre ses avions au gouvernement canadien. Il va alors aux États-Unis où il réussit assez bien. Revenu au Canada pendant la guerre avec son école de vol, il crée la Canadian Aeroplanes qui, de Toronto, s'engagera dans la production en série et l'exportation massive d'avions. Une première dans l'histoire de l'aéronautique.
Un jeune Canadien désireux de devenir pilote militaire devait assumer lui-même les coûts liés à sa formation, qu'elle ait lieu au Canada ou aux États-Unis. Si les Britanniques enrôlaient ensuite le nouveau pilote, soit dans le corps d'aviation rattaché à la marine, soit dans celui de l'armée, ils remboursaient les cours qu'il avait suivis. Au fil de la guerre, plusieurs volontaires du Corps d'armée canadien vont demander d'être mutés dans l'aviation ou recevront une proposition à cet effet.
La véritable naissance de l'arme aérienne a lieu sur la Somme. Dans ce secteur, au début des combats des Britanniques, en juillet 1916, 240 aviateurs canadiens sont en première ligne. À ce moment-là, les Alliés dominent l'espace aérien. Dans les premiers mois de 1917, de nouveaux avions allemands plus performants font basculer la maîtrise de l'air du côté de l'ennemi. Mais, dès la fin de 1917, les Alliés ont changé cela grâce à du nouveau matériel et à la présence de milliers de pilotes dont un grand nombre ont été formés au Canada. Cette domination aérienne alliée sera maintenue durant toute l'année 1918.
L’Instruction d’aviateurs en terre canadienne
Sur la Somme, les pertes aériennes impériales ont été importantes. L'Angleterre, qui a de plus en plus besoin d'aviateurs entraînés, crée au Canada un programme d'instruction structuré en fonction du Royal Flying Corps. Le moment est propice, car on célèbre déjà les exploits d'aviateurs canadiens, dont ceux de Billy Bishop. L'enthousiasme est si grand que le gouvernement canadien réexamine sa politique aérienne et songe à créer un corps d'aviation canadien, ce qui ne viendra cependant que dans les années 1920. À la fin de 1916, la proposition du Royal Flying Corps est acceptée. Parmi les avantages de ce projet, le gouvernement canadien décèle celui de servir l'Empire sans s'engager trop avant dans les questions aériennes à l'égard desquelles il entretient une certaine méfiance. En 1917, la formation de pilotes britanniques débute au Canada. Des milliers de spécialistes canadiens, tant pilotes que techniciens, seront formés grâce à cette initiative. Il faut signaler qu'à l'époque un pilote devait aussi être un mécanicien capable de réparer son avion. Entre les deux guerres, les hommes formés au Canada contribueront à l'éveil de l'intérêt public pour l'aviation et l'aéronautique. Même si les nouveaux aviateurs répondent à des chefs et à des critères britanniques, on observera bientôt parmi eux l'émergence d'un réel sentiment pro-canadien. C'est alors qu'on commencera à réclamer, assez timidement il est vrai, une aviation canadienne.
L’aéronavale
Pendant la Première Guerre mondiale, les avions de la marine sont utilisés pour le bombardement - très inefficace - des sous-marins ennemis et la surveillance des activités militaires le long des côtes. Sur les côtes françaises, certains des avions de la marine serviront parfois les armées. Quand les premiers porte-avions apparaissent, il s'agit de chalands halés par des navires. On aménagera bientôt des plates-formes sur certains navires existants. Différents agrès sont utilisés pour stopper un avion qui atterrit, mais la sécurité laissant à désirer, on déplorera de nombreux incidents dont nombre d'hommes tombés à la mer. C'est une formation aéronavale alliée qui sera la première à utiliser le bombardement stratégique, c'est-à-dire le vol en formation de plusieurs appareils munis de bombes vers un objectif à détruire.
Les rôles de l’aviation
Dirigeable allemand surpris par un projecteur. Bien que la Première Guerre mondiale ne fut pas le premier conflit dans lequel des avions furent utilisées à des fins militaires (ce fut en 1911 au cours de la guerre italo-turque), la Grande Guerre vit le début des missions de bombardement sur de longues distances. Les Allemands utilisaient des dirigeables (populairement appelés « Zeppelins » du nom de leur constructeur, le comte Zeppelin) pour des missions de bombardement nocturnes sur la France et la Grande-Bretagne. Cette illustration montre une technique utilisée par les défenseurs : des projecteurs pour éclairer les dirigeables et des canons anti-aériens pour tenter de les abattre.
De part et d'autre, on en viendra à bombarder des villes. Les bombes vont pleuvoir sur Londres et Paris ainsi que sur les villes allemandes de la Ruhr et dans les zones belges et françaises occupées par les Allemands. En 1918, on expérimente les bombardements aériens de nuit. Leur efficacité influencera le cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Les raids de bombardement créeront l'illusion que l'avion pourrait jouer un rôle plus important que les combats terrestres à l'occasion d'une autre guerre. Comme plusieurs des aviateurs ont auparavant vécu la terrible expérience des tranchées, il est sans doute normal qu'ils cherchent désespérément une façon plus propre pour eux, mais malheureusement plus meurtrière pour les populations touchées, de faire et de gagner toute guerre éventuelle.
Les avions rendent toutefois d'autres services, en particulier dans la surveillance de l'ennemi, la protection des ballons d'observation ainsi que dans le repérage et la destruction de sous-marins, navires et ballons ennemis.
Au cours de la guerre, la tactique et les techniques d'utilisation de l'avion au combat évolueront. On parviendra, par exemple, à synchroniser le tir des mitrailleuses avec le nombre de rotations à la seconde des hélices se trouvant dans la trajectoire des balles. À la fin de la guerre, les aviateurs sauront attaquer les troupes ennemies au sol avec des chasseurs ou des bombardiers modifiés.
L’efficacité de l’arme aérienne
Le 8 août 1918, à la bataille d'Amiens, le Corps d'armée canadien a excellé. Comment l'aviation alliée s'en est-elle tirée ? En raison du brouillard matinal, elle n'a pas pu prendre son envol avant 9 heures. Dès lors, quelques avions viennent étendre des écrans de fumée entre des chars de combat et certains points de résistance allemands. D'autres, de manière très inefficace, couvrent les troupes canadiennes en mitraillant et en bombardant les Allemands. Ainsi, à plusieurs reprises, des avions en nombre essaient vainement de faire sauter des ponts sur la Somme, surtout ceux de Péronne et de Python, par où arrivent (et arriveront dans la nuit) les nombreux renforts allemands qui, le lendemain, ralentissent l'élan canadien. Finalement, l'aviation aura surtout été utile, durant cette attaque, par sa capacité d'observation du dispositif ennemi
Les Canadiens dans les forces aériennes impériales
Ils ne seront pas réunis dans des escadrilles canadiennes ou au sein d'un corps aérien national et ne seront pas commandés par leurs officiers. En somme, les conditions qui ont été à la base du sentiment national canadien dans l'armée n'existent pas du côté aérien, car il s'agit de recrues coloniales dans un corps impérial.
Bien que des milliers de Canadiens aient servi dans l'aviation britannique, aucun Canadien ne s'élèvera au-dessus du grade de capitaine de groupe (colonel). Ces hommes, qui formeront l'ossature de l'Aviation royale du Canada encore en devenir, auront été déployés partout. Sur le front franco-belge et en Grande-Bretagne, ils ont fait face aux meilleurs appareils et pilotes allemands. On les a aussi rencontrés dans des secteurs aériens moins actifs en Italie, en Macédoine, où les Bulgares et les Turcs sont les principaux ennemis, en Égypte et, plus tard, en Russie. Parmi eux, de grands noms ressortiront : Billy Bishop, A.A. McLeod et Billy Barker mériteront chacun une Croix de Victoria. Raymond Collishawn enregistrera 66 victoires et D.R. MacLaren, 54, en huit mois de combat seulement. Parmi les 10 premiers as de toutes les nations combattantes, on retrouvera quatre Canadiens (Barker, Bishop, Collishaw et MacLaren).
Bilan de l’effort militaire canadien
Drapeau régimentaire et drapeau du roi, 38ème Bataillon, Corps expéditionnaire canadien, 1914-18. Le 38ème bataillon du Corps expéditionnaire canadien fut levé à Ottawa, en 1915. Il servit aux Bermudes avant de joindre la 4ème division du Corps canadien en France en 1916. Sauf pour les insignes, les drapeaux des unités canadiennes étaient similaires à ceux des Britanniques jusqu’en 1968. Avant son départ d’Ottawa, le 38ème bataillon reçut le drapeau régimentaire tel qu’illustré dans ce tableau. Le drapeau du roi fut présenté en 1921 à l’unité qui perpétua le 38ème, The Ottawa Regiment (Duke of Cornwall’s Own).
Comparée à l'effort total industriel et militaire fourni par les principaux belligérants, la contribution du Canada semble faible. Cependant, compte tenu de sa population, alors inférieure à huit millions, et de son expérience militaire, presque inexistante en 1914, l'effort qu'il a consenti est considérable. Il est de plus très coûteux humainement : 212 688 pertes au 11 novembre 1918, dont 53 216 morts et mourants dans l'armée de terre seulement. Ces chiffres disent l'immensité de l'effort, mais ils ne traduisent pas du tout le courage et l'abnégation consentis par les volontaires, qu'ils y soient restés ou qu'ils en soient revenus. Un petit exemple suffira. Dans un article destiné à la revue des anciens du collège Loyola de Montréal, Gilbert Drolet rappelait qu'un peu moins de 300 jeunes hommes formés dans cette institution étaient allés se battre en Europe et que 37 d'entre eux (12 pour cent) y avaient perdu la vie. Un cas d'espèce qui s'est répété d'un océan à l'autre.
Le sacrifice des Canadiens en terre de France est commémoré à plusieurs endroits. On peut voir Le Soldat mélancolique, près de Saint-Julien, où la première attaque allemande au gaz a eu lieu. À Vimy, le Canada entretient un immense et magnifique monument rempli de signification. Enfin, à Beaumont-Hamel, un impressionnant caribou de bronze domine le champ de bataille où le Régiment de Terre-Neuve (province qui ne faisait pas encore partie de la Confédération canadienne) fut anéanti le 1er juillet 1916, pendant la première demi-heure de la première grande attaque sur la Somme.
L’identité canadienne s’affirme
Durant la guerre, c'est l'armée de terre qui porte et transforme l'identité canadienne que veulent les autorités politiques. En Grande-Bretagne, le Canada organise son propre système d'approvisionnement, ses écoles et ses hôpitaux qui sont placés sous le commandement du major général Turner, décoré de la Croix de Victoria, en Afrique du Sud. À compter de 1916, le gouvernement canadien crée en Grande-Bretagne le ministère des Forces militaires du Canada au Royaume-Uni, afin que tout ce qui concerne les forces canadiennes en Europe puisse être discuté sur place, à travers cet organisme politique reconnu. Quant au Corps canadien au combat, on a vu comment, en 1918, il a refusé de copier les nouveaux corps britanniques. Mais, dès 1915, les Canadiens avaient refusé de fractionner leur seule division afin de servir des intérêts britanniques à court terme.
Ces centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes contribuent à ce que leur pays soit reconnu par leurs alliés. Leurs actions glorieuses et leur volonté d'être différents influenceront le gouvernement dans sa politique de désengagement de l'emprise impériale. À l'autonomie militaire du champ de bataille succédera l'autonomie politique acquise graduellement au cours des décennies à venir. Dans les mois et les années qui suivront immédiatement la fin de la guerre, notre pays participera aux négociations de paix, signera des traités de paix et deviendra membre à part entière de la Société des Nations.
Les prisonniers de guerre canadiens
Réveil 8 h 00
Petit déjeuner 8 h 30
Lecture et/ou exercice jusqu'à 13 h
Déjeuner 13 h
Lecture et/ou exercice jusqu’à 18 h 30
Dîner 18 h 30
Appel 20 h 30 - 21 h
Extinction des feux 22 h
Ces officiers ont le droit d'écrire deux lettres par mois et quatre cartes postales. Ils doivent payer leurs repas (environ huit marks par jour ou cinq livres par mois). Lorsqu'ils écrivent à leur famille, ces hommes demandent qu on leur envoie des vêtements propres, des livres, des magazines ou des chaussures
Le Canadien français et le français dans le Corps expéditionnaire canadien
22e Bataillon (canadien-français), Corps expéditionnaire canadien, en juillet 1916
Cette photographie prise en juillet 1916 montre des hommes du 22e Bataillon (canadien-français) CEC qui réparent des tranchées. Notez les caillebotis au pied qui maintenait l'équilibre lors que la terre devenait de la boue à cause de la pluie. Le panneau de tôle ondulée au premier plan de la photo aida à renforcer le mur des tranchées dans ces conditions. À compter du mois septembre 1915 jusqu'en novembre 1918, 'les vingt-deux' ont établi une réputation de combat formidable.
La mobilisation initiale des volontaires se fait dans l'espacement des unités de milice existantes et des particularités linguistiques du pays. Des pressions exercées de plusieurs côtés conduisent le gouvernement à accepter de créer le 22e Bataillon (Canadien français), l'ancêtre de l'actuel Royal 22e Régiment. Mais les décennies d'oblitération du fait francophone dans l'institution militaire canadienne devaient avoir des répercussions. L'historien J. Granatstein pense qu un maximum de 50 000 francophones se sont portés volontaires, soit moins de huit pour cent des enrôlements. Et l'on sait que la conscription de 1917-1918 causera de sérieux troubles au Québec, en plus d y détruire le Parti conservateur pour quelques générations.
Pourtant, au début de la guerre, l'enthousiasme règne partout au pays. Dès le 1er août 1914, le 6e Régiment d'artillerie canadienne, de Québec et Lévis, se propose pour participer à la guerre qui sévit en Europe. Mais les autorités ne veulent pas mobiliser les unités. Cela dit, à cause de la menace des sous-marins, le 6e Régiment se voit ordonner d'aller prendre ses positions de défense côtière en aval de Québec, au Fort de la Martinière et à l'île d'Orléans. Jusqu'à la fin de la guerre, durant la saison navigable, le 6e Régiment sera confiné à ce rôle. Durant ces périodes de service, officiers et soldats vivent sous la tente et servent deux batteries. Des volontaires du régiment iront aussi à l'île Sainte-Lucie, dans les Indes occidentales, et y resteront jusqu’à la fin de la guerre. Quelques hommes du régiment se porteront volontaires pour aller outre-mer. Certains auront l'occasion de séjourner aux Bermudes comme membres d'une garnison de remplacement des Britanniques. Dans une autre partie du pays, la Libre Parole de Winnipeg indique, le 20 avril 1916, que 30 descendants des Métis de 1870 et de 1885 - dont 19 semblent être francophones - viennent de s’enrôler à Qu’Appelle. À la même époque, le Free Press, également de Winnipeg, publie un texte du capitaine MA. Fiset, de la 36e Batterie de campagne, qui décrit les exploits du soldat P. Riel, neveu de Louis Riel, qui, de mars 1915 à janvier 1916, a abattu 30 Allemands comme tireur embusqué. Ayant été tué par un éclat d'obus le 13 janvier 1916, son fusil est exposé bien en vue dans une fenêtre d'un édifice de Londres.
Au vu de ces deux petits exemples, on peut se demander combien de francophones de tout le pays seraient allés outre-mer volontairement si un cadre d'accueil avait existé pour eux avant et après l'ouverture du conflit. L'insensibilité au fait francophone du système militaire canadien de l'époque a eu des répercussions. Pourtant, les cadres n'étaient pas systématiquement anti-francophones.
Ainsi, le lieutenant-colonel Francis Farquhar, secrétaire militaire du gouverneur général, jusqu'à ce qu'il devienne commandant du PPCLI, annonce à ses officiers qu'il veut qu’ils puissent lire le français ou envoyer un message simple dans cette langue. Il croit que les officiers devraient connaître environ 500 mots de base en français avant d'arriver en France. Des cours sont donnés durant la traversée de l’Atlantique, même si la plupart des étudiants s'en passeraient volontiers.
Le rejet de certains volontaires
On a ouvertement parlé au Canada d'une guerre entre hommes blancs. On entend par là que le sport consistant à tuer un ennemi de race blanche doit être réservé aux Blancs. Au Canada, ce sont les commandants locaux qui acceptent ou refusent les volontaires. Dans les premiers jours, seuls les autochtones sont explicitement exclus, sous prétexte que dans les aléas du combat, les Allemands pourraient leur refuser le traitement habituellement réservé aux combattants « civilisés ». Cela n'empêche pas plusieurs commandants, conscients ou pas de cette directive, d'accepter des autochtones, et certains d'entre eux se feront ensuite toute une réputation, en particulier à titre de francs-tireurs.
Cependant, les membres de groupes plus visibles, comme les Noirs des Maritimes, ou les Asiatiques et les Indiens de la Colombie-Britannique, qui se présentent par centaines à divers centres de recrutement, ne peuvent participer à cette guerre de Blancs. En 1915, on écarte les propositions d'un bataillon de Canadiens d'origine nipponne et d'un autre composé d'hommes de race noire. Pourtant, le bassin de volontaires blancs s'épuise déjà.
Même si aucune directive discriminatoire n'existe, il est clair qu une politique de discrimination a été appliquée. Des offres visant à créer des compagnies formées de Noirs ou d’Asiatiques échouent, mais on en viendra à intégrer deux compagnies autochtones au sein d'un bataillon qui recrute surtout en Ontario. Finalement, en 1916, un bataillon de travailleurs noirs est créé, le N° 2 Construction Battalion (Coloured), qui sera encadré par des Blancs et dont le seul o acier noir sera l'aumônier auquel on a donné le grade de capitaine honoraire.
À compter de l'été 1916, les problèmes de recrutement s'étant intensifiés, le ministère prône enfin une politique d'ouverture, mais le racisme n'étant pas le seul apanage des Blancs, des problèmes surgissent. Ainsi, les autochtones font clairement savoir qu'ils ne veulent pas servir au sein du N° 2 Construction Battalion, qui manque d'hommes. Ils ne veulent, à la guerre, ne côtoyer aucun Noir. Deux ans après le début du conflit, la ferveur guerrière s'est estompée. Aucun des bataillons levés à compter de 1916, y compris le N° 2 Construction Battalion, n'arrivera à combler ses cadres. Le bataillon ne sera jamais plus qu'une grosse compagnie de 500 hommes commandés par un major plutôt que par un lieutenant-colonel.
Quant à la conscription de 1917, elle s'applique à tous, sauf aux autochtones qui ne manquent pas de rappeler qu'ils sont encore privés du droit de vote. Les Nippo-Canadiens, qui n'ont pas davantage le statut de citoyen à part entière, réclament le même privilège d'exemption. La Loi des Indiens servira à exempter les autochtones, alors qu un décret du 17 janvier 1918 exemptera japonais et Indiens.
Malgré ces obstacles, on a établi comme suit la participation de ces groupes à la Première Guerre mondiale : 3 500 autochtones, 1 000 Noirs et 600 Nippo-Canadiens.
La particularité des âmes canadiennes
réparant le transport de la 1re Division canadienne sur le continent européen, l'aumônier supérieur canadien, Richard Steacy, tente d'assurer la participation de ses 33 aumôniers, un pour un millier d'hommes environ. Pour leur part, les Britanniques disposent de cinq aumôniers par division d'infanterie, soit un pour 4 000 hommes. Lord Kitchener demande à Sam Hughes d'envoyer moins de pasteurs à l'avenir et refuse que les 33 qui sont en Angleterre passent en France. Steacy propose alors le nombre de 25 aumôniers, ce qui est refusé par les Britanniques qui tiennent au chiffre magique de cinq. Les Canadiens sont furieux.
Une délégation composée d'un pasteur de l'Église Unie et d'un prêtre catholique se rend au War Office. Les Britanniques persistent dans leur résistance jusqu’à ce que les délégués soulignent l'évidence : le Canada paie et il fera ce qu'il veut. Au War Office, on rappelle que, malgré le grand nombre d'aumôniers qui les accompagnent, la conduite des troupes canadiennes en sol anglais ne sont pas des plus civilisées. La réponse vole aussi vite : la situation serait bien pire si nous n'étions pas là, dit le pasteur Frederick George Scott. Finalement, l'aumônier général britannique promet d'intervenir en leur faveur auprès de ses supérieurs. Le 2 février 1915, les Britanniques acceptent enfin 11 aumôniers pour chaque division canadienne, une proportion qui sera plus tard adoptée pour toutes les divisions britanniques.
Les Canadiens ont-ils montré la route en ce domaine ? Chose certaine, ils ont signalé leur statut canadien distinct, tel que le voulait le ministre Sam Hughes.
D'une guerre mondiale à une autre (1919-1943)
Le retour à la vie civile. Les anciens combattants rentrent au pays
Un soldat canadien à domicile, 1919. Les vétérans du Corps expéditionnaire canadien ont dû faire face à une réalité qui ne correspondait pas à ce regard idyllique du retour de ce soldat.
La guerre ne sera jamais tout à fait finie pour ceux qui l'ont vécue de près. Plusieurs anciens combattants seront hantés le restant de leurs jours par de vieilles blessures physiques ou psychologiques. Beaucoup mourront prématurément, d'autres se suicideront.
Le pays veut oublier la guerre et ceux qui l'ont faite. Ces derniers, qui n'ont pas toujours apprécié ce qui se passait sur le front intérieur, refusent de parler de ce qu'ils ont vécu, qu'il s'agisse des pertes massives subies ou des actions individuelles ou collectives admirables dont ils ont été les témoins. Parallèlement, ils en viendront peu à peu à idéaliser la camaraderie des tranchées et à appuyer les vertus civiques. Parmi eux, le pacifisme aura facilement prise : comment ne pas les comprendre !
Une pension substantielle, la meilleure au monde, fait partie des avantages obtenus par les veuves et les orphelins de guerre, ainsi que par les grands handicapés. Les hôpitaux pour anciens combattants se multiplient. Mais, pour tous les autres, le gouvernement d'Union se montre mesquin, peu enclin à la générosité. L'ancien combattant reçoit une petite somme d'argent dont l'importance dépend de la durée de son service, 35 $ pour l'achat de vêtements civils, et il obtient une année de soins médicaux gratuits.
Les gouvernants ont la hantise du déficit, d'autant plus que le pays sort de l'épreuve très endetté. Ils ne veulent absolument pas encourager la dépendance et le manque d'initiative, disent-ils. Parmi les mesures prévues, il y a une aide pour les anciens combattants qui veulent s'établir en tant que cultivateurs. On leur donne des terres et on leur accorde des prêts à bas taux d'intérêt : en 1930, 50 pour cent de ceux qui auront choisi cette option auront tout perdu.
Peu de personnes ont prévu ce qui suivrait la fin des hostilités. Un aumônier militaire presbytérien, Edmund Oliver, écrit dans Social Welfare, à l'automne 1918, que ceux qui vont revenir du front ne se contenteront plus de l'ancien ordre. « Nous sommes aveugles si nous n'entrevoyons pas devant nous des bouleversements sociaux profonds et des ajustements politiques. » Oliver croit que les Églises canadiennes devront défendre les droits des anciens combattants en demandant, entre autres, qu'à leur retour on les éduque et on leur offre une formation professionnelle.
Inflation et chômage
Les hommes qui reviennent souhaitent des changements, mais lesquels ? Chacun des grands débats socio-politico-économique de l'époque les divise. L'élan du Corps d'armée canadien vient se briser contre la dure réalité du front intérieur trop souvent faite d'inflation et de chômage. Le pays, qui devient plus urbain que rural et dont la classe ouvrière a énormément crû entre 1914 et 1919, est mal préparé à convertir son industrie de guerre. Souvent, les usines d'armement se contentent de fermer leurs portes. Au fil des années, face à une situation économique difficile, qui ne décolle vraiment qu'entre 1924 et 1930, et une société civile qui se durcit, on tentera de trouver des emplois aux plus démunis des démobilisés.
Une brisure politique interne s'est effectuée dès la Loi de conscription de 1917, suivie d'une élection truquée qui laisse le gouvernement d'Union dans un état de mort anticipé : beaucoup de régimes politiques ne survivront pas à cette guerre. La gestion militaire, qui n'avait jamais été le point fort du Canada d'après 1867, n'allait pas s'améliorer soudainement au retour des troupes. Lorsque Meighen remplace Borden, il ne fait que reprendre les problèmes là où son prédécesseur les a laissés. Mackenzie King poursuivra dans cette voix même si, à force de pressions et de démonstrations, les anciens combattants verront lentement leur sort s'améliorer. Leurs revendications serviront à leurs successeurs.
Indépendant et isoliationniste
Tambour, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, 1924-1927. Le PPCLI a commencé à porter l'uniforme rouge à revêtements bleu pâle, dit gris français, en 1924. À cette époque, le voile du casque colonial était aussi bleu pâle, mais cela ne suivait pas les règlements et le régiment a dû commencer à porter le voile blanc en 1927. Finalement, le régiment a pu porter de nouveau le voile bleu pâle suite à la Seconde Guerre mondiale.
L'entre-deux-guerres militaire au Canada. La planification militaire entre les guerres
Tableau résumant l'état de la Défense dans l'entre-deux-guerres
Ce tableau fournit des renseignements portant sur les budgets, le personnel militaire, les navires de guerre et les aéronefs militaires de 1923 à 1939.
Le Canada est pris dans une dichotomie presque humoristique. Les États-Unis, dans les années 1920, sans beaucoup se tromper sur le fond, perçoivent toujours le Canada comme une colonie britannique. En conséquence, leurs plans de guerre prévoient qu'en cas de conflit armé avec la Grande-Bretagne, ils attaqueraient le Canada. Pour sa part, le plan de défense nº 1 du Canada s'énonce ainsi : en cas de guerre anglo-américaine, les Canadiens s'empareraient de certaines régions des États-Unis. Ce plan de défense secret sera écarté en 1926.
La période 1919-1939, du point de vue de la défense du Canada, est marquée par plusieurs réorganisations. Les forces de défense du Canada retournent à leur rôle d'avant-guerre. Elles sont peu nombreuses, avec un plafond total de 10 000 hommes pour les trois armées, chiffre qui ne sera jamais atteint jusqu'à l'entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. La période 1922-1935, marquée par une inflation galopante suivie d'une crise, voit les capacités financières du pays justifier les changements militaires.
En 1918, le Canada a un ministère de la Défense et de la Milice, un ministère de la Marine et une commission pour l'aviation. En 1922, la Loi du ministère de la Défense nationale rassemble ces trois éléments. Cette législation, qui cherche à entraîner des économies, entre en vigueur au début de 1923. Comme suite à cet encadrement, on tente de fusionner les trois armées. Le chef de l'état-major général devient chef d'état-major du ministère de la Défense nationale (CEMMDN) et, à ce titre, inspecteur des trois armées. La Marine s'oppose à cet arrêté ministériel qui ne deviendra jamais exécutoire. Le directeur du Service naval, membre du Conseil de la Défense (qui remplace celui de la Défense et de la Milice de 1904) devient chef de l'état-major de la flotte, en 1927 et le CEMMDN reprend son ancien titre. Au sein du Conseil, se trouve également le directeur du Corps d'aviation royal canadien.
Les budgets de ce ministère remanié ne sont pas très imposants. En 1924-1925, il est de 13,5 millions de dollars, et de 23,7 en 1930-1931. Mais la crise entraîne des compressions et, en 1932-1933, l'effort budgétaire tombe à 14 millions. Plus tard, certains fonds de chômage financent des constructions militaires, mais ils n'aident guère à l'efficacité de l'institution. À compter de 1936, on entreprend un programme de réarmement qui arrive bien tard. On accorde la priorité à la défense du territoire, en particulier aux côtes : en conséquence, on entreprend des travaux sur la côte ouest à compter de 1936-1937, mais ceux-ci ne sont pas terminés en septembre 1939 et la partie qui l'est s'avère peu utile. Les armes installées en batteries sont souvent dépassées ou mal situées. Les unités prévues ont des effectifs incomplets. Les avions de patrouille et d'attaque sont presque inexistants.
La marine 1919-1939
Le Canada décide de se garder une marine et, à cet effet, il achète un croiseur léger, deux destroyers et deux sous-marins de la Grande-Bretagne. Le Niobe et le Rainbow sont pour leur part envoyés à la ferraille. En adoptant cette solution, le gouvernement d'Union, qui inclut plusieurs des Conservateurs de 1913, revient à la logique d'une marine nationale qu'avait préconisée Laurier. Quant aux chefs de cette marine, ils cherchent des solutions qui, sur le plan du personnel et du matériel, leur permettront d'être plus actifs qu'ils ont pu l'être depuis 1910. En 1939, la Marine aura plus de 1 800 marins professionnels. Elle aura également créé, en 1923, la Réserve de la Marine royale du Canada, avec un effectif maximal de 500, et, plus tard, la Réserve volontaire de la Marine royale du Canada, qui ne dépassera pas un effectif de 1 500 avant 1939. À compter des années 30, laborieusement, la Marine met en marche un programme de réarmement. En 1931, elle acquiert deux destroyers récents de la Royal Navy, les NCSM Saguenay et Skeena. Ces navires de 1 360 tonnes ont une vitesse maximale de 31 nœuds, un armement principal de quatre canons de 4,7 pouces et un équipage de 181 hommes. À la fin des années 30, quatre destroyers similaires, le Fraser, le Saint-Laurent, le Restigouche et l'Ottawa, s'ajoutent aux deux précédents, en plus de l'Assiniboine, un peu plus gros que les précédents.
L’armée planifiée 1919-1939
Pour faire des recommandations sur ce que devrait être l'après-guerre pour l'Armée de terre, l'état-major général confie à une commission, dirigée par le major général Otter, la réorganisation de la Milice. En ce qui concerne la force professionnelle, on conservera deux des nouveaux régiments apparus durant la Première Guerre mondiale, soit le PPCLI, et le Royal 22e Régiment. Ainsi, le Corps d'armée canadien sera-t-il perpétué et, pour la première fois, les francophones auront-ils accès à une unité d'infanterie permanente de langue française. Le RCR et les autres unités de la Milice permanente d'avant-guerre survivent également. Mais toutes ont des effectifs réels moindres que les maximums approuvés. Entre 1919 et 1939, le Canada ne disposera jamais d'une brigade d'infanterie prête au combat et ces unités de la Force régulière ne seront pas rattachées officiellement à des brigades de la Milice non permanente, ni aux forces prévues pour l'outremer en cas de conflit. La première concentration de la Force permanente de l'après-guerre a lieu en 1936.
Quant à la Milice non permanente, on conclut qu'il lui faudrait 15 divisions (11 divisions d'infanterie et quatre divisions de cavalerie) pour assurer la défense du pays. Un des débats ayant alors cours est de savoir si l'on gardera les bataillons numérotés de la Force expéditionnaire canadienne ou si on fera disparaître ces unités de combat au sein des unités de milice d'avant 1914. Les anciens combattants désirent la survie des unités de 1914-1918 qui maintiendraient les liens avec le Corps d'armée commandé par Currie et serviraient bien le recrutement. Mais, bien appuyés par une panoplie de politiciens, ce sont les régiments de milice qui survivent. Ils recevront toutefois les honneurs de guerre et les récentes traditions des bataillons numérotés auxquels chaque unité de milice a le plus contribué.
La réduction de la milice
Après la disparition du plan de défense nº 1, les 15 divisions du début des années 1920 sont jugées trop coûteuses et doivent faire place à six divisions d'infanterie et une division de cavalerie, ce qui correspond plus ou moins à la force maximale que le Canada pourrait fournir lors d'une prochaine guerre. Quant aux unités et sous-unités de service ou d'artillerie, elles ne sont allouées à aucune des brigades de ces formations. Le chef de l'état-major général tente de vendre ce projet de réduction, au tournant des années 1930, en disant qu'avec moins d'unités (la majorité de celles qui existent ne parvenant pas, tout comme avant 1914, à remplir ses cadres), on pourra mieux entraîner et équiper les unités en place. Il ne réussira qu'en 1933 et par un artifice : la réduction devient politiquement acceptable une fois placée à l'intérieur de la contribution canadienne aux pourparlers de désarmement de Genève. Cela dit, les 15 divisions étaient des tigres de papier.
En 1936 donc, l'ordre de bataille de la milice, tel qu'il était constitué en 1920, a diminué de plus de la moitié et plusieurs régiments ont disparu pour de bon ou ont été amalgamés à d'autres. Certains changent aussi de rôles, reflétant ainsi l'avancée technologique. Des fantassins deviennent artilleurs ou membres d'unités dites « blindées » (le Corps blindé n'apparaîtra qu'en 1940). La réorganisation de 1936 est largement faite sans rancœurs ou protestations, car on a assuré aux défenseurs de la Milice non permanente que les unités survivantes auraient de vrais rôles dans une éventuelle mobilisation. Dans les faits, l'état-major général tiendra sa promesse : lors de la mobilisation de 1939, la Milice non permanente sera à la base du recrutement des volontaires pour l'outremer et des conscrits pour la défense territoriale, contrairement à ce qui s'était passé en 1914. Par ailleurs, en 1939, on attendra encore le nouveau matériel promis au moment de la réorganisation. Le cheval a disparu, mais les unités de cavalerie n'ont presque pas de chars. Les unités dites motorisées de la Milice active non-permanente n'ont pas de véhicules.
La force aérienne de 1919-1939
Hydravion Vickers Vedette, Aviation royale du Canada, vers la fin des années 1920. Cet hydravion fut le premier aéronef commercial construit selon des spécifications canadiennes afin d’affronter les conditions propres au pays. L’Aviation royale du Canada avait besoin d’un avion pouvant faire des relevés topographiques et la surveillance des incendies de forêt. L’avionnerie Canadian Vickers de Montréal proposa le Vedette de conception britannique avec quelques ajustements pour le Canada et l’ARC fit l’acquisition de 44 hydravions qui entrèrent en service en 1925. Ces engins furent très utilisés dans les régions sauvages du pays, assurant les communications avec les petites communautés isolées et faisant des levés aérophotogrammétriques pour la préparation des cartes de la Commission géologique du Canada.
Le Canada de nouveau en guerre
Le monde continue pourtant sa route inexorable vers la catastrophe. Le 25 août 1939, le pacte de non-agression germano-soviétique est signé. Aussitôt, le Canada prend des mesures de pré-mobilisation, incluant la protection de points stratégiques, avec deux divisions incomplètes de troupes auxiliaires. Le ler septembre, la Pologne est envahie par l'Allemagne. Le 3 septembre, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, suivies par le Canada, le 10 : mais, déjà, le 4 septembre, 303 Allemands qui séjournaient au Canada sont arrêtés. Le manque de préparation flagrant du pays ne l'empêchera pas, comme on le constatera, de participer de façon appréciable à l'écrasement des forces de l'Axe.
Le recensement national de juin 1941 compte 115 06 655 Canadiens, ce qui est environ quatre fois moins que la population britannique et douze fois moins que la population américaine. En 1939, après quelques années d'une très lente reprise économique consécutive à la grande dépression, le Canada a 530 000 chômeurs. Deux ans plus tard, ce nombre a baissé à 200 000, le PNB a augmenté de 47 pour cent, la production de fer et d'acier a doublé et le Canada a repris sa marche sur la route de l'industrialisation. En 1941, les fabrications militaires tiennent une grande place : blindés légers et cellules d'avions (sans les moteurs, dans les deux cas), munitions, corvettes et frégates. Le Canada qui a multiplié par six ses rentrées d'argent en moins de deux ans, peut couvrir 70 pour cent de ses dépenses de guerre à partir de ses revenus courants. Ce résultat tient en grande partie à l'augmentation des impôts personnels et des taxes des corporations, rendue possible par une entente avec les provinces qui devait se terminer un an après la fin de la guerre. Cette ponction fiscale fédérale a d'autres effets : elle réduit le pouvoir d'achat, contrôle en partie la concurrence ainsi que la flambée des prix, deux secteurs qui sont de plus réglementés par la Commission du commerce et des prix en temps de guerre. L'effort financier canadien sera également important et prendra diverses facettes : prêts sans intérêts et dons de sommes importantes à la Grande-Bretagne, ainsi que des déboursés de guerre qui, en 1945, totaliseront 21 786 077 519 $, hors les services médicaux et les pensions d'invalidité fournis aux anciens combattants.
Sur la scène internationale, le Canada joue un rôle, mais très modeste. Il est absent du Comité des chefs d'état-major et oublié lorsque la Déclaration des Nations unies est proclamée. Deux grandes réunions stratégiques, auxquelles participent Roosevelt et Churchill, ont bien eu lieu à Québec (août 1943 et septembre 1944), mais le Premier ministre du Canada évite de prendre part aux discussions. Cependant, des Canadiens en viendront à faire partie de grands comités alliés (ceux des munitions, du transport et des richesses naturelles).
Sans entrer dans les détails, soulignons que c'est durant les années 1939-1945 que la base du système social que nous connaissons aujourd'hui s'élargit avec l'arrivée de l'assurance-chômage et des allocations familiales. Les Canadiens n'ont généralement pas conscience que la société dans laquelle ils vivent actuellement a été considérablement façonnée par les années 1939-1945.
La mobilisation au Canada
Après avoir déclaré la guerre à l'Allemagne, notre pays s'installe lui aussi dans la drôle de guerre. La base de Valcartier est remise à contribution. Contrairement à 1914-1918, elle fonctionnera toute l'année comme centre de mobilisation et d'instruction des unités du 5e District militaire, et centre d'instruction de l'infanterie en général. Entre 1933 et 1936, grâce au programme de secours aux hommes sans travail, les infrastructures ont été très améliorées. De 1939 à 1946, on y construira de nombreux bâtiments « temporaires » qui dureront souvent plus de 30 ans.
Dès le désastre de Dunkerque, en juin 1940, le Canada vote la Loi de la mobilisation des ressources nationales qui apportera, entre autres choses, 98 000 conscrits pour la défense territoriale. En ce qui concerne l'outremer, la décision de 1939 de n'y employer que des volontaires est maintenue. Disons tout de suite que 64 000 conscrits se porteront volontaires pour les combats dont plus de 58 000 dans l'Armée de terre.
Entre 1939 et 1945, plus d'un million d'hommes et de femmes auront porté l'uniforme, soit environ un habitant sur douze. Durant les six années de guerre, 41 pour cent des hommes de 18 à 45 ans ont servi, d'une façon ou d'une autre, dans les Forces armées canadiennes. À la suite de la défaite de l'Allemagne, le Canada est la quatrième puissance militaire après les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. Dans quelques domaines, comme certains types de navires marchands ou le caoutchouc synthétique, la production canadienne est proportionnellement supérieure à celle des États-Unis. Un engagement militaire d'une telle amplitude a encore des répercussions de nos jours. Ainsi, il reste environ 400 000 anciens combattants canadiens. La vaste majorité d'entre eux est issue de la Deuxième Guerre mondiale, dont des dizaines de milliers de mutilés. Un Canadien sur trois de plus de 65 ans était un vétéran en 1994.
L’armée de terre jusqu’en 1942. Une armée en guerre
Soldat en tenue de combat d'hiver, 1943. L'entraînement de combat d'hiver a eu lieu dans le Parc national du Canada Yoho. En dépit de quelques années d'entraînement et d'organisation pour la possibilité d'une campagne en Norvège, l'opération n'a jamais eu lieu. La coupe de l'uniforme d'hiver illustrée dans cette photographie de 1943 a été adoptée pour la patrouille dans le saillant de Nimègue pendant l'impasse là de novembre 1944 à février 1945.
Au maximum de ses effectifs de combat, en 1943, l'Armée de terre dispose de cinq divisions : trois d'infanterie et deux de blindés en plus de deux brigades blindées indépendantes. La 1re Division est arrivée en Angleterre en décembre 1939, sous la conduite du major général A. McNaughton qui sera plus tard promu pour devenir commandant de la 1re Armée canadienne. En mai 1940, la 2e Division, d'abord prévue pour la défense territoriale, part pour le Royaume-Uni et on annonce la formation de la 3e Division. Le danger est devenu très présent.
Ceux qui ont vécu ce début de guerre se rappellent que, souvent, les volontaires n'avaient pas d'uniformes, pas de bottes, pas de manteaux d'hiver, peu ou pas de matériel de campagne. Nous savons déjà que l'armement était déficient. Encore une fois, le Canada doit initialement compter sur sa mère patrie.
La division d'infanterie de la Deuxième Guerre mondiale compte en principe 18 376 hommes. Le cœur de cette formation est constitué de 8 148 fantassins qui représentent 44,3 pour cent des effectifs soit la plus basse proportion pour cette catégorie parmi les divisions d'infanterie alliées et ennemies. Les autres membres de la division se retrouvent dans l'artillerie de campagne (2 122) ; l'intendance (1296) ; les ingénieurs (959) ; le service médical (945) ; les techniciens et artisans en électricité et mécanique (784) ; les signaleurs (743) ; le groupe antichar (721), plus une panoplie d'autres petits groupes de spécialistes. Lorsque les 7 400 premiers hommes de la 1re Division arrivent en Angleterre, en décembre 1939, ils retrouvent le froid et la pluie de la plaine de Salisbury qu'avaient connus leurs prédécesseurs de 1914. La division ne sera au complet qu'en février 1940. Les chefs, qui veulent véritablement contribuer à la victoire, seront servis. Leur volonté de voir leur pays être reconnu comme l'une des puissances militaires alliées leur sera toutefois déniée par les autorités politiques nationales qui refusent de participer aux réunions stratégiques de haut niveau.
Morceaux d'une torpille allemande trouvée sur une plage à Saint-Yvon près de Gaspé en 1942. Suite à l'implication des Américains dans la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs sous-marins allemands ont été envoyé au large de l'Amérique du Nord en 1942. Au cours de 1942, les Allemands ont coulé vingt-quatre navires dans le golfe du Saint-Laurent. Grâce à des améliorations dans l'entraînement et une percée dans le déchiffrement des codes allemands qui a donné un avantage aux Alliés, la crise s'est terminée en septembre 1943.
Jusqu'à 1943, l'Armée canadienne est engagée dans plusieurs actions pas toutes glorieuses. Les 12 et 13 juin 1940, des éléments de la 1re Brigade (artillerie et logistique) pénètrent en Bretagne et avancent vers Laval et Le Mans. Devant la progression allemande irrésistible, ils reçoivent l'ordre de revenir. Le 17 juin, ils rembarquent avec leurs canons et une partie de l'équipement, le reste étant détruit. Le réduit breton ne sera pas défendu. La 1re Division canadienne sera cependant la seule qui, durant de longs mois après Dunkerque, aura suffisamment d'équipement pour s'opposer sur les plages anglaises du sud-est à une éventuelle invasion allemande : telle sera d'ailleurs sa mission. En juin 1940, 2 500 hommes de la 2e Division sont envoyés en Islande, point important de contrôle de l'Atlantique Nord. La vie du soldat y est dure et ennuyeuse, mais aucun combat n'a lieu. En octobre suivant, ces hommes rejoignent leurs compagnons en Grande-Bretagne sauf ceux du Cameron Highlanders, qui resteront en Islande jusqu'au printemps 1941.
La menace dans le Pacifique
Fantassin canadien, Hong-Kong, décembre 1941. Lorsque les relations avec les japonais s'empirent, les Britanniques demandent des renforcements pour la garnison à Hong Kong. Le gouvernement du Canada envoie deux régiments : le Royal Rifles of Canada de Montréal, Québec, et le Winnipeg Grenadiers du Manitoba. Les deux unités était classées 'inapte pour le combat' par le Ministère de la défense nationale à cause de leur manque d'entraînement, mais les japonais n'étaient pas considérés une menace. Les Canadiens ont été dotés d'un équipement tropical et ils sont arrivés seulement six semaines avant que la guerre se déclenche dans le Pacifique. Les hommes ont été courageux mais ils étaient accablés par la puissance des japonais.
En septembre 1940, l'Allemagne, l'Italie et le Japon signent un pacte. Durant plus d'un an, le Japon reste coi. Puis, le 7 décembre 1941, il attaque les États-Unis à Pearl Harbor. Dans les heures et jours qui suivent, une série d'objectifs sont visés dans le Pacifique, dont la colonie britannique de Hong Kong, où viennent à peine d'arriver deux bataillons canadiens et un quartier général de brigade, en tout 1 973 hommes et deux infirmières, commandés par le brigadier J.K. Lawson.
Depuis le début des années 1920, le plan de défense no 2 du Canada prévoit ce qu'il faudrait faire en cas d'attaque par le Japon. En 1930, cela se transforme en dispositions à prendre pour protéger le territoire canadien en cas de guerre entre les États-Unis et le Japon. À la suite de l'attaque contre Pearl Harbor, le Canada entre en guerre contre le Japon dès le 7 décembre, 24 heures avant les États-Unis et le Royaume-Uni. Comme on le sait déjà, la côte du Pacifique est mal préparée. En 1939, le Canada y a huit avions, tous désuets, sans armes, parfois sans radio et au rayon d'action problématique. En 1941, cet état des choses n'a guère changé. Par ailleurs, les unités antiaériennes et l'artillerie côtière sont insuffisantes : dans ce dernier cas, l'élévation possible des canons limite la portée du tir. Environ 10 000 hommes de l'Armée de terre sont dispersés le long de la côte. Certains voudront sans doute trouver une consolation dans le fait que la côte nord-ouest des États-Unis est à ce stade plus mal défendue que la canadienne. En 1942, des radars commencent à y être installés.
Toujours est-il que l'intérêt du Canada pour le Pacifique, mais surtout sa subordination aux intérêts britanniques, l'a amené à promettre, à l'automne 1941, deux bataillons pour renforcer la garnison de Hong Kong. Le départ de cette force se fait de Vancouver, le 27 octobre 1941, sur l'Awatea et le Prince Robert. À la fin de novembre, les troupes arrivent à Hong Kong. Peu entraînés, ces volontaires ont à peine le temps de prendre leurs positions que le Japon passe à l'attaque. La situation est perdue d'avance. Le brigadier Lawson est tué le 19 décembre en défendant son quartier général : ce vétéran de la Première Guerre mondiale a le triste honneur d'être le premier officier canadien de ce grade à mourir au combat au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le 25 décembre, tout est fini. Au total, 557 hommes mourront, dont près de la moitié dans les camps japonais. Le sergent John Osborne, du Winnipeg Grenadiers, recevra la Croix de Victoria à titre posthume, après la guerre, pour avoir sauvé la vie de camarades en se jetant sur une grenade.
Les choses ne s'arrêtent pas là. Les Japonais, en effet, s'approchent du continent par les Aléoutiennes. Les 6 et 7 juin 1942, les îles Attu et Kiska tombent entre leurs mains. Plus tard, un de leurs sous-marins tire contre la station de télégraphie et le phare de la pointe d'Estevan, en Colombie-Britannique, sans causer de dommages sérieux.
La réaction canadienne s'organise vite. L'armée de la côte du Pacifique prend de l'ampleur ainsi que son budget. L'aviation fait passer son nombre d'escadrons à 36, avec des appareils plus modernes. Jusqu'à un certain point, les politiciens cèdent ici aux exigences des habitants de la Colombie-Britannique, face à une menace d'invasion peu plausible étant donné les engagements militaires nippons dispersés dans leur vaste sphère d'influence et même au-delà de celle-ci.
La situation des Nippo-Canadiens est précaire depuis l'ouverture du conflit. Ils sont mal intégrés et mal acceptés par la population locale. L'armée a décidé de ne pas les utiliser ainsi que les Asiatiques d'origine chinoise. Après Pearl Harbor, des manifestations anti-japonaises deviennent possibles en Colombie-Britannique. Pour éviter toute provocation, des écoles et des journaux de langue japonaise sont fermés volontairement. Après la défaite à Hong Kong, la passion populaire se déchaîne. On demande l'internement de ces Japonais locaux qui pourraient former une cinquième colonne. Localement, journalistes et politiciens rivalisent de zèle pour démontrer le danger et les conséquences de l'immobilisme en la matière. Au bout de quelques semaines, le gouvernement fédéral cède et annonce, le 27 février, l'évacuation de toutes les personnes d'origine japonaise de la côte Ouest. Les 22 000 personnes concernées seront déracinés, et leurs biens vendus. Ce cas de discrimination flagrante et injustifiée - les études des militaires concluaient en l'absence de danger - ne rehausse pas le profil moral du Canada, officiellement en guerre pour écraser les injustices de ce type.
Le désastre de dieppe 1942
Mais la descente aux enfers du Canada n'est pas terminée. En effet, le 19 août 1942, c'est le désastre de Dieppe. Dans ce raid d'envergure, mal planifié, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, peu importe les raisons avec lesquelles on l'a justifié après coup, les Canadiens subissent en moins de cinq heures d'une bataille impossible, 68 pour cent de pertes, incluant 907 morts.
Il faut dire qu'au moment de Dieppe, plusieurs de nos volontaires, de nos politiciens et de nos médias se plaignent du fait que nos troupes d'outre-mer soient demeurées en Angleterre, pendant qu'Anglais, Australiens, Néo-Zélandais, Américains et une panoplie d'autres alliés étaient engagés partout dans le monde. Bien que la marine japonaise ait déjà subi quelques revers d'importance, la situation n'est pas particulièrement rose pour les pays engagés contre l'Axe. Pour leur part, Américains et Soviétiques poussent pour l'ouverture d'un deuxième front sur le continent européen, où seuls les Soviétiques se battent. Plusieurs raisons, dont le manque d'équipement et d'hommes, militent contre ce projet. Mais les raids, parfois lourds, sont à la mode. On en prévoit un, contre Dieppe, pour juin 1942, avec l'équivalent d'environ deux brigades de la 2e Division canadienne. Pour diverses raisons, ce projet est abandonné et les unités concernées retournent, déçues, dans leurs casernes.
Environ deux mois plus tard, le même raid est soudainement réactivé : il aura lieu le 19 août 1942. Le plan est très complexe et sa réalisation dépend d'un minutage précis de toutes les phases. Malheureusement, le renseignement sur l'ennemi est inadéquat ; on n'a pas tenu compte des inévitables problèmes qui peuvent survenir ; l'appui-feu aux troupes engagées au sol est très déficient aussi bien de la part de la marine que de l'aviation. Quant à la surprise, elle n'a aucun succès à peu près partout sur les différentes plages de débarquement. Par hasard, une unité allemande de défense côtière est en exercice cette nuit-là et peut sonner l'alarme très tôt.
Bien que toute la planification soit britannique, les exécutants canadiens, en partie emportés par leur enthousiasme d'un premier combat, n'en font pas une critique sérieuse. Seule une grossière incompétence allemande aurait pu changer le cours des choses. Il y a 4 963 Canadiens engagés dans le raid qui commence mal, car les débarquements prévus se font rarement à l'endroit et au moment voulus. Des 2 210 qui reviendront en Grande-Bretagne, seulement 336 sont indemnes. Toutes les unités (six régiments d'infanterie, un de blindé, puis des centaines d'hommes du génie, du Corps de santé, de l'artillerie et d'un régiment de mitrailleuses moyennes) subissent des pertes. Dominés à peu près partout face à des falaises imprenables et en l'absence d'une artillerie massive et d'une force aérienne bien utilisée, les hommes glissent vers la mort (907, plus de 18 pour cent des effectifs), les blessures (2 460 ou à peu près 50 pour cent) ou les geôles (1 874, ou 37 pour cent, incluant 568 blessés). En tout et pour tout, les Alliés (Canadiens, Britanniques et quelques Américains) ont subi 4 350 pertes (3 610 dans l'armée, 550 dans la marine et 190 dans l'aviation). Quant aux Allemands, ils s'en tirent avec 591 pertes (316 dans l'armée, 113 dans la marine et 162 dans l'aviation).
Le calvaire des prisonniers canadiens du raid n'est pas terminé. Parmi les papiers récupérés à leurs ennemis, les Allemands découvrent que les Canadiens prévoyaient enchaîner leurs éventuels prisonniers, en vue d'en faciliter le contrôle durant l'opération, ce qui contrevient aux lois de la guerre. Aussitôt, ils mettent aux chaînes nos propres prisonniers : pour certains, cette humiliation durera 18 mois. Au Canada, on agira de la même façon durant quelques mois avec des prisonniers de guerre allemands. En décembre 1942, on abandonnera cette méthode qui, encore une fois, nous rapproche beaucoup trop de l'hydre que nous cherchons à abattre.
L'aviation jusqu'en 1942. L'expansion de l'ARC et le Programme d'entraînement aérien du Commonwealth
Avion de reconnaissance Westland Lysander IIIa. Le solide avion Westland Lysander fut conçu pour accomplir des reconnaissances à basse altitude et guider le tir des artilleurs. Il était capable de décoller et d’atterrir sur des petites pistes. Bien qu’il prenne son envol en 1936, le Lysander était déclassé quand la guerre se déclara trois ans plus tard. Entre-temps, on commença à fabriquer des Lysander II sous licence au Canada en 1938 à Malton (sur le site de l’actuel aéroport international Pearson à Toronto). La première escadrille de l’Aviation royale du Canada envoyée en Grande-Bretagne au début de 1940 en était équipée. Les Lysander IIIa produits plus tard — tels que celui illustré et conservé au Musée canadien de l’aviation — étant surtout utilisés pour tirer des cibles pour l’entraînement de l’artillerie anti-aérienne.
Après juin 1940, l'aviation britannique joue un rôle primordial dans la guerre. Jusqu'à l'automne 1940, le Canada n'essaie pas de faire identifier ses milliers d'aviateurs servant dans la Royal Air Force. Par la suite, quelques dizaines d'escadrons seront marqués aux couleurs canadiennes. Cette façade ne peut guère cacher plusieurs faits : 60 pour cent des aviateurs canadiens servent dans la RAF, et ils composent 25 pour cent des effectifs du British Bomber Command. Les activités des quelques unités aériennes canadiennes sont contrôlées par les Britanniques qui leur fournissent la plupart de leurs équipes au sol et même une partie de leur personnel volant.
L'effort aérien canadien serait incomplet si l'on ne mentionnait pas le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth britannique, mis en application au Canada, et grâce auquel 131 000 membres d'équipages alliés, dont 73 000 Canadiens, ont été formés avant d'entrer en action. En prévision de la guerre imminente, la Grande-Bretagne avait essayé, à l'été 1939, de relancer sur une base plus large le plan d'entraînement de pilotes au Canada qui avait connu un bon succès durant la Première Guerre mondiale. Mackenzie King en avait repoussé l'idée. Après le déclenchement des hostilités, ce projet refait surface et le premier ministre canadien y trouve désormais des avantages. En effet, ce serait une participation importante à l'effort de guerre, tout en étant peu coûteuse en vies humaines. La hantise de Mackenzie King est que cette guerre entraîne une conscription qui diviserait encore une fois le pays.
Bombardier Bristol Bolingbroke IVT. Ce bimoteur était une version canadienne du bombardier léger britannique Bristol Blenheim. Le nom de Bolingbrooke fut donné à la version du Blenheim Mk. IV construite au Canada. Plus de 600 furent produits par l’avionnerie Fairchild à Longueuil, au Québec, à compter de 1939. Le Bolingbrooke fut le premier avion moderne fait en aluminium construit au Canada mais, avant même que le premier exemplaire prit son envol, il était déjà déclassé. On s’en servit néanmoins, faute de mieux. En juillet 1942, un Bollingbrooke contribua à couler un sous-marin japonais au large des côtes de la Colombie-Britannique. La photo montre un Bollingbroke Mk IVT dans la collection du Musée canadien de l’aviation. 457 MK IVT furent construits et utilisés pour l’entraînement des navigateurs et des artilleurs.
En décembre 1939 donc, le Plan d'entraînement aérien du Commonwealth sera signé. Le Canada paiera une bonne partie des frais ainsi encourus. Les équipages canadiens produits par le Plan serviront en Grande-Bretagne. Les premiers diplômés du Plan seront prêts vers la fin de 1940, année où l'on commencera à discuter de la mise en application d'un des articles du protocole d'entente, celui disant que des escadrons d'outre-mer seront identifiés clairement comme canadiens. À la fin de 1942, le Plan a 107 écoles au Canada, la plupart ayant nécessité la construction d'infrastructures nouvelles qui donneront naissance aux grands aéroports du Canada contemporain.
Toutefois, durant cette guerre, notre pays ne contrôlera pas le travail de ses propres escadrons qui ne disposeront pas d'équipages au sol à majorité canadienne. Lors de la bataille aérienne du 19 août 1942, qui a lieu au-dessus de Dieppe et qui est presque indépendante de ce qui se passe au sol, huit escadrons de chasse canadiens sont impliqués sans même l'aval des officiers supérieurs de l'air canadiens affectés en Grande-Bretagne. On oublie souvent de mentionner que le raid de Dieppe a été une occasion, pour la RAF, de provoquer le plus important combat aérien au-dessus du continent européen. Bien que les pertes en appareils aient été de deux contre un en faveur des Allemands, ceux-ci ne parviennent plus à bâtir autant d'avions qu'ils en perdent, alors que les Alliés peuvent facilement combler leurs pertes.
Du côté de l'aviation, le Canada cherche son identité durant toute la guerre. Sa participation significative dans ce domaine sera plus ou moins diluée à l'intérieur du grand ensemble du Commonwealth.
La marine jusqu’en 1942. L'expansion de la Marine et la menace des sous-marins
Matelot ordinaire, Women's Royal Canadian Naval Service, 1942-1946. Membre du service féminin de la marine canadienne, le Royal Canadian Women's Naval Service, formé en 1942 et qui compta quelque 4 300 femmes. L'élégante tenue d'été bleu ciel illustrée ici distinguait les Canadiennes des Britanniques et des Américaines qui portaient le blanc. La tenue d'hiver bleu foncé était identique à celle portée par le British Royal Navy, le service féminin de la marine britannique. Le WRCNS a aussi adopté le surnom "Wrens" de leurs homologues britanniques, c'est-à-dire, le Women's Royal Naval Service.
La marine est la plus petite des armées canadiennes, mais certainement pas la moins importante par les services rendus. Durant la Première Guerre mondiale déjà, des sous-marins avaient menacé les côtes canadiennes et le commerce maritime sans que la marine britannique, stationnée dans les eaux européennes, ne puisse y faire quoi que ce soit. Le 11 novembre 1916, l'Amirauté avait signalé au Canada qu'il devait lui-même accroître ses patrouilles navales côtières. Les Canadiens, de façon on ne peut plus claire, venaient de se faire dire de ne plus compter sur les Britanniques pour leur défense maritime.
La Première Guerre mondiale a rapproché certains points de vue. Une marine totalement canadienne est plus attrayante aux yeux des Canadiens français que les dons d'argent désirés par les Conservateurs d'avant 1914. Quant aux Canadiens anglais, leur identité s'est développée et l'idée d'une marine nationale est devenue une nécessité. La petite marine canadienne d'après 1920 rappelle celle de Laurier de 1910, mais aussi les nombreux plans précédents que nous avons survolés. En 1939, notre marine possède quatre destroyers (contre-torpilleurs) opérationnels qui passent en Grande-Bretagne. À la suite de l'entente américano-britannique qui, en 1940, donne aux Britanniques 50 vieux destroyers américains, en échange de bases à installer à Terre-Neuve et dans les Antilles, six autres destroyers sont pris en charge par le Canada. Mais ceux-ci datent de la Première Guerre mondiale et sont plus ou moins fiables. L'un d'entre eux, rebaptisé NCSM Ste-Croix, doit revenir à Halifax lors de sa première sortie en route vers les eaux britanniques : la mer est trop rude pour ce navire dont la structure au-dessus de sa ligne de flottaison est trop lourde.
Officier, Marine royale du Canada, 1940-1945. Avec son duffel-coat et les jumelles en main, cet officier porte la tenue pour prendre le quart. On ne peut pas savoir son grade car tous les insignes son couverts, ni si il fait partie de la Marine royale du Canada ou de la Réserve des Volontaires de la Marine royale canadienne.
En juin 1941, les 10 destroyers reviennent au Canada et s'ajoutent aux corvettes construites sur place pour accompagner, tout en les protégeant, les convois de ravitaillement reliant l'Amérique du Nord à l'Angleterre. Ce service armé canadien qui, encore aujourd'hui, est sans doute le plus britannique des trois, est pourtant le seul qui, durant la guerre et malgré les nombreuses vicissitudes qu'il rencontrera, obtiendra un commandement autonome. Cette marine, mal équipée au début et dépourvue d'équipages d'expérience, sera lancée dans une guerre anti-sous-marine qui, dans un premier temps, aura peu de succès.
Les Allemands se sont mis à augmenter leur flotte d’U-boot durant la dernière année précédant l'entrée en guerre. À l'ouverture du conflit, ni la Grande-Bretagne ni le Canada ne sont prêts à faire face à cette menace. De fait, le lendemain de la déclaration de guerre anglaise, le paquebot Athenia, en partance de Liverpool pour Montréal, est coulé par un sous-marin allemand, sans avertissement, à 400 kilomètres à l'ouest de l'Irlande : cela rappelle le triste sort subi par le Lusitania durant la Première Guerre mondiale. Or, il apparaît évident, surtout après juin 1940, que la reconquête du continent européen reposera largement sur le lien vital transatlantique qui permettra de réunir, en Angleterre, les hommes et le matériel nécessaires à d'éventuels débarquements.
Hydravion Short Sunderland Mk. I de la Royal Air Force, 1940. Cet aéronef fut conçu avant la guerre par l’avionnerie Short Brothers comme l’hydravion postal transatlantique « S.23 ». De 1939 à 1945, ce grand quadrimoteur fut utilisé pour les missions de reconnaissance lointaines et contre les sous-marins par la Royal Air Force. Le Sunderland était très bien armé et capable de se défendre efficacement contre les chasseurs ennemis ou de couler des sous-marins. L’Aviation royale du Canada eut deux escadrilles équipées d’hydravions Sunderland Mk. II et Mk. III. Il s’agissait des escadrilles de reconnaissance 422 et 423 qui faisaient partie du commandement côtier de la Royal Air Force; ils coulèrent sept sous-marins ennemis.
Bien que l'on se soit préparé en fonction d'une guerre de surface, l'expérience des convois acquise quelque 25 ans plus tôt n'a pas été perdue. Entre-temps, les Allemands ont pour leur part amélioré leurs sous-marins et, après avoir conquis la côte atlantique française, ils deviennent très dangereux. Leurs sous-marins ont un long rayon d'action (plus de 10 000 kilomètres, pour les moins performants) une vitesse en surface entre 17 et 19 nœuds (alors que les convois font de 8 à 12 nœuds), une possibilité d'immersion de 24 heures et de bonnes communications avec leur quartier général en Europe. Peu à peu, les Allemands développent la tactique de la meute : un sous-marin repère un convoi et rameute ses collègues des environs avant de passer à l'attaque, généralement dans un secteur de l'Atlantique Nord qu'aucun avion de patrouille ne peut couvrir au cours des premières années de guerre. La constitution des stocks stratégiques en Grande-Bretagne est mise en péril.
Pour les marins canadiens, les choses ne vont pas très bien. Le NCSM Fraser est coupé en deux par le Calcutta britannique, le 25 juin 1940, dans l'estuaire de la Gironde : 47 morts. Plus tard, c'est au tour du NCSM Margaree, en patrouille à l'ouest de l'Irlande, de subir le même sort de la part d'un navire marchand 142 morts. Par ailleurs, le 6 novembre 1940, le NCSM Ottawa participe à la destruction d'un sous-marin italien.
Terre-Neuve et la bataille de l’Atlantique
Au début de la guerre, les Allemands cherchent leurs cibles dans les eaux européennes, très rarement dans les eaux terre-neuviennes qui sont sous la responsabilité canadienne. Entre septembre 1939 et octobre 1941, ils coulent 164 navires marchands au service des Alliés, mais seulement sept de ceux-ci faisaient partie de convois.
En août 1941, une rencontre dans la baie de Placentia, à Terre-Neuve, entre le premier ministre britannique, Winston Churchill, et le président américain, Franklin Delano Roosevelt, amène les États-Unis à accepter de participer à la protection des navires marchands naviguant dans l'Atlantique Ouest. Jusque-là, les Américains avaient assuré la sécurité navale le long des côtes, les Canadiens allant en mer, à l'est de Terre-Neuve ; les deux autres segments de la route des convois étaient entre Terre-Neuve et l'Islande, et l'Islande et la Grande-Bretagne. Du coup, la petite marine canadienne tombe sous commandement américain. Lorsque les Américains vont en haute mer, ils accompagnent les convois les plus rapides et sont donc moins faciles à atteindre par les Allemands.
À la suite de la guerre avec le Japon, les États-Unis transfèrent une bonne partie de leur flotte de l'Atlantique vers le Pacifique. À l'automne 1942, les Américains ne fournissent plus que deux pour cent des unités de protection des convois transatlantiques, bien que le commandement de la zone reste entre leurs mains.
Vers juin 1942, environ la moitié des navires escorteurs et le quart des patrouilles aériennes des côtes au nord de New York sont canadiens. Comme les États-Unis ne protègent presque plus leur côte atlantique, les Allemands y frappent leur commerce de plein fouet. Le Canada doit envoyer des corvettes au sud, affaiblissant d'autant ses groupes d'escorteurs du nord. Au moment où les Allemands vont s'installer solidement au creux de l'Atlantique Nord, les Canadiens se retrouvent plus ou moins seuls avec une flotte de petits navires d'escorte en croissance, des équipages mal entraînés et de l'équipement désuet.
La marine de corvettes
NCSM Sackville, corvette de la classe 'Flower', Marine royale canadienne. Durant la Seconde Guerre mondiale, la marine canadienne fut surnommée 'la marine des corvettes' car elle comptait plus de 130 de ces petits navires qui escortaient les convois et pourchassaient les sous-marins allemands. La coutume de peindre une feuille d’érable verte sur la cheminée, commençée en 1917, devint généralisée durant la Seconde Guerre mondiale. Ce cliché montre la seule corvette encore existante, le Sackville construit en 1941 à Saint-Jean (NB), restaurée au début des années 1980 et amarrée à Halifax comme musée naval.
À compter de 1940, les Canadiens se sont mis à construire des corvettes, de petits navires d'une soixantaine de mètres de long, dont les plans sont fondés sur les baleinières britanniques de la fin des années 30. Très remuantes sur la mer, elles ont une vitesse maximale de 16 nœuds, un canon de quatre pouces, un ASPIC (version britannique du SONAR) désuet et une mitrailleuse antiaérienne. Bien que pouvant résister à tous les gros temps de l'Atlantique Nord et tout en étant excellentes pour les manœuvres, les corvettes sont aussi très inconfortables. Qui plus est, la plupart des officiers professionnels sont sur les navires plus importants (destroyers, croiseurs et plus tard porte-avions), se préparant à la guerre à la Nelson désirée par leurs collègues britanniques et laissant le convoyage et les corvettes à la Réserve navale et à la Réserve volontaire navale.
Au fur et à mesure que nos chantiers navals produisent ces corvettes, celles destinées aux équipages canadiens sont lancées dans la bataille avec des volontaires assez verts. On n'a pas le temps, au Canada, de former des groupes solides de navires escorteurs dont les équipages apprendraient à travailler ensemble. Les périodes de repos sont rares. L'équipement, comme les radars, les ASPIC ou les détecteurs des hautes fréquences émises par les radios des sous-marins ennemis, est dépassé, souvent reçu de six mois à un an après que les navires britanniques en eurent été munis. En 1941, il arrive même que des corvettes, n'aient pas de radar. L'enthousiasme évident des volontaires canadiens ne peut combler totalement les lacunes laissées avant-guerre par le manque d'infrastructure industrielle adéquate et d'une marine expérimentée et assez nombreuse pour assumer ses rôles. Au sommet de cette faible charpente règne, depuis 1934, l'amiral Percy W. Nelles, compétent dans son domaine, mais sans inspiration et dépassé par une situation qu'il n'avait pas prévue et à laquelle il ne parvient pas à s'adapter.
Dès l'été 1941, la Force d'escorte de Terre-Neuve nouvellement créée va vivre des expériences traumatisantes. Un de ses grands problèmes est le manque de couverture aérienne en certains endroits du parcours. Le convoi SC-42, parti le 30 août 1941 de Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour la Grande-Bretagne, se fait couler 16 navires marchands en plus d'un des escorteurs, les 9 et 10 septembre. Le SC-44 ne perd que quatre navires marchands et une corvette ; le SC-48 est très touché, mais pas autant que le SC-42 ; le SC-52 fait demi-tour et rentre au port par une mer déchaînée.
Puis les choses semblent se tasser dans l'Atlantique, lorsque les sous-marins allemands attaquent en priorité le trafic du sud de l'État de New York. Quand à la fin de l'été et à l'automne 1942, l'intérêt allemand reprend envers l'Atlantique Nord, la situation devient rapidement intenable. Le convoi ON-127, avec 32 navires marchands partis d'Angleterre le 5 septembre 1942 pour le Canada, est escorté par deux destroyers canadiens et trois corvettes dont une britannique, le seul des navires à avoir un radar performant qui ne fonctionne d'ailleurs que par intermittence. Neuf navires marchands sont coulés, plus le destroyer Ottawa qui perd 114 membres d'équipage. Le 30 octobre, le SC-107 part du Canada vers la Grande-Bretagne et perd 15 navires marchands. Dans ces deux cas, aucun sous-marin ennemi n'a été détruit. Britanniques et Américains s'interrogent sur l'efficacité des escorteurs canadiens lorsqu'ils sont au centre de l'Atlantique. Entre les 26 et 28 décembre 1942, l'ONS-154, vers le Canada, perd 14 navires marchands plus un navire de guerre britannique. Cette fois, les escorteurs munis de radars récents et de bons détecteurs de hautes fréquences (HF/DF), même si le personnel n'a aucune expérience de leur utilisation, ont pu couler un sous-marin allemand.
La bataille du ST-Laurent
Le 9 janvier 1943, pressé par ses alliés, le Canada décide d'abandonner momentanément son rôle d'escorte au milieu de l'Atlantique. Il utilisera les quelques mois à venir pour munir ses escorteurs de nouveaux équipements et pour former ses équipages à leur utilisation. La Marine royale du Canada atteint ici le nadir. Encore plus quand on considère que, quelques mois plus tôt, on a dû fermer le fleuve Saint-Laurent à toute circulation commerciale.
En effet, en mai 1942, les sous-marins allemands ont croisé dans l'estuaire du Saint-Laurent. Puis, d'août à novembre, ils s'y sont installés de façon presque constante. Huit sous-marins participent, à des moments différents et sans subir de pertes, à une chasse fructueuse, car ils y détruisent une corvette, un yatch armé, 19 navires marchands ou de passagers en plus d'en endommager deux autres. Devant la panique qui s'installe dans les populations locales, le gouvernement doit expédier quelques-uns de ses escorteurs de l'Atlantique - déjà pas assez nombreux - vers le golfe du Saint-Laurent. En octobre, finalement, on ferme cette voie de navigation : tout le commerce transatlantique se fera directement des côtes. Le Canada pourra ainsi dégager des escorteurs vers la Méditerranée, où l'on prépare le débarquement en Afrique du Nord (opération Torch).
À la mi-novembre 1942, un sous-marin allemand débarque un espion en Gaspésie, mais il se fera arrêter presque aussitôt. Enfin, le 14 octobre, le SS Caribou, un traversier entre North Sydney, Nouvelle-Écosse, et Port-aux-Basques, Terre-Neuve, a été coulé par un sous-marin : 136 des 237 passagers et membres d'équipage périssent. Jusqu'en 1943, la Marine royale du Canada n'a détruit que quatre sous-marins ennemis.
Après plus de trois ans de guerre, le Canada a réussi sa mobilisation totale, mais n'a guère pu se faire valoir sur le plan strictement militaire. De nouvelles occasions se profilent à l'horizon qui permettront de mieux mettre en valeur les qualités des combattants militaires en mer, dans les airs et sur terre.