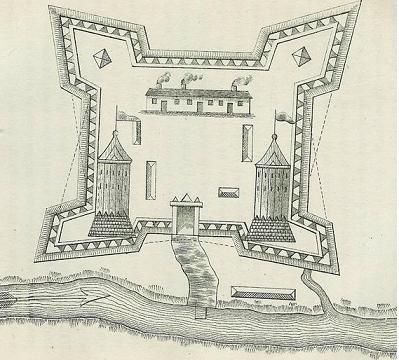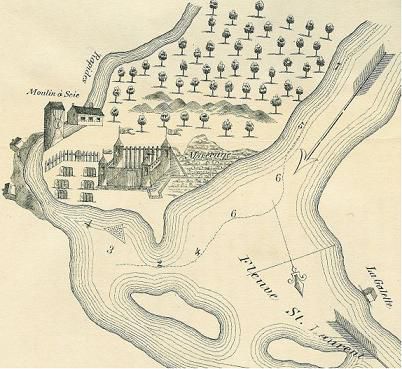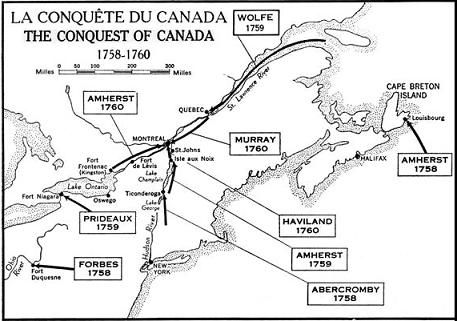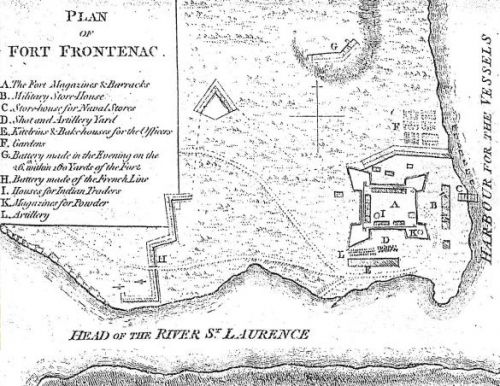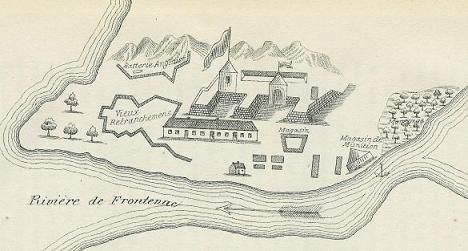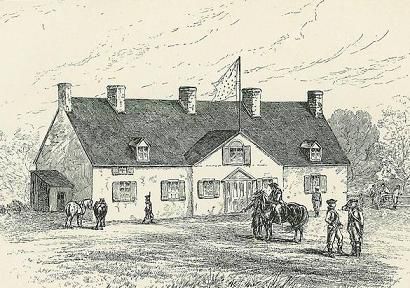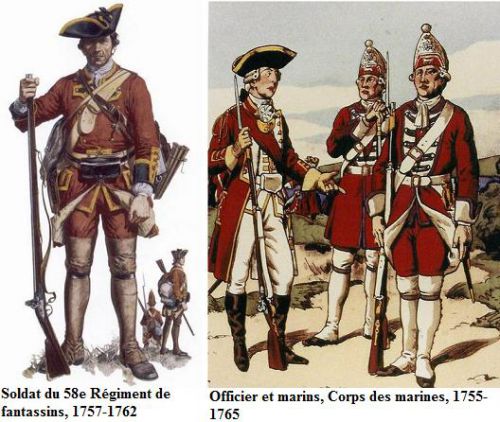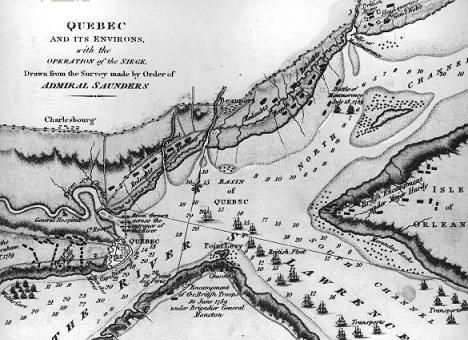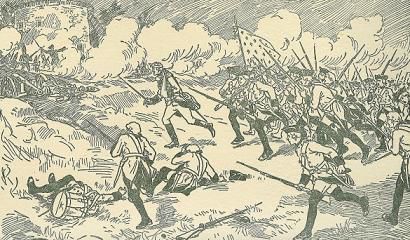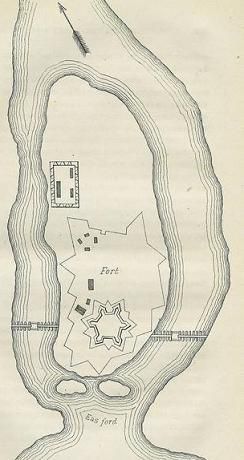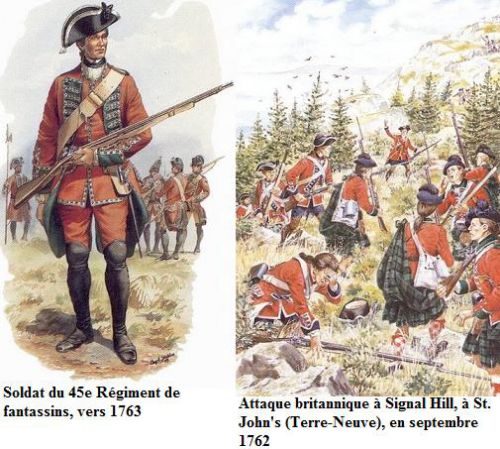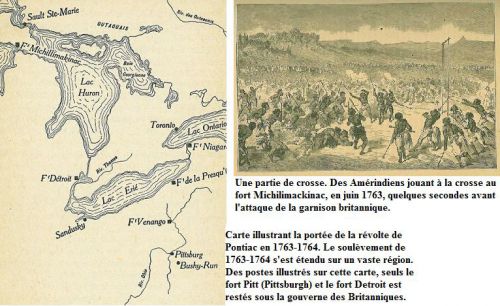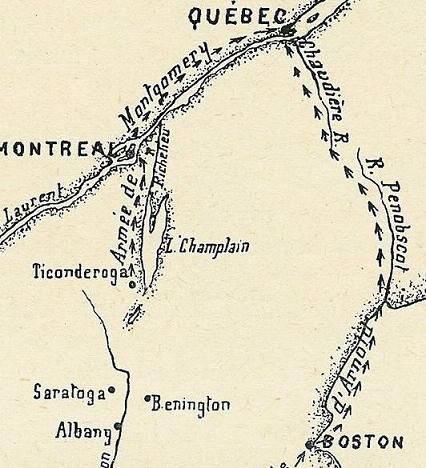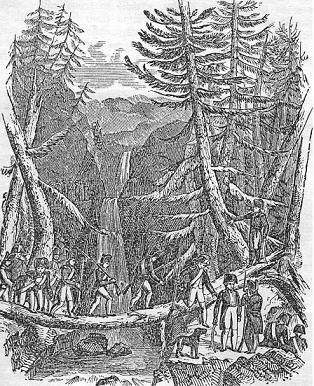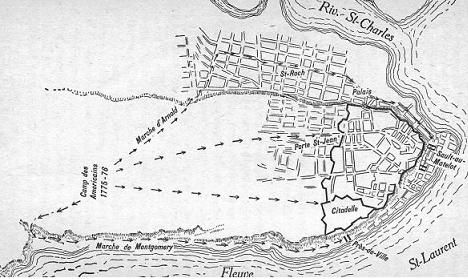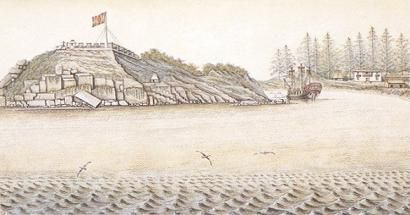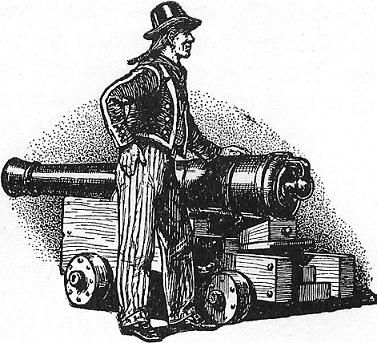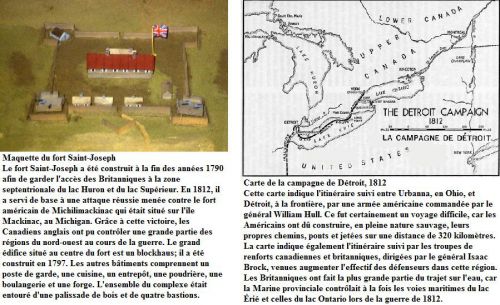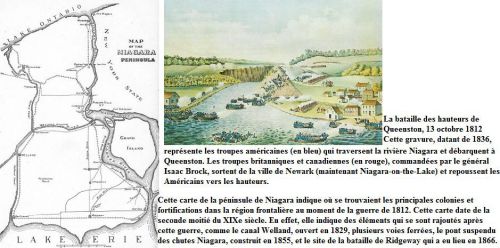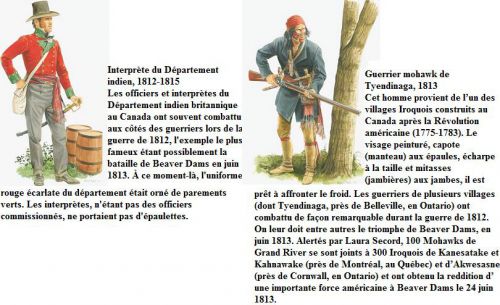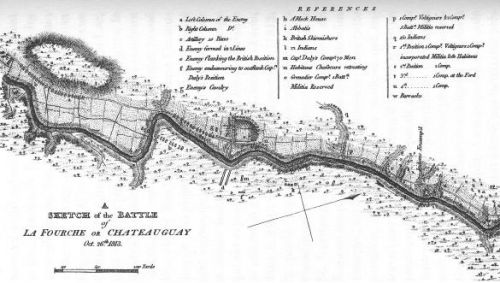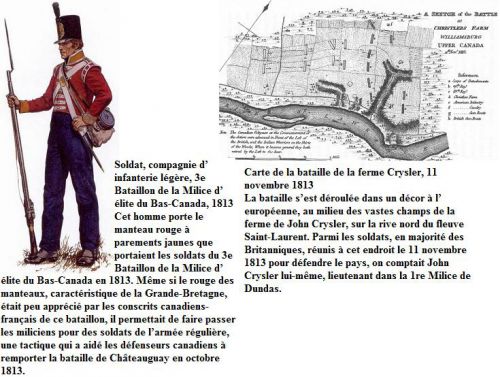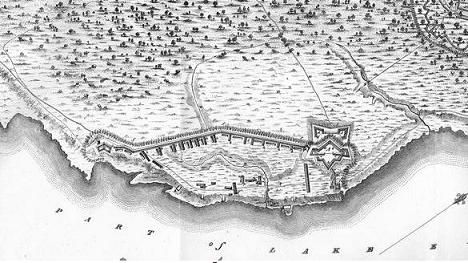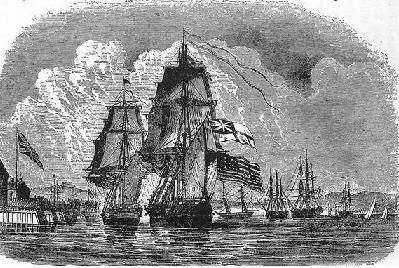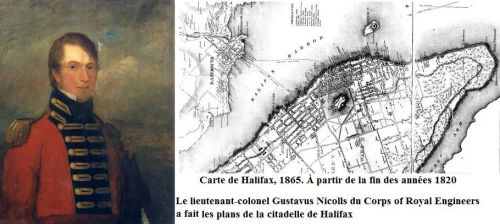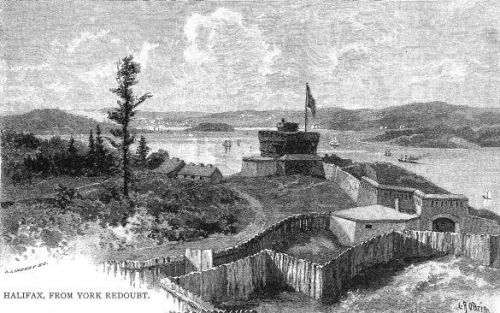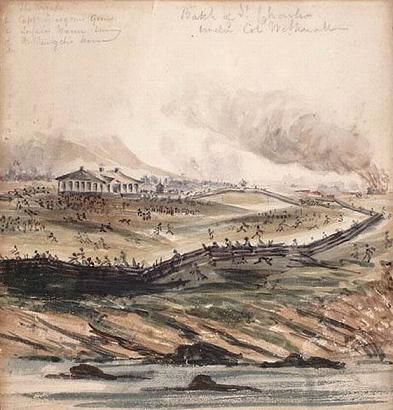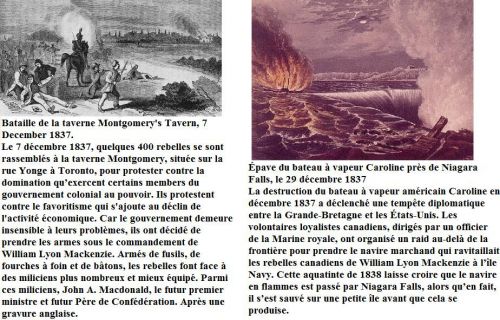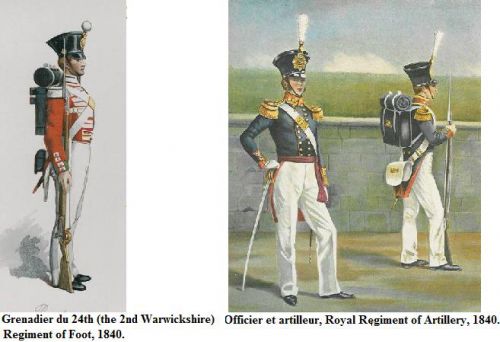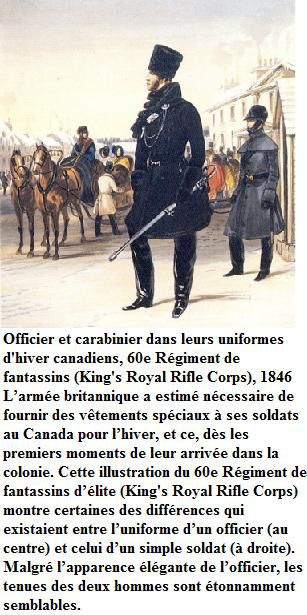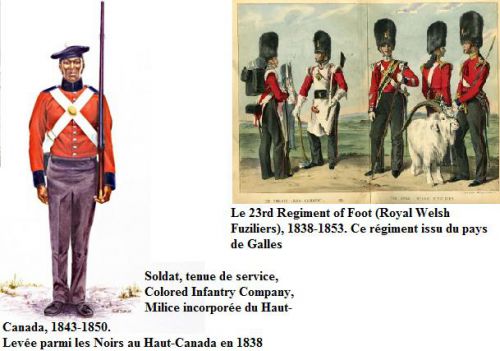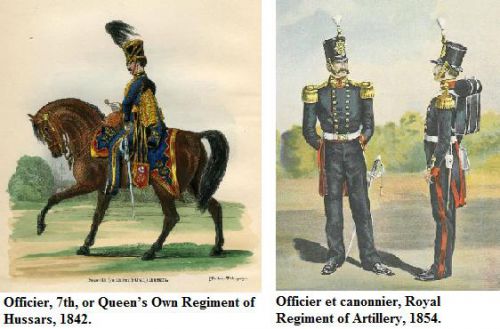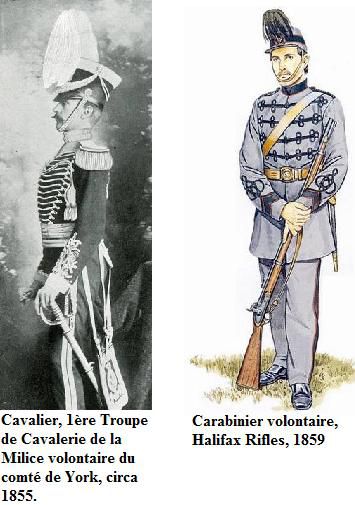1755-1871
La guerre de la conquête
L'invasion de la vallée de l'Ohio. Une manœuvre délibérée Forces en présence au début de la guerre. La garnison française
Fort Saint-Jean, dans les années 1750. D'abord construit sur la côte Ouest de la rivière Richelieu par des soldats du Régiment de Carignan-Salières en 1665, le fort Saint-Jean a été reconstruit à plusieurs reprises. Selon ses plans, le fort (illustré tel qu'il était dans les années 1750) était composé de palissades et de quatre grands bastions. Abandonné aux Britanniques en 1760, le fort Saint-Jean a été pris par l'armée américaine du général Montgomery après le siège de 1775, pour être occupé encore une fois par les troupes britanniques en 1776. Il a servi de base militaire au cours des 19e et 20e siècles et a été le site du Collège royal militaire de 1952 à 1995.
Au début de l'année 1755, deux grandes puissances européennes sont sur le point de s'affronter en Amérique du Nord : la France et la Grande-Bretagne. Les colonies britanniques occupent un espace restreint le long du littoral atlantique ; composée essentiellement d'agriculteurs et de marins, leur population d'origine européenne dépasse le million. En contrepartie, avec guère plus de 70 000 habitants, la Nouvelle-France contrôle un immense territoire englobant les vallées du Saint-Laurent et du Mississippi, ainsi que les vastes contrées de l'intérieur du continent.
Après la guerre de Succession d'Autriche, les autorités françaises s'aperçoivent de la nécessité de doter la Nouvelle-France d'une importante garnison, afin de maintenir sa position géostratégique. En 1750, elles augmentent donc considérablement les effectifs militaires de leur colonie. En Louisiane, on passe de 850 à 2 000 soldats, à l'île Royale de 700 à 1200 et au Canada, de 812 à 1500. Ces 4 700 soldats sont encadrés par plus de 300 officiers. Au total, les troupes coloniales régulières en Nouvelle-France comptent alors quelque 5 000 militaires de tous rangs. Il s'agit surtout de fantassins appartenant pour la plupart aux Compagnies franches de la Marine, auxquels s'ajoutent une centaine d'artilleurs.
Fort La Présentation, dans les années 1750. Établi vers 1718, le fort La Présentation a été reconstruit en 1748. Ce fort a été une importante base pour les Indiens alliés des Français sur le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent, qui subissaient grandement l'influence du père Piquet, un missionnaire sulpicien. En 1752, John Defever a décrit le fort comme un village composé d'environ 40 wigwams et près duquel un prêtre français habitait. Les Britanniques ont pris le fort en 1760. La ville de Ogdensburg, dans l'État de New York, a été construite sur le site du fort La Présentation.
Ces troupes sont réparties de la façon suivante : les 1200 soldats affectés à la défense des 7 000 habitants de l'île Royale et de l'île Saint-Jean logent presque tous à la forteresse de Louisbourg. En Louisiane, où l'on peut en compter 2 000 pour une population d'environ 6 000 colons, la ville de la Nouvelle-Orléans héberge à elle seule plus de 1 000 militaires, ce qui équivaut à peu près au tiers de sa population ; de plus, 500 autres soldats sont stationnés à Mobile, et un nombre équivalent d'hommes est détaché dans des fortins répartis le long du Mississippi, jusqu'en Illinois. Au Canada, où la presque totalité de la population de 60 000 civils est établie dans la vallée du Saint-Laurent, les deux tiers des troupes, soit 1 500 à 1 800 hommes, sont postées à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières ; les petites garnisons des forts de l'ouest ne nécessitent pas plus de 500 à 600 officiers et soldats.
Des renforts d'Europe. Le général Braddock conduit ses troupes en Virginie
Telles sont les forces en présence lorsqu’éclate, en 1754, l'incident de Jumonville, suivi de la prise du fort Necessity. L'assassinat d'un officier canadien en mission parlementaire provoque une grande indignation en France, et la Grande-Bretagne, de son côté, est outrée d'apprendre que des militaires français chassent ses sujets américains de la vallée de l'Ohio. Dans les colonies britanniques, l'exaspération est à son comble. Quand la Virginie lève sa propre petite armée, la Caroline du Nord, le New York, le Connecticut et le Massachusetts s'apprêtent à l'imiter. Les politiciens américains réclament à l'unisson l'envoi en Amérique de nombreuses troupes régulières de l'armée britannique afin de régler, une fois pour toutes, le problème que représente la Nouvelle-France.
Cédant à ces pressions, le gouvernement britannique autorise, à la fin de 1754, la levée de deux régiments à ses frais : il s'agit des 50e et 5le d'infanterie qui comptent respectivement 1 000 hommes recrutés dans les colonies nord-américaines. De plus, le gouvernement ordonne l'envoi en Virginie de deux régiments de 700 hommes chacun, les 44e et 48e d'infanterie, tous deux sous les ordres du général Edward Braddock. Ces régiments, équipés d'artillerie de campagne, partent d'Irlande en janvier 1755 pour arriver à destination à la mi-mars. La stratégie britannique va consister à affaiblir la Nouvelle-France en s'emparant de ses avant-postes. Avec l'aide des troupes coloniales, Braddock et ses soldats devront chasser les Français de la vallée de l'Ohio. Au même moment, les troupes anglaises postées en Nouvelle-Écosse s'empareront de l'isthme de Chignectou, tandis que d'autres attaqueront le fort Saint-Frédéric sur le lac Champlain et, si possible, le fort Niagara sur le lac Ontario.
La réaction des français
En France, la réaction à l'envoi de troupes britanniques en Virginie ne se fait guère attendre. Afin de renforcer ses garnisons nord-américaines, Louis XV décide, en février 1755, d'envoyer au plus tôt six bataillons détachés des « troupes de terre », car on ne peut se permettre d'attendre que de nouvelles troupes coloniales soient recrutées. Les 2e bataillons des régiments de La Reine, de Languedoc, de Guyenne, de Béarn, de Bourgogne et d'Artois, au total 3 336 officiers et soldats, sont désignés à cet effet. Les bataillons de Bourgogne et d'Artois auront pour tâche de renforcer la garnison de la forteresse de Louisbourg, tandis que les quatre autres, sous le commandement du général Jean-Armand Dieskau, serviront au Canada. Au début du mois de mai, les six bataillons quittent enfin Brest pour la Nouvelle-France.
C’est la guerre
Le gouvernement anglais, apprenant que la France dépêche des forces armées en Amérique, ordonne aussitôt à la Royal Navy d'intercepter tout navire français ayant des troupes à bord. Il s'agit là d'une mesure très virulente étant donné que la guerre n'a pas encore été déclarée. Le 8 juin, au large de Terre-Neuve, l'escadre de l'amiral Edward Boscawen repère trois navires français séparés de leur propre escadre par la brume l'Alcide, le Lys et le Dauphin royal. Les vaisseaux anglais et français s'étant rapprochés à portée de voix, le commandant de l'Alcide demande : « Sommes-nous en paix ou en guerre ? - Nous n'entendons pas », lui répond-on depuis le HMS Dunkirk, le moins éloigné des voiliers anglais, avant d'ajouter: « La paix, la paix 3 ! » Mais, arrivé à moins de 100 mètres de l'Alcide, le Dunkirk ouvre brusquement le feu ! Quelque 80 marins français sont fauchés et le navire perd son gouvernail. L'effet de surprise est total. Les canonniers français tentent tant bien que mal de riposter au tir des Anglais, mais le combat est perdu d'avance. L'Alcide et le Lys se voient contraints de baisser pavillon. Seul le Dauphin royal parvient à s'échapper pour atteindre Louisbourg. À la suite de ce sanglant incident, l'état de guerre entre la France et l'Angleterre se confirme, même si les hostilités ne débuteront officiellement qu'un an plus tard.
Les Anglo-américains attaquent. Reddition du fort Beauséjour
Camp du 43e Régiment britannique pendant le siège de Fort Beauséjour, juin 1755
Les hommes du 43e Régiment de fantassins faisaient partie d'une imposante armée de 2 000 hommes sous la gouverne du lieutenant-colonel Robert Monkton, qui a pris le fort Beauséjour après un court siège pendant l'été de 1755. À gauche, on voit des hommes de la compagnie de grenadiers, que l'on peut distinguer grâce à leur bonnet pointu. Au centre se trouvent des soldats ordinaires qui portent le tricorne, tout comme la plupart des membres du Régiment. Les jeunes hommes à droite sont des tambours et les couleurs de leur manteau sont inversées pour que l'on puisse facilement les distinguer lors des batailles; élément très important à l'époque parce que les battements de tambour servaient à donner les ordres. La présence de femmes et d'enfants semble peu appropriée dans un campement militaire, mais un petit nombre de familles de soldat suivaient chacun des régiments britanniques lors des campagnes.
Offensive contre la vallée de l'Ohio
Cependant, les Britanniques dirigent leur principale offensive dans la vallée de l'Ohio. L'enjeu est considérable pour la Nouvelle-France puisque l'Ohio relie la Louisiane aux Grands Lacs et au Canada. Une défaite pourrait sonner le glas des alliances françaises avec les nombreuses nations amérindiennes de la région. Dès mai 1755, les troupes du général Braddock sont rassemblées à l'ouest de la Virginie : il s'agit d'une armée de 2 200 hommes, comprenant les 44e et 48e régiments, quelques compagnies franches régulières, le régiment de la Virginie sous le commandement de George Washington, des miliciens, et même quelques marins. L'objectif à atteindre est le fort Duquesne, distant de quelque 200 kilomètres à travers forêts et marécages. Chemin faisant, les troupes doivent construire une route et ériger des ponts afin de transporter le matériel, car Braddock mène sa campagne à l'européenne. L'armée avance péniblement, à raison de quelques kilomètres par jour, et se voit contrainte de laisser à l'arrière les lourdes pièces d'artillerie de siège sur lesquelles Braddock comptait pour bombarder le fort Duquesne. Mais la lente progression de l'armée anglo-américaine semble irrésistible. Au début de juillet, elle parvient enfin à atteindre la rivière Monongahela, où le terrain est plus praticable, et il ne lui reste guère plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir pour arriver au fort Duquesne. Ne trouvant aucune trace des Français, plusieurs officiers britanniques s'attendent à percevoir un bruit sourd au loin : celui de l'explosion du fort, que la garnison française pourrait faire sauter avant d'évacuer l'Ohio.
Le désastre du général Braddock
Capitaine Daniel Lienhart de Beaujeu, vers 1750. Daniel-Hyacinthe-Marie Liénard de Beaujeu (1711-1755) était un officier au sein des troupes de la Marine (troupes régulières françaises en garnison en Nouvelle-France). Il a commandé les forces françaises, canadiennes et amérindiennes au début de la bataille de Monongahela le 9 juillet 1755, au cours de laquelle il a été tué.
Le 9 juillet, l'armée de Braddock avance en rang, tambour battant, lorsque l'avant-garde rencontre l'ennemi et se met à tirer dans les bois où s'est embusqué un corps comprenant 105 officiers et soldats des Compagnies franches de la Marine, 146 miliciens canadiens, et plus de 600 Amérindiens. Cette troupe est sous le commandement de Liénard de Beaujeu qui, tué dès les premières salves anglaises, a été aussitôt remplacé par le capitaine Jean-Daniel Dumas. Bientôt, la confusion s'installe dans les rangs de l'armée anglo-américaine, décimée par la fusillade meurtrière d'un adversaire bien camouflé dans la forêt, d'où fusent les cris de guerre effrayants des Amérindiens ; plusieurs officiers sont tués en tentant de rallier leurs hommes avant que le général Braddock ne tombe à son tour, mortellement blessé. Au désordre succède la panique, puis la débandade. Enfin, après environ quatre heures de combat, l'armée anglo-américaine, en déroute, abandonne sur le champ de bataille toute son artillerie de campagne, ses bagages et quelque 25 000 livres en argent. Du côté anglais, les pertes s'élèvent à 977 hommes, dont près de 500 tués. Il s'agit d'une véritable catastrophe pour les forces britanniques. Les pertes françaises se limitent à 23 morts, soit trois officiers, deux soldats, trois miliciens, 15 Amérindiens, et à 16 blessés dont 12 Amérindiens.
Capitaine Jean-Daniel Dumas. Le capitaine Jean-Daniel Dumas (1721-1794) était l'officier des troupes de la Marine qui a dirigé les forces mixtes françaises, canadiennes et amérindiennes qui ont vaincu l'armée britanno-américaine du général Braddock lors de la bataille de Monongahela, le 9 juillet 1755. Après avoir rendu des services remarquables au Canada jusqu'en 1760, Dumas est devenu le gouverneur de Maurice. Cette île de l'océan Indien était connue sous le nom d'Isle de France jusqu'au début du 19e siècle, comme il est indiqué sur l'imprimé accompagnant un portrait de Dumas (vers 1780).
Du point de vue des officiers canadiens des troupes coloniales françaises, cette victoire fournissait la preuve indéniable que leur tactique pouvait avoir raison non seulement des miliciens de la Nouvelle-Angleterre, mais également d'un fort contingent de troupes régulières venues d'Europe. Pour la première fois, un modeste corps d'infanterie légère se déployant rapidement et se camouflant habilement démontrait qu'il pouvait mettre en échec une puissante armée en lui faisant subir des pertes irrémédiables, et ce, avec pour seules armes des fusils. Malheureusement pour la Nouvelle-France, les officiers métropolitains ne tirèrent pas profit de cette leçon de tactique fournie par les officiers coloniaux du Canada.
Mort du major-général Braddock lors de la Bataille de Monongahela, le 9 juillet 1755
La défaite du major-général Edward Braddock fut la concrétisation de la défaite des Britanniques à Monongahela. Puisqu'il était parfaitement conscient des difficultés que posait une bataille dans les forêts nord-américaines, Braddock a minutieusement préparé son armée avant son arrivée au fort Duquesne. Cependant, malgré toutes les précautions prises, lorsque ses hommes ont été piégés par les forces françaises, canadiennes et amérindiennes, les recrues à demi formées formant les rangs de ses deux régiments réguliers ont paniqué. Après la mort de Braddock, personne ne possédait l'expérience ni le talent nécessaires pour reprendre le contrôle, et l'armée a été dissoute. Les détails de l'uniforme illustré sur cette gravure du 19e siècle sont incorrects, mais la confusion et le chaos qui régnaient à l'époque sont bien exprimés.
L'échec du général Dieskau. Échec de la tentative de prendre le fort Edward
Entre-temps, le baron de Dieskau parvient en Nouvelle-France avec ses troupes. À part les 350 hommes pris sur le Lys, tous les bataillons français étaient finalement arrivés à destination. Le général Dieskau est responsable des choix tactiques mais, sur le plan stratégique, il reste tenu d'obéir aux ordres du gouverneur général Pierre de Rigaud de Vaudreuil. Or, l'objectif de ce dernier est avant tout d'attaquer le fort Oswego (que les Français appelaient Chouaguen) sur la rive sud du lac Ontario. Toutefois, il annule cette expédition en apprenant qu'une armée de miliciens américains de 3 000 hommes s'assemble au sud du lac Champlain sous le commandement du colonel William Johnson afin de s'emparer du fort Saint-Frédéric. Si cette armée parvenait à remonter le lac Champlain, puis le Richelieu, Montréal serait pour ainsi dire à sa merci.
Les bataillons de La Reine et de Languedoc, ainsi que des troupes de la Marine, des miliciens et des Amérindiens sont donc assemblés au fort Saint-Frédéric sou le commandement de Dieskau. Fort d'un corps de 1 500 hommes, le général décide de contourner l'armée ennemie assemblée au lac George et d'attaquer le fort Edward, situé plus au sud, afin de lui couper la retraite. Ce plan audacieux est malheureusement voué à l'échec. En effet, Dieskau se voit contraint d'y renoncer près du fort Edward, car les Agniers alliés aux Français refusent de prendre part au combat. Ils se déclarent prêts à défendre le Canada, mais pas à attaquer les Anglais sur leur territoire. En réalité, ils ne veulent pas se battre contre leurs frères agniers alliés aux Anglais. Dieskau décide alors de remonter vers le nord et d'attaquer le camp où se trouve Johnson avec une partie de son armée.
De son côté, ce dernier se trouve dans une position difficile, le mouvement de Dieskau ayant coupé ses communications avec Albany. Plus grave encore, son armée, se composant uniquement de miliciens de la Nouvelle-Angleterre enrôlés pour la durée de la campagne, ne compte pas de troupes régulières. Johnson envoie 1 000 hommes à la rencontre de Dieskau, qui leur tend une embuscade. Mais celle-ci est éventée par les Agniers alliés aux Français qui avertissent ceux du camp adverse. Les miliciens américains en sont quittes pour quelques pertes légères, et se réfugient dans le campement barricadé où se trouve le reste des troupes de Johnson, sur le site actuel de Lake George, dans l'État de New York.
Échec cuisant pour la stratégie européenne
Bien qu'il dispose de forces moindres, Dieskau refuse de prendre en considération les mises en garde des Canadiens et des Amérindiens et décide d'attaquer ce camp fortifié et doté d'artillerie par un assaut général en colonnes serrées, dans le plus pur style européen. Jugeant ce genre de combat ridicule, les miliciens canadiens se jettent à plat ventre, cherchant quelque abri pour riposter au tir ennemi. De leur côté, les soldats français, parvenus à une cinquantaine de mètres des abattis et visés à bout portant, hésitent à avancer. Dieskau est alors gravement blessé, pendant qu'il exhorte ses hommes au combat. Les Français se retirent peu après, d'autant plus que des renforts ennemis arrivent du sud. Abandonné sur le champ de bataille, Dieskau est capturé par les miliciens de Johnson.
Ce premier combat des forces métropolitaines françaises se solde donc par un fiasco. Au Canada, il s'agit d'un événement sans précédent : un général capturé et des troupes battues avec de lourdes pertes par les miliciens de la Nouvelle-Angleterre ! Pour se disculper, Dieskau attribua cet échec au fait que les Canadiens n'avaient pas marché en rang...
La tragédie acadienne. Nettoyage ethnique déclenché par l'avidité
Milicien acadien, 1755-1760. Ce ne sont pas tous les Acadiens qui ont été déportés en 1755. Certains d'entre eux se sont enfuis vers le territoire actuel du Nouveau-Brunswick et, de là, ont mené une bataille digne d'une guérilla dans les secteurs britanniques. Cette bataille fut telle que de nombreuses troupes britanniques et américaines furent nécessaires pour garder, avec un succès discutable, les frontières à l'ouest de la Nouvelle-Écosse. La capitulation de l'armée française en septembre 1760 n'a pas découragé les partisans acadiens qui ne voulaient pas se rendre aux Britanniques. Ce sont des officiers français qui ont finalement convaincu les Acadiens de déposer les armes et de respecter la capitulation.
L'année 1755, déjà riche en événements guerriers, devait aussi être celle d'une grande tragédie : la déportation des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. En 1713, par le traité d'Utrecht, la France avait cédé l'Acadie à l'Angleterre, et ce territoire était devenu colonie britannique sous le nom de Nouvelle-Écosse. Par la suite, quelques Acadiens avaient pris les armes contre les Britanniques, mais la majorité d'entre eux étaient restés neutres. Cependant, la présence de cette population prospère, catholique et française au sein d'une colonie anglaise soulevait bien des jalousies et des rancœurs, d'autant plus que les Acadiens, au nombre d'environ 9 000, occupaient les meilleures terres. Au nom de la « sécurité », on jugea finalement opportun de les remplacer par de loyaux sujets. Par conséquent, en juillet 1755, Charles Lawrence, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, décrète la déportation de la population acadienne. Au cours de cette opération, que l'on qualifierait maintenant de manœuvre de « purification ethnique », les forces armées jouèrent un rôle de premier plan.
Rassemblement des femmes et enfants acadiens en vue de la déportation, Grand Pré, Acadie, juillet 1755.Vient maintenant le temps de déporter les femmes et les enfants de Grand Pré, en Acadie. Les troupes arrivent pour les rassembler et les déporter au cours de l'automne de 1755. Historiquement, au Canada, on avait parfois recours aux soldats pour bannir des populations civiles innocentes de leurs maisons. La déportation des Acadiens est le premier exemple d'envergure de l'utilisation des soldats au Canada - des troupes britanniques et du Massachusetts dans ce cas-ci - pour entourer les civils. L'arrestation et l'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale sont le plus récent exemple.
Une partie des troupes régulières britanniques et les régiments du Massachusetts des lieutenants-colonels John Winslow et George Scott avaient été chargés de rassembler les Acadiens. C'est ainsi que la mise en scène utilisée par Winslow à Grand-Pré est entrée dans les annales de l'histoire. On demanda à tous les hommes de se rendre à l'église pour entendre la lecture d'un important décret. Pendant qu'ils écoutaient, horrifiés, l'ordre de déportation dicté par Winslow et ses officiers, les troupes encerclèrent l'église. Puis, les soldats allèrent cueillir les femmes et les enfants dans leurs fermes, qu'ils brûlèrent ensuite. Ce scénario se répéta à travers l'Acadie durant tout l'été. Bientôt, des milliers de civils des deux sexes et de tout âge furent rassemblés dans ce que nous appellerions aujourd'hui des « camps de concentration » pour y attendre les navires qui devaient les transporter au loin. Après plusieurs semaines de retard, les bateaux parurent enfin et, le 8 octobre, l'embarquement commença. Les militaires essayaient, dans une certaine mesure, de ne pas séparer les familles, mais ce n'était pas toujours faisable et l'on assista à des scènes déchirantes durant lesquelles des femmes en pleurs, retenues par les soldats sur la grève, regardaient leurs maris et leurs fils faire voile vers l'inconnu.
Échec de la politique britannique
Quelque 2 000 Acadiens parviennent à s'échapper vers le Canada tandis que les autres sont déportés dans les colonies anglaises. Toutefois, cette cruelle politique de dépossession et de déportation n'apporta pas les résultats escomptés. Les soldats du Massachusetts - était-ce par l'effet du remords ? - refusèrent les terres prospères qu'on leur offrait, de sorte que seule une minorité de ces nouveaux colons d'allégeance britannique se fixa en Acadie. D'autre part, le prétendu problème de sécurité invoqué pour justifier l'opération n'était pas résolu pour autant. Plusieurs Acadiens réfugiés dans les bois se livrèrent dès lors, avec l'aide des Amérindiens, à une guérilla implacable jusqu'à la fin de la guerre, ce qui obligea les Britanniques à maintenir de nombreuses garnisons dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse. On ne peut prétendre que cette entreprise purificatrice fût un accident de la politique britannique, car ces terribles scènes de déportation se répétèrent en 1758 à l'île Royale (île du Cap-Breton) et à l'île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard).
Peu de changement dans la stratégie
Grenadier, 60e (Royal American) Régiment de fantassins, 1757-1767. Le 60e (Royal American) Régiment de fantassins a été formé dans un effort pour créer des unités de l'armée britannique à partir des colonies américaines. Le successeur de ce régiment fait encore partie de l'armée britannique au 21e siècle, bien qu'il n'ait pas recruté en Amérique du Nord depuis des centaines d'années. Les grenadiers ont porté ce bonnet distinctif pointu jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un bonnet de fourrure en 1768. L'uniforme des officiers et tambours (mais pas celui des soldats ordinaires) du 60e Régiment était parementé de rubans. Il est à noter que les grenadiers transportaient un fusil, contrairement à la plupart des officiers d'infanterie.
Au début de l'année 1756, la situation militaire en Amérique du Nord est sensiblement la même qu'un an auparavant. Les Britanniques continuent de poursuivre les objectifs qu'ils n'ont pas atteint l'année précédente : occuper la vallée de l'Ohio, tout en s'emparant des forts Saint-Frédéric, sur le lac Champlain, et Niagara, sur le lac Ontario. C'est dans cette intention que les colonies de la Nouvelle-Angleterre mobilisent plusieurs milliers de miliciens et réclament un surplus de troupes en provenance de la métropole. Celle-ci dépêche les 35e et 42e régiments, et crée le 60e. Comptant quatre bataillons au lieu d'un seul comme la majorité des régiments, le 60e se compose en partie de recrues américaines, d'où son nom de « Royal American ». L'échec du général Braddock a cependant plongé l'état-major britannique dans le doute quant aux moyens à employer pour affaiblir la Nouvelle-France.
Les Français se ressaisissent assez rapidement de la perte du général Dieskau. Le gouverneur général Vaudreuil est conscient qu'il doit reconquérir l'estime des alliés amérindiens pour les armes françaises par un coup d'éclat, et ordonne un raid contre le fort Bull, non loin d'Oswego. Le 27 mars 1756, la place est prise d'assaut et détruite par un groupe de soldats, de miliciens et d'Amérindiens, sous les ordres du lieutenant Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, qui, par la même occasion, débusque et chasse un contingent américain venu secourir le fort. La tactique traditionnelle des Canadiens a de nouveau fait ses preuves, et les Amérindiens sont rassurés.
Prise d'Oswego par le général Montcalm
Louis-Joseph de Montcalm, Marquis de Montcalm (1712-1759). Le général et marquis de Montcalm a été envoyé en Nouvelle-France en 1756 pour remplacer le baron de Dieskau qui avait été capturé. Son passage dans la colonie a été marqué par des querelles avec les autorités locales. Il fut un brave soldat qui a remporté quelques victoires notables. Il a trouvé la mort peu de temps après avoir prématurément envoyé ses hommes sur les Plaines d'Abraham. Reproduction d'un portrait original conservé en France.
À Québec, le grand événement de l'année est l'arrivée, en mai, des deuxièmes bataillons des régiments de La Sarre et de Royal-Roussillon, ainsi que celle du remplaçant du baron de Dieskau, le général Louis-Joseph de Montcalm. Issu de la noblesse provençale et vétéran de nombreuses campagnes depuis 1733, le marquis de Montcalm est un homme vif et débordant d'énergie, mais il est toutefois doté d'un caractère colérique et irascible qui va compromettre les rapports entre officiers supérieurs et provoquer des tensions au sein de l'état-major.
Malgré ses réticences, le premier geste de Montcalm consiste à préparer une attaque contre Oswego, selon la volonté du gouverneur général Vaudreuil. Très bien défendu par trois forts généreusement pourvus en artillerie, l'endroit abrite une garnison de 1 800 hommes des 50e et 51e régiments de ligne et du régiment du New Jersey, l'un des meilleurs corps jusqu'alors levé par une colonie américaine. Arrivé à Oswego le 10 août à la tête de 3 000 hommes, et disposant d'une artillerie de siège, Montcalm fait bombarder le fort Ontario qui est rapidement évacué, et dont la garnison se réfugie dans les forts George et Oswego. À leur tour, ceux-ci essuient le bombardement intensif de l'artillerie française. Dans la matinée du 14 août, le commandant britannique, le colonel James Mercer, est décapité par un boulet et, une heure plus tard, la garnison capitule. Les Français s'emparent de 93 canons et mortiers, et de cinq drapeaux régimentaires. C'est une belle victoire qui démontre qu'un siège à l'européenne appuyé par un important support logistique peut venir à bout de places fortifiées occupant une position très avancée à l'intérieur du pays.
Tensions au sein de l'état-major français. Hostilité entre les officiers coloniaux et métropolitains
Louis-Antoine de Bougainville, compte de Bougainville (1729-1811). Le jeune officier Bougainville est venu au Canada à titre d'aide de camp sous la gouverne du général Montcalm et a rapidement gravi les échelons pour joindre les rangs des soldats sur le champ de bataille. Après la guerre, il a connu la gloire en tant qu'un des premiers explorateurs du Sud du Pacifique entre 1766 et 1769. Cette illustration nous le montre alors qu'il était plus vieux.
Dès l'automne de 1756, Montcalm, dans une lettre tenue secrète, se plaint auprès du ministre de la Guerre, prétendant que le gouverneur général Vaudreuil et ses officiers coloniaux ne connaissent rien à la guerre. Vaudreuil, de son côté, se fait l'écho auprès du ministre de la Marine du mépris qu'affichent les officiers français envers les Canadiens et de leur façon cavalière de traiter les officiers de la colonie. Cette animosité ne tarde pas à se propager et on voit bientôt se dresser deux camps au sein de l'état-major celui des officiers métropolitains regroupés autour de Montcalm face à celui des officiers canadiens avec, à leur tête, Vaudreuil.
Préjudices causés par la corruption
Soldat portant le drapeau régimentaire, Régiment de Béarn, vers 1757-1760. Lorsque le 2e bataillon du Régiment français de Béarn a été envoyé en Nouvelle-France en 1755, il portait ce drapeau régimentaire. Remarquer la cravate blanche accrochée au bout du mât. Cette cravate et la croix blanche étaient des éléments communs de toutes les unités de l'armée française à l'époque. La couleur isabelle (brun jaunâtre) et les barres horizontales rouges sur le drapeau représentaient le Régiment de Béarn. Cette gravure contemporaine illustre l'uniforme du régiment européen avec un col, des manchettes et un gilet rouges. De 1755 à 1757, les soldats portaient une version canadienne spéciale de l'uniforme avec des manchettes et un gilet bleus, mais l'uniforme illustré a été porté en Nouvelle-France par le deuxième bataillon, de 1757 à 1760.
La gestion malhonnête des finances canadiennes par l'intendant François Bigot ne manque pas d'accentuer ces tensions. Certaines denrées venant à manquer, l'inflation devient galopante. L'intendant et ses acolytes multiplient l'octroi de crédits, dont une partie est décernée aux officiers canadiens chargés de l'approvisionnement des troupes. Tandis que la spéculation permet à quelques-uns d'amasser des fortunes, les autres voient se réduire presque à néant la valeur de leurs appointements. Si plusieurs peuvent compter sur des alliances familiales et sur les revenus de leurs seigneuries pour pallier le manque, tel n'est pas le cas des officiers des régiments venus de France. Ceux-ci se trouvent considérablement appauvris par l'inflation, qui rogne leur solde. Les rumeurs selon lesquelles certains officiers canadiens s'enrichissent en toute impunité ne font qu'accroître leur aigreur. À l'instar de leur général, ces hommes affichent un profond mépris pour leurs collègues canadiens, considérant qu'ils ne sont pas de véritables militaires et qu'ils se battent « comme des Sauvages ». De leur côté, les officiers canadiens font en sorte de limiter leurs relations avec eux. Cette attitude touche juste, puisque l'un des officiers métropolitains note qu'il a l'impression d'être perçu comme un ennemi au Canada.
Les sous-officiers et soldats, tant coloniaux que métropolitains, sont mieux protégés contre l'inflation, étant logés, nourris et vêtus aux frais du roi. À mesure que la guerre se prolonge et que les denrées alimentaires se font rares, on en vient à remplacer la viande de bœuf par celle de cheval, puis à réduire les rations.
Soldat portant le drapeau régimentaire, Régiment de Guyane, vers 1757-1760
Le deuxième bataillon du Régiment français de Guyane avait ce drapeau régimentaire (ou drapeau d'ordonnance) lors de son départ pour la Nouvelle-France en 1755. Remarquer la cravate blanche accrochée au bout du mât. Cette cravate et la croix blanche étaient des éléments communs de toutes les unités de l'armée française à l'époque. La couleur isabelle (brun jaunâtre) et la couleur vert-gris représentaient le Régiment de Guyane. Cette gravure contemporaine illustre l'uniforme du régiment européen, porté en Nouvelle-France par le deuxième bataillon, de 1757 à 1760.
Malgré les tensions qui les opposent, tous les officiers s'accordent néanmoins sur un point : le besoin de renforts pour défendre la Nouvelle-France. Au Canada même, Vaudreuil réorganise la répartition des troupes afin d'augmenter les forces mises à la disposition de Montcalm. En mai, l'artillerie s'enrichit d'une compagnie d'ouvriers recrutée parmi les Canadiens. En juillet, un bataillon de 500 hommes tiré des Compagnies franches de la Marine est mis sur pied pour épauler les régiments métropolitains. On le surnomme bientôt le «Régiment de la Marine». Néanmoins, la nécessité de faire venir d'autres troupes de France se fait sentir. Durant l'été, les 2e et 3e bataillons du régiment de Berry débarquent à Québec, ainsi que quelques centaines de recrues, mais c'est encore insuffisant. On organise donc sept « brigades » de miliciens canadiens de 150 hommes chacune, avec 16 soldats réguliers des Compagnies franches de la Marine pour leur servir d'instructeurs.
La stratégie d'invasion britannique. Nouveau Premier ministre, nouvelle stratégie
Carte de la conquête du Canada, 1758-1760. Cette carte illustre les territoires conquis par les Britanniques et les Américains en Nouvelle-France, entre 1758 et 1760.
En réalité, c'est en Angleterre, et non en France ou à Québec, que se décide le sort de la Nouvelle-France. En décembre 1756, le nouveau gouvernement dirigé par William Pitt modifie profondément le déroulement de la guerre. Le premier ministre britannique est un homme talentueux, énergique et visionnaire, persuadé que la richesse et la grandeur de sa nation résident non pas en Europe, mais outre-mer. Par conséquent, il convainc le roi George II de faire porter l'effort principal de la guerre en Amérique du Nord où, contre toute logique, quelques dizaines de milliers de colons et de soldats français tiennent en respect plus de un million d'habitants anglais recroquevillés le long du littoral atlantique. Afin de venir à bout de la Nouvelle-France, une seule solution paraît possible : celle d'une invasion à grande échelle.
Certes, ce n'est pas la première tentative d'invasion du Canada mais, cette fois, la stratégie est élaborée, les moyens mis en œuvre considérables et la volonté plus ferme. Le général en chef des forces anglo-américaines, John Campbell, comte de Loudoun, est un excellent officier qui a été l'aide de camp du roi lui-même. Fin diplomate, il s'emploie d'abord à harmoniser les relations souvent tumultueuses entre officiers britanniques et américains, car, en Nouvelle-Angleterre comme en Nouvelle-France, les officiers métropolitains ont tendance à mépriser leurs homologues coloniaux. Contrairement à Montcalm, Loudoun comprend que cette attitude ne peut que compromettre le succès. Il reconnaît également la valeur des tactiques utilisées par les Canadiens, et, afin que l'armée britannique puisse se les approprier, il favorise la levée d'un corps d'infanterie légère et de Rangers.
D'abord Louisbourg, puis Québec et Montréal
Stratège de talent, Loudoun élabore un plan grandiose pour envahir la Nouvelle-France qui reçoit l'approbation du nouveau gouvernement de William Pitt. Il s'agit d'abord de prendre Québec, porte de la colonie vers l'Europe, puis Montréal, principale base militaire de la Nouvelle-France et clé de l'intérieur du continent.
Le premier objectif doit s'accomplir à partir du fleuve Saint-Laurent, et ce, en mettant à contribution l'efficacité redoutable de la Royal Navy. Toutefois, pour y parvenir, il faut d'emblée réduire la forteresse de Louisbourg. Les Britanniques ne peuvent en effet laisser une base navale de cette importance à la portée de la marine française. Cette opération préliminaire exige le rassemblement à Halifax d'une armée composée de troupes régulières en vue de son embarquement sur une puissante flotte. On prévoit d'assiéger d'abord Louisbourg, puis Québec.
Le second objectif, soit la prise de Montréal, nécessite la création de deux armées disposant d'un noyau de troupes régulières britanniques secondées de troupes provinciales américaines. La première, la plus importante, se regroupera à Albany pour naviguer sur le lac Champlain et descendre le Richelieu. La seconde se rassemblera en Virginie et en Pennsylvanie afin de remonter l'Ohio puis les lacs Érié et Ontario avant d'emprunter le fleuve Saint-Laurent. La dernière phase de l'opération n'aura lieu qu'après la chute de Québec, afin que les trois armées anglo-américaines puissent se rejoindre devant Montréal. Ce plan ne pouvait se réaliser dans la hâte. Malgré une bonne stratégie et l'importance des forces mobilisées, l'année 1757 fut défavorable aux forces des Anglo-Américains.
Les Français prennent le fort William-Henry. Une manœuvre audacieuse
De leur côté, les Français ne restent pas inactifs. Dès la fin de la campagne de 1756, le gouverneur général Vaudreuil s'était fixé comme objectif de s'emparer du fort William-Henry (fort George pour les Français), sur le lac George. Cette prise aurait pour but d'empêcher une attaque contre les forts Carillon (Ticonderoga pour les Anglais) et Saint-Frédéric.
En août 1757, Montcalm quitte Montréal pour assiéger William-Henry avec un puissant corps de 6 000 soldats et miliciens accompagnés de 1 600 Amérindiens, afin de mettre les Britanniques sur la défensive. Le 6 août, après seulement trois jours de bombardements, le lieutenant-colonel George Monro, commandant de la place, capitule. Montcalm accorde les honneurs de la guerre à la garnison de 2 500 hommes, qui pourra se retirer, avec drapeaux, fusils et bagages, contre la promesse de ne pas combattre pendant 18 mois. Mais c'est sans compter avec les alliés amérindiens ! Frustrés de n'avoir pu faire main basse sur un butin et de ne pouvoir capturer de prisonniers, ceux-ci attaquent les soldats anglo-américains au moment où ils se retirent, en tuant plusieurs et ramenant environ 600 captifs. Les officiers français, dont Montcalm, interviennent et parviennent à libérer quelque 400 hommes. Par la suite, Vaudreuil en rachètera un grand nombre. Mais certains seront tués, d'autres atrocement suppliciés et quelques-uns, même, dévorés. Scandalisé, l'état-major britannique refuse de reconnaître les conditions de la capitulation et décide de ne plus accorder, à l'avenir, les honneurs de la guerre aux troupes françaises. La reddition du fort William-Henry porte néanmoins un coup dur aux Britanniques, empêchant toute opération de leur part au sud de Montréal pour le restant de l'année.
L’offensive contre Louisbourg est retardée
À Halifax, les préparatifs du siège de Louisbourg sont déjà compromis par le mauvais temps quand Loudoun apprend, au début d'août, qu'une flotte française s'y trouve depuis peu. N'étant plus assuré désormais de sa supériorité navale et jugeant la saison trop avancée, il décide d'annuler toute l'opération. En Angleterre, l'opinion publique montre des signes d'impatience et Loudoun devient le bouc émissaire des revers subis durant l'année. William Pitt le rappelle alors pour des raisons beaucoup moins militaires que politiques.
À la fin de 1757, l'étendue de la Nouvelle-France reste donc inchangée, même si la situation militaire de la France décline considérablement en Europe, ce qui l'oblige à mobiliser son effort de guerre de ce côté de l'Atlantique, à l'inverse de l'Angleterre qui, elle, concentre le sien principalement en Amérique du Nord.
Soldat portant le drapeau régimentaire, Régiment de Cambis, vers 1758
L'année 1758 voit donc les Britanniques intensifier leurs préparatifs de campagne. Le major général James Abercromby succède à Loudoun à titre de commandant en chef des troupes anglo-américaines, mais on maintient la stratégie élaborée par ce dernier pour conquérir la Nouvelle-France. Louisbourg sera attaquée par le général Jeffery Amherst et la vallée de l'Ohio par le général John Forbes, pendant qu'Abercromby éliminera les forts français sur le lac Champlain. Les 15e, 28e, 58e et 62e régiments d'infanterie de ligne viennent se joindre à l'armée déjà en place. De plus, un régiment d'infanterie légère, le 80e, est levé, portant l'armée régulière britannique en Amérique du Nord à environ 23 000 hommes. De son côté, la France envoie les 2e bataillons des régiments de Cambis et des Volontaires-Étrangers à Louisbourg, mais aucun effectif pour Montcalm, si bien qu'on ne compte que quelque 7 000 soldats français pour défendre le Canada et l'île Royale.
Les Britanniques assiègent Louisbourg
Modèle de la forteresse de Louisbourg, 1758. Cette représentation de Louisbourg montre la forteresse telle qu'elle était juste avant le siège par les forces britanniques, en 1758.
Le 2 juin, une imposante flotte britannique de plus de 150 voiles, transportant 27 000 hommes dont 13 000 soldats de métier, arrive au large de Louisbourg. Malgré les renforts de France, les forces dont dispose le gouverneur Augustin de Boschenry de Drucour sont quatre fois moins nombreuses que celles des assaillants, même en comptant marins et miliciens. La garnison française se sait perdue, mais elle est résolue à tenir jusqu'au bout. Les Britanniques débarquent le 8 juin, et ont tôt fait de creuser des tranchées et d'encercler la forteresse de leur artillerie, de sorte qu'à partir du 19 juin, ils bombardent méthodiquement la ville. Les défenseurs ripostent avec détermination. L'épouse du gouverneur en personne n'hésite pas à monter tous les jours sur les remparts pour tirer trois coups de canon, ce qui encourage grandement la garnison, et lui vaut l'admiration de l'ennemi.
Après cinq semaines de bombardement intensif, les fortifications sont percées de nombreuses brèches, l'artillerie se trouve presque réduite au silence et les quelques navires de guerre français ancrés au port sont coulés ou brûlés; la ville n'est plus que ruines, et la population civile se terre dans des abris. Le 26 juillet, le gouverneur Drucour s'enquiert des conditions d'une reddition. Les Britanniques refusent d'accorder les honneurs de la guerre aux troupes françaises, malgré la vaillance dont elles ont fait preuve. Elles sont donc contraintes de remettre armes et drapeaux. Outrés, la plupart des officiers insistent pour poursuivre la lutte. Le commissaire-ordonnateur, Jacques Prévost de La Croix, plaide alors en faveur de la sécurité des civils, faisant valoir qu'un assaut général pourrait dégénérer en scènes de vols, de meurtres et de viols. Son point de vue est approuvé et la capitulation est signée le jour même.
À l'annonce de cette nouvelle, les soldats du régiment de Cambis brisent leurs fusils et brûlent leurs drapeaux pour ne pas avoir à les rendre, mais les autres corps respectent les termes de la capitulation. La garnison est envoyée en Europe et toute la population française des îles Royale et Saint-Jean est déportée durant l'automne. La chute de la « sentinelle du golfe Saint-Laurent » ouvrait la voie vers la capitale de la Nouvelle-France. Mais la longue et valeureuse défense de la garnison de Louisbourg obligeaient les Britanniques à reporter à l'année suivante le siège de Québec.
La victoire française de Ticonderoga.Une attaque qui coûte cher
Photo aérienne du fort Carillon / fort Ticonderoga en 1927. Le fort Carillon, ou Ticonderoga comme l'appelaient les Britanniques, a été construit par les Français à partir de 1755. La victoire du général français Montcalm, en juillet 1758, sur l'armée britanno-américaine du général britannique Abercomby, a eu lieu près du fort. Malgré cette victoire, le fort a dû être laissé aux mains de la surprenante armée du général Amherst au cours de l'été de 1759. Une partie des révolutionnaires américains dirigés par Ethan Allen se sont emparés du fort en 1775. Cette photo aérienne prise en 1927 montres les fondations originales. Le site historique est maintenant une attraction touristique populaire.
Au moment où Amherst assiège Louisbourg, le général Abercromby rassemble ses troupes au sud du lac Champlain. Il s'agit de la plus grande armée jamais vue en Amérique du Nord, composée d'environ 15 000 hommes, dont pas moins de 6 000 originaires de l'infanterie régulière britannique. En juillet, cette armée s'embarque dans quelque 1 500 barges et chaloupes et remonte le lac George jusqu'aux environs du fort Carillon.
Du côté français, Montcalm choisit de poster ses huit bataillons métropolitains sur une colline proche du fort Carillon, à l'abri d'une ligne d'abattis faite de troncs d'arbres. Les troupes coloniales, les miliciens et les Amérindiens alliés se dispersent dans les bois adjacents. Abercromby aurait pu, certes, contourner cette position et installer son artillerie sur les collines avoisinantes, mais cette manœuvre aurait nécessité plusieurs semaines. Or, les Anglo-Américains veulent une victoire éclatante et rapide. Informé par le génie que les abattis français peuvent être pris d'assaut, Abercromby opte pour une attaque générale de front prévue pour le 8 juillet. Pour leur part, les quelque 3 000 soldats français retranchés ont planté les drapeaux de leurs régiments sur les abattis et se tiennent prêts.
Général Montcalm lors de la Bataille de Carillon, 8 juillet 1758. Cette image de la bataille de Carillon, datant du début du 20e siècle, provient d'un texte produit par une école primaire de Québec que plusieurs générations d'enfants ont appris. Elle illustre le général Montcalm encourageant ses troupes. Les nuages de fumée sont assez fidèles, même si d'autres détails, notamment en rapport avec le costume et le terrain, ne le sont pas. Une épaisse fumée envahissait les environs lorsque les soldats utilisaient de la poudre à canon. Aucun canon n'a été utilisé à partir des lignes françaises d'abatis pendant la bataille. Des canons ont par contre été installés sur ces lignes pendant les jours qui ont suivi.
À midi, ils distinguent enfin trois colonnes composées de plusieurs milliers d'hommes remontant lentement la colline et se dirigeant vers eux, mais ils n'ouvrent le feu que lorsque les Britanniques arrivent à proximité de leurs retranchements : une première salve, terrible, décime les rangs de l'ennemi. Les troupes britanniques et américaines ont beau lancé assaut sur assaut, elles n'obtiennent pas davantage de succès malgré des prodiges de valeur au combat. À la fin de la journée, environ 2 000 morts et blessés jonchent la colline, et les Français résistent toujours, malgré 527 morts et blessés dans leurs rangs. Abercromby doit finalement battre en retraite, l'attaque britannique ayant littéralement tourner au désastre.
Grôgne dans les rangs français
Dans le camp français, cette victoire quasi inespérée déclenche le délire. Montcalm dépêche la nouvelle de son triomphe en France, en octroyant le succès de l'opération aux officiers et soldats métropolitains. Une révolte a failli « éclater » au sein des troupes coloniales « lorsqu'elles ont constaté que M. de Montcalm, au lieu de faire valoir leurs services, les a attribués aux troupes de terre », rapporte pour sa part le gouverneur général Vaudreuil. Certes, la participation des troupes coloniales et des milices canadiennes à la bataille avait été relativement modeste, mais ce genre de discours ne pouvait qu'envenimer les relations déjà très tendues entre coloniaux et métropolitains. Il n'en restait pas moins que l'invasion britannique du Canada par le sud avait été repoussée, pour le moment !
L'invasion de la vallée de l'Ohio. Une manœuvre délibérée
Soldat, 60e (Royal American) Régiment de fantassins, 1758-1767. Le 60e Régiment de fantassins était différent des autres régiments de l'infanterie britannique parce qu'il comptait quatre bataillons au lieu d'un seul. De plus, ses rangs étaient principalement formés d'étrangers. Il devait initialement recruter des membres dans les 13 colonies américaines, mais les volontaires se faisaient rares. De nombreux Suisses, Allemands et autres étrangers ont donc été recrutés. Les quatre bataillons ont participé à toutes les campagnes menées au Canada entre 1756 et 1764. Contrairement aux manteaux des membres des autres régiments britanniques, ceux des soldats et des caporaux de ce régiment n'ont pas été enrubannés avant 1768.
Pendant ce temps, une troisième armée anglo-américaine, sous le commandement du général John Forbes, approche lentement du fort Duquesne, dans la vallée de l'Ohio. Forbes dispose de 400 hommes du 60e régiment, de 1 400 hommes du 77e régiment de Highlanders écossais et d'environ 5 000 miliciens américains. Pour éviter de subir le même sort que Braddock trois ans auparavant, Forbes fait construire une nouvelle route de ravitaillement, jalonnée de fortifications et de dépôts d'approvisionnement. Son armée n'avance donc qu'à pas de tortue, et par petites étapes. À la fin d'août, l'avant-garde anglo-américaine atteint Loyalhanna, où elle érige le fort Ligonier ainsi qu'un grand camp fortifié, à 70 km seulement du fort Duquesne.
Attaque contre-attaque
Persuadé que le gros de l'armée anglo-américaine va se déplacer par l'ancienne route de Braddock, le commandant français sur l'Ohio, François-Marie Le Marchand de Lignery, est d'abord dérouté par la lenteur de Forbes. Mais, lorsqu'il découvre que ce dernier construit une nouvelle voie, Lignery adopte aussitôt une tactique de harcèlement pour ralentir sa progression. Bientôt, les soldats anglo-américains qui s'éloignent de leurs camps tombent aux mains des Amérindiens alliés se tenant constamment à l'affût à l'orée des bois. Afin de redonner courage aux soldats, que la terreur gagne, on organise un raid sur le fort Duquesne. Le 14 septembre, le major James Grant, avec une partie de son 77e régiment de Highlanders et un groupe de miliciens américains, soit environ 800 hommes, arrive à proximité du fort et décide d'attendre la nuit pour attaquer. Mais Lignery et son second, le capitaine Aubry, sont au rendez-vous... Grant et ses hommes se retrouvent rapidement cernés par quelque 500 soldats des Compagnies franches de la Marine, des miliciens canadiens et des Amérindiens « faisant des cris de Sauvages ». Le combat est qualifié de « vif et opiniâtre ». Les Écossais sont presque anéantis, ayant perdu plus de 300 hommes sur le terrain, et une centaine sont faits prisonniers, dont le major Grant lui-même, sans compter ceux qui prennent la fuite. De leur côté, les Français n'ont à déplorer que 16 morts et blessés.
Le 12 octobre, fort de ce succès, le capitaine Aubry, à la tête de 450 soldats et miliciens et d'une centaine d'Amérindiens, organise un raid contre le fort Ligonier. Contraints de se réfugier dans le fort, les Britanniques et les Américains, impuissants, assistent pendant deux jours à la destruction et au pillage de leur camp. Un mois plus tard, un autre raid effectué par une trentaine de miliciens canadiens et environ 140 Amérindiens provoque une telle confusion que des régiments anglo-américains s'affrontent entre eux dans la bataille, croyant avoir affaire à l'ennemi !
Pour la Nouvelle-France, le vent tourne
Fort Frontenac en 1758. Le fort Frontenac en 1758, maintenant Kingston, en Ontario. Fondé en 1673, ce fort a également été appelé Cataraqui (différentes graphies possibles), mais a par la suite conservé le nom de son fondateur, le gouverneur général, le conte Louis de Buade de Frontenac et de Palluau. Ce fut le plus important fort français aux abords du lac Ontario jusqu'à la construction du fort Niagara dans les années 1720. Le fort Frontenac a été pris par une importante force sous la gouverne du lieutenant-colonel Bradstreet en 1758 pour ensuite être abandonné. Le site a aussi servi à des fins militaires par les armées britanniques et canadiennes. Dans la partie supérieure gauche de ce croquis, on aperçoit les batteries britanno-américaines mises en place pendant l'attaque de 1758.
Ces succès des Français ne peuvent néanmoins compenser la grande faiblesse de leurs moyens. Forbes, de plus en plus malade - il est maintenant transporté en litière -, l'a bien compris. Ses troupes sont certes inaptes à la guerre de raid, mais, par leur nombre et la puissance de leur artillerie, elles parviendraient inévitablement à s'emparer du fort Duquesne. De plus en plus abandonné par les Amérindiens qui sentent le vent tourner, Lignery en a tout autant conscience. Le 26 novembre, alors que l'armée de Forbes n'est plus qu'à quelques kilomètres, il envoie sa garnison vers les petits forts Machault et Massiac, et fait sauter le fort Duquesne. Sur le même emplacement, les Anglo-Américains construisent un autre fort, qu'ils nomment Pittsburgh, lieu appelé à devenir une importante ville de la Pennsylvanie.
Officier, Régiment royal de l'Artillerie, 1755-1760. L'artillerie britannique a été déployée en force avec les armées qui envahissaient la Nouvelle-France. Elle a joué un rôle particulièrement important pendant les sièges de Louisbourg et de Québec. En 1750, des rubans (dorés pour les officiers et jaunes pour les hommes enrôlés) ont été ajoutés à l'uniforme. Le hausse-col (une plaque métallique servant à protéger le cou) que l'on aperçoit autour du cou de cet officier indique qu'il est en service. Cet uniforme a été porté de 1755 à 1760 - une bande de couleur cramoisie était brodée sur l'épaule des officiers britanniques.
La prise du fort Frontenac (aujourd'hui Kingston, en Ontario) par le lieutenant-colonel John Bradstreet constitue un autre revers français. Ses 3 000 hommes, presque tous des miliciens des colonies américaines, traversent le lac Ontario en barques, puis donnent l'assaut. Les 110 hommes de la garnison résistent trois jours durant avant de se rendre, le 28 août. Bradstreet se retira après avoir incendié et démoli le fort. À court terme, les conséquences stratégiques de la destruction du fort Frontenac n'étaient pas graves, mais, pour la première fois, les communications françaises avec Niagara, Detroit et les forts de l'Ohio se trouvaient sérieusement menacées.
Fort Frontenac en 1758. Dans le coin supérieur gauche se trouvent les tranchées britanniques construites lors du court siège du fort Frontenac, en 1758. Une partie des fondations du fort sont encore en place à Kingston (Ontario).
L'année 1758 s'achevait donc sur d'importants points marqués par les Britanniques malgré la victoire française de Carillon, ils avaient pris une partie de la vallée de l'Ohio et, surtout, la forteresse de Louisbourg, ouvrant ainsi la voie vers Québec. Waudreuil et Montcalm en sont bien conscients, et, malgré leurs différends, ils s'entendent pour supplier les autorités françaises d'envoyer d'importants renforts, le sort de la Nouvelle-France étant plus que jamais en jeu. Pour plaider la cause de la colonie, ils dépêchent à Versailles Louis-Antoine de Bougainville. Ce jeune et brillant officier de l'état-major de Montcalm, destiné à devenir un jour l'un des grands explorateurs du Pacifique, fait tout son possible, mais la situation des armées et des flottes françaises en Europe est au plus bas. Le ministre de la Marine, Berryer, lui répond même sèchement : « Quand le feu est à la maison, on ne s'occupe pas des écuries.
Changement de tactique
Depuis le début de la guerre, les armées anglo-américaines ne cessent d'augmenter. En 1755, on compte quelque 11 000 soldats britanniques et miliciens américains sous les armes, nombre qui passe à 44 000 en 1758, auquel viennent s'ajouter les milliers de marins et d'Amérindiens alliés qui participent à l'effort de guerre. Au total, le nombre d'individus mobilisés - entre 60 000 et 70 000 - représente à peu près l'équivalent de la population entière de la Nouvelle-France. Cette supériorité numérique écrasante permet aux Britanniques d'utiliser les stratégies européennes, la guérilla ne pouvant suffire à tenir indéfiniment en échec des armées aussi nombreuses.
Cependant, et contrairement aux officiers métropolitains français présents au Canada, plusieurs membres de l'état-major britannique comprennent l'importance de ces tactiques. Ils pensent même, avec raison, qu'elles peuvent être combinées avantageusement à la stratégie européenne classique. Dès 1756, le général Loudoun recrute des Rangers américains pour servir d'éclaireurs à l'armée régulière. En 1758, c'est tout un régiment régulier d'infanterie légère, le 80e, qui est levé par le lieutenant-colonel Thomas Gage. Les hommes qui en font partie sont armés de fusils légers, coiffés de casquettes au lieu des tricornes traditionnels qui s'accrochent aux branches, et portent des habits à basques courtes qui gênent moins les mouvements. Mais le plus étonnant est la couleur de leur uniforme « brun foncé, sans galons, doublé de brun foncé, avec des boutons noirs » pour mieux se camoufler, au lieu du sacro-saint habit rouge rehaussé de couleurs vives, de galons multicolores et de boutons luisant au soleil. Ces soldats sont de bons éclaireurs, entraînés à se dissimuler et à se déplacer rapidement. Bref, ils sont rompus aux tactiques de l'infanterie dite « légère », par opposition aux méthodes rigides et aux manœuvres en rang de l'infanterie dite « de ligne ».
Toutes ces innovations introduites dans l'armée britannique s'inspirent des tactiques pratiquées depuis la fin du XVIIe siècle par les Canadiens. Bientôt, une des dix compagnies que compte chaque régiment britannique d'infanterie de ligne en Amérique du Nord se transforme en « compagnie légère », dont les hommes portent des habits rouges coupés court, sans galons, et des casques en feutre faits de vieux tricornes. Cependant, les corps britanniques d'infanterie légère et les Rangers ne purent jamais égaler tout à fait les Français et les Amérindiens dans ce type de combat. C'était néanmoins un net progrès, et ces troupes remportèrent d'ailleurs de nombreux succès. Ces modifications ne passèrent pas inaperçues chez les Amérindiens - les véritables maîtres de la forêt -, qui jugèrent alors que les Anglo-Américains « commençaient à apprendre l'art de la guerre.
Mobilisation générale au Canada
Louisbourg tombé, le fort Frontenac détruit, le fort Duquesne remplacé par le fort Pittsburgh. Au début de 1759, Vaudreuil et Montcalm sont convaincus de l'imminence d'une attaque massive sur tous les fronts, convergeant simultanément sur Québec et Montréal. Or, ils ne disposent plus que de 4 600 soldats de métier, tant des régiments métropolitains que des troupes coloniales, et ne peuvent compter sur aucun renfort. En 1757, les Compagnies franches de la Marine avaient été portées à 40 compagnies totalisant officiellement 2 600 soldats ; au début de 1759, ce nombre a diminué de plus de la moitié. L'unique source de recrues réside dans les miliciens canadiens. En mai 1759, environ 600 d'entre eux sont conscrits et incorporés dans les bataillons. Des centaines d'autres sont désignés pour aller au lac Champlain et dans l'Ouest. Cependant, les autorités n'osent incorporer d'importants effectifs de miliciens parmi les troupes. En effet, depuis deux ans, le Canada fait face à une sérieuse pénurie de blé et de viande et, pour éviter la famine, les Canadiens doivent se consacrer aux semences et aux récoltes. Néanmoins, ces hommes se tiennent prêts à rejoindre l'armée à tout moment en cas d'urgence.
En mai 1759, en prévision d'une campagne qui sera conduite « à l'européenne », on met sur pied un nouveau type de corps à Québec : le « Corps de cavalerie », formé de 200 volontaires canadiens et de cinq officiers français. Ces cavaliers portent un uniforme bleu avec collet et parements rouges. Ils rendent d'excellents services, pourchassant les patrouilles ennemies ou, encore, servant d'éclaireurs ou d'estafettes. Il s'agit là du premier corps à cheval constitué au Canada et, de ce fait, il est considéré comme l'ancêtre des nombreuses unités de cavalerie des Forces armées canadiennes.
Le siège de Québec. Maigres ressources pour les Français, forte poussée britannique
Quartiers généraux de Montcalm à Beauport. Cet édifice situé dans la petite communauté de Beauport a servi de quartier général au marquis de Montcalm pendant le siège de Québec. Beauport est situé sur la côte Nord du fleuve Saint-Laurent, à l'est des murs de la ville de Québec.
Vice-amiral Charles Saunders. Le vice-amiral Charles Saunders (1715-1775 environ) qui a commandé la flotte britannique pendant le siège de Québec en 1759.
Échec d'une offensive à la chute Montmorency
Incapables de défendre à la fois les deux rives du Saint-Laurent, les Français concentrent leurs forces sur la rive nord. La rive sud et l'île d'Orléans sont dès lors investies par les troupes britanniques, qui installent leurs gros canons d'artillerie de siège à la pointe de Lévy pour tirer sur Québec.
Par ailleurs, Wolfe sait pertinemment qu'il ne pourra prendre la ville, forteresse naturelle bien consolidée par de nombreuses fortifications, à l'aide de sa seule artillerie : il lui faut donc pratiquer une brèche à travers les lignes françaises. Malgré ses escarpements, la côte de Beauport lui paraît bientôt l'endroit le plus approprié à la conduite de cette manœuvre. Il décide donc de lancer une attaque tout près des chutes Montmorency. Le 31 juillet, une nuée de chaloupes de débarquement, portant des centaines de soldats d'élite, se dirige vers la plage. Après avoir mis pied à terre, cette troupe ne rencontre que très peu de résistance et Wolfe ordonne d'attaquer immédiatement les retranchements situés sur les hauteurs. Mais cette erreur lui coûte cher. Au lieu de reformer leurs rangs, les grenadiers, emportés par leur élan d'enthousiasme, commencent à monter l'escarpement dans le plus grand désordre et deviennent aussitôt une cible idéale pour le feu nourri des soldats français, des miliciens et des Amérindiens, bien abrités derrière leurs retranchements. L'assaut tourne au désastre. Ayant perdu quelque 200 soldats dans cette opération ratée, Wolfe ordonne la retraite.
Les Britanniques piétinent
Ce revers sème l'inquiétude dans le camp des assiégeants britanniques, frustrés. Au fil des semaines, ils voient l'échec se préciser, car il leur faudrait lever le siège au plus tard au mois d'octobre pour éviter l'hiver. Ils continuent néanmoins à bombarder Québec, surtout dans le but d'endommager sérieusement les fortifications, demeurées relativement intactes. Exaspéré, Wolfe commet alors un acte peu glorieux, qui rappelle les terribles répressions auxquelles il s'était livré en Écosse, treize ans auparavant. Il envoie des colonnes de soldats dévaster les campagnes canadiennes. À la fin du mois d'août, depuis Kamouraska jusqu'à Lévy, ceux-ci pillent et incendient approximativement 1 100 maisons, n'épargnant que les églises. Mais toutes ces exactions ne changent rien au fait que le siège de Québec piétine lamentablement.
La bataille des Plaines d’Abraham. Le coup de dé de Wolfe
Major-général James Wolfe. Voici un portrait du major-général James Wolfe portant l'uniforme rouge qui était habituellement de mise pendant le siège de Québec et probablement aussi celui de Louisbourg. Cet uniforme rouge a été conçu à l'époque du duc de Marlborough et servait de tenue de campagne optionnelle pour les officiers. La version originale de ce portrait de 1766 est un croquis fait par le capitaine Hervey Smyth - l'aide de camp de Wolfe pendant le siège. Le ruban noir que Wolfe porte au bras est un emblème de deuil en souvenir de son père, décédé en mars 1759.
Le temps presse, et, en septembre, les généraux de l'état-major de Wolfe lui proposent un plan de la dernière chance : il s'agit de tenter un débarquement de nuit à l'ouest de la ville et de gravir la falaise pour prendre position sur les hauteurs afin de livrer bataille aux Français. Le succès de l'entreprise reposerait uniquement sur l'effet de surprise.
Le risque est grand, bien sûr, mais Wolfe aime le danger, et il accepte. Durant la nuit du 13 septembre, la chance lui sourit enfin. Ses hommes parviennent à déjouer la vigilance des sentinelles françaises. Au matin, environ 4 500 soldats britanniques, équipés de quelques canons de campagne, forment leurs rangs sur les plaines d'Abraham, avec Wolfe à leur tête. N'ayant commis aucune erreur tactique, le jeune général anglais se prépare à l'affrontement en toute sérénité.
Canonnier, Artillerie royale, 1751-1764. L'artilleur britannique porte le manteau bleu du Régiment royal de l'Artillerie. Les canonniers de la plupart des armées européennes portaient des vêtements foncés pour camoufler la saleté et les souillures causées par les canons dont l'agent propulseur était la poudre à canon. Les rubans jaunes ont été ajoutés à l'uniforme en 1750 et cet uniforme, tel qu'il est représenté, a été porté de 1751 à 1764.
Carte du siège de Québec, 1759. Ce plan de 1810 du siège de Québec (1759) a été dessiné à la suite d'une enquête menée par l'amiral Saunders, le commandant de l'expédition de la Marine royale. (Archives nationales du Canada.
Vue de la prise de Québec, 13 septembre 1759. Cette gravure de 1797 s'inspire d'un croquis fait par Hervey Smyth, l'aide de camp du général Wolfe pendant le siège de Québec. Il s'agit d'une vue de la prise de Québec, le 13 septembre 1759.
Trop impulsif, Montcalm subit une lourde défaite
En apprenant que les Anglais sont arrivés sur les plaines d'Abraham, Montcalm cède à son tempérament impulsif et agit avec trop de hâte. Au lieu de harceler l'ennemi avec des miliciens embusqués, en attendant qu'une partie de son armée, postée plus à l'ouest, ne prenne les Britanniques par l'arrière, il décide d'attaquer sur-le-champ. Il dispose d'environ 4 500 hommes : les cinq bataillons de France sont placés au centre, encadrés de miliciens et de troupes coloniales sur les flancs.
Vers dix heures du matin, Montcalm donne le signal pour avancer. Ses lignes, plus ou moins bien formées, se mettent en branle. À environ 120 mètres des Britanniques, trop éloignés encore pour que leur tir soit efficace, les Français ouvrent néanmoins le feu. Bientôt, leurs rangs s'effritent mais ils continuent leur progression jusqu'à 90 mètres, approximativement, alors que les Britanniques commencent à tirer sporadiquement, par pelotons ; Wolfe ordonne d'attendre que l'ennemi soit à bout portant pour tirer une salve générale. Une trentaine de mètres seulement séparent les deux armées, lorsque les Britanniques déchargent brusquement leurs armes sur les rangs mal alignés des bataillons français. L'effet de cette manœuvre est une réussite. Pris de panique, les soldats français s'enfuient dans un sauve-qui-peut général. Les Britanniques chargent alors, baïonnette au fusil, mais ne réussissent à rattraper qu'un petit nombre de fuyards. Brandissant leur grande épée d'une main et tenant une dague dans l'autre, selon leur coutume lorsqu'ils chargent, les Highlanders écossais du 78e régiment se montrent les plus hardis dans la poursuite. Ils se heurtent bientôt à des miliciens canadiens embusqués qui, en couvrant la retraite de l'armée française, leur infligent de lourdes pertes
Québec se rend
La mort du général James Wolfe, telle qu'elle a été peinte par Benjamin West
Cette image peinte en 1769 par Benjamin West est l'image la plus connue de la mort du général britannique James Wolfe à Québec, en 1759. On aperçoit, de gauche à droite : le colonel William Howe, portant un chapeau et un manteau vert; Simon Fraser du 78e (Highland) Régiment de fantassins; le capitaine Debbieg; un Amérindien; le brigadier Robert Monkton; le colonel Napier; le capitaine Hervey Smyth (aide de camp); le colonel Isaac Barré; le colonel Williamson du Régiment royal de l'Artillerie; et le lieutenant Henry Browne du 22e Régiment de fantassins. On voit ensuite Wolfe; le médecin Robert Adair, portant un manteau bleu de civil; le serviteur de Wolfe; et un grenadier du 35e Régiment de fantassins. La toile de West est un chef-d’œuvre artistique, mais n'est pas très réaliste. L'artiste a peint toutes les personnes qui pouvaient prouver leur présence à Québec et le payer. Par conséquent, des officiers qui se trouvaient à différents endroits sont tous regroupés autour de Wolfe. L'image d'une personne qui n'a pas payé (Henry Browne, qui a aidé à transporter Wolfe hors du champ de bataille), est plutôt obscure. Adair n'a pas porté secours à Wolfe. L'identité de Napier n'est pas certaine.
Cette bataille décisive ne dure qu'une demi-heure environ, mais les dommages sont aussi grands de part et d'autre : 658 tués et blessés chez les Britanniques et environ le même nombre dans le camp français. Les deux généraux sont mortellement touchés. Wolfe a été frappé à la poitrine - probablement par un milicien canadien embusqué -, alors qu'il conduisait ses grenadiers de Louisbourg à la charge. À cette occasion, il demande à ceux qui se trouvaient près de lui de le soutenir en le retirant afin que ses soldats ne le voient point tomber. Quatre hommes l'étendent à l'écart quand l'un d'eux s'écrie : « Ils fuient, voyez comme ils fuient ! - Qui fuit ? Demanda Wolfe. - L'ennemi. » Le jeune général donne alors un ordre pour le mouvement de ses troupes, puis ajoute « Maintenant, que Dieu soit béni, je meurs en paix », avant de rendre l'âme.
La mort du général James Wolfe, telle qu'elle a été peinte par Edward Penny
Cette toile de 1763 illustre la mort du général James Wolfe. Cette œuvre d’Edward Penney est probablement plus réaliste que celle de Benjamin West, bien que moins connue. De toutes les versions des derniers moments du général, celle du capitaine John Knox est généralement acceptée comme étant la plus crédible. Knox a déclaré que plusieurs témoignages ont circulé au sujet de la mort du général Wolfe, de ses dernières paroles et des officiers auprès desquels il est mort, et que plusieurs, par simple vanité, ont déclaré avec honneur qu'ils étaient près de lui pour l'aider après qu'il fut blessé. Il a également dit que le lieutenant Brown, des grenadiers de Louisbourg et du 22e Régiment, M. Henderson, un volontaire de la même compagnie, et un soldat, étaient les trois personnes qui ont transporté Son Excellence hors du champ de bataille. Un officier d'artillerie, voyant la scène, s'est immédiatement porté au secours du blessé. Ce sont ces personnes qui ont accompagné le général pendant ses derniers moments.
Le général Montcalm, blessé à mort sur les Plaines d'Abraham, est ramené à Québec
Ce croquis du début du 20e siècle relate le retour du général français à Québec. Bien que l'on n'aperçoive pas la plaie abdominale qui sera la cause de la mort de Montcalm au lendemain de la bataille, cette image illustre avec exactitude l'homme blessé que quatre soldats retiennent sur son cheval.
Montcalm, pour sa part, a été blessé au bas-ventre pendant qu'il tentait d'organiser la retraite. Quatre soldats qui l'aident à se maintenir sur son cheval le ramènent dans Québec, alors que la population, effrayée, apprend la défaite par les militaires en déroute qui courent dans les rues. À l'hôpital, on constate qu'il n'y a plus rien à faire pour le général français, sa blessure est mortelle. Vaudreuil, qui se trouve à Beauport et qui veut contre-attaquer sur-le-champ, lui écrit pour lui demander conseil. Montcalm, jugeant la manœuvre trop risquée, préconise la retraite de l'armée et la reddition de la ville. Vaudreuil cède et ordonne la retraite durant la nuit. Montcalm meurt à l'aube du 14 septembre, et Québec se rend trois jours plus tard.
Les autres fronts. Lac Champlain
Pendant que Wolfe assiège Québec, le général Amherst remonte lentement le lac Champlain à la tête d'une imposante armée anglo-américaine de 11 000 hommes. Le 23 juillet, il arrive au fort Carillon où se trouve le général François-Charles de Bourlamaque avec environ 2 000 hommes. Les forces étant par trop inégales, les Français font sauter le fort trois jours plus tard, après l'avoir évacué. Poursuivant sa progression vers le nord, l'armée d'Amherst arrive à la hauteur du fort Saint-Frédéric, que les Français font également sauter. Lorsqu'ils y parviennent, le 4 août, les Anglo-Américains n'y trouvent plus que ruines. Amherst ordonne aussitôt d'en construire un autre à l'endroit qui s'appellera désormais Crown Point (aujourd'hui dans l'État de New York). L'armée d'Amherst tente ensuite de s'approcher de l'île aux Noix, sur le Richelieu, où Bourlamaque s'est retranché avec ses hommes, mais quatre petits navires français la tiennent en respect. L'hiver étant imminent, les Anglo-Américains se retirent finalement à Crown Point.
Le front ouest
Sur le front ouest, l'objectif principal de l'invasion britannique pour 1759 est le fort Niagara. Partis d'Albany sous le commandement du général John Prideaux, 5 500 soldats britanniques et américains, accompagnés par 600 guerriers iroquois sous la direction de sir William Johnson, arrivent près du fort français au début de juillet. La garnison, sous les ordres du commandant Pierre Pouchot, n'excède guère 500 hommes.
Malgré la supériorité écrasante des forces anglo-américaines, Pouchot décline l'offre qui lui est faite de se rendre et, le 9 juillet, le siège commence. Les Anglo-Américains se voient obligés de creuser des tranchées pour protéger les canons de siège, car Niagara n'est pas un fort typique de l'ouest nord-américain. Depuis 1755, les Français y construisent des bastions et des glacis à la manière des fortifications érigées en Europe par le maréchal Vauban. Prideaux juge préférable de bombarder la place à l'aide de mortiers, tout en menant un siège à l'européenne avec tranchées parallèles et sapes. Le 17 juillet, les gros canons britanniques enfin installés entrent en action. Les Français ripostent immédiatement. Dans le camp britannique, durant la seule journée du 20 juillet, deux hauts gradés, un lieutenant-colonel et un colonel, sont mortellement touchés. Mais le pire reste à venir : le soir même, le général Prideaux est tué accidentellement par un de ses propres mortiers. Refusant de céder au découragement, sir William Johnson prend le commandement de l'armée. Quatre jours plus tard, à La Belle Famille, à quelques kilomètres au sud du fort, Johnson écrase des troupes de renfort venues de l'Illinois et de l'Ohio, composées d'environ 800 soldats et miliciens, secondées par 600 Amérindiens. Le lendemain, désespérant de recevoir d'autres secours, Pouchot capitule. Les communications françaises vers l'Ouest sont désormais coupées.
Au Canada, la guerre continue. Lévis adopte une nouvelle méthode
Le brigadier François de Lévis succède à Montcalm. Cet officier jouit déjà d'une longue expérience dans l'armée métropolitaine. D'une personnalité tout à fait différente de celle de son prédécesseur, n'usant que de propos mesurés, Lévis est doté d'un tempérament calme et d'un esprit pragmatique. Il partage certainement l'opinion des autres officiers métropolitains quant à la meilleure façon de mener la guerre au Canada, mais il se garde de dénigrer les officiers canadiens. Conscient du fait qu'un état-major ne peut être pleinement efficace si des tensions y règnent, il entretient des relations relativement bonnes avec les officiers coloniaux, tout en relativisant sans doute les propos incendiaires de son chef.
Lévis commande les troupes à Montréal, durant l'été de 1759, lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort de Montcalm et de la chute de Québec. Mis au courant du déroulement des événements, il déclare que Montcalm n'aurait pas dû livrer bataille avant l'arrivée des renforts, pour ajouter aussitôt - trait révélateur de sa personnalité - qu'il est bien facile de juger les généraux malheureux à la guerre, puisqu'ils ont toujours tort.
Une situation sans issue
Tambour des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France, 1755-1760
Ce tambour des Compagnies franches de la Marine porte la livrée du roi de France, avec son ruban distinctif - cramoisi avec un fil blanc brodé. Les tambours portaient souvent des vêtements différents des autres pour que l'on puisse les repérer facilement sur le champ de bataille. En fait, le seul moyen de transmettre les ordres à un grand groupe d'hommes, avant l'invention des radios portables, était le battement des tambours. Les officiers devaient être en mesure de repérer rapidement un tambour, même parmi de nombreux soldats. C'est pourquoi les tambours portaient un uniforme différent.
François-Gaston de Lévis, Duc de Lévis (1719-1787). François-Gaston de Lévis, duc de Lévis, est venu au Canada en 1756 en tant que brigadier-général. Il était commandant en second des forces françaises au Canada, sous la gouverne du général Montcalm. Il a pris part à la capture des forts Oswego et William-Henry, ainsi qu'à la défense du fort Carillon (Ticonderoga). Pendant le siège de Québec en 1759, il a commandé la troupe au sud et à l'ouest de Montréal. Au printemps 1760, il a tenté en vain de reprendre Québec et a gagné la bataille de Sainte-Foy contre le général Murray, mais a été contraint à lever le siège lorsque des renforts britanniques sont arrivés par navire. Se retrouvant inférieur en nombre et en manque d'armes, il a finalement capitulé à Montréal, le 8 septembre 1760. Ce soldat talentueux et courageux a par la suite fait carrière au sein de l'armée française, notamment en Allemagne en 1762. Il a par la suite été promu à un rang supérieur, soit maréchal de France, en 1783, et nommé duc par le roi Louis XVI, l'année suivante. Il est décédé en 1787.
La bataille de Sainte-Foy. Lévis assiège Québec
L'idée d'assiéger Québec a ses détracteurs, qui n'hésitent pas à qualifier l'entreprise de « folie de Lévis ». Mais ce dernier sait que son armée, isolée et entourée de forces ennemies bien supérieures en nombre, se découragerait après la défaite des plaines d'Abraham, si on ne lui proposait un projet audacieux. Il devient nécessaire de redonner courage aux hommes, et de les galvaniser pour livrer un dur combat aux Britanniques. Lévis y parvient et, en mai 1760, l'armée française se présente devant Québec.
Le général James Murray commande la garnison britannique, qui compte environ 7 300 officiers et soldats, tous issus des troupes régulières. Informé du fait que l'armée française vient l'assiéger, il fait d'abord évacuer toute la population de Québec, Sainte-Foy et Lorette, et ordonne de faire raser les quartiers Saint-Roch et Sainte-Famille afin que les attaquants ne puissent s'abriter derrière les maisons pour s'approcher des fortifications. Il emploie ensuite une partie de la garnison à construire des retranchements avancés à l'ouest de la ville, près de Sainte-Foy. Le 27 avril, alors que l'armée française approche, quelques escarmouches éclatent entre la cavalerie de Lévis et des détachements britanniques. Dès le lendemain, Murray décide d'attaquer les Français avant qu'ils ne parviennent à se retrancher. La ligne britannique forte de 3 200 hommes, s'avance vers les troupes de Lévis. L'artillerie de campagne, qui se trouve tout près, canonne les positions françaises. Si Murray parvient à enfoncer la gauche de la ligne ennemie, l'armée de Lévis se retrouvera coincée entre les baïonnettes anglaises et le fleuve Saint-Laurent.
Victoire française sur les plaines d'Abraham
Bataille de Sainte-Foy, 28 avril 1760. La bataille de Sainte-Foy, le 28 avril 1760. Les troupes attaquent les Britanniques pendant la bataille de Sainte-Foy. On peut voir les grenadiers britanniques qui défendent le secteur près du moulin à vent de Jean-Baptiste Dumont, qui ont été très contesté. Certains détails relatifs à l'uniforme ne sont pas exacts, il s'agit néanmoins d'une bonne reproduction. Elle a été tirée de l'édition de 1925 du livre Les anciens canadiens d'Aubert de Gaspé. Éclipsée par la bataille des Plaines d'Abraham, cette bataille a rarement été illustrée.
La bataille est âprement menée. Le théâtre des combats les plus acharnés se déroule sur l'emplacement de la demeure d'un certain Dumont qui occupe une position charnière. Le régiment de La Sarre et les 43e et 60e régiments britanniques s'y affrontent au corps à corps, et la maison change de camp à plusieurs reprises. Le régiment de Berry vient prêter main-forte à celui de La Sarre, puis charge l'artillerie britannique à travers la mitraille, enlevant les canons. La ligne étant ébranlée, Murray ordonne la retraite, qui se fait en bon ordre. Les Britanniques perdent 1 100 hommes, morts, blessés ou prisonniers, alors que les pertes de Lévis s'élèvent à 572 morts et blessés.
Le général Lévis encourageant l'armée française lors de la bataille de Sainte-Foy, le 20 avril 1760. Cette image en est une plutôt romancée, mais François-Gaston de Lévis a en effet joué un rôle important pour rehausser le moral de l'armée française après sa défaite sur les Plaines d'Abraham. Certains ont parlé de son plan pour reprendre Québec au début du printemps de 1760 comme étant la folie de Lévis, mais le projet a donné aux hommes découragés une raison de continuer à se battre. Il est ironique de constater que les Français ont gagné la bataille de Sainte-Foy, mais ont été incapables de reprendre la ville avant que la Marine royale n'arrive avec des renforts britanniques.
L’arrivée de renfort. La flotte britannique met fin au siège
Québec, vue du Nord, peu après le siège de la ville, en 1759. Cette gravure publiée en 1761 illustre les murs de Québec, vus du nord. L'imposant édifice blanc que l'on aperçoit au centre, à droite, est l'orphelinat et le couvent des Ursulines. Le couvent abritait quelque 50 religieuses qui, selon un document de 1753, ont enseigné à environ 60 pensionnaires et 150 élèves de jour.
Cependant, les Britanniques tiennent toujours Québec. Les troupes de Lévis encerclent la ville, mais elles manquent de canons de fort calibre et, surtout, de munitions. Lévis doit même limiter le nombre de boulets par canon. Au contraire, Murray dispose d'une importante artillerie et d'abondantes munitions. Quand l'artillerie française commence à bombarder Québec, le 11 mai, la riposte est « vigoureuse », selon l'expression employée par Lévis. Chaque camp compte néanmoins sur les secours de sa métropole. Le 9 mai, une seule frégate anglaise a jeté l'ancre en rade de Québec. Or, c'est l'arrivée d'une flotte qui réglera le sort des armes. Les regards des assiégeants et des assiégés sont désormais rivés sur le fleuve et, le 15 mai, trois voiles se profilent enfin à l'horizon. Bientôt, la mort dans l'âme, les Français reconnaît les navires de guerre britanniques. Le lendemain, dès les petites heures du matin, Lévis commence à se replier sur Montréal.
Espérant couper la voie aux petites embarcations qui accompagnaient l'armée française, les navires ennemis attaquent, à l'ouest de Québec, deux frégates, la Pomone et l'Atalante, sous les ordres du capitaine Jean Vauquelin. Les vaisseaux français se sacrifient afin de protéger la retraite de l'armée. La Pomone s'étant échouée, l'Atalante, commandée par Vauquelin, parvient à retenir momentanément les navires britanniques. Ses munitions épuisées, son navire transpercé de toutes parts par les boulets ennemis, Vauquelin n'abaisse pas pavillon pour autant, mais il le cloue au mât de son bâtiment sous le feu incessant de l'ennemi, avant d'être fait prisonnier avec son équipage.
Les français perdent espoir
Bataille entre la frégate française Atalante et la flotte anglaise en 1760
Lorsque l'armée française du général Lévis a brisé le siège de Québec en mai 1760, les forces qui battaient en retraite étaient accompagnées d'un certain nombre de petits navires. Lorsque les Britanniques ont tenté de capturer ces navires, les navires de guerre français se sont sacrifiés pour couvrir la retraite. On voit ici la frégate Atalante du capitaine Jean Vauquelin, s'échouant mais encore en combat, après que la Pomone fut coulée.
L'arrivée des navires britanniques sème le découragement dans le camp français, qui ne voit plus aucun espoir de recevoir des secours de la métropole. Celle-ci envoie cependant un petit renfort au Canada. Quatre cents soldats des Compagnies franches de la Marine s'embarquent à bord de cinq navires de transport, escortés par la frégate le Machault. Malgré tout son courage, ce corps expéditionnaire se sait sacrifier à l'avance, car il est nettement insuffisant. Parvenu au golfe du Saint-Laurent, il se heurte aux navires de la Royal Navy qui s'y trouvaient déjà. Prise en chasse, la flottille française se réfugie dans la baie des Chaleurs et livre un ultime combat à l'embouchure de la rivière Restigouche, en juillet 1760.
Au sein de la colonie française, la situation, déjà difficile, se dégrade de jour en jour. Les coffres de l'armée sont vides et les soldats ne reçoivent plus leur solde. Plusieurs denrées alimentaires viennent à manquer et on redoute maintenant une véritable famine. Aucun espoir n'est permis, et tout le monde se rend compte du fait que la Nouvelle-France est en train d'agoniser. À partir du mois de mai 1760, les miliciens commencent à déserter en grand nombre pour aller ensemencer leurs terres. Lévis à beau les menacer de la peine de mort, rien n'y fait. Bientôt, les soldats de métier à leur tour suivent leur exemple. Malgré les désertions et les pénuries, l'armée française continue néanmoins à résister et il faudra que les Anglo-Américains déploient un nouvel effort militaire considérable pour en venir à bout.
La guerre de la conquête. L’invasion finale
Soldat des Compagnies franches de la Marine du Canada, 1757-1760. En 1757, 500 hommes des Compagnies franches de la Marine du Canada ont été regroupés en un bataillon, officieusement appelé le Régiment de la Marine. L'unité devait se battre à l'européenne avec les bataillons des troupes de la Terre (l'armée métropolitaine française) envoyés en renfort pour aider la garnison de la Nouvelle-France. Ce soldat porte l'uniforme complet que les soldats portaient pendant les dernières campagnes en Nouvelle-France.
Espérant donner le coup de grâce à la petite armée de Lévis, trois armées anglo-américaines tentent de la prendre en étau à Montréal. Celle de Murray remonte le Saint-Laurent à partir de Québec, celle du général William Haviland descend le Richelieu à partir de Crown Point, et celle du général en chef, Jeffery Amherst, descend le Saint-Laurent à partir d'Oswego, sur le lac Ontario.
Forte de 11 000 hommes et de 700 Amérindiens, l'armée d'Amherst se heurte à une résistance particulièrement opiniâtre au fort Lévis (près de Prescott, en Ontario). Du 20 au 25 août, elle est tenue en échec par guère plus de 300 soldats, marins et miliciens sous les ordres du commandant Pouchot. Les artilleurs français endommagent même deux navires anglais et obligent un troisième à baisser pavillon. Quand Pouchot rend enfin le fort, celui-ci n'est plus qu'un amas de ruines, et les Britanniques ont peine à croire qu'une résistance aussi farouche a pu être déployée par une si faible garnison.
Plan des fortifications de l'Île-aux-Noix, 1759-1760. Les fortifications illustrées sur ce plan de l'Île-aux-Noix ne sont pas terminées, notamment au nord. Au sud, la partie inférieure du fort illustrée avec six bastions a été construite par les Français en 1760, comme une grande batterie d'artillerie semi-circulaire. Les batteries britanniques (non illustrées) ont été construites sur la côte Est (à gauche) de la rivière Richelieu et ont bombardé les installations françaises du 16 au 20 août 1760. Les troupes françaises se sont enfuies pendant la nuit.
Au sud, l'armée d'Haviland - 3 500 hommes - reste bloquée à l'île aux Noix durant la majeure partie du mois d'août par 1 400 Français et Canadiens. Le 28 août, les Anglo-Américains s'emparent finalement des retranchements abandonnés au cours de la nuit précédente par les soldats français et les miliciens canadiens. Leur commandant, Louis-Antoine de Bougainville, a décidé de se replier, par crainte de voir sa retraite vers Montréal coupée par les 3 500 hommes de Murray, arrivés à Sorel le 27 août.
L'armée du Général Amherst passe les rapides à Cascades, près de Montréal, 1760
Le passage de l'armée britannique sur les rapides du Saint-Laurent, à Cascades, a été tragique. Cinquante-cinq bateaux ont été perdus et 84 hommes ont été tués. Cette unité sous la gouverne du général Jeffery Amherst, fermant le chemin en provenance de l'Ouest au cours de l'été de 1760, était l'une des trois armées britanniques convergeant vers Montréal, le dernier bastion français au Canada. Cette aquarelle a été peinte par un officier du Régiment royal de l'Artillerie qui accompagnait l'armée.
La Capitulation. Les Britanniques atteignent Montréal
L'armée d'Amherst approche de Montréal à bord de chaloupes quand, à la suite d'une mauvaise estimation de la force des rapides à Cascades, 55 embarcations sont entraînées par les eaux, emportant 84 hommes dans la mort. Le reste de la nombreuse armée parvient cependant sans encombre au lac Saint-Louis et débarque, le 6 septembre, à Lachine, dans l'île de Montréal, à l'ouest de la ville. Le lendemain, Vaudreuil et Lévis retirent les troupes françaises dans l'enceinte de Montréal, pendant que les soldats de Murray arrivent à l'est de la ville et que ceux de Haviland apparaissent sur la rive sud du Saint-Laurent. Les trois armées britanniques ont enfin réussi à établir leur jonction ; environ 18 000 soldats anglo-américains encerclent Montréal.
De sévères conditions de Capitulation
Toute tentative de défense paraît vaine. Les fortifications de la ville - un simple mur de pierre dans lequel l'artillerie ennemie ouvrira une brèche en quelques heures - ne sont nullement conçues pour soutenir un siège à l'européenne. Vaudreuil et Lévis ne peuvent que capituler. Ils délèguent Bougainville auprès des Britanniques pour négocier les termes de la reddition. Amherst se montre intraitable : les troupes régulières françaises doivent se rendre sans les honneurs de la guerre, remettre leurs armes, et surtout leurs drapeaux, conditions extrêmement dures pour l'époque, et même injustes envers une armée qui s'est battue avec tant d'acharnement et de vaillance. Outré, Lévis envisage de se retrancher avec les régiments français dans l'île Sainte-Hélène, tout près de la ville, afin de livrer un ultime combat. Vaudreuil refuse, probablement la mort dans l'âme, voulant éviter un bain de sang inutile et protéger les civils contre les éventuels méfaits d'une soldatesque débridée.
Lévis se soumet donc. Cependant, dans la nuit du 7 au 8 septembre, les soldats français tiennent une émouvante cérémonie au cours de laquelle les porte-drapeaux de chaque bataillon brûlent ces symboles sacrés que sont les drapeaux régimentaires. Le lendemain, 8 septembre 1760, Vaudreuil signe la capitulation. Les grenadiers et l'infanterie légère britanniques se rendent à la place d'armes où les troupes françaises déposent leurs armes. Quand les Britanniques exigent les drapeaux, Lévis répond sur son honneur qu'ils n'existaient plus au moment de la capitulation, ce qui est exact. Offensé de ne pouvoir mettre la main sur ces trophées, Amherst soupçonne les Français de les avoir cachés, provoquant un « scandale», consigne-t-il dans son journal. Mais il est bien forcé de s'en tenir à la parole d'honneur de Lévis.
Amherst a néanmoins d'autres problèmes autrement plus pressants à régler que celui des drapeaux. Les Britanniques se retrouvent en effet avec 3 116 officiers et soldats français prisonniers, dont 907 issus des troupes coloniales. Avec les femmes, les enfants et les domestiques qui accompagnent habituellement l'armée, le nombre de personnes sous leur garde excède les 4 000. Plusieurs soldats français ayant épousé des Canadiennes durant la guerre, la possibilité de quitter le service et de rester au Canada s'offre à tous, et des centaines d'hommes s'en prévalent.
Le sort des officiers canadiens
Le phénomène à la fois le plus surprenant et le plus révélateur de cette période touche les officiers des Compagnies franches de la Marine et des compagnies de canonniers-bombardiers. Parmi les 63 présents à Montréal lors de la reddition, 44 choisissent de rentrer en France. D'autres partiront l'année suivante - et un certain nombre d'entre eux périront d'ailleurs dans le naufrage de l'Auguste.
La différence fondamentale entre ces officiers et les autres militaires des régiments français est que les Canadiens ne « retournaient » pas en France, puisqu'ils n'y étaient tout bonnement jamais allés. Issus de familles de gentilshommes établies en Nouvelle-France depuis le XVIIe siècle, la plupart étaient nés au Canada. Au sein de la société canadienne, ces officiers jouaient non seulement le rôle de défenseurs, mais encore celui de dirigeants ; grâce à leurs alliances familiales, ils exerçaient une influence notable sur la vie économique de la colonie.
Dans ces conditions, on peut se demander pour quelle raison ils abandonnaient leur terre natale. En réalité, certains étaient tout simplement incapables de subsister au Canada dans un autre contexte que celui du service militaire. D'autres ne pouvaient concevoir de se retirer sur la seigneurie familiale pour être gouvernés par les Britanniques en attendant que soit scellée la paix entre la France et l'Angleterre. Enfin, ces hommes étaient avant tout des militaires au service de leur roi, désireux de poursuivre leur carrière dans les forces armées et de se battre pour la France, et il se trouve que la guerre se poursuivait ailleurs.
Le régime miltaire
Sir Jeffery Amherst, général en chef des forces britanniques en Amérique du Nord, 1759. Sir Jeffery Amherst (plus tard le baron Amherst) a dirigé l'armée qui a forcé les Français à se retirer de Ticonderoga en 1750. Il a dirigé les trois armées britanno-américaines en convergence sur Montréal en septembre 1760, forçant ainsi la capitulation définitive de la Nouvelle-France. Cette gravure de 1766 montres Amherst portant l'étoile de chevalier de l'Ordre du bain, un honneur qui lui a été accordé en 1761.
En septembre 1760, après la capitulation de Montréal, Amherst et ses officiers font face à un nouveau défi, celui de gouverner le Canada. Il s'agit d'un enjeu de taille, car le pays est en ruines, la famine menace et de nombreuses familles sont sans abri. De plus, il faut maintenir la paix parmi cette population à l'aide de troupes qui ne s'expriment pas dans la langue du pays.
Amherst a alors recours à la milice canadienne : dès le 22 septembre 1760, il décrète que les officiers de milice assureront « le bon ordre et la police » dans les paroisses et les villes, comme sous le Régime français, et qu'ils serviront d'intermédiaires entre le gouvernement et le peuple. Selon les termes de la capitulation, tous les Canadiens doivent être désarmés. Mais, deux semaines plus tard, les autorités britanniques reviennent sur leur décision, autorisant les officiers de milice à conserver leurs armes, permission qui s'étend aux miliciens, dans la mesure où ils en font la demande. De plus, les officiers de milice serviront désormais de juges de paix dans les causes mineures, car les magistrats sont rentrés en France, emportant avec eux leur connaissance des lois et des coutumes. Cette mesure est à l'origine de la création des « cours de milice ». Bien que ces nouveaux juges soient peu familiers avec la jurisprudence, le système des cours de milice était nettement préférable pour la population à celui des cours martiales britanniques. La prise en charge d'une partie du gouvernement civil par la milice canadienne était un événement capital. En effet, la milice constituait un intermédiaire crédible entre une population en désarroi et une armée étrangère qui aurait pu tomber dans certains excès durant cette époque fort troublée.
De leur côté, les troupes régulières de l'armée d'occupation reçoivent la consigne de se comporter correctement. Elles font preuve de modération et il y aura peu d'incidents durant cette période entre les Canadiens et les soldats britanniques qui, d'ailleurs, se tiennent habituellement à l'écart les uns des autres. Personne ne sait alors si le Canada deviendra colonie britannique ou s'il sera rétrocédé à la France à la fin de la guerre.
L'Angleterre gagne la guerre
Parmi ses anciennes colonies, la France ne détient plus qu'Haïti, alors nommée Saint-Domingue, ainsi que la Louisiane et la Guyane. Elle consent donc un ultime effort pour les renforcer en envoyant environ 5 000 soldats, escortés par les quelques vaisseaux de guerre dont elle dispose encore. Parallèlement, les négociations de paix commencent. Probablement dans le but de créer une diversion et de reprendre le territoire près des riches pêcheries de l'embouchure du Saint-Laurent, une flottille française avec 650 soldats à son bord s'empare de St. John's, à Terre-Neuve, en juin 1762, à la grande surprise des Britanniques. Ces derniers organisent une expédition qui parvient à reprendre la place en septembre de la même année. La France perd ainsi la base qu'elle désirait posséder à proximité de ces eaux poissonneuses. Entre-temps, les renforts qu'elle a dépêchés parviennent à ses autres colonies, qui demeureront donc françaises jusqu'à la fin des hostilités. L'entrée en guerre de l'Espagne aux côtés de la France, en 1762, ne changera rien à la situation. Les Britanniques et leurs alliés sont devenus trop puissants. Leur armée et leurs forces navales triomphent partout, et ils remporteront finalement la guerre de Sept Ans.
Le traité de paris. La France abandonne ses « quelques arpents de neige »
Attaque britannique à Signal Hill, à St. John's (Terre-Neuve), en septembre 1762. Les soldats du 1er Régiment de fantassins (Royal Scots) et du 77e Régiment de fantassins (montagnards de Montgomery) ont dirigé leur assaut sur Signal Hill à St. John's, Terre-Neuve, en septembre 1762. Cette manœuvre a conduit à la reprise des lieux après leur quatrième et dernière capture par les Français, en juin 1762. En possession de Signal Hill, les forces britanniques avaient un avantage stratégique par rapport aux Français qui étaient en poste près du fort William. Les envahisseurs ont capitulé après une nuit de bombardement de mortiers sur la colline.
Mais les victoires militaires ne déterminent pas à elles seules le sort des territoires. Cette prérogative revient également aux diplomates qui doivent finalement composer avec les succès et les revers des généraux, et le sort de la Nouvelle-France n'échappe pas à cette règle. Durant des mois, émissaires britanniques et français négocient pour que la France récupère le Canada et cède la Guadeloupe à l'Angleterre !
Or, le fait de céder une petite île en échange de quasiment la moitié du continent nord-américain ne constitue pas nécessairement une aubaine : la Nouvelle-France revient cher et ne profite en rien au trésor royal, tandis que la Guadeloupe ne coûte presque rien et rapporte gros. De toute évidence, les coffres de l'État sont vides. Dans les deux camps, commerçants et intellectuels de tout acabit prennent position. Pour reprendre la Nouvelle-France en charge, la France devrait investir massivement afin de contenir les pressions anglo-américaines sur ses frontières, les mêmes pressions d'ailleurs qui sont à l'origine de cette guerre perdue. Dans la métropole, l'opinion publique, lasse du Canada, ne veut plus se battre pour « quelques arpents de neige », selon la célèbre expression du philosophe Voltaire. Finalement, le duc de Choiseul tranche : que la France conserve la Guadeloupe et abandonne le Canada.
Le démembrement de la Nouvelle-France
La Nouvelle-France cesse dès lors d'exister. Le Canada, les îles Royale et Saint-Jean, ainsi que la partie de la Louisiane située à l'est du fleuve Mississippi, passent à la Grande-Bretagne. L'autre partie de la Louisiane, incluant la ville de la Nouvelle-Orléans, échoit à l'Espagne, alliée de la France. Cette dernière récupère la Martinique et la Guadeloupe au prix de quelques petites îles antillaises, ainsi que quelques comptoirs en Inde, notamment celui de Pondichéry. Toujours intéressée par les lucratives pêcheries de Terre-Neuve, la France obtient même les petites îles de Saint-Pierre et de Miquelon pour servir de base à ses pêcheurs, avec le droit d'y maintenir une modeste garnison. Somme toute, la France tire bien son épingle du jeu, mais les Canadiens sont bel et bien sacrifiés.
Pour les officiers canadiens encore présents sur le sol français, l'heure est aux grandes décisions. Quelques-uns retournent au Canada, mais la plupart demeurent en France, certains s'y retirant, d'autres poursuivant leur carrière militaire dans les forces françaises outre-mer. Le traité de Paris confirme ainsi la perte définitive de la majeure partie de l'élite sociale et militaire canadienne. Pour les anciens officiers canadiens devenus seigneurs sur leurs terres, comme pour le reste de la population canadienne, la France appartient désormais au passé. C'est le début d'une ère nouvelle, remplie d'incertitudes et probablement de batailles à venir.
La révolte de Pontiac et l'invasion américaine
Les nations autochtones résistent à la mainmise britannique. Mécontentement des Amérindiens
La nouvelle de la signature du traité de Paris, le 10 février 1763, parvient au Canada au moment de l'ouverture de la navigation. Aussitôt que les Canadiens apprennent que leur pays reste sous pavillon britannique, une information, autrement plus inquiétante à court terme, arrive à Québec, en provenance de l'Ouest et de la vallée de l'Ohio. Les forts de ces régions, évacués par les Français et occupés désormais par des garnisons britanniques, font l'objet d'attaques de la part des Amérindiens ! En effet, la présence des Britanniques dans ces régions déplaît à bon nombre de nations autochtones, qui regrettent la diplomatie cordiale, assortie de présents, dont elles bénéficiaient à l'époque des Français. Plus grave encore, les Américains se comportent comme en pays conquis et considèrent les territoires de chasse amérindiens comme des terres à coloniser ! La rancoeur s'est donc installée parmi les guerriers. Pourquoi, se demandent-ils, des batailles qui se sont déroulées au loin, entre Blancs, devraient-elles décider de leur sort et de celui de leurs territoires ? Un homme exceptionnel, le chef Pondiac, parvient à rallier plusieurs nations amérindiennes. Son plan est fort simple : il faut chasser les Britanniques et les Américains.
Les nations autochtones résistent à la mainmise britannique. La guerre éclaire de Pontiac
Chef iroquois, 1760-1790
Ce chef iroquois porte différents ornements autochtones et européens utilisés dans les cultures forestières de l’Est au 18e siècle. Remarquer, par exemple, la chemise de lin européen, portée en froc. Cet homme porte également un hausse-col, un croissant doré que les officiers européens en service portaient. L’hausses-col était considérés comme l'un des présents les plus convoités qu'un chef amérindien pouvait recevoir. Parmi les articles nord-américains que l'on peut voir, se trouvent des jambières (mitasses) et des mocassins. Le visage du chef est également peint et ses cheveux sont décorés de plumes (son cuir chevelu est dénudé, sauf à cet endroit). Le résultat est très coloré et hallucinant.
Au cours des mois de mai et juin suivants, les attaques déferlent comme des tornades sur les forts Sandusky, Saint joseph, de la Presqu'île, Miami, Venango et Michillimakinac, ainsi que sur plusieurs autres petits postes, littéralement pris d'assaut. Grâce aux nombreuses ruses que les Amérindiens maîtrisent à la perfection, la plupart d'entre eux tombent. À Michillimakinac, par exemple, les guerriers sauteux entreprennent de jouer à la crosse hors de la palissade. À un moment donné, la balle est projetée près de la porte où quelques officiers et soldats regardent la partie. Les joueurs se ruent alors vers la balle, suivis de près par leurs femmes. En un clin d'œil, celles-ci leur passent les armes qu'elles dissimulaient sous leurs couvertures et ils se précipitent à l'intérieur, tuant la garnison. Seuls les forts Pitt (Pittsburgh), Ligonier et Detroit parviennent à résister à Pondiac, encore que le premier ait été attaqué à deux reprises et que la garnison de Detroit, galvanisée par le major Henry Gladwin, ait dû soutenir un long siège. Pondiac et ses hommes n'épargnent que le fort Niagara, le jugeant - avec raison - trop bien fortifiée.
La réaction Britannique
De mémoire française, on n'avait jamais vu pareille situation. Des Amérindiens s'attaquant à des postes fortifiés défendus par des garnisons régulières, et, qui plus est, s'en emparant ! Voilà qui paraît bien contraire à leurs coutumes. Les militaires britanniques et les colons américains sont consternés. Tout l'Ouest est en train de tomber et, par voie de conséquence, une bonne partie de la traite des fourrures se trouve compromise. Les Canadiens - devenus nouveaux sujets britanniques - sont perplexes, sinon inquiets. À New York, le général Amherst, commandant suprême en Amérique du Nord britannique, d'abord décontenancé par la vigueur des attaques de Pondiac, décide finalement qu'un fort contingent de troupes régulières, appuyé par des miliciens volontaires américains, se rendra au plus vite dans la vallée de l'Ohio afin de secourir les forts assiégés. Un second contingent, composé de troupes britanniques assistées par leurs implacables ennemis d'hier - les miliciens canadiens !
partira plus tard de Montréal pour reprendre les autres petits forts situés plus à l'ouest.
Les Amérindiens battus à leur propre jeu
La Bataille de Bushy Run, Pennsylvanie, 5 août 1763
La charge du 42e (Royal Highland) Régiment de fantassins a dispersé les guerriers et a permis aux forces britanno-américaines du colonel Bouquet de remporter une victoire décisive. Cette défaite des Amérindiens a mené à l'échec de la révolte de Pontiac en Amérique du Nord. Cette gravure comporte une erreur de précision : les garnitures des revers et les manchettes du 42e Régiment doivent être bleues et non beiges. Le Régiment a changé de beige à bleue la couleur des garnitures lorsque le mot « royal » a été ajouté à son titre, le 22 juillet 1758. L'endroit rouge et bleu était et est toujours la livrée royale britannique.
En juillet 1763, le contingent du colonel Henry Bouquet, officier suisse passé au service des Britanniques, se rend aussi vite que possible dans la vallée de l'Ohio. Composée du 42e régiment écossais, d'une partie du 60e et de Rangers américains, la petite armée de Bouquet, forte d'environ 600 hommes, se dirige vers le fort Pitt. Le 5 août, à Bushy Run (Pennsylvanie), les Amérindiens ouvrent le feu sur son arrière-garde. La troupe est encerclée assez rapidement ; les cris de guerre des Amérindiens fusent de tous côtés. Mais Bouquet est un admirateur des tactiques amérindiennes utilisées jadis contre Braddock avec tant de succès par les Canadiens. En tacticien rusé, il dispose ses hommes en cercle et laisse les Amérindiens l'attaquer dès le lendemain. Au bout d'un moment, il feint la défaite, ordonnant la retraite à une partie de ses soldats. Se croyant victorieux et espérant se procurer des scalps, les Amérindiens se ruent alors dans la brèche ainsi créée, fonçant tête baissée dans le piège. Leurs flancs sont aussitôt balayés par les salves des soldats embusqués qui n'attendaient que cet instant. Ceux-ci chargent ensuite à la baïonnette, sonnant la déroute pour les guerriers de Pondiac. Ce désastre marque le point décisif de cette guerre, Bouquet ayant réussi à battre les Amérindiens sur leur propre terrain. En combinant leurs tactiques à la discipline et à la puissance de feu de ses troupes, il vient de démontrer que les soldats britanniques peuvent tenir les Amérindiens en respect, tout comme l'avaient fait leurs prédécesseurs, les Français.
Les Amérindiens retournent les enfants capturés au colonel Bouquet à l'issue de la bataille
En 1764, le colonel Henry Bouquet a insisté sur le fait que les Amérindiens devaient délivrer tous les hommes blancs en échange de quoi leurs villages seraient épargnés. Cela en a fait souffrir plusieurs. Les Amérindiens traitaient bien les enfants qu'ils avaient capturés et certains les adoptaient. Un récit contemporain de l'expédition de Bouquet révèle que : « aussi cruels et sans merci qu'ils sont [les Amérindiens], leurs actions sont des exemples à suivre pour les chrétiens. Aucun enfant n'est traité, par les personnes qui les ont adoptés, différemment des enfants biologiques de ces personnes. » Sur cette gravure, un garçon capturé recule à la vue d'un soldat britannique, cherchant refuge dans les bras de ses parents adoptifs amérindiens qui sont probablement les seuls parents dont il se souvient.
À la suite de cet échec, les Amérindiens lèvent les sièges des forts Ligonier, Pitt et Detroit. Au printemps de 1764, l'armée de Bouquet, renforcée par des centaines de volontaires de la Virginie et de la Pennsylvanie, pénètre jusqu'au cœur des territoires amérindiens sans rencontrer beaucoup de résistance.
1764 : le Bataillon des volontaires canadiens. Des canadiens au service des Britanniques
Pendant que ces événements se déroulent dans la vallée de l'Ohio, les instructions d'Amherst concernant la formation d'un contingent de troupes au Canada parviennent au général Murray. Au début de mars 1764, ce dernier décrète la levée de cinq compagnies de Canadiens, composées chacune de 60 hommes commandés par des officiers canadiens. Murray demande aux capitaines de milice de rassembler les « jeunes gens de leurs Paroisses et d'y demander des volontaires ». Les districts de Montréal et de Québec devaient fournir deux compagnies chacun, celui de Trois-Rivières en serait quitte pour une.
Or, les conditions offertes aux Canadiens leur paraissent inusitées, habitués qu'ils sont à servir gratuitement sous le Régime français. En effet, ils seront payés six sous par jour pendant la durée de leur service, outre l'habillement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis. En réalité, tous les miliciens des autres colonies britanniques jouissent des mêmes avantages, mais leur caractère insolite réveille la méfiance naturelle des Canadiens envers « les Anglais ». La rumeur se répand bientôt dans les paroisses que les jeunes gens, puisqu'ils sont payés, s'engagent « pour la vie » dans l'armée britannique. De sorte qu'à la fin du mois de mars, le recrutement piétine. Les gouverneurs britanniques parviennent finalement à rassurer les Canadiens, en insistant notamment sur le fait que leurs officiers et sous-officiers ne seront pas des Britanniques.
Poursuite d’une tradition militaire
Le commandement est effectivement confié à des Canadiens, plusieurs étant d'ailleurs d'anciens officiers des Compagnies franches de la Marine, dont le major même du bataillon, Jean-Baptiste-Marie Blaise Des Bergères de Rigauville. La confiance se réinstalle peu à peu, si bien qu'à la mi-avril les cinq compagnies sont complètes. Les Canadiens ont un uniforme différent de celui des soldats réguliers, portant bonnet de laine, capot, mitasses et mocassins, selon leur coutume; leur habillement semble avoir été rouge et vert. Le « Bataillon des volontaires canadiens » part pour l'Ouest en mai, accompagnant d'abord les soldats britanniques au fort Oswego, puis à Niagara, à Detroit et finalement à Sandusky. Cependant, les hostilités tirent déjà à leur fin. Les Amérindiens de Pondiac se soumettent durant l'été de 1764 et concluent la paix. Les Canadiens ne prennent donc part à aucun combat, mais la nouvelle de leur présence auprès des Britanniques a contribué à troubler quelque peu les Amérindiens, qui connaissent bien leur habileté à la guerre dans les bois. La campagne terminée, les compagnies canadiennes réintègrent leurs districts respectifs au cours de l'automne, comme convenu, et sont finalement dissoutes au début du mois de décembre. Ce bataillon servit donc de trait d'union entre, d'une part, les anciennes troupes de la Nouvelle-France et les compagnies de milice qui existaient dans les paroisses depuis 1760 et, d'autre part, celles du nouveau régime britannique. Grâce à son existence, les Canadiens, bien qu'abandonnés par la France, maintenaient leur tradition militaire.
La guerre de Sept Ans gagnée, les Amérindiens soumis, l'Angleterre doit désormais songer à pourvoir sa nouvelle colonie d'une garnison suffisante de soldats réguliers. On estime que deux ou trois régiments, dont une partie serait détachée dans les forts des Grands Lacs, devraient suffire. Le fort situé le plus à l'ouest qui recevra une garnison sera Michillimakinac, car on juge inutile d'en maintenir dans les fortins des Prairies. Un ou deux régiments seront également postés en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.
La guerre de Sept Ans gagnée, les Amérindiens soumis, l'Angleterre doit désormais songer à pourvoir sa nouvelle colonie d'une garnison suffisante de soldats réguliers. On estime que deux ou trois régiments, dont une partie serait détachée dans les forts des Grands Lacs, devraient suffire. Le fort situé le plus à l'ouest qui recevra une garnison sera Michillimakinac, car on juge inutile d'en maintenir dans les fortins des Prairies. Un ou deux régiments seront également postés en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.
La Grande-Bretagne n'entend pas davantage négliger l'aspect naval, toujours très important pour elle. Une flottille de petits navires sera entretenue sur les Grands Lacs, avec quelques officiers et marins de la « Marine provinciale » - un genre de petite marine lacustre. On abandonnera le chantier militaire qui servait à la construction de navires de guerre sous le Régime français, et Québec deviendra un port d'attache des vaisseaux de guerre, sans constituer pour autant la plus importante base navale britannique. Celle-ci demeure Halifax, ville située à un emplacement idéal, avec son grand havre, pour jouer le rôle de « sentinelle » de l'Atlantique Nord.
Organisation militaire et civile. Une nouveauté pour les Britanniques
Du point de vue militaire, la situation de la Grande-Bretagne, nation insulaire, est alors passablement différente de celle des autres pays de l'Europe occidentale. Dépourvue de frontières terrestres, il ne lui est pas nécessaire d'entretenir de grandes armées ni de construire d'imposantes forteresses. Par conséquent, son armée est numériquement beaucoup plus modeste par rapport aux autres grandes puissances européennes. Elle comprend à peu près 40 000 hommes en temps de paix, alors que les autres nations doivent en entretenir entre 200 000 et 300 000. Qui plus est, une bonne partie de l'armée britannique ne sert pas en Grande-Bretagne même, mais dans les divers territoires outre-mer où flotte le pavillon britannique. Outre les troupes indiennes maintenues par la Compagnie des Indes orientales anglaise, l'Angleterre ne dispose pas de troupes coloniales distinctes comme la France ou l'Espagne. C'est l'armée métropolitaine elle-même qui fournit les garnisons coloniales en hommes.
Dans chaque colonie britannique, un système de rotation permet d'assurer une présence militaire permanente. Un régiment en relève un autre, lequel, après quelques années passées en Angleterre, repart à son tour vers d'autres horizons. Il n'y a rien d'immuable dans ce procédé et certains régiments demeurent dans la colonie pendant une décennie, alors que d'autres y restent moins de deux ans.
Changements sociaux
Ce système est une grande nouveauté pour la population de l'ancienne Nouvelle-France et il entraînera des modifications sociales majeures. En effet, en raison de cette organisation, les officiers ne seront désormais plus recrutés parmi les gentilshommes coloniaux, ce qui prive l'élite canadienne de sa principale source d'emplois, de revenus et d'influence. À un autre niveau, les soldats sont également touchés par ces mesures. En effet, après leur service, bon nombre de soldats des Compagnies franches de la Marine française restaient au Canada pour y fonder un foyer. Dorénavant, cette possibilité existe de moins en moins puisque l'armée régulière, au lieu de faire partie intégrante de la société, forme un groupe étranger isolé au sein même de la population coloniale.
Réputation guerrière des Canadiens. Projet de création d’un corps militaire canadien
Bien des officiers britanniques, et non des moindres, admirent depuis longtemps les qualités guerrières des Canadiens et souhaitent recruter des corps de troupes coloniales parmi eux. « Les Canadiens sont une race rude et ils ont été habitués au maniement des armes dès leur enfance... ces gens fourniraient certainement le meilleur genre de troupes à utiliser dans une guerre amérindienne... Aussitôt que les Amérindiens verront un corps de Canadiens en armes contre eux, ils seront persuadés que l'Amérique n'a qu'un maître... », écrit l'un d'eux. Le général Amherst lui-même reprend ces propos à son compte, ajoutant que le gouvernement britannique devrait tirer parti des talents exceptionnels des anciens officiers des troupes coloniales françaises vivant au Canada.
De plus, Amherst considère que les Canadiens, grâce à leur habileté et à leur discipline, sont supérieurs aux Rangers américains. Divers corps de Rangers avaient participé à la guerre de Sept Ans, et les plus appréciés du haut commandement britannique semblaient être ceux du colonel Joseph Goreham. Les « Rogers'Rangers », comme on surnommait ceux du major Robert Rogers, avaient rendu de nombreux services, mais ils s'étaient révélés incapables de se mesurer victorieusement aux Canadiens, particulièrement lors d'un combat dans les bois, en 1758, et ils passaient aux yeux d'Amherst pour des aventuriers. Alors même qu'il incite les autorités londoniennes à approuver la levée d'un corps colonial composé de Canadiens, il se réjouit du licenciement des Rangers car, avoue-t-il, « j'en ai une très mauvaise opinion ... ». La mise sur pied d'un régiment canadien constitue donc une excellente idée sur le plan militaire. Malheureusement, elle s'avère irréalisable du point de vue politique. Au même moment, en effet, dans le but d'économiser, le gouvernement britannique réduit son infanterie régulière de 124 à 70 régiments. Dans ces conditions, l'opinion publique anglaise verrait d'un très mauvais oeil le licenciement de dizaines de milliers d'officiers et de soldats d'origine britannique, au profit du recrutement de ces ennemis de fraîche date, catholiques et de souche française par surcroît !
Des problèmes juridiques et politiques insurmontables
Peu après son arrivée, Guy Carleton, qui succède à Murray en tant que gouverneur du Canada en 1766, propose également la levée d'un ou de deux régiments composés de Canadiens. Il évoque, statistiques à l'appui, le nombre élevé d'officiers de divers grades, aptes à servir, parmi la « French Noblesse in the Province of Québec », soit 51, dont 10 capitaines. Afin de rallier les gentilshommes de la colonie à l'Angleterre, soutient-il, il faut donner à ces militaires des brevets d'officiers dans un nouveau régiment colonial régulier, voire leur octroyer quelques places dans l'armée métropolitaine.
Londres oppose un nouveau refus, évoquant cette fois un problème juridique et politique incontournable. Selon la loi anglaise, en effet, les catholiques ne peuvent détenir aucun poste officiel dans le royaume. Il est donc impossible d'accorder aux Canadiens des brevets d'officiers dans les forces armées régulières. La situation risque de dégénérer à tout moment bien que les Canadiens, encore affaiblis et ruinés par l'invasion de leur pays, ne se montrent pas, pour l'heure, ouvertement hostiles aux Britanniques. Mais qu'adviendra-t-il à l'avenir si leur mécontentement prend de l'ampleur ? Parmi les quelque 18 000 Canadiens en mesure de porter les armes, la plupart ont déjà combattu et connaissent mieux les tactiques de guérilla que les soldats réguliers, et sont en outre des tireurs hors pair et d'excellents miliciens. Une population aussi militarisée constitue un cas sans équivalent en Europe ni dans les autres colonies. Si un conflit sérieux advenait avec les Canadiens, ce ne seraient pas deux régiments britanniques qu'il faudrait tenir en garnison dans la vallée du Saint-Laurent, mais bien une douzaine !
L’Acte de Québec. Imminence d'affrontements politiques
Sir Guy Carleton, vers 1763. Guy Carleton (1724-1808) est d'abord venu au Canada à titre de quartier-maître général de l'armée du général James Wolfe. La carrière de Carleton au Canada a été considérable : il a été le gouverneur du Canada à deux reprises - de 1766 à 1778 et de 1786 à 1796; il a été nommé chevalier en 1776 après qu'il eut défendu Québec des Américains, en 1775-1776. On le voit ici dans l'uniforme du 72e Régiment de fantassins (endroits écarlates et parement écarlate avec ruban doré) - ce qui permet de conclure que ce portrait a été peint, par un inconnu, entre 1758 et 1763.
Depuis que le Canada est devenu colonie britannique, en 1763, un autre problème politique, encore latent, risque à tout moment de dégénérer en affrontement. Certes, le 10 août 1764, un gouvernement civil a remplacé le régime militaire mais, en raison des lois et des proclamations royales britanniques, les gouverneurs font face à des contradictions quasi insolubles lorsqu'il s'agit de l'instaurer. Ainsi, d'une part, un petit groupe d'aventuriers et de marchands américains et anglais récemment installés au Canada réclament vigoureusement une assemblée législative ; ils obtiendraient ainsi le droit de se comporter comme des seigneurs en pays conquis, car seuls d'« anciens sujets » de religion protestante pourraient y siéger. D'autre part, les « nouveaux sujets » demandent à être gouvernés selon les clauses du traité de Paris qui leur garantit le libre exercice de leur religion et le maintien de leurs lois civiles. Enfin, la milice, indispensable à la gestion de la colonie, représente un problème des plus épineux étant donné qu'en principe, seuls des Britanniques protestants peuvent y être officiers - règle absurde brimant les Canadiens qui ont toujours été très fiers d'appartenir à cette organisation. À la fin de novembre 1765, la milice est même abolie et les capitaines remplacés par des « baillis » au sein de chaque paroisse. Mais ceux-ci sont priés de s'acquitter de leurs seules fonctions civiles, la question de leurs obligations militaires étant laissée en suspens... Des années de confusion et de contestation administrative s'ensuivront. Mais si le gouverneur Murray parvient à ménager les uns et les autres, son successeur, sir Guy Carleton, sait qu'il lui faudra bientôt faire face à la situation, d'autant plus que les tensions politiques entre l'Angleterre et ses Treize colonies américaines de la Nouvelle-Angleterre s'accentuent de jour en jour.
Il faut ralier les Canadiens à la cause britannique
Pour Carleton, comme pour les membres du gouvernement britannique, une émigration massive de la Grande-Bretagne vers le Canada paraît improbable. Ils demeurent convaincus que la « Province de Québec » restera une colonie à population majoritairement française et catholique. Seulement 2 000 Britanniques et Américains environ y résident- la plupart habitant Québec et Montréal - et il est peu probable que leur nombre augmente de façon significative, car même les tentatives de peuplement militaire se sont avérées peu fructueuses.
La seule façon de garantir la sécurité, la paix sociale et la prospérité de la colonie consiste donc à rallier les Canadiens à la cause britannique. Pour y parvenir, le parlement britannique adopte finalement, en 1774, l'Acte de Québec. Celui-ci confirme le maintien des lois civiles françaises et le libre exercice de la religion ; il permet aussi aux Canadiens catholiques d'accéder à des postes officiels, mais ce, uniquement au sein de la colonie. Par conséquent, toute possibilité de carrière militaire dans l'armée régulière demeure inaccessible aux gentilshommes du pays.
La milice est rétablie au cours de l'année suivante avec des seigneurs pour officiers. Influencé par le clergé et la noblesse qui cherchaient à consolider leur position sociale, Carleton en arrive à penser que la colonie gagnerait à être gouvernée selon un genre de régime féodal où les seigneurs, les membres du clergé et les grands marchands conseilleraient le gouverneur. Habitués à un régime autocratique, les Canadiens ne comprendraient rien, selon lui, à une assemblée législative, et seraient plus heureux en obéissant à leurs seigneurs et à leurs prêtres. Il s'agit d'une erreur fondamentale, qui trahit une mauvaise compréhension du gouvernement de l'époque française.
La révolution américaine. La lutte pour le contrôle
Un carabinier américain du Régiment du colonel Morgan, vers 1775-1776. Ce carabinier porte la blouse de chasse frangée que les bûcherons américains portaient à l'époque. La compagnie de Morgan a été formée avec ces hommes qui avaient une carrière différente pendant la Révolution américaine. Il s'agit de l'une des unités qui ont fait partie de l'armée rebelle de Benedict Arnold qui a envahi le Canada en 1775. Bien que la plupart des membres de l'unité fut capturés pendant une tentative ratée pour prendre Québec le 31 décembre 1775, Morgan a été en mesure de former un autre régiment qui a combattu à Saratoga.
Extraordinairement florissantes et jalouses de leur indépendance locale, les Treize colonies établies depuis le XVIIe siècle en Amérique du Nord sont, quant à elles, gouvernées par des législatures élues au moyen d'un suffrage restreint, tandis que l'autorité métropolitaine se trouve assurée par un gouverneur nommé par le roi. Or, on n'y apprécie guère l'autorité métropolitaine. Déjà, lors de la guerre de Sept Ans, on déplorait de vives tensions entre les officiers et les soldats de l'armée britannique et ceux des régiments provinciaux américains.
La paix revenue, le gouvernement britannique adopte, au nom de la suprématie du parlement impérial et de la volonté royale, des mesures très impopulaires. Il commence par imposer diverses taxes avant de voter, en 1765, le « Quartering Act » qui oblige les Américains à loger les soldats britanniques dans leurs foyers, situation courante au Canada, mais intolérables pour eux. Le cri de ralliement des Américains devient : « No taxation without representation ! » - pas de taxes sans représentation parlementaire. Des intellectuels, tel l'inventeur, philosophe et journaliste Benjamin Franklin, commencent à préconiser l'indépendance politique comme solution. La situation dégénérant, l'Angleterre décide de renforcer sa garnison à Boston.
Crainte d’attaque à partir du Canada
C'est dans ce contexte explosif que les Américains apprennent la nouvelle de l'Acte de Québec. Ils l'interprètent comme une tentative de la part des Britanniques pour amadouer les Canadiens, afin de les utiliser éventuellement contre eux, ce qui est bel et bien le cas. Ainsi, les Américains devraient subir de nouveaux raids de la part de Canadiens et d'Amérindiens qui ravageraient, pour le compte des Britanniques cette fois, les localités frontalières des colonies récalcitrantes ! L'indignation américaine atteint toutefois son comble le jour où 19 régiments britanniques débarquent à Boston pour étouffer par la force toute velléité de protestation. Un premier congrès continental, qui réunit toutes les colonies américaines, se tient à Philadelphie en octobre 1774 ; on déclare que les lois anglaises, dont l'Acte de Québec, spolient les droits américains. Le 10 mai 1775, le Congrès décrète la création d'une force armée permanente sous le commandement suprême de George Washington.
Le plan du Canada
Routes de l'invasion américaine vers le Canada, pendant l'automne de 1775. Cette carte illustre les routes prises par deux armées rebelles américaines qui ont envahi le Canada à l'automne 1775. L'armée de Montgomery a monté la rivière Richelieu tandis que les troupes d'Arnold ont traversé la forêt du Maine.
Pendant qu'une première armée américaine encerclera Boston sous le commandement de George Washington, une deuxième s'assemblera à Albany pour envahir le Canada sous les ordres du général Richard Montgomery. Enfin, une troisième armée, commandée par Benedict Arnold, se rendra à Québec à travers bois en longeant la rivière Kennebec, plus à l'est. L'armée de Montgomery devra s'emparer des forts situés sur le lac Champlain et le long de la rivière Richelieu, puis prendre Montréal avant de se joindre aux troupes d'Arnold pour assiéger Québec. Voilà un plan d'invasion qui ne manque pas d'audace !
Dès le mois de mai, les forts Ticonderoga et Crown Point sont enlevés sans coup férir par des petits groupes d'Américains. Ces pertes n'augurent rien de bon pour le Canada. Au cours du même mois, Carleton ordonne la mobilisation des milices de Montréal, mais cette mesure rencontre de fortes résistances, tant chez les marchands anglais favorables à la cause américaine que parmi plusieurs paroisses canadiennes des environs de la ville. Le 22 mai, Mgr Briand émet un mandement enjoignant de repousser les Américains et, le 9 juin, Carleton instaure la loi martiale.
Marche des Américains sous la gouverne de Benedict Arnold. Le voyage de l'armée rebelle de Benedict Arnold le long des rivières Kennebec et Chaudière à destination de Québec fut toute une épopée. Cette gravure américaine datant de 1838 nous donne une bonne idée des obstacles auxquels l'armée de Benedict Arnold a été confrontée.
L’invasion du Canada. Les défenseurs
On ne compte alors que deux régiments en garnison, les 7e et 26e. L'appel à la milice, principale force de défense du pays, ne connaît qu'un succès mitigé, car bon nombre de Canadiens craignent que les autorités anglaises ne les entraînent dans un conflit qui ne les concerne guère. Néanmoins, les marchands et les bourgeois canadiens forment une compagnie de volontaires qui monte la garde à la résidence montréalaise du gouverneur. Au début du mois de juillet, les marchands anglais forment également la leur. Mais cette compagnie est infiltrée par des sympathisants américains, comme le prouve le sabotage des fusils, une nuit, dans le corps de garde. À l'annonce de l'approche de l'armée de Montgomery, 120 Montréalais « tous Canadiens sous le commandement de M. de Longueuil se portent volontaires et vont renforcer la garnison britannique du fort ».
Les 2 000 hommes de Montgomery encerclent bientôt le fort Saint Jean, dont le siège débute le 18 septembre. Le 25, une avant-garde américaine de 200 hommes, sous le commandement d'Ethan Allen, est repoussée à Longue-Pointe, tout près de Montréal, par 200 volontaires canadiens appuyés par environ 30 soldats britanniques et par autant de volontaires anglais. Allen est constitué prisonnier et envoyé en Angleterre.
Montréal, ville américaine. Indécision de Carleton
Forts de ce succès, les Britanniques pourraient contre-attaquer aussitôt en harcelant les Américains qui assiègent le fort Saint Jean. C'est ce que préconisent les miliciens canadiens rassemblés à Montréal, habitués à de telles tactiques. Mais ils se heurtent à l'hésitation du gouverneur. Selon un rapport de l'époque, les miliciens « murmuraient - ainsi que les citoyens de la ville de Montréal - de voir que le Général [Carleton] s'obstinait à ne point vouloir traverser du côté sud pour aller repousser l'ennemi ». Au lieu de s'ennuyer « à rien faire », ils songent bientôt à retourner chez eux. Pis, ils deviennent de plus en plus nombreux à penser que cette inaction signifie « que le gouvernement n'avait point de confiance dans les Canadiens ». Blessés dans leur amour-propre, plusieurs se demandent même pourquoi ils devraient se montrer loyaux et combattre pour les Britanniques, alors que leurs concitoyens anglophones - qui les regardent comme un peuple conquis - refusent souvent de le faire. Après tout, les Américains n'ont-ils pas été les alliés des Britanniques contre le Canada jusqu'en 1760 ? La situation prend l'allure d'une dispute entre des Anglais qui, de part et d'autre, cherchent à attirer les Canadiens dans leur camp. Devant ces contradictions, et livrés à eux-mêmes par Carleton, la majorité d'entre eux opte pour la neutralité.
Chute de la ville
Au cours du mois d'octobre, quelques escarmouches éclatent à Longueuil, sur la rive sud du fleuve, où sont déjà parvenus des détachements américains. De nouveau, les Canadiens, impuissants, sont découragés de voir Carleton « ne point vouloir traverser du côté sud, pour chasser environ 40 hommes qui étaient dans le fort de Longueuil ». Le 18 octobre, le fort Chambly tombe aux mains des Américains, sa garnison n'ayant offert qu'une faible résistance. Encouragés par ces succès, les envahisseurs redoublent d'ardeur au fort Saint-Jean qui, sans aucun espoir de secours, capitule le 2 novembre, après 45 jours de siège. C'est là le dernier obstacle avant Montréal. Carleton, pour sa part, ne trouve rien de mieux à faire que de fuir vers Québec. Du côté des résidents anglais, on déplore de plus en plus de défections à mesure que l'armée américaine approche, si bien que le 13 novembre, Montgomery entre dans Montréal sans avoir à tirer un seul coup de feu.
Certains Montréalais, dont James Livingston, Moses Hazen et Jeremiah Dugan, se joignent alors aux Américains, qui les chargent de former des troupes canadiennes pour leur armée. Le recrutement n'obtient cependant pas le succès escompté et peu de Canadiens prendront les armes pour la cause américaine.
Les Américains assiègent Québec. Sauvez les meubles
Pendant ce temps, à Londres, les autorités entendent profiter des retombées positives de l'Acte de Québec. En juillet, le secrétaire d'État aux Colonies américaines, Lord Dartmouth, demande à Carleton de mobiliser un corps d'infanterie légère de 6 000 Canadiens qui servirait en permanence contre les Américains. Des canons légers en laiton, des armes, des munitions et des uniformes sont envoyés en toute hâte pour équiper cette nouvelle armée.
Cependant, au moment où ces instructions et tout l'équipement nécessaire parviennent à Québec, il est déjà trop tard. Il n'est plus question de recruter 6 000 Canadiens, mais plus simplement de sauver ce qui peut encore l'être. La chute de Montréal est d'autant plus grave qu'elle a interrompu les communications avec les forts de l'Ouest. Pour rétablir la situation, il faut absolument tenir la ville de Québec jusqu'au printemps de 1776, date à laquelle des renforts arriveront de Grande-Bretagne, mais, dans l'immédiat, ce sont les Américains qui se présentent. Le 14 novembre, en effet, les habitants de Québec voient apparaître, au sud de la ville, les premiers éléments de la petite armée de 1 100 hommes commandée par Benedict Arnold. Au début du mois de décembre, l'armée de Montgomery rejoint celle d'Arnold et, le 6, les Américains commencent le siège de la ville de Québec.
Carleton rallie les défenseurs
Fort heureusement pour les Britanniques, Carleton se ressaisit et révèle enfin ses qualités de chef. À Québec, hormis quelques officiers d'état-major, il ne reste, en fait de troupes régulières, qu'une soixantaine de soldats du 7e régiment, 37 soldats d'infanterie de marine et 6 artilleurs. Carleton peut aussi compter sur environ 200 recrues récemment arrivées de Terre-Neuve, qui appartiennent à un nouveau régiment colonial nommé le Royal Highland Emigrants, sur les marins tirés des navires qui se trouvaient dans le port, et sur environ 80 artificiers et ouvriers. Enfin, il dispose aussi de quelque 900 hommes de la milice de la ville, divisés en huit compagnies de « Milice Canadienne » et six de « British Militia », rassemblant les résidents francophones et anglophones.
Carleton s'emploie d'abord à renvoyer de la ville toute personne favorable aux idées américaines, prend des mesures pour renforcer les fortifications et rassemble une bonne réserve de vivres et de munitions. Il réorganise alors sa garnison hétéroclite et l'équipe grâce aux fournitures récemment arrivées d'Angleterre. Avec les soldats réguliers et les recrues écossaises, il forme un corps d'élite et de réserve ; il intègre les marins et les artificiers à l'artillerie et au génie, et confie aux deux corps de milice le gros de l'effort de défense. À tous, il fait distribuer des uniformes verts et, en prévision de l'hiver, il fournit des bonnets de fourrure, des capots, des mitaines et d'autres vêtements appropriés. Enfin, Carleton parvient à stimuler ses hommes. Convenablement nourris, armés, et bien au chaud à l'abri des murailles de la ville, ils attendent les Américains de pied ferme.
Pour les assiégeants, au contraire, la vie devient de plus en plus difficile à mesure que le froid s'installe. Ceux-ci ne disposent que de tentes et de baraques, peu efficaces contre les vents glacés ; en outre, ils n'ont pas amassé suffisamment de bois de chauffage, et ils manquent même parfois de vivres. Leurs uniformes ne les protègent guère des rigueurs du climat. De plus, Montgomery ne dispose pas d'une véritable artillerie de siège, de sorte qu'il ne pourrait causer de grands dommages chez les défenseurs. Bref, la seule solution est encore de prendre la ville d'assaut ! Cette décision repose aussi sur une autre raison décisive : les Américains sont convaincus que de nombreux miliciens canadiens partagent secrètement leur cause et qu'ils déposeront les armes sitôt la basse-ville prise.
L’assaut sur Québec. Attaque nocturne
Croquis cartographique des attaques américaines à Québec, 31 décembre 1775
Voici les routes empruntées par le général Montgomery et les colonnes d'Arnold au moment d'attaquer la basse ville, ainsi que la feinte contre les murs de la haute ville. La bataille a en fait eu lieu dans les petites rues de la basse ville, où la noirceur, le froid et la confusion ont entraîné un combat désespéré aux barricades.
L'état-major américain choisit la nuit du 31 décembre pour lancer trois attaques simultanées contre la ville. Ce soir-là, une tempête de neige joue en leur faveur en empêchant les défenseurs de les voir et de les entendre arriver. Vers quatre heures du matin, des fusées lumineuses s'élèvent depuis les lignes américaines : c'est le signal convenu ! L'assaut commence par une attaque à coups de canons contre la porte Saint-Jean. Dans la ville, les cloches des églises et les tambours sonnent le branle-bas de combat. Mais cette première attaque n'est qu'une feinte, pendant laquelle Montgomery, à la tête de quatre régiments new-yorkais passe, inaperçu, sous le Cap-aux-Diamants, et s'engage dans un petit chemin très étroit (aujourd'hui la rue Petit-Champlain) menant à la place Royale. Peu après, Montgomery et ses hommes parviennent à distinguer une maison à travers la tempête. « En avant, mes braves, Québec est à nous ! », s'écrie le général, en s'élançant l'épée à la main. Un instant plus tard, une formidable détonation éclate ! Elle provient du premier poste de défense de la basse-ville, tenu par une trentaine de miliciens canadiens et par quelques marins britanniques. Montgomery et ceux qui se trouvent près de lui tombent, ensanglantés, dans la neige. Seul rescapé, l'aide de camp Arron Burr, futur vice-président américain, reste debout, stupéfait. D'autres coups de canons et les rafales de fusils des miliciens crépitent. Pris de panique, les New-Yorkais s'enfuient à toutes jambes !
La mort du général Richard Montgomery, le 31 décembre 1775
Cette gravure pittoresque du début du 20e siècle montre le général des rebelles américains, Richard Montgomery, lors de sa mort pendant l'attaque de Québec, le 31 décembre 1775. Les troupes américaines sont correctement dépeintes dans leur uniforme d'été - elles ne portaient aucun vêtement d'hiver.
Les Américains sont repoussés
Miliciens canadiens et soldats britanniques repoussant l'attaque américaine à Sault-au-Matelot. Cette scène illustre le climax de l'attaque de la colonne américaine du général Arnold. Les miliciens canadiens (à gauche et à droite, portant des bonnets rouges) et les soldats britanniques du 7e Régiment de fantassins (Régiment royal de fusiliers) (à droite, portant des bonnets de fourrure) défendent une barricade à Sault-au-Matelot (dans la basse ville de Québec) pendant la nuit du 31 décembre 1775. Les défendeurs portent tous de chauds vêtements d'hiver, tandis que les rebelles n'étaient pas habillés convenablement et souffraient en raison du froid. Remarquer l'officier britannique avec son épée et son pistolet, qui porte une écharpe cramoisie par-dessus son manteau.
Entre-temps, Arnold et quelque 700 hommes ont été repérés près de la porte du Palais. Ils se ruent à l'attaque de la basse-ville, croyant que la colonne de Montgomery s'y trouve déjà. Blessé lors de l'assaut d'une première barricade, rue du Sault-au-Matelot, Arnold est remplacé par le colonel Daniel Morgan qui prend le commandement et se rend à la seconde barricade. Derrière elles l'attendent un détachement du 7e régiment, rangé en ligne de bataille, et des miliciens canadiens dissimulés dans des maisons. Quand les Américains parviennent au sommet de la barricade, ils sont accueillis par une intense fusillade. Carleton considère alors que le moment est venu de leur couper la retraite. Il fait sortir, par la porte du Palais, un important détachement d'Écossais et de marins, qui prend les hommes de Morgan à rebours. Les Américains, se sachant perdus, déposent les armes. Lorsque le jour se lève, environ une centaine d'entre eux gisent par terre, et parmi ces morts se trouve le général Montgomery ; 300 autres sont faits prisonniers, notamment le colonel Morgan. La garnison québécoise, pour sa part, ne compte que cinq morts et un blessé. Ainsi se termina la dernière attaque en date dans l'histoire de la ville de Québec.
La tyranie américaine. Le siège se poursuit
Cette défaite ne met cependant pas un terme aux ambitions des Américains. Pendant plusieurs mois encore, ils persistent à assiéger la ville. En fait, il s'agit plutôt d'un blocus que d'un véritable siège, puisque leur artillerie ne constitue pas une menace sérieuse. De décembre 1775 à mai 1776, en effet, quelque 780 boulets et 180 bombes sont tirés sur Québec, blessant deux matelots et occasionnant la mort d'un enfant. Les défenseurs le leur rendent au centuple, puisqu'ils tirent 10 466 boulets et 996 bombes sur leurs lignes ! En outre, les soldats américains sont décimés par la petite vérole qui se déclare dans leur camp, provoquant de nombreux décès.
De leur côté, malgré des tentatives répétées, Livingston et Hazen éprouvent de grandes difficultés à recruter des Canadiens pour renforcer l'armée américaine. Parmi ceux qui s'enrôlent, « le plus grand nombre était des soldats français qui avaient resté dans le Canada à la conquête », aux dires d'un contemporain. Les Canadiens se méfient d'autant plus des Américains que ces derniers se comportent davantage comme des tyrans. Si bien que certains Canadiens, à l'extérieur de la ville, acceptent même de prendre les armes pour les combattre. Tel sera le cas de Louis Liénard de Beaujeu de Villemonde, seigneur de l'île aux Grues, qui, à la demande de Carleton, parvient à recruter des volontaires canadiens pour tenter de forcer le blocus américain de Québec. Son projet devait cependant être dévoilé et les Américains repousseront ses volontaires le 25 mars 1776, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, près de Beaumont. Néanmoins, cette escarmouche n'augure rien de bon pour les Américains.
Relation houleuse entre les canadiens et américains
En effet, les relations entre Américains et Canadiens vont en s'envenimant, particulièrement à Montréal. À la suggestion de marchands anglais ralliés aux Américains, le général David Wooster, qui y commande, fait arrêter une douzaine de notables canadiens, soupçonnés d'être restés fidèles aux Britanniques. On les relâche à la suite d'un mouvement de protestation, mais les soldats de Wooster prennent ensuite des otages, désarment une partie des Canadiens et multiplient les vexations. Une sorte de « prison politique » est même aménagée dans le fort Chambly. On assiste à des saisies de marchandises sans compensation, et certains marchands sont payés avec de l'argent de papier, sans valeur. Un médecin canadien est tourné en dérision et humilié lorsqu'il présente sa note de frais après avoir soigné des soldats américains. Protestant farouche commandant en pays catholique, Wooster pousse l'arrogance jusqu'à faire fermer les églises par ses soldats afin d'empêcher la population d'assister à la messe de minuit ! Bientôt, des pamphlets circulent sous le manteau à Montréal, dénonçant la « plus cruelle tyrannie.
L’arrivée de renfort britannique. Le siège est levé
Au début de mai 1776, plusieurs voiles battant pavillon britannique apparaissent sur le fleuve Saint-Laurent, voguant vers Québec. Ce sont les secours tant attendus ! La nouvelle se répand comme une traînée de poudre à travers le pays. Le 6 mai, la frégate HMS Surprise jette l'ancre dans le port de Québec, suivie bientôt par d'autres navires. Sitôt les renforts débarqués, Carleton organise une sortie hors de la ville avec ses troupes et ses miliciens pour attaquer les Américains. Mais ces derniers ont déjà abandonné leurs positions et fuient vers Montréal. Carleton les poursuit jusqu'à Trois-Rivières. Le 8 juin, le général américain John Sullivan songe à contreattaquer les Britanniques sur place, mais l'arrivée de navires de guerre anglais l'en empêche. Un combat qui s'ensuit néanmoins se solde par l'échec des Américains, battus par des soldats d'élite des 9e, 20e et 62e régiments.
Les Américains chassés de Montréal
Pendant l'invasion américaine, les forts situés à l'ouest de Montréal, dont les garnisons se composent d'une partie des soldats du 8e régiment, étaient restés aux mains des Britanniques. En mai 1776, le capitaine George Forster, avec 36 soldats, secondé par Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier à la tête de 11 volontaires canadiens et d'environ 160 Iroquois, se présente aux Cèdres, à l'ouest de l'île de Montréal, où 390 soldats américains occupent l'un de ces forts. D'autres volontaires canadiens se joignent à Forster et la place est rapidement encerclée. Ne disposant d'aucun canon, les assiégeants harcèlent les Américains à coups de fusil, tout en espérant les intimider grâce aux cris de guerre des Amérindiens. Le succès est total ! Terrifiés par la perspective du scalp, les occupants se rendent à Forster le 19 mai. Deux jours plus tard, à Vaudreuil, un détachement de renforts de 150 soldats américains tombe dans une embuscade tendue par de Lorimier à la tête d'un groupe de Canadiens et d'Amérindiens. À cette occasion, près d'une centaine d'Américains se rendent.
Il devient de plus en plus difficile à ces derniers de maintenir leurs positions. Le 15 juin, le général Arnold et ses soldats évacuent précipitamment Montréal, non sans commettre une dernière perfidie : ils tentent d'incendier la ville. Les Montréalais parviennent cependant à maîtriser les flammes et la milice canadienne est mobilisée pour maintenir l'ordre. Deux jours plus tard, les troupes britanniques arrivent. Les Américains abandonnent ensuite les forts Chambly et Saint-Jean, non sans les avoir embrasés, et se regroupent à Crown Point. Ainsi prend fin la première invasion américaine du Canada.
La défense de la Nouvelle-Écosse. Une colonie mal défendue
Depuis la guerre de Sept Ans, la Nouvelle-Écosse s'est développée et sa population augmente régulièrement. En octobre 1758, la colonie a été dotée d'une assemblée législative élue, la première au Canada, et la milice s'organise en fonction des comtés qui divisent la province. En raison de son importante base navale, Halifax possède une garnison britannique. Au fil des ans, son port de commerce constitue une plaque tournante et son centre de construction de navires marchands devient le plus imposant au nord de Boston. Outre son régiment de milice, Halifax entretient également une compagnie franche de Durant tout l'été de 1776, l'arrivée des renforts britanniques se poursuit. Des dizaines de navires se succèdent aux quais de Québec pour débarquer des tonnes de provisions, des dizaines de canons de campagne en laiton et des milliers de soldats venus d'Europe. Les 9e, 20e, 21e, 24e, 47e, 53e et 62e régiments ainsi que les grenadiers des 29e, 31e et 34e arrivent, accompagnés de près de 500 artilleurs. Mais le plus surprenant pour les Canadiens est sans doute de voir arriver des fantassins en uniformes bleus ou verts, leurs grenadiers coiffés d'une espèce de haute mitre de métal brillant, et marchant au pas cadencé... des soldats allemands !
L'attaque tant redoutée survient en novembre, quand environ 500 Américains assiègent le fort Cumberland. Celui-ci est occupé par une garnison de 200 soldats et par des familles loyalistes qui s'y sont réfugiées. La garnison avait tenté tant bien que mal de préparer ce fort, abandonné depuis les années 1760, à l'état de défense, mettant même à profit de vieilles baïonnettes françaises retrouvées au rebut pour façonner des piquets. Elle manquait cependant de provisions et les rations en étaient réduites d'autant. De plus, les soldats, qui n'avaient pas reçu d'uniformes, étaient en loques. Goreham leur permet d'endosser, par-dessus leurs vêtements, « des tapis de la caserne et des couvertures car ils souffriraient grandement, sinon périraient » du froid et des intempéries.
Les Américains, ne possédant pas d'artillerie, lancent un assaut durant la nuit du 13 décembre, mais sont repoussés. Les 22 et 23, ils tentent d'incendier le fort et parviennent à détruire plusieurs bâtiments, dont l'hôpital, mais Goreham tient bon. Le 28 décembre, le navire de guerre HMS Vulture apparaît et débarque des soldats du Royal Highland Emigrants et de l'infanterie de marine qui, joints à ceux de la garnison, chassent enfin les assiégeants.
Par la suite, des garnisons sont postées à Annapolis et en d'autres points stratégiques de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. On assiste encore à quelques échauffourées, la plus sérieuse étant la prise de Liverpool par des corsaires américains, en septembre 1778. Cependant, dans l'ensemble, les colonies maritimes ne sont plus incommodées par les Américains, la majorité de la population ayant choisi le camp britannique.
Devant la gravité de la situation, Gage détache deux compagnies du 14e régiment et une centaine de recrues d'un nouveau corps colonial, le Royal Fencible Americans, sous les ordres de l'un des grands noms du patrimoine militaire de la Nouvelle-Écosse, Joseph Goreham, ce même Goreham qui commandait naguère un corps de Rangers. Le gouverneur Legge est également autorisé à lever un autre régiment colonial parmi la population loyale, le Loyal Nova Scotia Volunteers. En décembre, d'autres troupes régulières venues d'Angleterre arrivent à Halifax. Legge peut enfin respirer et préparer la province à se défendre. Au début de l'été de 1776, le colonel Goreham et ses Royal Fencible Americans montent la garde au fort Cumberland - l'ancien fort Beauséjour - afin de protéger l'isthme de Chignectou contre une incursion américaine.
Charlottetown, petite ville sans garnison ni milice de l'île Saint-Jean (qui deviendra l'Île-du-Prince-Édouard), est mise à sac par des corsaires américains. En Nouvelle-Écosse, les rumeurs de dissensions se multiplient, particulièrement dans l'ouest de la province - l'ancienne Acadie - où des familles américaines se sont établies après la guerre de Sept Ans, tout comme à Halifax même.
Le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Francis Legge, demande donc des renforts au général Thomas Gage, commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, mais en vain... En juillet, après que des sympathisants américains ont tenté d'incendier les entrepôts de l'armée à Halifax, il mobilise des miliciens pour patrouiller dans la ville. Au cours de l'automne, dans l'est de la province, où la population est plus fiable, Legge organise quelques compagnies d'infanterie légère composées de miliciens volontaires. Dans l'ouest, ironie du sort, ce sont des Acadiens, de retour de leur déportation, qui prennent les armes pour défendre la couronne britannique en formant deux compagnies de milice à Annapolis et deux à Chignectou ! Toutefois, sans l'envoi de troupes régulières pour venir appuyer la population demeurée loyale aux Britanniques, la province risque fort de basculer dans le camp américain.
Milice pour le chantier naval, recrutée sans doute parmi les ouvriers, et une compagnie de « cadets » qui regroupe probablement des membres de la bourgeoisie.
Lorsque la révolution américaine éclate, en 1775, la garnison britannique est ridiculement faible dans l'ensemble des provinces maritimes. On ne compte que trois compagnies du 65e régiment à Halifax et une à Terre-Neuve. Charlottetown, petite ville sans garnison ni milice de l'île Saint-Jean (qui deviendra l'Île-du-Prince-Édouard), est mise à sac par des corsaires américains. En Nouvelle-Écosse, les rumeurs de dissensions se multiplient, particulièrement dans l'ouest de la province - l'ancienne Acadie - où des familles américaines se sont établies après la guerre de Sept Ans, tout comme à Halifax même.
Le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Francis Legge, demande donc des renforts au général Thomas Gage, commandant en chef des troupes britanniques en Amérique du Nord, mais en vain... En juillet, après que des sympathisants américains ont tenté d'incendier les entrepôts de l'armée à Halifax, il mobilise des miliciens pour patrouiller dans la ville. Au cours de l'automne, dans l'est de la province, où la population est plus fiable, Legge organise quelques compagnies d'infanterie légère composées de miliciens volontaires. Dans l'ouest, ironie du sort, ce sont des Acadiens, de retour de leur déportation, qui prennent les armes pour défendre la couronne britannique en formant deux compagnies de milice à Annapolis et deux à Chignectou ! Toutefois, sans l'envoi de troupes régulières pour venir appuyer la population demeurée loyale aux Britanniques, la province risque fort de basculer dans le camp américain.
L’invasion de la Nouvelle-Écosse
Devant la gravité de la situation, Gage détache deux compagnies du 14e régiment et une centaine de recrues d'un nouveau corps colonial, le Royal Fencible Americans, sous les ordres de l'un des grands noms du patrimoine militaire de la Nouvelle-Écosse, Joseph Goreham, ce même Goreham qui commandait naguère un corps de Rangers. Le gouverneur Legge est également autorisé à lever un autre régiment colonial parmi la population loyale, le Loyal Nova Scotia Volunteers. En décembre, d'autres troupes régulières venues d'Angleterre arrivent à Halifax. Legge peut enfin respirer et préparer la province à se défendre. Au début de l'été de 1776, le colonel Goreham et ses Royal Fencible Americans montent la garde au fort Cumberland - l'ancien fort Beauséjour - afin de protéger l'isthme de Chignectou contre une incursion américaine.
La défense du fort Cumberland
L'attaque tant redoutée survient en novembre, quand environ 500 Américains assiègent le fort Cumberland. Celui-ci est occupé par une garnison de 200 soldats et par des familles loyalistes qui s'y sont réfugiées. La garnison avait tenté tant bien que mal de préparer ce fort, abandonné depuis les années 1760, à l'état de défense, mettant même à profit de vieilles baïonnettes françaises retrouvées au rebut pour façonner des piquets. Elle manquait cependant de provisions et les rations en étaient réduites d'autant. De plus, les soldats, qui n'avaient pas reçu d'uniformes, étaient en loques. Goreham leur permet d'endosser, par-dessus leurs vêtements, « des tapis de la caserne et des couvertures car ils souffriraient grandement, sinon périraient » du froid et des intempéries.
Les Américains, ne possédant pas d'artillerie, lancent un assaut durant la nuit du 13 décembre, mais sont repoussés. Les 22 et 23, ils tentent d'incendier le fort et parviennent à détruire plusieurs bâtiments, dont l'hôpital, mais Goreham tient bon. Le 28 décembre, le navire de guerre HMS Vulture apparaît et débarque des soldats du Royal Highland Emigrants et de l'infanterie de marine qui, joints à ceux de la garnison, chassent enfin les assiégeants.
Par la suite, des garnisons sont postées à Annapolis et en d'autres points stratégiques de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. On assiste encore à quelques échauffourées, la plus sérieuse étant la prise de Liverpool par des corsaires américains, en septembre 1778. Cependant, dans l'ensemble, les colonies maritimes ne sont plus incommodées par les Américains, la majorité de la population ayant choisi le camp britannique.
L'armée de John Burgoyne au Canada
Durant tout l'été de 1776, l'arrivée des renforts britanniques se poursuit. Des dizaines de navires se succèdent aux quais de Québec pour débarquer des tonnes de provisions, des dizaines de canons de campagne en laiton et des milliers de soldats venus d'Europe. Les 9e, 20e, 21e, 24e, 47e, 53e et 62e régiments ainsi que les grenadiers des 29e, 31e et 34e arrivent, accompagnés de près de 500 artilleurs. Mais le plus surprenant pour les Canadiens est sans doute de voir arriver des fantassins en uniformes bleus ou verts, leurs grenadiers coiffés d'une espèce de haute mitre de métal brillant, et marchant au pas cadencé... des soldats allemands !
Des soldats allemands
Levée de troupes au Canada. La milice canadienne démobilisée
Au Canada, l'arrivée de cette armée marque le signal de la démobilisation des milices. Les Canadiens en ont vu de toutes les couleurs ! Bien que soucieux de défendre leurs terres, ils préfèrent rester neutres, laissant les « Anglais » se disputer entre eux, d'autant plus que les Britanniques peuvent maintenant compter sur les excellents soldats allemands. Aussi, lorsque Burgoyne décide de lever 300 Canadiens pour servir avec son armée, il se heurte à des difficultés considérables, ne trouvant que très peu de volontaires. Les capitaines des trois compagnies sont pourtant des seigneurs, mais « les seigneurs étaient impopulaires » et les Canadiens craignent d'être enrôlés de force dans l'armée britannique. Finalement, en mai 1777, le gouverneur Carleton se voit obligé de recourir à la loi de la milice pour incorporer les jeunes célibataires. Il menace même, pour prévenir toute tentative de résistance de leur part, de prendre « deux hommes mariés à la place de chaque garçon... déserté », de sorte que les « trois compagnies furent bien vite complètes». Le gouverneur doit néanmoins promettre qu'ils seront de retour dans leurs familles en novembre. Forts de ces assurances, les Canadiens se mettent en marche, deux compagnies partant avec l'armée de Burgoyne et la troisième avec le corps auxiliaire du lieutenant-colonel Barrimore Matthew St. Leger.
De nouvelles unités de Loyalsites américains
Après le retrait des troupes américaines, des réfugiés arrivent de plus en plus nombreux au Canada, principalement en provenance de l'État de New York. On les appelle les « Loyalistes ». Il s'agit d'Américains qui n'avaient pas épousé la cause de la majorité en faveur de l'indépendance, préférant demeurer fidèles à la couronne britannique. Or, ceux qui voulaient rester sujets britanniques faisaient l'objet de persécutions. Beaucoup étaient cependant parvenus à rejoindre les lignes anglaises et, armés par les Britanniques, formaient des régiments loyalistes. Plusieurs corps militaires loyalistes avaient également été mis sur pied au Canada même.
Le premier groupe important de réfugiés, composé d'environ 200 personnes, arrive à Montréal en mai 1776. Il est conduit par sir John Johnson, à qui Carleton accorde la permission de former un régiment de Loyalistes « afin de fournir à ces gens les moyens de se défendre ». Nommé The King's Royal Regiment of New York, il servira à la frontière canadienne. Au début de 1777, les frères Jessup arrivent d'Albany avec plusieurs réfugiés et forment le King's Loyal Americans. Regroupant d'autres réfugiés, le Queen's Loyal Rangers est créé à la même époque. En outre, le premier bataillon des Royal Highland Emigrants se recrute également parmi les Loyalistes. Ces nouvelles troupes sont pour la plupart postées dans la région montréalaise.
L’expédition de Burgoyne. Offensive désastreuse
Pendant que les Loyalistes forment ces différents régiments, Burgoyne planifie la campagne britannique contre le nord des États-Unis. L'avance des troupes empruntera deux voies. L'armée principale, sous son propre commandement, se rendra au sud du lac Champlain par bateau, puis marchera jusqu'à Albany. Un second corps expéditionnaire, sous les ordres du lieutenant-colonel St. Leger, se dirigera aussi vers Albany, mais en passant par la vallée de la Mohawk et en s'emparant du fort Stanwix (à Rome, dans l'État de New York), avant de rejoindre l'armée principale.
En 1777, au début du mois de juin, 7 000 soldats, parmi lesquels 3 000 Allemands, parviennent donc sans encombre au sud du lac Champlain, mais cette étape franchie, l'expédition s'empêtre dans de multiples difficultés. Burgoyne perd des semaines précieuses à rassembler bagages et équipement, et à construire une route et des ponts.
La lenteur de l'avance des Britanniques fournit aux Américains le temps pour mobiliser une armée de quelque 12 000 hommes, composée en grande partie de miliciens, sous le commandement du général Horatio Gates. Bientôt, l'armée britannique devient la cible des tirs meurtriers de la part de carabiniers embusqués dans les bois. Le général Simon Fraser, qui commande en second, tombe sous leurs balles - et sa perte est très vivement ressentie. Les Américains parviennent à encercler l'armée de Burgoyne près de Saratoga. Après une tentative désespérée et futile pour briser les lignes ennemies, Burgoyne dépose les armes le 17 octobre. Sa défaite constitue l'un des pires désastres des annales de l'armée britannique. Les répercussions de cette victoire américaine sont énormes, conférant une crédibilité militaire éclatante aux Américains à travers toute l'Europe. En effet, comment continuer à traiter ces derniers de fermiers tout juste capables de tenir des fourches, après les avoir vus vaincre les troupes britanniques et allemandes, jugées comme les meilleures au monde ? Les Américains gardent les soldats réguliers prisonniers, mais relâchent les Canadiens et les Loyalistes, ne les considérant pas comme des soldats de métier.
Attaque contrecarrée
Pendant ce temps, St. Leger se présente devant le fort Stanwix avec sa troupe : les Loyalistes de Johnson, environ 200 soldats du 8e régiment britannique, une compagnie de miliciens canadiens et environ 800 Amérindiens. Bien retranchés, les Américains parviennent à le tenir en échec. À la fin du mois d'août, impuissant à prendre le fort, St. Leger doit lever le siège et regagner le Canada. La victoire américaine sur l'offensive britannique est donc totale. D'une certaine façon, ce succès était cependant imputable au général Howe ; au lieu d'envoyer des troupes secourir Burgoyne au nord, Howe avait quitté New York avec son armée en direction du sud...
Milice et corvée
Ce revers désastreux remet en question l'efficacité de la défense du Canada dans l'éventualité d'une autre invasion. Au printemps de l'année 1777, le gouverneur Carleton avait promulgué une loi de la milice, la première depuis la fin du Régime français. Dans l'ensemble, cette loi reprenait les dispositions en vigueur depuis 1669. Tous les hommes âgés de 16 à 60 ans en état de porter les armes devaient appartenir à la milice. Regroupés en compagnies paroissiales, ils étaient tenus de participer aux exercices et aux devoirs civiques, notamment les corvées. Fait nouveau, cependant, les résidents anglais étaient maintenant assujettis à cette loi. En réalité, leurs obligations n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les Canadiens murmuraient d'ailleurs que les « habitants et artisans anglais, qui sont assez nombreux au Canada» n'étaient jamais appelés pour les dures corvées de construction et d'entretien.
En mars 1778, un incident survenu à Mascouche vient aggraver ce malaise plusieurs citoyens « refusèrent d'obéir à leur capitaine », décrit comme « un ivrogne ». D'apparence relativement anodine, l'affaire prend des proportions importantes lorsque le commandant de Montréal envoie au village un détachement de soldats, « qui pillèrent presque toutes les maisons et violèrent plusieurs filles et femmes... châtiment terrible qui ne se fait pas parmi les Barbares ». Cette nouvelle fait rapidement le tour des campagnes. Carleton n'intervenant pas pour punir les coupables, plusieurs croient qu'il approuve tacitement cette conduite. Cet événement, ajouté à l'injustice des corvées, a pour effet de cantonner davantage encore les Canadiens dans la neutralité car, comme le constate l'un d'eux, « comment veut-on que les Canadiens, après un traitement si rigoureux, soient disposés à prendre les armes.
La présence allemande. De bonne relation avec les Canadiens
Dans ce contexte, le fait que la garnison de troupes régulières ait alors compris de nombreux Allemands peut être considéré comme providentiel. Les soldats allemands s'entendent fort bien avec la population canadienne-française et la plupart de leurs officiers comprennent mieux le français que l'anglais, comme l'atteste leur correspondance administrative, habituellement rédigée en français ou en allemand. L'un d'eux écrit, à propos des Canadiens, qu'ils sont « de très bonnes gens, sérieux, avenants et d'une grande droiture. Conquise, leur amitié est sans limite... Aucune nation ne pourrait supporter les efforts, le travail et la fatigue avec autant de patience ». Pour leur part, les Canadiens apprécient l'ordre et la discipline des troupes allemandes. À Kamouraska, par exemple, l'excellent comportement d'un détachement du régiment Anhalt-Zerbst recueille l'entière approbation des capitaines de milice.
La majorité des troupes allemandes se trouve cantonnée à Sorel. Il s'agit surtout des régiments et bataillons du Brunswick sous le commandement du général Riedesel, une partie étant restée en garnison pendant la campagne de 1777. L'année suivante, les soldats allemands capturés par les Américains sont échangés et reviennent au Canada. À l'exception du régiment Prinz Friedrich, tous les autres fantassins, dragons et chasseurs vont être incorporés dans le bataillon Ehrenbrook et le régiment von Barner durant l'automne de 1778, le tout s'élevant à 2 000 hommes, sans compter quelque 800 fantassins, chasseurs et artilleurs du Hesse-Hanau. En outre, le régiment d'Anhalt-Zerbst, fort de 600 à 700 hommes, arrive en mai 1778 pour être affecté à la garde de Québec et des environs. Plusieurs Canadiens durent se souvenir des Français en les voyant sur les remparts, car, au lieu de l'habituelle tenue bleue des Allemands, ces soldats portaient un uniforme seyant blanc avec revers, parements et collet écarlates. Les régiments allemands comptent alors près de 3 200 hommes, soit la moitié des troupes régulières en garnison dans la vallée du Saint-Laurent.
Au cours des années qui suivent, les Britanniques augmentent encore cette présence allemande. En mai 1780, le nombre de soldats allemands passe de 3 600 à 4 300, avec l'arrivée des troupes du Hesse-Cassel, et, à la fin de 1782, ils sont près de 5 000. Des renforts envoyés du Brunswick permettent de rétablir les dragons et les grenadiers, et de porter les forces d'infanterie à cinq régiments. Quand la paix s'installe, ces troupes sont rapatriées, mais nombre de soldats allemands choisissent de s'établir et de faire souche au Canada. Les noms allemands portés aujourd'hui par plusieurs Québécois remontent à ces ancêtres. Les Wilhelmy, par exemple, descendent d'un soldat des Chasseurs de Hesse-Hanau. En outre, plusieurs patronymes allemands, difficiles à prononcer, furent francisés : ainsi Maher devint Maheu, Beyer devint Payeur, et Schumpff devint Jomphre.
Enfin, ces militaires allemands introduisent au Canada l'une des plus belles traditions qui existe encore l'arbre de Noël ! À la Noël de 1781, la baronne von Riedesel, épouse du général, donne une fête à leur demeure de Sorel, et les invités sont agréablement surpris d'y voir un magnifique sapin illuminé de bougies et décoré de fruits divers. L'idée plaît et se répand. Ainsi, nous devons cette coutume à des militaires allemands venus pour défendre le pays, il y a plus de deux siècles !
La guerrilla sur les frontières américaines. Retour aux anciennes méthodes
Il ne suffit pas, cependant, d'entretenir une garnison suffisamment forte pour assurer la sécurité du Canada. Il est tout aussi important désormais de maintenir les Américains sur la défensive pour les décourager de tenter une nouvelle invasion.
La solution que l'on adoptera sera la même qu'à l'époque de la Nouvelle-France : lancer des attaques-surprise en envoyant des groupes de soldats et d'Amérindiens semer la confusion et le désarroi le long des frontières américaines. Mais, cette fois, au lieu de Canadiens, ce seront des Loyalistes réfugiés au Canada qui exécuteront ces raids, appuyés par les Iroquois qui, eux aussi, sont demeurés loyaux aux Britanniques. D'ailleurs, comme la plupart des Amérindiens, les Iroquois n'aiment guère les Américains. Avant même le début des hostilités, ils avaient été soumis à de nombreuses pressions de leur part ; dans la vallée de la Susquehanna, plusieurs colons s'étaient même installés sur leurs territoires traditionnels. Dès le début de cette nouvelle phase du conflit, les Britanniques rallient donc sans aucune difficulté les Iroquois à leur cause, d'autant plus qu'au sein même de leur nation émerge un chef remarquable, dont la sympathie leur est assurée : Thayendanegea, mieux connu sous le nom de Joseph Brant.
À Niagara, durant l'automne de 1777, le major loyaliste John Butler recrute, avec l'aide de son fils Walter, les huit compagnies de Butler's Rangers, nouveau corps colonial d'infanterie légère composé de réfugiés essentiellement originaires des régions frontalières de l'ouest de l'État de New York et de la Pennsylvanie. Ces hommes ont une revanche à prendre sur leurs voisins qui les ont chassés de leurs provinces natales. À la fin de l'été de 1778, les vallées de Wyoming, de Scholarie et de la Susquehanna ont été pratiquement dévastées par les nombreux raids qu'ils y ont menés et auxquels les troupes américaines n'ont pu résister. En novembre, les Butler's Rangers et un groupe d'Iroquois attaquent avec succès Cherry Valley, et ce, malgré la présence d'un régiment américain. Celui-ci subit de lourdes pertes et se voit contraint de se réfugier dans des fortins, incapable de pourchasser les assaillants.
Les Américains sur la défensive
Ces grands raids, sans parler de multiples petites expéditions menées parallèlement, secouent les Américains. George Washington ordonne au général John Sullivan de contre-attaquer. En 1779, à la tête de quelque 3 500 soldats, Sullivan dévaste les villages iroquois, causant des dommages considérables. Plus de 2 600 Iroquois sont contraints d'aller se réfugier à l'intérieur des murs du fort Niagara. Malgré cela, les Américains ne parviennent pas à neutraliser les forces britanniques et iroquoises. De nombreuses escarmouches éclatent, généralement coûteuses pour les Américains, et Sullivan n'ose pas attaquer Oswego ni le fort Niagara, quartier général de Butler et de Brant. Malgré la destruction des villages iroquois, les raids reprennent de plus belle l'année suivante, non seulement à partir de Niagara, mais aussi de Crown Point, par des détachements du régiment loyaliste de sir John Johnson.
Un orateur indien lors d'une rencontre avec les officiers du ministère britannique des Affaires indiennes, vers 1780. Le ministère des Affaires indiennes a été un ministère militaire jusque pendant les années 1830. Son mandat était d'établir et d'entretenir des alliances avec les nations autochtones - tâche pour laquelle il a eu beaucoup de succès pendant la Révolution américaine. L'uniforme des officiers du ministère était écarlate et les endroits étaient beiges.
Le fort Stanwix est tellement harcelé par Butler et Brant que les Américains l'abandonnent en mai 1781. En 1781 et 1782, un détachement des Butler's Rangers parti de Detroit va même guerroyer jusque dans le Kentucky. Cependant, en 1781, plusieurs petits corps de Loyalistes ont été regroupés à Montréal en un bataillon de Loyal Rangers; avec l'aide d'un autre corps loyaliste, le King's Rangers, il effectue quelques expéditions de reconnaissance dans le Vermont. Durant tout le conflit, cette tactique de guérilla accule les Américains à la défensive, depuis le lac Champlain jusqu'à Detroit.
Joseph Brant, ou Thayendanegea (1742-1807), en 1776
En tant que grand chef de la nation Mohawk des Autochtones iroquois, Thayendanegea était un allié de la Couronne britannique et a dirigé ses guerriers contre les Américains.
La France et l’Espagne entrent dans la guerre. Une occasion de revanche pour les français
Du point de vue militaire, les Britanniques forcent donc les Américains à combattre sur leur propre terrain, plutôt qu'au Canada. Du point de vue diplomatique, cependant, la situation de l'Angleterre devient bientôt délicate. Au sein du forum des nations, en effet, elle ne rencontre guère de sympathie, et encore moins d'alliés pour la soutenir contre ses colonies rebelles. La France, de son côté, n'attend que le moment opportun pour se venger des humiliations de la guerre de Sept Ans. Son armée, réorganisée, modernisée et renforcée, est devenue l'une des plus redoutables d'Europe. Sa flotte de guerre, presque anéantie vingt ans auparavant, s'est enrichie de plusieurs grands vaisseaux des plus modernes et est maintenant la deuxième plus puissante au monde.
En juillet 1778, les hostilités entre la France et l'Angleterre reprennent ouvertement, et les Français connaissent aussitôt des succès aux Antilles et en haute mer. En 1779, l'Espagne entre elle aussi en guerre contre la Grande-Bretagne, suivie, l'année suivante, par la Hollande. Le conflit se mondialise et les Britanniques, débordés, sont attaqués à Minorque et à Gibraltar dans la Méditerranée, en Floride, en Inde et aux Antilles, outre qu'ils voient un puissant corps français se joindre à l'armée américaine. En octobre 1781, le général Charles Cornwallis, acculé par l'armée franco-américaine à Yorktown, en Virginie, doit capituler, mettant presque un terme aux hostilités le long du littoral atlantique. Au cours de la même année, l'armée espagnole obtient la capitulation de Pensacola, en Floride occidentale, mettant ainsi fin à toute présence britannique dans le golfe du Mexique.
Crainte de l’arrivée de navires français
Lieutenant-général Sir Frederick Haldimand, gouverneur général du Canada, vers 1770
Sir Frederick Haldimand (1718-1791) a été gouverneur général de 1778 à 1784. Il devait protéger le Canada tout en exerçant une pression sur les frontières au nord du territoire américain alors que sa garnison britannique venait tout juste d'être réduite en nombre. Il a donc eu recours aux services des troupes allemandes qui agissaient à titre de garnison pendant qu'il dirigeait les raids des loyalistes et des Mohawk sur le territoire américain. Sur ce portait, il porte l'uniforme d'un officier supérieur du 60e (Royal American) Régiment de fantassins, au début des années 1770.
À Halifax, la perspective de voir une puissante flotte de guerre française dans les parages du golfe Saint-Laurent n'a rien de rassurant. Aussi, dès que la France entre en guerre, les Britanniques organisent-ils une expédition contre les petites îles françaises de Saint-Pierre et de Miquelon, afin de neutraliser cette base navale potentielle. La garnison des îles, ne comptant que 50 hommes de la Compagnie franche de Saint-Pierre-et-Miquelon, se rend en échange des honneurs de la guerre.
Malgré ce succès, les Britanniques demeurent sur le qui-vive, non sans raison, d'ailleurs, puisque l'année suivante ils interceptent des dépêches américaines proposant une attaque française contre Terre-Neuve. Alarmés, les habitants de l'île lèvent un régiment colonial pour aider la petite garnison de troupes régulières à monter la garde. En 1780, les 350 hommes du Newfoundland Regiment sont postés à St. John's et à Placentia.
La crainte de raids navals se confirme quand des vaisseaux français attaquent des convois britanniques en route vers l'Amérique du Nord. À Québec, le gouverneur Frederick Haldimand s'inquiète lui aussi des conséquences de l'entrée de la France dans le conflit. Déjà, une déclaration du roi de France à l'adresse des Canadiens circule sous le manteau ; comment réagiraient-ils si un corps de troupes françaises débarquait sur les rives du Saint-Laurent ? Or, Haldimand n'a rien à craindre et les Canadiens rien à espérer de leur ancienne mère patrie. En effet, la France avait promis secrètement aux Américains de ne pas reprendre le Canada, ni militairement ni par traiter.
Conflit dans le Grand Nord et dans le Sud. Lapérouse dans la baie d’Hudson
En revanche, des raids français sur des territoires éloignés demeurent toujours possibles. Le 8 août 1782, les employés de la Compagnie de la baie d'Hudson occupant le fort Prince of Wales voient trois voiles se profiler à l'horizon. À mesure que les bâtiments approchent, ils réalisent avec étonnement, puis désarroi, qu'il ne s'agit pas des habituels navires marchands venus d'Angleterre pour chercher des fourrures, mais d'un vaisseau de guerre de 74 canons, le Sceptre, accompagné de deux frégates de 36 canons.
Et ces navires battent pavillon français ! À bord, outre quelques centaines de marins se trouvent 250 soldats des régiments d'Armagnac et d'Auxerrois, un détachement d'artillerie coloniale avec des pièces de campagne, ainsi que des soldats d'infanterie et d'artillerie de marine. Tout ce monde se trouve sous les ordres de Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse, navigateur audacieux appelé à devenir l'un des grands explorateurs du Pacifique. Son expédition est partie du Cap-Haïtien dans le but de dévaliser les lucratifs établissements anglais de la baie d'Hudson.
Prise du fort Prince-of-Wales
Fort Prince-de-Galles
Cette vue aérienne montre le fort Prince-de-Galles, juste à côté de la rivière Churchill (site actuel de Churchill, au Manitoba). Sa construction a été amorcée en 1717. Le fort a été pris sans bataille par une expédition française à destination de la Baie d'Hudson, en 1782. On disait de ce fort qu'il était le seul fort de pierre de cette envergure sur l'océan Arctique. Ses murs ont été restaurés dans les années 1950.
Si les Français arrivent en force, c'est parce que le fort Prince of Wales, leur objectif, est de taille à décourager toute tentative pour s'en emparer. À la suite des raids effectués par d'Iberville à la fin du XVIIe siècle dans le but de résister aux attaques futures, la Compagnie de la baie d'Hudson avait commencé à construire, en 1717, un grand fort avec bastions dans une île située près de la ville actuelle de Churchill, au Manitoba. Baptisé Prince of Wales (Prince de Galles), il est érigé en pierre de maçonnerie et muni d'une imposante artillerie. Cette construction remarquable, le seul grand fort en pierre à donner sur l'océan Arctique, se poursuit pendant une soixantaine d'années. Les employés de la Compagnie de la baie d'Hudson doivent en assurer la garde et s'exercer au maniement des armes une fois par semaine. Des décennies d'isolement paisible les ont toutefois convaincus que ces mesures militaires sont désormais inutiles - jamais plus les Français n'oseront attaquer! C'est pourquoi, lorsque Lapérouse se présente devant le fort, le gouverneur Samuel Hearne - également passé à la postérité pour ses explorations du nord canadien - ne dispose que de 80 hommes environ, Amérindiens compris, pour faire fonctionner ses 42 pièces d'artillerie ! Le lendemain matin, les troupes françaises débarquent donc « sans obstacle ». Sommés de capituler, « le gouverneur et sa garnison se rendirent à discrétion ». Le même scénario se répète à York Factory et à Severn. Après avoir embarqué les fourrures et fait sauter les forts, les Français quittent la baie d'Hudson au début du mois de septembre.
Combat en contre les espagnoles en Louisiane
L'entrée de l'Espagne dans la guerre, en juillet 1779, soulève aussi des inquiétudes chez les Britanniques sur la question de la préservation de l'Ouest. En effet, les Espagnols occupent déjà tout le territoire compris à l'ouest du Mississippi. De plus, en 1778-1779, les Américains du général George Rogers Clark, aidés par une partie des habitants de souche française, se sont déjà emparés des forts britanniques de Vincennes, Cahokia et Kaskaskia. Le territoire britannique situé au sud des Grands Lacs risque donc de passer aux mains des Espagnols et des Américains ! Pour parer le coup, les Britanniques présents à Michillimakinac décident d'attaquer Saint-Louis, capitale de l'Illinois espagnol. Cette petite ville ne dispose pour se défendre que de 29 soldats du régiment colonial Fijo de Luisiana, et de 281 miliciens, presque tous de souche française. En juillet 1780, ils parviennent néanmoins à repousser l'attaque d'une troupe hétéroclite composée d'environ 750 Amérindiens, de volontaires canadiens et de quelques soldats britanniques. À Cahokia, les Américains résistent également à une attaque britannique. L'année suivante, les Espagnols passent à l'offensive : 65 miliciens de Saint-Louis, accompagnés d'une soixantaine d'Amérindiens, s'emparent du fort Saint-Joseph. Une attaque sur Michillimakinac, poste clé de la traite des fourrures dans la région des Grands Lacs, est à craindre. Sa garnison est transférée dans un nouveau fort érigé dans l'île de Mackinac, située à proximité et jugée plus sûre. En fait, ni les Espagnols ni les Américains ne souhaitent se lancer dans un tel assaut et chacun reste sur ses positions jusqu'à la fin des hostilités.
Les Britanniques perdent la guerre
À la fin de 1782, les armées britanniques en Amérique du Nord ne se maintiennent plus qu'à quelques endroits au sud du Canada : à New York, à Charleston, en Caroline du Sud et dans l'est de la Floride. Les Américains et les Espagnols sont en possession de tout le reste du territoire à l'est du Mississippi. Ailleurs dans le monde, la situation des Britanniques est loin d'être enviable. Conservant peu d'espoir de voir leur situation militaire se redresser, ils entament donc des pourparlers de paix. Le 20 janvier 1783, un armistice est proclamé à la suite de la signature d'ententes préliminaires, ententes qui seront formellement ratifiées par le traité de Versailles, le 3 septembre suivant. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la géographie n'est guère modifiée, sinon par le fait que les Britanniques cèdent quelques îles antillaises aux Français et celle de Minorque aux Espagnols. En Amérique du Nord, en revanche, les changements sont majeurs. L'Angleterre reconnaît l'indépendance de ses Treize anciennes colonies, devenues les États-Unis d'Amérique. L'Espagne récupère la Floride et conserve tout le territoire pris aux Britanniques sur le golfe du Mexique. Même les îles Saint-Pierre et Miquelon redeviennent françaises. La Grande-Bretagne perd ainsi tout son empire nord-américain, au sud du Canada.
L’arrivée des Loyalistes. Une nouvelle population
Hommes du Régiment royal du Roi, New York, s'installant à Johnstown en 1784
Cette aquarelle contemporaine illustre un campement de vétérans loyalistes et leur famille, à Johnstown (aujourd'hui Cornwall en Ontario), en 1784. Certains de ces hommes du Régiment royal du roi, de New York, portent encore leur manteau rouge.
Pour les Canadiens de souche française qui espèrent encore que le Canada, à l'exception des provinces maritimes, soit restitué à la France, le traité de Versailles marque la fin des illusions. L'Angleterre est humiliée à son tour, mais le Canada demeure colonie britannique. Par ailleurs, un sérieux problème humain se pose : celui des milliers d'Américains loyalistes qui ont combattu aux côtés des Britanniques dans leurs anciennes colonies. Ces hommes ne peuvent rester aux États-Unis avec leurs familles sans s'exposer à des représailles. Il faut donc les évacuer. C'est ainsi qu'en 1783 et 1784, environ 40 000 Loyalistes - hommes, femmes et enfants - se réfugient au Canada. La plupart proviennent de régiments de volontaires loyalistes licenciés, et s'établissent dans une nouvelle province créée pour eux, le Nouveau-Brunswick. Beaucoup d'autres se fixent en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Les régiments loyalistes formés au Canada durant la guerre sont également licenciés. Les hommes du King's Royal Regiment of New York et des Loyal Rangers s'établissent dans l'est de l'Ontario avec leurs familles, tandis que les 469 soldats des Butler's Rangers avec leurs 111 femmes et 257 enfants se voient offrir des terres dans la péninsule de Niagara.
Dans l'immédiat, ces milliers de vétérans loyalistes fournissent un excellent potentiel défensif contre toute agression éventuelle des États-Unis. Mais, à long terme, ils modifient radicalement la composition de la population du pays. Dix ans plus tôt, à l'époque de l'Acte de Québec, un tel afflux démographique était absolument imprévisible. Les provinces maritimes ne disposaient que d'une population modeste, et la vallée du Saint-Laurent était massivement française. Avec l'arrivée de ces dizaines de milliers d'Américains de langue anglaise, de religion protestante et farouchement attachés aux valeurs britanniques, tout allait changer.
Tension entre les nouveaux venus et les habitants de longue date
Des tensions sont à prévoir entre ceux-ci et les Canadiens de souche française. Il y en a effectivement dès le début, et encore de nos jours entre les descendants de chaque groupe. Les gouvernants britanniques tentent, dans l'ensemble, de minimiser les préjugés réciproques, et obtiennent un certain succès. Après tout, au-delà de leurs différences, les deux groupes possèdent aussi certaines affinités. Les Loyalistes ont essuyé une terrible défaite qui les a chassés de leur patrie, et les Canadiens français se sont vu livrer aux Britanniques à la suite d'une défaite semblable. Les deux groupes possèdent une forte tradition militaire, puisqu'ils sont composés en grande partie d'anciens combattants - miliciens ou soldats. Enfin, et surtout, chaque groupe soupçonne, à sa manière, les Américains de nourrir de sombres projets d'invasion au Canada.
Les motifs de méfiance envers les Américains diffèrent selon les groupes. Pour les Canadiens anglais issus des Loyalistes, il n'est pas question d'adopter un modèle politique républicain ; ils conservent aussi une mémoire collective douloureuse de leurs anciens compatriotes. Les Canadiens français ne sont ni séduits par la royauté britannique ni très hostiles aux Américains, mais leur intérêt principal réside dans le maintien de leur langue, de leur religion et de leurs lois, ce que les Britanniques leur garantissent. Donc, au-delà des préjugés et des rivalités, chaque groupe sait qu'il doit s'unir à l'autre pour aider les troupes britanniques à repousser toute tentative d'invasion américaine.
Enfin, les Loyalistes ne sont pas tous de souche britannique, on compte parmi eux des Iroquois que la fin de la guerre laisse à la merci des Américains, puisque leur territoire traditionnel se trouvait dans l'État de New York. Le chef Joseph Brant obtient du gouverneur Haldimand la cession de la vallée de la rivière Grand (dans la région de Brantford, en Ontario) et, en 1784, environ 400 Agniers quittent leurs terres ancestrales pour aller s'y établir. D'autres s'installent dans l'est de l'Ontario et dans la région de Montréal. Ceux-ci ont également leurs raisons de se méfier des Américains.
La côte du Pacifique convoitée
Le nouveau théâtre d'opérations des conflits européens.Un océan espagnol
Alors même que se déroulent les guerres qui opposent les Français aux Britanniques, puis ces derniers aux Américains, les territoires qui se trouvent à l'ouest des Prairies demeurent totalement inconnus. Personne n'a encore traversé le continent, que ce soit par voie terrestre, à travers les montagnes Rocheuses, réputées infranchissables, ou en navire, par l'énigmatique passage du Nord-Ouest. Au XVIIIe siècle, toutefois, une série d'événements projetteront la côte nord-ouest du continent nord-américain sur la scène mondiale. Les grandes puissances frôleront même la guerre pour maintenir leurs intérêts géostratégiques dans cette partie du globe qui, à terme, deviendra la rive canadienne du Pacifique.
Jusqu'au XVIIIe siècle, l'océan Pacifique est encore presque inconnu, seuls quelques explorateurs ayant osé s'y aventurer. Au XVIe siècle, les Espagnols ont été les premiers à établir des colonies sur cette côte de l'Amérique, ainsi qu'aux Philippines, en Extrême-Orient. Ils inaugurent aussi la première liaison régulière transpacifique avec leurs fameux « galions de Manille » faisant la navette entre Manille, aux Philippines, et Acapulco, au Mexique. Peu à peu, les Espagnols en viennent à considérer le Pacifique comme leur propre domaine, puisqu'ils contrôlent toute la côte ouest de l'Amérique, depuis le cap Horn, au Chili, jusqu'au nord du Mexique. Les établissements espagnols échelonnés le long de cet immense littoral n'ont jamais été menacés, si ce n'est par quelques rares pirates ou corsaires particulièrement téméraires, et il ne s'y trouve aucune autre colonie européenne.
Le défit russe
À partir de 1725, cette situation change quand, depuis sa capitale de Saint-Pétersbourg, le tsar de Russie, Pierre Ier, charge Vitus Jonassen Béring, capitaine de la marine impériale russe, de trouver un passage vers l'Amérique via la Sibérie. En 1741, Béring et le capitaine Alexis Chirikov atteignent l'Alaska. Au cours des décennies suivantes, des commerçants russes à la recherche de fourrures fréquentent le littoral jusqu'au nord de la Colombie-Britannique actuelle. Au cours des années 1760, l'ambassade espagnole à Saint-Pétersbourg rapporte des nouvelles alarmantes : les Russes songent à s'établir sur la côte du Pacifique, au nord du Mexique, compromettant, par là même, la sécurité de la Nouvelle-Espagne ! Cette colonie occupe alors un vaste territoire, riche en mines d'argent, qui comprend l'Amérique centrale, le Mexique et le sud-ouest des États-Unis actuels. Mis au courant des ambitions russes, le marquis de Croix, vice-roi de la Nouvelle-Espagne, adopte des mesures énergiques pour contrer ces visées : il ordonne la construction d'une base navale militaire à San Blas, au nord-ouest du Mexique, et l'exploration de l'Alta California (État actuel de la Californie), en vue de sa colonisation.
Premières explorations de la côte Nord-Ouest
Lieutenant Esteban José Martinez Fernandez y Martinez de la Sierra, Marina real, vers 1785. Martinez (1742-1798), portant ici l'uniforme de grande tenue des lieutenants de la Marina real (marine espagnole), était une personnalité importante de l'exploration espagnole sur la côte du Nord-Ouest de l'Amérique. En 1774, il était commandant en second de la frégate espagnole Santiago, qui a établi le premier contact répertorié avec les Haïda dans l'Archipel de la Reine-Charlotte. En 1790, Martinez est l'officier qui a presque mené l'Espagne et la Grande-Bretagne à la guerre en raison de son comportement lors de la pause diplomatique à Nootka.
Avant ces événements, les Espagnols n'ont pas réellement exploré la côte ouest à la latitude du Canada actuel, s'étant limités à effectuer quelques voyages de reconnaissance. Ils ne possèdent par conséquent aucune carte fiable des lieux. Le vice-roi Antonio Maria Bucareli y Ursua, qui succède au marquis de Croix, charge donc la marine d'explorer le littoral au nord de la Californie, non seulement pour localiser les Russes, mais aussi pour faire des relevés cartographiques précis. En janvier 1774, l'enseigne Juan Josef Pérez Hernandez, commandant la frégate Santiago, quitte San Blas pour faire voile vers le nord. Outre son second, Estebàn José Martinez, un aumônier et un chirurgien, son équipage se compose de 84 marins, dont un canonnier. Aucun soldat ne se trouve à bord, mais une douzaine de marins ont été entraînés au maniement des armes et peuvent remplir ce rôle, au besoin. Le vice-roi a formellement ordonné d'éviter tout combat avec les autochtones.
Le 18 juillet 1774, la vigie du Santiago signale une terre à l'horizon : l'extrémité nord de ce qui est aujourd'hui l'archipel de la Reine-Charlotte, en Colombie-Britannique.
Sans le savoir, Pérez et ses hommes sont les premiers Européens à atteindre cette partie de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, et à rencontrer les Haïdas. Ceux-ci viennent au-devant d'eux à bord de grands canots, dont l'un transporte jusqu'à 22 rameurs et un tambour. Impressionnés par le degré avancé de civilisation de ces Amérindiens, les Espagnols jugent plus prudent de ne pas s'aventurer à terre, mais procèdent néanmoins à des échanges avec eux. Après avoir poursuivi sa route vers le nord pendant quelques jours, Pérez vire de bord, mettant ensuite le cap vers le sud. Le 7 août, il arrive à proximité de Nootka, dans l'île de Vancouver. Tout comme les Haïdas, les Amérindiens nootkas s'approchent du Santiago à bord de canots. Les rapports sont très cordiaux ; Espagnols et Nootkas trafiquent, les premiers offrant des biens divers, dont des cuillères d'argent, et recevant en retour des peaux et plusieurs autres objets, notamment des chapeaux finement tressés, ornés de scènes de chasse à la baleine. Cette fois, Pérez voudrait aller à terre, mais le mauvais temps l'en empêche. Finalement, le Santiago remet le cap vers le sud et regagne le Mexique.
Les « Vikings du Pacifique Nord. Des nations amérindiennes
Pendant leurs expéditions, les Espagnols devaient parfois utiliser leurs fusils et canons pour garder les Amérindiens à la baie. Ce dessin de 1792 illustre un incident survenu pendant l'expédition espagnole visant à atteindre l'île de Vancouver. Les Européens utilisent leurs fusils et canons pour garder les Autochtones près de la baie.
À l'époque de ces premières explorations européennes, la côte ouest est habitée par un grand nombre de petites nations amérindiennes formant plusieurs groupes linguistiques. Au nord, dans l'Alaska actuel, se trouvent les Tlinglits. Les îles de la Reine-Charlotte abritent le domaine des Haïdas, tandis que le long des côtes, sur la terre ferme, à la même latitude habitent les Tsimshians. Le territoire des Nootkas (aussi appelés Wakashans) s'étend jusqu'au sud de l'île de Vancouver, et celui des Salish comprend l'est de l'île ainsi que la terre ferme, le long du littoral.
Ces peuples sont à la fois sédentaires et navigateurs, la nature se montrant fort généreuse dans leur lieu d'établissement. On y trouve du poisson en abondance et la forêt côtière regorge de cèdres incomparables, dont ils tirent grand profit, construisant des maisons de planches et fabriquant des canots pour chasser la baleine, car ce sont des marins et des pêcheurs hors pair. Leur art reflète le degré de leur raffinement culturel.
De redoutables guerriers
Ces mêmes peuples se révèlent aussi de redoutables combattants qui, à l'instar des autres nations autochtones nord-américaines, accordent à la guerre un rôle primordial. Ils ne connaissent pas les armes à feu et leur discipline s'apparente à celle de guerriers plutôt que de soldats. Leurs tactiques reposent, d'après ce dont on peut en juger aujourd'hui, sur des attaques massives plutôt que sur des attaques-surprise. Parmi leurs ruses les plus redoutables figure celle qui consiste à feindre l'amitié pour mieux attaquer à l'improviste. Armés d'arcs et de flèches, de javelots, de gourdins et de dagues (des lames taillées dans des os), les guerriers combattent nus, ou protégés par des armures en lattes de bois ou en cordage tressé. Certains se coiffent de magnifiques casques en bois sculpté et peint représentant des têtes d'animaux.
L'art de la guerre dans le Nord-Ouest américain
Les nations côtières, qui se composent essentiellement de navigateurs, attaquent souvent des villages ou des forts ennemis à bord de flottilles de canots. Ces grandes embarcations, richement décorées, peuvent atteindre vingt mètres de long.
Elles s'avèrent particulièrement rapides et efficaces lorsqu'elles sont propulsées à la force des bras par de nombreux rameurs. Quand les pagayeurs soutiennent une cadence rapide, de tels canots dépassent la vitesse de sept nœuds marins, allure supérieure à celle d'une frégate européenne. Ces peuples connaissent aussi l'usage de la voile. Les raids qu'ils effectuent par ce moyen ont surtout pour but de faire des prisonniers, gardés comme esclaves. Dans certains villages dont les expéditions sont régulièrement couronnées de succès, le tiers de la population peut être composé d'esclaves. Contrairement aux autochtones de l'est et du centre, ceux de la côte du Pacifique ne pratiquent pas la torture rituelle et ne lèvent pas de scalps, mais tranchent la tête de l'ennemi tué qu'ils gardent en guise de trophée. Tant pour leur bravoure que pour leur habileté à naviguer, on les a parfois nommés les « Vikings du Pacifique Nord ».
Outre leurs imposants villages, ces peuples bâtissent des forts côtiers à l'aide de hauts troncs de cèdre. Ils en érigent également au sommet des collines et le long des rivières, afin de contrôler et de taxer le trafic maritime sur les cours d'eau qu'ils dominent. Des fouilles archéologiques récentes ont fait connaître le fort de Kitwanga, sur un promontoire de ce type situé en amont de la rivière Skeena, mais il y en a bien d'autres, qui constituent autant de postes de péage. À l'occasion, un désaccord relatif au droit de passage peut provoquer un siège, au cours duquel les assaillants tenteront d'incendier le fort, pendant que ses défenseurs feront débouler sur eux, du haut des palissades, des troncs d'arbres.
L'art militaire des peuples de la côte nord-ouest de l'Amérique est donc passablement développé et ceux-ci constituent potentiellement de redoutables adversaires pour les Européens. D'ailleurs, lorsqu’auront lieu les premiers contacts, ils ne manifesteront aucune crainte à l'endroit de ces nouveaux venus blancs arrivant sur de grands navires à voile.
Nouvelles explorations espagnoles. Les espagnos reprennent leurs expéditions
Capitaine Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Marina real, vers 1785. L'officier de marine et explorateur espagnol Juan Francisco de la Bodega y Quadra (1743-1794) porte l'uniforme de grande tenue d'un capitaine de la Marina real (marine espagnole). Bodega y Quadra était le représentant espagnol au sein de la commission de 1792 qui a conclu l'entente de Nootka Bay en collaboration avec l'officier et explorateur britannique, George Vancouver.
À la première expédition espagnole, effectuée par Pérez en 1774, succède, l'année suivante, celle placée sous les ordres du lieutenant Bruno de Hezeta. Elle compte deux bâtiments : le Santiago, commandé par Hezeta lui-même, et la goélette Sonora, commandée par son second, le lieutenant Juan Francisco de la Bodega y Quadra. Le vice-roi Bucareli avait réalisé que l'erreur principale de l'expédition précédente, c'est-à-dire n'envoyer qu'un seul navire, avait obligé Pérez à se montrer excessivement prudent, dans ses explorations comme dans ses rencontres avec les Amérindiens. Cette fois, le vice-roi tient particulièrement à ce que les explorateurs mettent pied à terre, afin que les territoires nouvellement découverts soient reconnus comme appartenance espagnole. Enfin, il souhaite surtout que l'on repère les établissements russes.
Conflit avec les peuples locaux
Durant leur voyage vers le nord, les deux navires sont éprouvés par de nombreuses tempêtes, et la maladie se déclare au sein des équipages. En juillet 1775, ils parviennent aux environs de Point Grenville, dans l'actuel État de Washington. Les Amérindiens ayant apparemment manifesté des signes de cordialité, un détachement de sept marins est envoyé à terre pour obtenir de l'eau potable et du bois de chauffage. À peine débarqués sur la plage, ils sont massacrés en quelques instants par environ 300 Amérindiens surgis des bois, sous l'œil horrifié de leurs compagnons restés à bord des navires. Bodega fait ouvrir le feu, mais son navire est trop éloigné.
Ébranlé par ce désastre, Hezeta décide de retourner au Mexique, mais Bodega refuse de le suivre sans avoir rempli l'essentiel de leur mission : localiser les Russes. Il continue vers le nord à bord du Sonora et se rend jusqu'au 58e degré de latitude nord, en Alaska. Dans une grande baie qu'il nomme Bucareli, Bodega met pied à terre avec son équipage afin d'exécuter l'acte formel de prise de possession territoriale au nom de Carlos III, roi d'Espagne et des Indes occidentales, tel que spécifié par le vice-roi. Puis, n'ayant vu aucun Russe, Bodega se dirige vers le sud, prenant des relevés en longeant la côte. Après cette expédition, il devient clair pour les Espagnols que les Russes tant redoutés ne constituent pas une menace très sérieuse. Certains se demandent même s'il faut continuer l'exploration de cette côte, puisqu'il n'est pas question d'y fonder d'établissement.
Cook et les Britanniques entrent en scène. A la recherche du passage du Nord-Ouest
Capitaine James Cook, Marine royale, dans les années 1770. James Cook (1728-1779) fut l'un des officiers de la marine britannique les plus connus du 18e siècle. Mieux connu pour ses explorations dans le Pacifique Sud, Cook a également apporté une importante contribution pour l'histoire du Canada. Ses cartes du fleuve Saint-Laurent, datant de 1759, ont été cruciales au succès des attaques britanniques sur Québec cette année-là. Il a également consacré cinq saisons à tracer la carte des côtes de Terre-Neuve. Finalement, en 1778, pendant son dernier voyage, l'explorateur a levé la carte de certaines sections de la côte de la Colombie-Britannique alors qu'il était à la recherche du passage du Nord-Ouest. Cette gravure est inspirée d'un portrait de 1776. Cook porte l'uniforme de grande tenue d'un capitaine de la Marine royale porté de 1774 à 1787, ainsi qu'une perruque grise.
Entre-temps, d'autres pays ont également commencé à s'intéresser au Pacifique. Louis-Antoine de Bougainville, vétéran de l'état-major de Montcalm au Canada, avait exploré le Pacifique Sud durant les années 1760, tout comme un autre participant du siège de Québec, le Britannique James Cook, capitaine de la Royal Navy. C'est à cet explorateur émérite, ayant déjà effectué deux circumnavigations, que le gouvernement britannique confie la mission d'explorer la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord. Cook doit tenter de trouver l'entrée d'un éventuel passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire d'une voie maritime qui relierait le Pacifique à l'Atlantique en contournant le continent nord-américain.
Des cartes russes, publiées en 1774, représentent l'Alaska comme une île, longée par un large détroit du côté du continent américain. En 1771, l'explorateur Samuel Hearne, de la Compagnie de la baie d'Hudson, s'était rendu jusqu'à l'embouchure de la rivière Coppermine, dans les Territoires du Nord-Ouest, par voie de terre, et avait aperçu le littoral de l'Arctique. Ces informations permettent de croire en l'existence d'un passage du Nord-Ouest d'une importance stratégique immense pour le Canada ; s'il existe réellement, la Grande-Bretagne se doit alors de le contrôler.
Le 12 juillet 1776, le HMS Discovery, de 12 canons, ayant à son bord 22 officiers, 71 marins et 20 soldats d'infanterie de marine, et le HMS Resolution, avec 81 officiers et marins, quittent Plymouth. Cook a reçu l'instruction de ne pas s'opposer aux prétentions territoriales espagnoles ou russes. Mais il doit prendre possession des territoires « utiles », au nom du roi, avec l'accord des autochtones.
Navires de l'expédition de Cook à Nootka, en 1778. Cette gravure est inspirée d'un dessin de John Webber, l'artiste officiel du capitaine Cook, lors du troisième voyage sur le Pacifique (1776-1779). Les Navires de sa Majesté Resolution et Discovery sont ancrés à Ship Cove près de Nootka Sound. L'expédition a pris une pause à cet endroit en avril 1778 pour effectuer un radoub. Une série d'observations astronomiques ont été effectuées à partir d'un observatoire temporaire érigé sur la côte. On peut voir les tentes et les instruments de l'observatoire à gauche. Des habitants de la région observent les visiteurs.
En mars 1778, Cook atteint la côte nord-ouest de l'Amérique et entreprend de la longer. Le 29 mars, ses deux navires jettent l'ancre dans le havre de Nootka, face au village de Yuquot. Les Européens l'ont déjà approchée, mais c'est la première fois qu'ils y débarquent. Cook et ses hommes sont reçus amicalement par le chef, Muquinna. Les relations sont d'abord excellentes et les échanges jugés très fructueux de part et d'autre. Les Anglais constatent que les Amérindiens possèdent quelques outils en fer et deux cuillères en argent, preuve qu'ils ont déjà été en contact, directement ou pas, avec des Européens.
Le capitaine James Cook rencontrant les dirigeants de Nootka à Nootka Sound, en 1778
Le Capitaine James Cook (1728-1779) rencontre le chef Muquinna de Nootka (décédé en 1798) à Nootka Sound (lieu actuel de l'île de Vancouver) en 1778, pendant ses explorations de la côte Nord-Ouest du Canada.
Ces bonnes relations se gâtent quelque peu par la suite, quand certains membres de l'expédition accusent les Amérindiens de leur avoir volé des objets. Cook fait alors construire un observatoire provisoire. Il donne l'ordre aux hommes affectés à cette tâche de travailler en armes, mais les Amérindiens lui font comprendre qu'ils sont rarement armés et qu'ils ne veulent pas l'attaquer. Pour qu'ils sachent bien à quoi ils s'exposent s'ils deviennent hostiles, le lieutenant James Williamson leur fait une démonstration de tir ; à l'aide d'un fusil, il tire sur un manteau de peau de loutre marine à vingt mètres de distance, la transperçant de plusieurs gros trous. La puissance de l'arme à feu provoque l'effet escompté, car les Amérindiens « se regardèrent pendant un long moment, surpris, craintifs et silencieux». Cet ouvrage achevé, Cook effectue des relevés très précis de sa position. Le 28 avril, après avoir radoubé ses navires et restauré ses hommes, il reprend la mer, cinglant vers le nord.
Vers le nord et l’Alaska
Le mauvais temps force Cook à se tenir au large et il ne revoit la terre qu'en Alaska. Il longe alors la côte jusqu'au détroit de Béring, mais se heurte bientôt à une véritable muraille de glace, qui le contraint à rebrousser chemin sans avoir trouvé l'entrée du passage du Nord-Ouest. Il est finalement tué au début de l'année suivante par des indigènes dans les îles Hawaï, mais le reste de son expédition parvient à regagner l'Angleterre. Après cette extraordinaire reconnaissance du Pacifique, l'existence d'un passage du Nord-Ouest, entre Nootka et l'Alaska, est sérieusement remise en question. Contrairement aux Russes et aux Espagnols, qui gardaient les résultats de leurs explorations secrets, les Britanniques publient le récit et les excellentes cartes du voyage de Cook en 1784. Ils ont compris qu'en rendant publiques leurs découvertes, ils se dotent d'un avantage considérable si des contestations devaient s'élever par la suite.
Cette ouverture s'inscrivait d'ailleurs dans une nouvelle tendance apparue durant le Siècle des lumières, qui devait atteindre son apogée avec les explorations du Pacifique : la reconnaissance du principe selon lequel la sécurité des navires et de leurs occupants transcende la question des frontières nationales. Une nation qui diffuse ses connaissances scientifiques et cartographiques pour en faire bénéficier toutes les autres voit son prestige sensiblement accru.
Réaction espagnole
Cependant, à Madrid, les autorités espagnoles redoutent les conséquences de l'expédition de Cook, dont les préparatifs leur ont été signalés dès 1776 par des espions à leur solde. Ayant ordonné au vice-roi Bucareli de s'opposer à Cook s'il atteignait la Californie, celui-ci avait répondu que de tels ordres étaient diplomatiquement risqués, tout en étant irréalisables avec les moyens dont il disposait. Il avait même retardé le départ d'une nouvelle expédition vers le nord, et ce jusqu'en 1779.
Enfin, le 11 février de la même année, les frégates Princesa et Favorita, sous le commandement du lieutenant Ignacio de Arteaga et de son second, le lieutenant Bodega, quittent San Blas. Ces deux hommes ont pour mission d'explorer la côte nord-ouest, et non d'intervenir contre les navigateurs anglais. Le seul fait de croiser ces derniers suffira pour confirmer la présence de l'Espagne dans cette région. La rencontre n'a cependant pas lieu. Cook est parti depuis longtemps déjà quand les frégates espagnoles arrivent à Nootka, en juillet 1779, après avoir longé la côte de l'Alaska. Arteaga et Bodega rapportent des relevés détaillés, qui sont consignés aux archives avec ceux des expéditions antérieures, car l'Espagne est maintenant en guerre contre l'Angleterre et sa marine mobilisée à des fins de combat plutôt que d'exploration.
Après le retour de la paix, en 1783, les Espagnols ne reprennent pas immédiatement leurs expéditions vers le nord, les considérant désormais comme inutiles. En 1786, l'arrivée en Californie d'une expédition française dirigée par Lapérouse les fait changer d'opinion. Celui-ci confirme aux Espagnols non seulement l'existence en Alaska de postes russes, mais aussi la présence, sur la côte nord-ouest, de navires marchands anglais venus commercer avec les Amérindiens. En effet, les voyages de Cook avaient révélé que des profits extraordinaires pouvaient être tirés de la vente en Chine de fourrures obtenues sur la côte nord-ouest du Pacifique.
Par conséquent, en janvier 1787, le roi Carlos III ordonne la reprise des expéditions espagnoles. L'année suivante, le Princesa et le San Carlos remontent le long de la côte jusqu'à l'île Kodiack, en Alaska. Chemin faisant, l'enseigne de vaisseau Estebàn José Martinez, qui les commande, constate en effet que plusieurs navires marchands anglais et américains fréquentent la région. De retour au Mexique, il s'empresse de recommander l'établissement d'un fort à Nootka afin de protéger les droits de l'Espagne.
Projets russes, britanniques et espagnols. La présence russe
Malgré toutes les craintes que suscitent les Russes, leur présence en Alaska est beaucoup moins importante qu'on ne le pense alors. Ils y possèdent seulement quelques petits postes de commerce dotés d'une infime population, et n'y entretiennent pas de troupes en garnison ni de navires de leur marine de guerre. Cependant, les explorations anglaises, espagnoles et françaises finissent par inquiéter les autorités impériales et, en décembre 1786, la tsarine Catherine II ordonne à la marine impériale d'organiser une expédition vers les côtes de l'Alaska. Les marchands étrangers devront être chassés et la souveraineté de la Russie sera proclamée sur tout le territoire situé au nord du 55e degré de latitude (au nord des îles de la Reine-Charlotte) au moyen de balises, de prises de possession officielles et de patrouilles effectuées par des navires de guerre. Des relevés scientifiques et cartographiques détaillés devront également être exécutés. L'amirauté russe assigne quatre navires de guerre et un navire de transport à l'expédition, qui doit compter 34 officiers, 639 marins et soldats, ainsi que des hommes de science. Le commandement en est confié au capitaine Gregorii Ivanovich Mulovskii, jeune officier talentueux, âgé de 29 ans seulement. L'expédition doit partir en 1789 et son retour est prévu pour 1791, mais, à la fin de l'été 1787, la guerre éclate entre la Russie, la Turquie et la Suède, de sorte que l'impératrice juge préférable d'annuler l'opération.
Plans d'implantation d'une colonie britannique dans la baie Nootka
Les Russes ne sont pas les seuls à nourrir des ambitions impérialistes dans le Pacifique. Les Britanniques passent à l'action en Australie avec la fondation de Port Jackson, en janvier 1788. Ils projettent aussi de fonder un établissement sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, non seulement pour servir de port d'attache aux navires marchands anglais, mais surtout dans un but géostratégique d'envergure : assurer l'hégémonie britannique de l'Atlantique au Pacifique sur l'ensemble de la partie septentrionale de l'Amérique du Nord !
En 1789, le gouvernement britannique prépare une imposante expédition afin d'établir une colonie à Nootka. Le navire d'exploration HMS Discovery se rendra dans le Pacifique, escorté par le HMS Gorgon, grosse frégate de 44 canons. À Hawaï, ils rencontreront le HMS Sirius, frégate de 28 canons. À partir de là, les trois bâtiments navigueront de conserve jusqu'à l'île de Vancouver afin d'y établir une petite base navale, au printemps de 1791. Parallèlement, le gouverneur général du Canada organise une expédition qui partira de Montréal pour se rendre à la côte du Pacifique par voie de terre - ce qui n'avait encore jamais été accompli -, afin d'opérer une liaison transcontinentale avec l'expédition partie d'Angleterre. Toutefois, cet ambitieux projet britannique tournera vite court.
Poursuite des explorations espagnoles
Capitaine Alejandro Malaspina, Marina real, vers 1795
Ce portrait de 1795 illustre Alejandro Malaspina (1754-1810) portant l'uniforme d'un capitaine de la Marina real (ou marine espagnole). Malaspina était un scientifique reconnu et a commandé l'expédition espagnole de 1789-1795 qui a fait le tour du globe. Les navires de Malaspina ont visité Nootka sur la côte de la Colombie-Britannique, en août 1791. Une intrigue politique en rapport avec la corruption de la Cour espagnole a mené à l'arrestation de Malaspina pour trahison en 1796. La carrière de l'explorateur a été interrompue prématurément. Museo naval, Madrid.
Par ailleurs, dès 1788, l'Espagne prépare également une expédition dans le Pacifique, d'une visée à la fois « scientifique et politique ». Elle sera commandée par l'un des chefs de file du monde scientifique espagnol, le capitaine Alejandro Malaspina. Malgré ces objectifs d'un autre ordre, l'aspect militaire de l'expédition s'avère fort important. En effet, d'après les instructions qu'il a reçues, Malaspina doit repérer des havres propres à constituer des bases pour les navires de guerre espagnols, évaluer la sécurité et la défense du commerce maritime colonial, et constater l'état d'avancement des établissements européens dans le Pacifique, particulièrement ceux des Britanniques en Australie. Une partie de son périple comprendra aussi une exploration détaillée de la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord, à la hauteur de la Colombie-Britannique actuelle. Deux corvettes, la Descubierta et l'Atrevida, dotées des meilleurs instruments scientifiques et portant chacune 24 canons, sont construites en vue de la réalisation de ce projet, et l'expédition de Malaspina quitte Cadix à la date prévue, le 30 juillet 1789, pour se diriger vers le Pacifique.
L'incident de Nootka. L’Espagne veut assurer sa souverainnetée
Au Mexique, le vice-roi Manuel Antonioflôrez approuve la suggestion de Martinez d'occuper Nootka. En février 1789, le Princesa et le San Carlos font voile vers Nootka pour y construire un poste provisoire suffisant pour garantir la souveraineté espagnole. Outre leur équipage, les deux bâtiments transportent 31 soldats. Martinez, qui commande l'expédition, doit veiller à ce que les navires étrangers reconnaissent l'autorité espagnole, sans toutefois avoir recours à la force. Mais en arrivant à Nootka, le 5 mai, il a la surprise d'y trouver trois navires marchands à l'ancre ! Deux d'entre eux sont américains, ce qui ne pose guère de problème, ces derniers n'étant pas considérés comme menaçants du point de vue des revendications espagnoles. Cependant, le troisième navire, l'Efigenia Nubiana, n'a manifestement de portugais que son pavillon et son « capitaine », tout l'équipage étant anglais. Martinez en conclut qu'il s'agit d'un bâtiment britannique naviguant sous un pavillon de convenance. De plus, il apprend par des autochtones qu'une expédition commerciale anglaise sous le commandement de John Meares - un ancien lieutenant de la Royal Navy - s'est non seulement arrêtée à Nootka l'année précédente pour commercer, mais qu'elle y a aussi érigé des abris temporaires et même construit un petit navire, le North West America.
Une inquiétante présence britannique
Afin de raffermir la mainmise espagnole sur la région, Martinez commence donc immédiatement à ériger une plate-forme d'artillerie et quelques bâtisses. Les travaux vont bon train quand, le 2 juillet, un navire britannique commandé par le capitaine James Colnett, l'Argonaut, arrive de Chine, ayant à bord, outre le personnel navigant, 28 ouvriers chinois et un équipement considérable. Pour comble, Colnett déclare à Martinez avoir reçu de son roi l'ordre d'édifier un établissement à Nootka !
Il n'en faut pas plus pour que Martinez conclue à un complot anglais dont l'objectif est d'envahir la côte nord-ouest et d'en expulser sa nation. Colnett, par ailleurs, ne tient pas à se soumettre à l'autorité espagnole. Au cours d'une discussion, les deux commandants, dotés l'un et l'autre d'un tempérament bouillant, finissent par s'emporter et Colnett met la main à son épée. Martinez saisit ce prétexte pour l'arrêter et s'emparer de son navire. Peu après, le 12 juillet, un autre navire britannique, le Princess Royal, arrive à son tour à Nootka en provenance de Chine. Martinez décide de régler le problème une fois pour toutes et, outrepassant ses instructions, saisit tous les navires anglais pour les envoyer à la base navale de San Blas, au Mexique !
Troubles autour de la première colonie de peuplement européenne
Soldat, Primera Compañia franca de Voluntarios de Cataluña à Nootka, 1790-1794
La Primera Compañia franca de Voluntarios de Cataluña (ou première compagnie franche de volontaires catalans) était une unité coloniale espagnole formée en 1767 pour servir en Amérique. En 1790, elle a détaché des hommes pour la garnison espagnole en poste à Nootka. Il s'agissait alors de la première unité militaire européenne en poste sur le site actuel de la Colombie-Britannique. L'uniforme des membres de cette unité ressemblait beaucoup à celui de son régiment parent en Espagne, le Segundo Regimiento de los Voluntarios de Cataluña (ou second régiment de volontaires catalans), avec le même manteau bleu, le col et les manchettes jaunes, le gilet jaune, les culottes bleues et le tricorne noir, ainsi que la cocarde rouge des rois bourbons d'Espagne.
Jusqu'alors, les Amérindiens s'étaient tenus à l'écart de ces disputes entre Blancs. Cependant, les saisies espagnoles les empêchent de commercer avec les Britanniques, ce qui leur déplaît souverainement ! Mécontent et irrité, un de leurs chefs, Callicum, va à la rencontre du commandant Martinez, et ce qu'il crie, depuis sa pirogue, est pris pour des insultes. Cédant à son tempérament impulsif, Martinez tire un coup de feu en l'air pour l'intimider. Mais voilà qu'un marin de l'équipage, croyant que son commandant a manqué la cible, épaule à son tour, vise, et tue Callicum ! Funeste erreur que les propagandistes britanniques ne manqueront pas d'utiliser ultérieurement... Martinez demeure à Nootka avec ses hommes jusqu'à l'automne, puis reçoit l'ordre de rentrer à San Blas afin de s'expliquer devant les autorités pour avoir saisi des navires anglais en temps de paix.
Malgré ces incidents, les Espagnols décident de rendre permanent leur poste militaire de la baie de Nootka. Le 3 avril 1790, trois de leurs navires, sous le commandement du lieutenant Francisco de Eliza y Reventa, jettent l'ancre, et les travaux de construction reprennent aussitôt. Bientôt, une batterie de canons défend l'entrée du port, tandis que des casernes pour les soldats et une villa pour les officiers sont érigées. Près de 80 militaires, portant l'uniforme bleu relevé de jaune de la première compagnie des Voluntarios de Cataluna, sous le commandement du lieutenant-colonel Pedro de Alberni, s'y installent. Ces volontaires ne sont cependant catalans que de nom. Il s'agit en réalité d'un corps de l'armée coloniale de la Nouvelle-Espagne, dont la plupart des hommes ont été recrutés au Mexique.
Ce « présidio », comme les Espagnols appellent leurs forts frontaliers, est le poste le plus septentrional de tout leur empire. Cette base militaire et navale constitue aussi le premier établissement européen sur la côte ouest canadienne.
Tempête diplomatique
En Amérique, personne ne prévoit la tempête diplomatique que va soulever, dans les cours d'Europe, la saisie des navires britanniques. Dès que les rumeurs de l'opération parviennent en Angleterre, l'opinion publique se montre scandalisée par ce geste qui remet en cause le principe de la libre circulation sur les mers. La susceptibilité nationale est à fleur de peau le drapeau britannique et l'honneur du pays a été piétiné, croit-on, par les militaires espagnols ! En avril 1790, l'arrivée de John Meares, un des associés de James Colnett, confirme ces rumeurs et ravive le sentiment anti-espagnol. En mai, la question est débattue à la Chambre des communes. L'amirauté annule l'expédition qui devait partir pour la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord et ordonne à la Royal Navy de se préparer en vue d'hostilités.
La Grande-Bretagne et l’Espagne au bord de la guerre
Madrid, le roi Carlos IV donne également l'ordre de mobilisation à sa marine, mais, pour éviter d'être entraîné malgré lui dans un engrenage infernal, il fait savoir aux gouvernements européens qu'il ne déclarera pas la guerre le premier... En Angleterre, en revanche, le vent de la guerre souffle ! Dès le mois de juillet, l'amiral Howe croise au large des côtes européennes à la tête d'une puissante escadre de la Royal Navy composée de 29 grands vaisseaux de guerre pour impressionner les Espagnols par un peu de « diplomatie des canonnières ». Cette stratégie tourne mal lorsque le cabinet britannique apprend, non sans inquiétude, qu'une escadre espagnole tout aussi puissante a quitté Cadix pour se diriger vers le nord ! Qu'arrivera-t-il si ces deux puissantes flottes se rencontrent en haute mer ? Plongeront-elles l'Europe occidentale dans une guerre pour la possession de Nootka, un endroit situé aux antipodes du monde connu ?
Fort heureusement, les deux escadres ne se rencontrent pas, mais la guerre, si elle avait été déclarée, aurait mis en jeu les marines militaires de trois pays. D'abord, la marine britannique, qui compte environ 400 navires de toutes tailles, mais dont une partie seulement est en état de livrer combat dans l'immédiat. Ensuite, bien évidemment, la marine espagnole, troisième au monde après les flottes anglaise et française, mais particulièrement redoutable à cause du nombre élevé de grands vaisseaux qui la composent - 64 bâtiments sur 110, incluant le plus gros navire de guerre au monde, le Santisima Trinidad, portant 130 canons. Enfin, à cause de l'alliance franco-espagnole, la marine française, forte d'environ 150 navires, aurait pu elle aussi entrer en scène ! C'est donc face à un défi de taille que la Royal Navy se serait trouvée confrontée.
Le rôle de la France
L'attitude de la France dans la crise de Nootka est donc alors décisive. La Révolution française a éclaté en juillet 1789, mais, à l'été de 1790, les plus graves conséquences de cet événement restent encore à venir. Les forces armées sont encore relativement intactes et le roi Louis XVI occupe toujours le trône, même si le véritable pouvoir repose de plus en plus dans les mains de l'Assemblée nationale. En guise de précaution, la France mobilise d'abord sa marine de guerre avant d'aborder la question principale : doit-elle respecter son alliance et appuyer l'Espagne dans sa revendication de Nootka, ce lointain morceau de son empire colonial ? À la fin du mois d'août, estimant que l'opinion publique n'acceptera jamais de prendre à son compte un tel conflit, l'Assemblée nationale déclare que la France n'ira pas en guerre contre la liberté et les droits de l'homme. En clair, cela signifie que la France se retire de l'alliance.
Sans l'appui de la France, la position espagnole devient intenable. Fort heureusement pour elle, la colère des Britanniques s'apaise au fil des semaines, de sorte qu'il devient possible de négocier. Le 28 octobre 1790, à Madrid, l'Espagne et la Grande-Bretagne signent la convention de la baie de Nootka. La menace de guerre est écartée ! Selon les termes de ce traité, les deux puissances coloniales reconnaissent détenir toutes deux des droits sur la côte nord-ouest, au nord de la Californie, et chacune aura accès aux établissements de l'autre. Des commissaires seront nommés par chaque nation pour régler les détails de l'entente.
Cette convention a souvent été interprétée comme un engagement, de la part des Espagnols, de se retirer de la côte nord-ouest. Or, rien ne les oblige à quitter Nootka. Bien au contraire, ils améliorent les fortifications terrestres et aménagent une batterie flottante dans le port. Ce que la convention de la baie de Nootka modifia fut plutôt la notion selon laquelle la côte du Pacifique était espagnole depuis le Chili jusqu'à l'Alaska. Désormais, la Grande-Bretagne détient des droits sur cette côte au nord de la Californie, droits qui restent encore à définir par les commissaires des deux nations.
La vie de garnison à Nootka. De meilleures relations entre Espagnols et indigènes
Fort espagnol à Nootka en 1793. Cette aquarelle produite par Sigismund Bacstrum est inspirée d'un croquis réalisé le 20 février 1793. On y voit le Presido à Nootka, ainsi que le drapeau espagnol rouge et jaune flottant au-dessus de la batterie, à gauche, et le campement des soldats, à droite.
Pendant que ces événements se déroulent en Europe, la vie à Nootka est relativement paisible, bien que pénible. La garnison, habituée au climat mexicain, souffre beaucoup du froid et de maladies, malgré ses provisions de vêtements chauds et de médicaments. Plusieurs soldats succombent, quelques-uns désertent, d'autres sont renvoyés en Californie pour y être soignés. La garnison compte entre 73 et 76 soldats durant l'année 1791, et entre 64 et 73 durant l'année 1792, nombre qui tombe à 59 en 1793.
Pedro de Alberni, commandant de la garnison de Nootka, met tout en oeuvre pour reconquérir l'amitié des Amérindiens, qui se sont retirés après la mort de Callicum. Ces derniers répondent aux avances des Espagnols et reviennent à Nootka. Fin diplomate, Alberni compose même un poème dans leur langue, que ses soldats chantent en choeur en l'honneur de leur chef Muquinna: « Muquinna, Muquinna, Muquinna est un grand prince, notre ami ; Espagne, Espagne, Espagne est l'amie de Muquinna et de Nootka ». Le chef est ravi et une ère d'entente cordiale entre la garnison espagnole et les autochtones s'ensuit. Très industrieux, Alberni étudie la botanique, fait aménager des jardins et entreprend de faire de l'élevage de bétail et de volaille dans ce lointain présidio, afin de pourvoir aux besoins des soldats de la garnison et des marins qui y séjournent pendant l'été. Alberni compile aussi le vocabulaire nootka avec son équivalent en espagnol. Il étudie en outre la météorologie, et ses relevés détaillés des années 1790 et 1791 sont les premiers à avoir été effectués systématiquement sur la côte nord-ouest. Alberni quitte Nootka en 1792, mais les Amérindiens garderont longtemps un excellent souvenir de lui. De nos jours, le nom de ce talentueux officier des volontaires catalans est perpétué par Port Alberni, en Colombie-Britannique.
Tambour, première compagnie française de volontaires de Catalogne à Nootka, 1790-1794
Il y avait deux tambours au sein de la Primera Compañia franca de Voluntarios de Cataluña (ou première compagnie franche de volontaires catalans). Cette unité de l'armée coloniale espagnole a garni les rangs de la garnison initiale à Nootka. Après 1760, les tambours de l'armée espagnole portaient la livrée du roi d'Espagne - un manteau bleu avec un col et des manchettes écarlates, ainsi qu'un gilet écarlate. Le manteau et le gilet étaient parementés d'un ruban écarlate brodé d'un fil blanc. Ce même patron de ruban était utilisé pour les uniformes français avant le début de la Révolution française, en 1789. Les rois bourbons d'Espagne étaient de la lignée de la famille royale de France et ont adopté une livrée semblable.
Les explorations et les escarmouches se poursuivent
Des Autochtones allant à la rencontre des goélettes Sutil et Mexicana de la Marine espagnole, en 1792. Cette toile illustre une rencontre, le 11 juin 1792, entre des canots autochtones et les goélettes Sutil et Mexicana de la Marine espagnole. On aperçoit le mont Baker en arrière-plan. Ce jour-là, au canal Guemes (près du site actuel de Anacortes, dans l'État de Washington), une expédition espagnole a pris une pause pour faire des observations astronomiques dans le but de fixer exactement sa longitude. Sa mission consistait à lever la carte du détroit de Juan de Fuca, et à chercher le passage du Nord-Ouest. Cette toile est l’œuvre de José Cardero, l'artiste officiel de l'expédition.
En 1791 et 1792, Nootka sert de petite base navale pour les explorations de la marine espagnole et plusieurs soldats de la garnison sont détachés sur des navires pour servir en qualité d'infanterie de marine. Ces expéditions sont quelquefois périlleuses. Ainsi, en 1791, près de la ville actuelle d'Esquimalt, des guerriers en canots contraignent les hommes du commandant Francisco de Eliza à rebrousser chemin. L'année suivante, un pilote de la marine espagnole trouve la mort, assassiné par des Amérindiens alors qu'il chassait dans ce qui est aujourd'hui Neah Bay (Washington). Cet acte amène son commandant, Salvador Fidalgo, à ouvrir le feu sur deux paisibles canots amérindiens, tuant plusieurs de leurs occupants. Fait à noter, Fidalgo est réprimandé par ses supérieurs tant au Mexique qu'en Espagne pour ce geste intempestif. Au nord, plusieurs hommes de l'Aranzazu échappent de justesse aux Haïdas des îles de la Reine-Charlotte. Dans les parages de l'île de Vancouver, les membres de l'équipage des petits navires Sutil et Mexicana, détachés de l'expédition de Malaspina, sous les ordres de Dionisio Alcalâ-Galiano et de Cayetano Valdés y Flores Bazan, connaissent des expériences plus paisibles.
Frégate du capitaine Dionisio Alcala-Galiano, Marina real, vers 1792. Dionisio Alcala-Galiano (1762-1805) était l'officier espagnol qui était aux commandes de la goélette Sutil lorsqu'elle a pris part à l'expédition pour lever des cartes dans le détroit de Juan de Fuca en 1792. Ce portrait contemporain illustre l'officier portant l'uniforme d'un capitaine de la Marina real (la marine espagnole). Alcala-Galiano est décédé au cours de la fameuse bataille de Trafalger, en 1805, alors qu'il commandait le navire aux 74 canons de la ligne Bahama.
Vancouver et Bodega y Quadra
Afin de régler les détails de la convention de la baie de Nootka, la Grande-Bretagne nomme George Vancouver, capitaine de la Royal Navy et ex-compagnon de l'explorateur James Cook, à la fonction de commissaire, tandis que Bodega, capitaine de la marine espagnole et vétéran des explorations de la côte nord-ouest, est son homologue pour l'Espagne. Vancouver et Bodega se rencontrent à Nootka en août 1792. Ils entretiennent de bonnes relations, mais ne parviennent pas à s'entendre sur les détails du transfert des propriétés prévu par la convention. Ils décident donc d'un commun accord de soumettre le problème à leurs gouvernements respectifs pour ne pas prendre le risque de provoquer un nouvel incident diplomatique.
Vancouver continue à explorer la côte et à faire le tour de l'île qui porte aujourd'hui son nom. Il poursuit aussi l'œuvre de Cook en cherchant à vérifier l'existence d'un passage du Nord-Ouest ; durant trois étés, il étudie minutieusement toute la côte entre les 30e et 60e degrés de latitude nord. Ce n'est qu'en septembre 1795 qu'il rentre en Angleterre. Trois ans plus tard, il publie le récit de son voyage - ouvrage exhaustif et d'une qualité exemplaire. Il peut affirmer sans l'ombre d'une hésitation que l'entrée du passage du Nord-Ouest tant recherché ne se trouve pas dans les limites du territoire qu'il avait exploré, ce qui est exact.
L’évacuation de Noutka
Soldat, Compañia Fija de San Blas, 1794-1795. La compagnie Fija de San Blas (ou compagnie fixe – garnison de San Blas) a été formée au Mexique en 1788 pour garder la base navale espagnole à San Blas. Un détachement de l'unité a remplacé la garnison de Nootka en 1794 et 1795. L'uniforme bleu et jaune que porte cet homme est agrémenté d'une culotte à jambières blanche et d'un gilet blanc qui, selon les documents de référence, ont été remis à la compagnie. Les petits fruits que cet homme déguste ne sont pas des éléments officiels.
Entre-temps, en Europe, l'intérêt pour Nootka a considérablement diminué. En effet, en février 1793, la Grande-Bretagne et l'Espagne s'étaient alliées dans une guerre contre la France ! Le problème de la côte nord-ouest semble déjà lointain et les deux alliées signent une entente, le 11 janvier 1794, selon laquelle elles déclarent abandonner la région. Au cours de la même année, les volontaires catalans en garnison à Nootka sont relevés par une vingtaine de soldats de la Compania fija de San Blas, qui montent la garde jusqu'au 23 mars 1795. Ce jour-là, après une cérémonie officielle d'adieu à laquelle participe le lieutenant d'infanterie de marine Thomas Pierce, qui représente l'Angleterre, le présidio de Nootka est démantelée. L'artillerie et la garnison sont embarquées à bord de l'Activa qui fait voile vers le sud. Ainsi prend fin le règne de l'Espagne sur la côte nord-ouest.
Tout au long de ce premier épisode de l'exploration de la côte canadienne du Pacifique par des nations européennes - exploration provoquée par la crainte chez les Espagnols d'une invasion russe -, les forces armées jouèrent un rôle prépondérant. Ces événements montrent bien également à quel point les militaires des nations maritimes du XVIIIe siècle se souciaient des progrès des sciences et de la géographie, et pas seulement de l'art de la guerre. Ces hommes constituaient le fer de lance des explorations et on les retrouvait partout aux confins du monde connu, occupés à compiler des données géographiques, hydrographiques, astronomiques, météorologiques et ethnographiques.
D’un océan à l’autre
« Du Canada par voie terrestre » - Alexandre MacKenzie atteint le Pacifique, le 22 juillet 1793. Alexander MacKenzie et ses compagnons sont arrivés sur la côte du Pacifique en passant par la rivière Bella Coola, le 22 juillet 1793. L'expédition est partie de Montréal et est passée par les montagnes Rocheuses. Il s'agit de la première traversée nord-américaine par terre vers le Pacifique. Cette traversée avait des implications géostratégiques importantes en ce qui concerne les revendications territoriales pour le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis. L'expédition des Américains Lewis et Clark, plus connue en raison des médias américains, n'a atteint le Pacifique qu'en 1805.
À la fin du XVIIIe siècle, malgré plusieurs tentatives, l'amirauté britannique n'est toujours pas parvenue à découvrir le fameux passage du Nord-Ouest reliant l'Atlantique au Pacifique. Cependant, d'autres tentent d'établir ce lien par voie de terre, notamment les trafiquants de fourrures travaillant à la solde de deux compagnies rivales, la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie d'Hudson. L'un d'eux, partenaire de la Compagnie du Nord-Ouest, y parvient enfin. Parti de Montréal, Alexander McKenzie franchit les Rocheuses et atteint la côte du Pacifique par la rivière Bella Coola, le 22 juillet 1793.
Au cours des décennies suivantes, d'autres trafiquants de fourrures construisent des postes de traite jusqu'à la côte du Pacifique. Ces hommes venus de l'est, souvent de souche canadienne-française ou écossaise, peuvent se transformer au besoin en miliciens, pour défendre le drapeau britannique qui flotte sur leurs petits postes. Ainsi, dès le début du XIXe siècle, peu après le départ des Espagnols de la côte nord-ouest, les principales balises de l'immense territoire de l'Amérique du Nord britannique sont en place, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Un jour, un pays en émergera : le Canada.
Les guerres Napoléoniennes et la guerre de 1812
Invasion repoussé à Quennston
Une décennie relativement paisible
La décennie qui suit la fin de la guerre d'Indépendance américaine est assez paisible. La nouvelle république des États-Unis ne représente plus une menace, du moins dans l'immédiat. Sa puissante armée est presque complètement démobilisée en 1783 et ne compte plus que quelques compagnies affectées à la garde des arsenaux. Sa modeste marine de guerre a aussi été supprimée. Seules les milices des divers États peuvent au besoin disposer d'un nombre considérable d'hommes en armes. Mais leur mandat est plutôt défensif qu'offensif, puisqu'elles ne sont légalement obligées de servir qu'à l'intérieur de leurs frontières. Par conséquent, les colonies britanniques situées au nord des États-Unis n'ont plus rien à craindre.
Par ailleurs, la dernière guerre a épuisé l'armée britannique, qui mettra plusieurs années à s'en remettre. C'est pourquoi, à la suite de la démobilisation de l'armée américaine, la Grande-Bretagne décide de ne maintenir qu'un nombre restreint de troupes régulières en Amérique du Nord. La Royal Navy, cependant, demeure très puissante et conserve son titre de première flotte de guerre au monde. La protection navale du Canada est assurée par son escadre de l'Atlantique-Nord, basée à Halifax, et par les petits navires de la Marine provinciale qui sillonnent les Grands Lacs.
La milice des nouvelles provinces
Au Canada, cette période de paix s'accompagne d'une forte croissance, car les dizaines de milliers d'émigrants loyalistes chassés par la guerre fondent des villes, défrichent des terres ou deviennent armateurs et marins. Des milices sont également constituées avec les nouveaux venus. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, la première loi à cet effet est votée en 1787 : elle oblige tous les hommes valides de 16 à 50 ans à se procurer armes et équipement et à s'enrôler dans la compagnie de leur localité. Chacune compte une cinquantaine d'hommes, commandés par un capitaine assisté d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant, et toutes sont rattachées au régiment du comté. Celui-ci possède un petit état-major composé d'un colonel, d'un lieutenant-colonel et d'un major.
En temps de paix, chaque compagnie doit se rassembler deux fois l'an pour la revue et l'entraînement, et une fois l'an - traditionnellement le 4 juin, jour de l'anniversaire du roi - toutes les compagnies de milice d'un même comté procèdent à la revue générale du régiment. Les miliciens qui n'assistent pas aux divers rassemblements se voient imposer des amendes, servant à financer l'achat des tambours et des drapeaux régimentaires. Les officiers sont choisis parmi les citoyens en vue et nommés par le gouverneur. Ces postes ne sont pas rémunérés, mais ils consacrent une certaine ascension sociale. À l'occasion, la charge peut même se révéler onéreuse. Ainsi, à Fredericton, un certain Stephen Jarvis, homme prospère, « est invité à prendre le commandement d'une compagnie de milice et la dote d'un uniforme à ses « très grands frais ». Il s'agit pour lui de faire bonne impression à l'occasion de la visite du duc de Kent, en juin 1794, car, généralement, peu d'officiers s'engagent dans de telles dépenses. Le colonel du régiment est habituellement quelque grand bourgeois du comté, reconnu pour sa loyauté et son attachement à la couronne.
Dans l'ensemble, cette organisation s'inspire largement de celle des milices de Grande-Bretagne, qui se caractérisent particulièrement par leur regroupement en régiments de comté. Le même type de division territoriale en comtés ayant été retenu pour les nouvelles colonies anglaises, c'est également le modèle qui prévaut en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard pour l'organisation de la milice. L'âge maximal pour servir est cependant fixé à 60 ans en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, plutôt qu'à 50 comme au Nouveau-Brunswick.
La Révolution française
John Graves Simcoe, gouverneur de la province du Haut-Canada, vers 1795
Simcoe fut un officier de carrière britannique qui a brillamment commandé l'unité loyaliste des Queen's Rangers (premier régiment américain) lors de la guerre de l'Indépendance américaine. En 1791, Simcoe a été promu lieutenant-gouverneur de la nouvelle province du Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario). Il a organisé la milice provinciale en s'inspirant du système anglais de milice de comté, lequel s'est avéré fort efficace. Ce portrait représente Simcoe vêtu d'un uniforme d'officier d'état-major et a été reproduit à partir d'une miniature offerte par la famille Simcoe à l'imminent antiquaire canadien Henry Scadding.
Alors qu'en Amérique du Nord le calme est revenu, ce n'est pas le cas en Europe, où des bouleversements majeurs s'annoncent. Le 14 juillet 1789, la population parisienne s'empare de la Bastille, symbole exécré des abus de la monarchie. Dès lors, la révolution se propage à travers toute la France. La presse canadienne de l'époque suivra attentivement le déroulement de ces événements.
Sous l'impact des idées nouvelles propagées par la Révolution française, et également par suite de l'arrivée de nouveaux colons en provenance des États-Unis, des pressions croissantes s'exercent à travers le pays pour obtenir des chambres d'assemblées élues. Le parlement britannique en est saisi et, après bien des débats houleux, adopte, à la fin de 1791, la loi constitutionnelle. Celle-ci divise le Canada en deux provinces : le Haut-Canada, à majorité anglophone (la province actuelle de l'Ontario), et le Bas-Canada, à majorité francophone (le Québec d'aujourd'hui). Ce nouveau régime, avec ses parlements élus, est mis en place en 1792 et accueilli très favorablement, comme représentant l'avènement de la « vraie liberté... jusqu'à la baie d'Hudson ».
Du point de vue militaire, la division du Canada en deux provinces engendre peu de changements, si l'on excepte la création d'un corps colonial régulier destiné à augmenter la garnison du Haut-Canada. Commandé par le premier lieutenant-gouverneur de la nouvelle province, le colonel John Graves Simcoe, il prend le nom de Queen's Rangers. C'est un petit régiment dont les effectifs autorisés sont de 432 officiers et soldats. Dans les faits, cependant, il ne comprend que deux compagnies, et celles-ci ne seront jamais complètes, la force réelle du corps atteignant environ 350 hommes. Même s'il sert surtout, en dehors de la garde, à construire routes et fortifications, on décide de le doter d'un uniforme d'infanterie légère, de couleur verte. Une partie des Queen's Rangers, dont plusieurs officiers, seront recrutés parmi les vétérans loyalistes et une autre partie en Angleterre. En 1792, le régiment s'installe à Newark (aujourd'hui Niagara-on-the-Lake, en Ontario) et y demeure jusqu'à ce que le siège du gouvernement de la nouvelle province déménage à York (aujourd'hui Toronto), trois ans plus tard. Des détachements des Queen's Rangers s'y trouvent d'ailleurs déjà depuis 1793, et ils y ont aménagé l'artère appelée à devenir la plus célèbre de la ville-reine : la rue Yonge.
Le Canada en guerre contre la France. Réaction des Canadiens Français
Colonel John Nairne, Régiment de la Malbaie, Milice sédentaire de la province du Bas-Canada, vers 1795
John Nairne (1731-1802) a débuté sa carrière militaire à l'âge de 14 ans en s'enrôlant dans la Scots Brigade, au service des Hollandais. Il a obtenu le grade de lieutenant dans le 78e Régiment de fantassins (Royal highland Emigrants) et a combattu auprès de Wolfe lors du siège de Québec. Après la guerre de sept ans, Nairne s'est établi au Canada et est devenu seigneur de la Malbaie. Lorsque la guerre de l'Indépendance américaine a éclaté, le vieux soldat a rapidement repris son uniforme et a joint le premier bataillon des Royal Highland Emigrants. Comme c'était habituellement le cas des seigneurs ayant de l'expérience militaire, Nairne est devenu colonel de l'unité de milice locale. La gravure représente Nairne aux alentours de 1795, lorsqu'il était colonel de la milice sédentaire de la province du Bas-Canada.
Pendant ce temps, la situation de la France soulève de vives inquiétudes. L'exécution de Louis XVI choque profondément de nombreux pays européens. Le ler février 1793, la Grande-Bretagne, de concert avec plusieurs autres pays, déclare la guerre à la République française, entraînant toutes ses colonies dans son sillage. Le Canada se retrouve donc par la force des choses en guerre contre la France.
L'annonce de la mort tragique du roi parvient à Québec au printemps de 1793. Elle cause un grand émoi parmi les Canadiens français qui, note Philippe Aubert de Gaspé dans ses Mémoires, « conservèrent, longtemps après la conquête, un souvenir d'affection pour leurs anciens princes français ». « Dès ce jour, relate-t-il, je compris les horreurs de la Révolution française. À cette nouvelle, un sentiment de profonde tristesse s'empara de toutes les âmes sensibles... et la douleur fut générale » parmi la population. Des Français réfugiés au Canada confirment les « horreurs » commises en France. S'ajoutant aux rumeurs d'invasion de Républicains maniant la guillotine, ces nouvelles n'ont rien de rassurant.
Dans l'immédiat, cependant, c'est aux activités d'un certain Edmond-Charles Genêt que s'intéressent surtout les autorités britanniques en Amérique du Nord. Cet ambassadeur de la France aux États-Unis est en effet l'auteur d'un appel aux Canadiens intitulé Les Français libres à leurs frères du Canada, invitant ces derniers à « sortir du sommeil léthargique » qui est censé être le leur, à s'armer, à appeler au secours leurs « amis les Indiens » et à compter « sur l'appui de [leurs] voisins [les Américains] et [sur] celui des Français », afin de combattre les Britanniques. Cet appel circule sous le manteau dans les villes et les villages durant la seconde moitié de 1793. Malgré l'attrait qu'il pourrait exercer sur les esprits, en matière de belles promesses venues de la mère patrie, l'expérience du passé a appris aux Canadiens français à ne pas trop se nourrir d'illusions... Il ne recueille donc pas le succès escompté.
Préparations navales
En revanche, les colonies britanniques donnant sur l'Atlantique prennent très au sérieux la menace française, car elles seraient éminemment vulnérables en cas d'attaques par des navires de guerre utilisant Saint-Pierre-et-Miquelon comme base de ravitaillement. Pour parer à cette éventualité, les Britanniques décident de prendre les devants et d'attaquer sans tarder ce petit territoire français d'outre-mer que la Révolution a fini par affecter malgré la distance : l'année précédente, des centaines d'habitants de l'archipel ne se sont-ils pas réfugiés à l'île du Cap-Breton et aux Îles-de-la-Madeleine ? C'est la raison pour laquelle, le 14 mai 1793, plusieurs navires de guerre britanniques arrivent à Saint-Pierre. Toute résistance s'avère inutile et les 120 hommes de la compagnie franche en garnison se rendent sans combattre. Pendant ce temps, une partie des troupes régulières et des navires britanniques postés en Amérique du Nord partent pour les Antilles où des combats font déjà rage. Afin de les remplacer, les autorités décident de lever immédiatement des troupes « provinciales », c'est-à-dire coloniales. On commence donc à recruter le Royal Nova Scotia Regiment, le King's New Brunswick Regiment, le Royal Newfoundland Regiment et deux compagnies de Volunteers of the Island of St. John.
Une escadre française à New York
Peu après, une nouvelle parvenue à Halifax provoque l'alerte générale. En juillet 1793, une grande escadre française est arrivée à New York, avec à son bord un contingent de troupes sous le commandement du général Galbaud. L'ambassadeur Genêt y voyait l'instrument idéal pour attaquer le Canada par mer et avait même commencé à recruter des volontaires américains pour les associer aux Français.
Avec cette puissante flotte, selon les rapports des espions britanniques, un corps de troupes pourrait débarquer en Nouvelle-Écosse avant que la Royal Navy ne parvienne à renforcer l'escadre de l'Atlantique Nord. Dans les Maritimes, c'est la consternation. Les troupes provinciales sont organisées en un temps record. On parvient à leur trouver des armes convenables, mais, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, on est momentanément à court d'uniformes rouges réglementaires, et les nouveaux soldats doivent parader en vestes bleues avec collets et parements rouges.
Par ailleurs, les milices sont mises sur le pied de guerre, particulièrement en Nouvelle-Écosse où une attaque en force des Français risque réellement de se produire. Dès juillet, le régiment de milice de la ville d'Halifax compte quelque 630 hommes qui s'entraînent deux fois par semaine. De plus, une légion de 1 000 miliciens répartis en compagnie d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie se tient constamment sur le qui-vive, prête à intervenir rapidement en cas de raid sur les côtes. Il est à noter qu'environ 400 Acadiens se portent volontaires dans la milice, ce qui fait dire au gouverneur, sir John Wentworth, dans un rapport, que les vieilles blessures de la déportation s'étaient cicatrisées et que les Acadiens voulaient eux aussi aider les Britanniques à défendre leur province.
Les Français sont donc attendus de pied ferme dans les Maritimes. À la surprise générale, ce sont finalement les Montréalais qui, en octobre 1793, voient arriver dans leur ville le général Galbaud en personne, mais sans ses troupes ! En effet, celui-ci avait abandonné son armée, déchirée par les dissensions politiques, pour se réfugier au Canada et se constituer prisonnier des Britanniques. De son côté, la flotte française retournait en France, ses hommes, profondément divisés par la discorde et les passions politiques, ayant perdu toute discipline. Ainsi s'évanouit la menace d'invasion française de la côte est. Ces événements confirmaient une fois de plus, dans l'esprit de la population canadienne-française, le peu de crédit qu'elle pouvait accorder à un éventuel « appui » de la France. Finalement, elle adopte une attitude de neutralité face à son ancienne mère patrie, tout en condamnant les excès de la Révolution. D'ailleurs, des problèmes plus pressants préoccupent déjà les autorités.
Tensions avec les États-Unis. Hostilités entre les colons et les Autochtones
Au lendemain de la guerre d'Indépendance américaine, les Britanniques avaient continué à occuper militairement plusieurs points stratégiques au sud des Grands Lacs, dont Detroit, Mackinac et Niagara. Or, à partir du début des années 1790, les tensions se font de plus en plus vives entre les États-Unis et l'Angleterre, sur la question des frontières du Canada.
La plupart des nations amérindiennes se montrent hostiles aux Américains et les colons qui s'établissent dans l'Ouest doivent faire face à la guérilla. En 1790 et 1791, le gouvernement américain envoie des troupes pour mater les Amérindiens, mais elles sont anéanties grâce à l'alliance de plusieurs nations préparée par le chef iroquois Joseph Brant. Quelques Loyalistes et Canadiens français, détestant les « Yankees », aident les Amérindiens, et vont parfois jusqu'à combattre à leurs côtés, ce qui ne favorise guère les relations diplomatiques canado-américaines...
Réaction américaine et réponse britannique
Outrés de l'hostilité des Amérindiens et de ce qu'ils considèrent comme un complot britannique pour leur ravir l'Ouest, les Américains prennent, en 1792, des mesures énergiques. Ils adoptent une loi nationale de la milice, établissent des arsenaux et, surtout, recrutent une armée régulière de 5 000 hommes sous le commandement du général Anthony Wayne. Cet officier dynamique et plein de talent galvanise l'enthousiasme de ses soldats. Le 30 août 1794, il écrase les Amérindiens à Fallen Timbers (près de Toledo, dans l'Ohio). Peu après, les Britanniques signent le traité de Jay, par lequel ils reconnaissent définitivement que la rive sud des Grands Lacs appartient aux Américains. Les troupes américaines se présentent bientôt pour prendre la relève dans les forts occupés jusqu'alors par les Britanniques. Ceux-ci leur cèdent la place, mais emménagent à proximité, dans de nouveaux forts construits du côté canadien de la frontière. Ainsi, la garnison de Mackinac s'installe au fort Saint Joseph (dans l'île Saint Joseph, en Ontario), celle de Detroit au fort Malden (à Amherstburg, en Ontario) et celle de Niagara au fort George (à Niagara-on-the-Lake, en Ontario).
Les volontaires royaux canadiens. Un régiment régulier canadien
Plaque du baudrier d'un soldat des Royal Canadian Volunteers, 1795-1802
Cette plaque de baudrier ovale en laiton arbore le monogramme des Royal Canadian Volunteers. Ce régiment régulier britannique, formé de deux bataillons, a été levé au Canada et a existé de 1795 à 1802. Ces plaques étaient ulitisées pour attacher les deux baudriers de cuir portés à l'époque par les soldats britanniques. La plupart des unités avaient un style de plaque de baudrier qui leur était propre. Le monogramme de cette plaque est fort simple : il présente les lettres « GR » du roi George III de Grande-Bretagne, lesquelles sont entourées du titre du régiment « CANADIAN VOLUNTEER BATTN ». Les portraits des officiers de ce régiment montrent que ceux-ci ne portaient pas ce modèle de plaque de baudrier; ils disposaient d'au moins deux modèles différents.
Pour parer à cette situation de tension avec les États-Unis, les autorités britanniques décident de lever au Canada un régiment de deux bataillons qui ne servira qu'en Amérique du Nord. Recruté entre 1794 et 1795, il est baptisé le Royal Canadian Volunteers, nom qui apparaît sur les drapeaux et les insignes, bien qu'en français, on utilise l'expression « Volontaires royaux canadiens ». L'effectif autorisé pour chaque bataillon est de 750 officiers et soldats, répartis en dix compagnies. La solde et les allocations sont identiques à celles de l'armée métropolitaine. Les brevets d'officiers ne sont accordés qu'à des gentilshommes résidant dans le Bas et le Haut-Canada. En outre, on choisit des officiers chevronnés pour commander chaque bataillon. Ainsi, le commandement du premier bataillon francophone est confié au lieutenant-colonel Joseph-Dominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil, qui avait commencé sa carrière militaire comme officier dans les Compagnies franches de la Marine, dès 1750, et participé à de nombreux combats durant la guerre de Sept Ans et celle de la révolution américaine. Le commandement du second bataillon, anglophone, échoit au lieutenant-colonel John Macdonell, officier d'origine écossaise qui avait émigré dans le Haut-Canada, vétéran des Butler's Rangers, ami des Iroquois et chef du clan écossais Macdonel
Terre-Neuve menacé
Le HMS Asia dans le port d'Halifax, 1797
Cette aquarelle représentant le HMS Asia dans le port d'Halifax est l'œuvre d'un lieutenant de la marine britannique, George Gustavus Lennock. Les Britanniques ont toujours maintenu une forte présence navale du côté américain de l'Atlantique Nord. À Halifax, les navires de guerre assuraient la sécurité des voies maritimes et protégeaient les flottes de pêche contre les corsaires américains et français surtout et contre les pirates à l'occasion. En temps de guerre, ces navires auraient également été déployés pour attaquer les côtes américaines ou même jusqu'aux Antilles françaises.
C'est dans les Maritimes, en 1796, que la menace la plus sérieuse se concrétise, lorsqu'une flotte française de sept vaisseaux et de quelques frégates, sous le commandement de l'amiral Joseph de Richery, paraît au large de Terre-Neuve, provoquant presque la panique. Bientôt, des rumeurs de débarquement dans l'île et d'attaque imminente contre St. John's surgissent de toutes parts. Les autorités britanniques demeurent cependant sceptiques, estimant que la flotte française n'osera s'attaquer à des objectifs militaires. En effet, il s'avère que Richery n'est venu que dans l'intention de perturber les pêcheries, ce qu'il réussit à merveille. Après avoir rôdé pendant quelques semaines dans les parages, l'amiral rentre en France, sachant fort bien que la Royal Navy finira par le rattraper s'il s'attarde davantage. Le seul véritable débarquement sur Terre-Neuve se produit à Bay Bulls où les marins français détruisent quelques maisons et des entrepôts.
Malgré leur caractère inquiétant, ces raids ne représentent pas une menace sérieuse d'invasion. Les Britanniques ne modifient donc pas leur stratégie navale et continuent d'affecter un nombre restreint de navires de guerre à la garde du Saint-Laurent et des pêcheries de Terre-Neuve. Même si une quelconque flotte ennemie parvenait à forcer le blocus britannique des côtes européennes, comme le fera par la suite celle de Richery, elle ne pourrait trop s'attarder dans les parages de l'Amérique du Nord sans risquer une rencontre avec de puissants poursuivants. D'ailleurs, les flottes française et espagnole subissent défaite après défaite en se mesurant aux Britanniques, et, à la fin des années 1790, l'Angleterre est la maîtresse presque incontestée des mers.
La paix de 1802. La guerre sans issue mène à la paix
Cependant, en Europe, les événements se précipitent. Contre toute attente, les armées de la République repoussent les tentatives d'invasion prussienne et autrichienne. Les Français occupent ensuite la Hollande, une partie de l'Allemagne et le nord de l'Italie. Au milieu de 1801, seule la Grande-Bretagne est encore en guerre contre la France. Elle triomphe sur les mers et dans les colonies, pendant que cette dernière remporte des victoires en Europe occidentale, situation qui aboutit à une impasse. Les belligérants proclament l'armistice le 12 octobre 1801 et signent la paix à Amiens, le 25 mars 1802.
Au Canada, cette nouvelle est accueillie avec un grand soulagement. Durant l'été et l'automne de 1802, tous les régiments coloniaux levés dans les Maritimes en 1793, ainsi que le Queen's Rangers et les deux bataillons des Volontaires royaux canadiens sont licenciés.
La guerre reprend
Soldat, 104e Régiment de fantassins (Nouveau-Brunswick) , vers 1810-1812
Le 104e Régiment de fantassins a été levé en 1803 au Nouveau-Brunswick et a pris le nom de New Brunswick Regiment of Fencible Infantry. En 1810, à la demande du régiment, celui-ci a été fusionné à l'effectif régulier britannique. Ainsi, ce régiment pouvait être déployé non seulement en Amérique du Nord, mais partout dans le monde. En fin de compte, le 104e Régiment n'a jamais quitté le Canada, mais il s'est démarqué lors de la guerre de 1812 contre les Américains. L'uniforme représenté sur cette image était porté par les soldats au début de la guerre, mais il a changé par la suite. Il convient de signaler que le soldat porte une culotte de cuir, une particularité des régiments, de même que des parements en cuir.
Mais à peine conclue, la paix est rompue. En effet, malentendus et incidents se multiplient, et, dès le 16 mai 1803, les hostilités entre la France et la Grande-Bretagne reprennent de plus belle. Cette situation provoque un branle-bas de combat en Amérique du Nord britannique. Mais, avant même que les législatures coloniales n'ordonnent la levée de troupes locales, Londres décrète la création de quatre régiments de « Fencibles ». Assujettis aux mêmes lois, règlements et conditions de service que les autres corps de l'armée britannique, ces régiments d'infanterie s'en distinguent sur un seul point : ils ne servent qu'en Amérique du Nord. Le trésor britannique assumant entièrement leurs frais, ils apparaissent sur l'Army List - registre officiel de l'armée régulière - et leurs officiers en font officiellement partie intégrante.
Dans les Maritimes, on recrute les régiments Royal Newfoundland, Nova Scotia et New Brunswick. Pour le Haut et le Bas-Canada, on décide d'abord de lever une partie du régiment Canadian Fencibles en Écosse. L'opération est cependant mal amorcée et les recrues se mutinent à Édimbourg, en 1804. Finalement, la majorité des soldats du régiment seront recrutés au Bas-Canada. Par ailleurs, les nominations de gentilshommes coloniaux, anglophones ou francophones sont rares, les officiers de ces régiments étant surtout des Britanniques.
Le bois d'œuvre canadien vital pour la Grande-Bretagne
Le premier train de bois descendant la rivière des Outaouais, 1806
Lors des guerres napoléoniennes, le bois coupé dans les vallées de l'Outaouais et de la Gatineau était rassemblé en d'immenses radeaux qui descendaient les cours d'eau jusqu'à Québec. Le bois était ensuite expédié en Grande-Bretagne par bateau. Le Canada est devenu une source vitale de bois d'oeuvre pour la construction des navires de la marine marchande britannique et de la Marine royale et a ainsi contribué à la grande puissance maritime de la Grande-Bretagne.
Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne obtenait presque tout le bois dont elle avait besoin pour sa marine de guerre et sa marine marchande des États voisins de la mer baltique. Mais cette situation change radicalement à partir de 1806, lorsque Napoléon décrète le blocus continental en réponse au blocus des ports français par la Royal Navy. Par cette mesure, la France empêche les autres pays d'Europe de commercer avec l'Angleterre sous peine de voir l'armée impériale - Napoléon s'était fait proclamer empereur des Français le 18 mai 1804 - envahir tout État récalcitrant.
L'Angleterre se tourne donc vers le Canada pour s'approvisionner en bois. Durant les guerres napoléoniennes, l'importance des exportations de chêne et de pin canadiens vers la Grande-Bretagne devient telle que l'on peut affirmer qu'elles soutinrent la Royal Navy dans son long combat contre l'Empire français. En 1811, par exemple, l'Angleterre importe 3 300 mâts de la Russie et de la Prusse, et 23 000 de l'Amérique du Nord britannique, dont 19 000 pour le seul Bas-Canada! Ces chiffres démontrent l'importance du Canada pour la Grande-Bretagne dans cette période critique de son histoire. Pour assurer ce trafic essentiel, la Royal Navy se doit cependant de bien protéger les routes maritimes vers l'Angleterre, et de nouvelles menaces se dessinent.
La bataille de Trafalgar
La bataille de Trafalgar, 21 octobre 1805
Bien que lointaine, la bataille de Trafalgar, au large de la côte sud de l'Espagne, a eu des répercussions directes sur le Canada. Grâce à la victoire remportée au nom de la Grande-Bretagne par l'amiral Nelson, les voies maritimes vers le Canada sont demeurées sécuritaires et les marines française et espagnole n'ont pas constituées une grande menace pour nos côtes.
La courte paix d'Amiens avait en effet permis à la flotte de guerre française de se renforcer. Unie à celle de son alliée espagnole, elle constitue maintenant une menace d'importance. L'invasion de l'Angleterre par une armée franchissant la Manche est même désormais possible, si la flotte franco-espagnole parvient à contrôler ce bras de mer pendant quelques jours. Napoléon avait bien saisi cet enjeu stratégique et, durant l'été de 1805, il se trouve à Boulogne, à la tête de la Grande Armée, attendant la flotte franco-espagnole de l'amiral Pierre-Charles de Villeneuve.
Marins britanniques, vers 1800-1815
Lors de la guerre de 1812, les marins de la Marine royale, à l'instar de ceux de la plupart des marines de l'époque, n'avaient pas de tenue réglementaire. Toutefois, en 1623, la Marine royale a instauré un système permettant aux marins d'acheter des habits de travail à un prix fixe. En général, les marins portaient un veston croisé bleu, orné de boutons en laiton ou en corne d'animal, un gilet court et un pantalon, habituellement rouge, mais qui pouvait être d'une autre couleur comme bleu ou blanc, un chapeau rond, un mouchoir de cou, habituellement noir, des bas et des chaussures. Il était également possible de se procurer ce genre de vêtements au Canada. En effet, dans une publicité parue dans la Nova Scotia Royal Gazette d'Halifax le 24 novembre 1813, il était question d'un ensemble complet d'habits pour homme et jeune homme. Cet ensemble comprenait des vestons et des pantalons de qualité, des gilets rouges et bleus en étoffe, des gilets de laine ou de velours côtelé, des chemises de coton rayé ou de flanelle rouge, de grands manteaux, des cabans et des pantalons rouges ainsi que des caleçons de flanelle pour se protéger contre le climat froid de l'Atlantique Nord.
L'avenir de l'Angleterre et de son empire est directement en jeu. La flotte britannique de l'amiral Horatio Nelson, qui cherche à intercepter la flotte franco-espagnole, la rattrape au large du cap Trafalgar, le 21 octobre 1805. Le hasard de la guerre rassemble, du côté espagnol, plusieurs officiers qui ont exploré la côte canadienne du Pacifique durant leur jeunesse, notamment Dionisio AlcalaGaliano, qui sera tué à bord du Bahama, et Cayetano Valdés, qui sera blessé sur le Neptuno. Une bataille acharnée s'engage entre les 33 vaisseaux de Villeneuve, dont 15 sont espagnols, et les 27 vaisseaux britanniques. Nelson est mortellement touché, mais la flotte franco-espagnole est presque anéantie. Cette victoire de l'amiral Nelson annonce l'hégémonie navale britannique sur toutes les mers du globe, suprématie qui ne sera pratiquement pas contestée pendant un siècle.
Marin britannique, vers 1807
Les habits portés par les marins britanniques au début du XIXe siècle pouvaient varier à l'infinie et être fort ornementés. Par exemple, certains marins posaient des rubans blancs sur les coutures et les bords de leur veston bleu; d'autres y cousaient des rangées serrées de petits boutons en laiton. Il arrivait souvent que le pantalon blanc fût orné de bandes bleues. Des emblèmes étaient parfois peints sur le chapeau goudronné noir ou le nom du navire était écrit en blanc sur le ruban noir du chapeau. Les chemises pouvaient être rayées de bleu, à carreaux, d'une teinte blanche, rouge ou bleue unie ou même blanche tachée de rouge ou de bleu.
Au Canada, on accueille la nouvelle de la victoire de Trafalgar avec un immense soulagement. Toute menace navale sérieuse est désormais écartée et les communications avec la Grande-Bretagne sont assurées. Les exportations de bois peuvent se poursuivre en toute sécurité. Les marchands montréalais en sont si heureux qu'ils élèvent un monument en l'honneur de Nelson avant même les Londoniens !
Nouvelle tension en Amérique. Changement politique en Louisiane
Le transfert de la Louisiane de la France aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans, 20 décembre 180. Le transfert de la Louisiane aux États-Unis en 1803 a eu des répercussions politiques et géostratégiques considérables sur l'expansion vers l'ouest du Canada au cours du XIXe siècle. Cette oeuvre exécutée à la fin du XIXe siècle représente la cérémonie du transfert. À la gauche se trouvent des officiers français. Au centre, un soldat américain hisse la bannière étoilée tandis que deux personnages vêtus d'uniformes français tiennent le tricolore français. Les uniformes des soldats américains situés à la droite de l'œuvre ont été représentés d'après les illustrations de Henry Ogden publiées en 1888. À l'arrière-plan se trouvent le vieil édifice « Cabildo » ainsi que la cathédrale Saint-Louis, telle qu'elle paraissait en 1803, avant l'ajout de ses flèches.
La sécurité maritime n'est cependant pas le seul sujet qui préoccupe les Canadiens. Au sud du pays, de nouveaux événements requièrent leur attention. Au lendemain de la paix conclue en 1802, Napoléon avait annoncé que la France récupérait la Louisiane. Du coup, l'ouest du Canada se retrouve voisin d'un immense territoire français ! Cela n'augure rien de bon, d'autant plus que l'on apprend qu'un préfet français est arrivé à la Nouvelle-Orléans, en mars 1803, avec quelques officiers, et qu'une armée de 3 700 hommes doit bientôt les rejoindre pour remplacer les Espagnols. La joie de la population louisianaise, presque entièrement de souche française, ne dure point. Lors de la reprise de la guerre contre l'Angleterre, Napoléon juge la Louisiane indéfendable et la vend aux États-Unis. Le 20 décembre 1803, le drapeau étoilé remplace donc le drapeau tricolore à la Nouvelle-Orléans. Pour Napoléon, c'était la meilleure carte géostratégique à jouer, car la Louisiane passait à une nation neutre, ne nourrissant pas de grande sympathie pour les Britanniques.
Un nouveau rêve américain
Soldat du Glengarry Regiment of Fencible Light Infantry, 1812-1816
Craignant avec raison l'éclatement d'une guerre contre les États-Unis, le gouverneur général Provost a ordonné la création du Glengarry Regiment of Fencible Light Infantry au début de 1812. On a commencé par recruter des membres auprès des colonies écossaises installées aux abords du fleuve Saint-Laurent dans le Haut-Canada (aujourd'hui l'Ontario). Toutefois, le recrutement s'est rapidement étendu aux colonies maritimes et au reste du Haut-Canada. Cette unité a servi du début à la fin de la guerre de 1812. Son uniforme, un manteau vert foncé orné de parements noirs et de garnitures blanches, était la copie de l'uniforme du 95e Régiment de fantassins, un régiment spécialisé dans le tir à la carabine de l'armée régulière britannique. Toutefois, les soldats de la Glengarry Light Infantry étaient armés de mousquets et non de fusils.
En conséquence, les Américains, jusqu'alors confinés à l'est du Mississippi, voient leur frontière occidentale s'écrouler ! De vastes territoires, pour la plupart inexplorés, s'ouvrent à eux. Certains, parmi lesquels le président Thomas Jefferson, commencent à rêver pour leur pays d'une hégémonie continentale, rêve qualifié plus tard de Manifest Destiny ; il leur paraît évident que les États-Unis sont appelés à dominer l'ensemble de l'Amérique du Nord, y compris le Canada et une partie du Mexique... Dès 1805, une mission d'exploration conduite par deux officiers de l'armée régulière américaine, Meriwether Lewis et William Clark, atteint le Pacifique à la hauteur de l'Oregon, établissant ainsi, pour la première fois, un lien transcontinental au sud du Canada.
Par la suite, les relations entre l'Angleterre et les États-Unis se gâtent peu à peu. La Royal Navy empêche les navires marchands américains, qui sont neutres, d'entrer dans les ports européens. Pis encore, elle effectue des perquisitions à bord de navires qui hissent le drapeau étoilé, afin de reprendre des marins déserteurs. La marine américaine ne comprend alors que quelques frégates et canonnières, mais ses hommes ne manquent pas de courage pour s'opposer aux croiseurs anglais. En 1807 et 1811, des navires de la Royal Navy et de la U.S. Navy se livrent même quelques combats isolés !
Finalement, les relations diplomatiques se détériorent à un point tel qu'au début de 1812 on décide de recruter un autre régiment de Fencibles dans le Haut-Canada. On lève le Glengarry Light Infantry, en partie parmi les colons écossais établis dans l'est de la province ontarienne actuelle.
Mobilisation au Bas-Canada. Remous politiques remplacés par la peur d'une invasion
Carte de l'est du Canada et du nord-est des États-Unis
Lors de la guerre de 1812, la plupart des batailles ont eu lieu dans les régions frontalières indiquées sur cette carte.
Parallèlement, la situation politique au Bas-Canada s'envenime sous la direction du gouverneur en chef sir James Henry Craig, bon soldat mais politicien maladroit. En 1810, dans le but de juguler l'opposition, il ordonne la fermeture du journal Le Canadien et l'emprisonnement de son imprimeur. Ce geste, suivant de peu l'annulation des brevets d'officiers de milice de plusieurs membres de l'opposition siégeant à la chambre d'Assemblée, plonge le Bas-Canada dans une crise politique, car l'opposition est composée essentiellement de Canadiens français, tandis que la plupart des partisans de Craig se recrutent parmi les bourgeois anglophones. La rivalité entre les deux groupes ethniques menace de dégénérer en affrontement.
Sir James Henry Craig, gouverneur général du Canada de 1807 à 1811
Sir James Henry Craig (1748-1812) a été gouverneur général du Canada de 1807 à 1811. Son règne a été mouvementé, mais il avait de nombreux amis et admirateurs dans la colonie si l'on en croit la vente au Canada des nombreuses gravures le représentant. Le gouverneur Craig est représenté vêtu d'un uniforme de général britannique. Il porte l'étoile de l'Ordre du Bain sur la poitrine.
En 1811, Londres décide de rappeler Craig et de le remplacer par un officier d'origine suisse, parlant le français, sir George Prevost. Excellent gestionnaire et fin politique, celui-ci a pour mandat de réparer les pots cassés et de se préparer à un conflit imminent avec les États-Unis. Grâce à ses manières conciliantes, Prevost rallie bientôt l'opposition. Il s'est rendu compte que Canadiens français et anglais confondus craignent avant tout une invasion américaine. En effet, le discours provenant de Washington n'est guère rassurant : le groupe des War Hawks - les faucons de la guerre - tient le haut du pavé avec l'assentiment du président James Madison. Ce groupe préconise la mobilisation de 50 000 miliciens dans le but d'envahir le Canada, entreprise des plus faciles, selon ses dires. Il suffirait « tout simplement de marcher jusqu'à Québec », affirme l'ancien président Thomas Jefferson, convaincu que la population ne saurait résister à des soldats portant l'étendard étoilé de la liberté.
Mobilisation du Bas-Canada. Une armée pour le Bas-Canada
Devant cette perspective, le Bas-Canada décide de lever sa propre petite armée. En mars et avril 1812, l'Assemblée approuve la création d'un régiment d'infanterie légère composé de volontaires et de quatre bataillons d'infanterie de ligne qui seront conscrits parmi la milice, faute d'un nombre suffisant de recrues volontaires. Quelque 2 000 hommes, officiers et soldats, sont ainsi mobilisés et répartis dans les quatre bataillons de « Milice d'élite incorporée du Bas-Canada » durant le printemps et le début de l'été. Ils doivent être âgés de 18 à 30 ans et servir pendant trois mois, mais « en cas de guerre » ils pourraient « être tenus au service pendant deux ans ». Ils sont postés principalement au sud de Montréal.
On décide de les habiller et de les équiper comme les soldats de l'infanterie régulière, autrement dit avec des habits rouges. Or, traditionnellement, les miliciens canadiens-français préfèrent le bleu. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville, commandant le 2e bataillon de la milice d'élite, confie à l'adjudant général des milices : « [Je suis] persuadé d'après les préjugés que je connais aux habitants, que l'habillement rouge n'est pas le plus propre à faire un bon effet dans le moment ». Malgré cette opinion, les miliciens d'élite de 1812 endossent des habits rouges, comme le feront beaucoup d'autres miliciens quand le gouverneur général Prevost leur signalera qu'ils pourraient être confondus avec l'ennemi, l'infanterie américaine portant elle-même l'uniforme bleu !
Le régiment d'infanterie légère composé de volontaires est baptisé Voltigeurs canadiens, nom appelé à devenir célèbre dans notre patrimoine militaire, tout comme celui de son commandant, Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry. Les Voltigeurs canadiens doivent compter six compagnies recrutées par les officiers du régiment. Ces derniers se dispersent dans les villes et les campagnes afin de convaincre les hommes âgés de 17 à 35 ans de porter l'uniforme gris et noir des Voltigeurs. Leur succès est tel qu'il devient nécessaire d'interrompre le recrutement en juin, la province frôlant la banqueroute en raison de ses dépenses militaires.
Les forces britanniques et canadiennes. Des milices inférieures en nombre dominées par les Canadiens français
En 1812, l'armée britannique en garnison en Amérique du Nord compte 9 000 hommes, chiffre comparable à celui des effectifs de l'armée régulière américaine. Sur ce nombre, 4 400 sont postés au Bas-Canada, 1200 au Haut-Canada et le reste dans les Maritimes. Les milices coloniales britanniques, cependant, accusent un déficit énorme par rapport aux américaines. La population de l'ensemble des colonies britanniques en Amérique du Nord totalise alors à peine un demi-million de personnes, dont les trois cinquièmes habitent au Bas-Canada. La très grande majorité des 60 000 miliciens de cette province se compose de Canadiens français. On compte environ 11 000 miliciens au Haut-Canada, autant en Nouvelle-Écosse et 4 000 au Nouveau-Brunswick. En ajoutant les milices de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, ainsi que les Amérindiens, dont on ignore le nombre précis, on obtient un total d'environ 90 000 hommes.
La milice du Bas-Canada constitue la force principale susceptible de protéger le pays, tant par l'importance de ses effectifs que par sa situation géographique. Sans sa collaboration, il est douteux que l'armée britannique puisse résister indéfiniment aux Américains. À part ceux qui font partie des Voltigeurs canadiens et des quatre bataillons de la milice d'élite incorporée, tous les hommes en état de porter les armes se retrouvent dans la milice dite « sédentaire ». Comme autrefois, les miliciens se trouvent répartis en compagnies paroissiales. Cependant, celles-ci sont regroupées en de nombreuses « divisions », qui est l'équivalent des régiments, et commandées par un colonel et son état-major. La milice sédentaire n'est appelée au service actif qu'en cas d'urgence.
Recrutement de soldats pour le Corps provincial d'infanterie légère (Voltigeurs Canadiens), 1812-1813
Dans le Canada français, le recrutement de soldats se faisait après la messe du dimanche. Un officier (en vert), un soldat, un clairon et un sergent (en gris) du Corps provincial d'infanterie légère (mieux connu sous le nom du régiment des Voltigeurs canadiens) sont représentés sur les marches d'une église du Bas-Canada aux alentours de 1812 ou de 1813. Le recrutement se faisait également dans les tavernes locales. Il était dans l'intérêt des officiers subalternes de recruter des membres car, souvent, ils ne montaient pas en grade tant qu'ils n'avaient pas enrôlé un certain nombre d'hommes.
La loyauté douteuse de la milice du Haut-Canada
La milice du Haut-Canada, pour sa part, suscite de grandes inquiétudes. À tel point que le gouverneur général Prévost rapporte à Lord Liverpool, secrétaire d'État à la Guerre et aux Colonies, « qu'il ne serait peut-être pas prudent » d'armer plus de 4 000 des 11 000 miliciens de la province en cas de guerre ! Cette méfiance est due au fait qu'une bonne partie de la population, sans doute plus de la moitié, est d'origine américaine. De plus, le comportement de l'Assemblée législative rend la situation politique instable. En mars 1812, le général Isaac Brock, également « président » et administrateur du gouvernement du Haut-Canada, parvient néanmoins à faire approuver par les députés une mesure défensive importante. Dorénavant, chaque régiment de milice du Haut-Canada comportera deux compagnies d'élite composées de volontaires qui s'entraîneront six jours par mois. En cas d'urgence, ils seront mobilisés sur-le-champ et serviront jusqu'à six mois.
Le 24 juin 1812, un courrier en provenance de New York arrive à Montréal, apportant la nouvelle tant redoutée : les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne sept jours auparavant.
Les Américains ont d'abord l'ambition d'envahir et de conquérir le Canada. Pour y parvenir, il leur faut cependant une bonne armée régulière appuyée par des milices fiables. Avec une population d'environ sept millions et demi d'habitants, ils disposent d'un potentiel énorme. Dès janvier 1812, ils augmentent leur armée régulière de 10 régiments d'infanterie et de deux régiments d'artillerie. À la fin du mois de juin, ces effectifs s'accroissent de nouveau quand le Congrès décide d'entretenir une armée régulière de 35 735 officiers et soldats. De leur côté, les États comptent au moins 600 000 jeunes hommes en état de porter les armes ; ils peuvent donc mobiliser des dizaines de milliers de miliciens pour le service actif, afin de seconder l'armée régulière.
Cette force militaire n'existe cependant qu'en théorie : la réalité est tout autre. En juin 1812, l'armée régulière ne compte que 11 000 hommes, dont 5 000 nouvelles recrues sachant à peine manier un fusil. À part l'artillerie et le génie, le corps des officiers est plutôt médiocre. L'apport d'officiers sans expérience, ayant souvent obtenu leur brevet par faveur politique, n'améliore guère les choses. Les milices, quant à elles, sont d'une qualité très inégale. À cette époque, les milices des différents États ne sont pas soumises à l'autorité fédérale, ce qui donne lieu à des situations incongrues. Par exemple, un général de milice peut revendiquer le commandement de troupes régulières ! Bien plus, un État peut refuser de mobiliser sa milice, même en temps de guerre. C'est d'ailleurs ce que décident les États de la Nouvelle-Angleterre, qui s'étaient opposés à la déclaration de guerre. Enfin, il n'existe pas de véritable état-major des armées pour établir la planification stratégique et tactique essentielle à tout succès militaire. Cette tâche relève d'un politicien, le secrétaire d'État à la Guerre, plus ou moins bien secondé par les généraux.
La stratégie d’invasion. Retarder une invasion éventuelle
Dès le début, il apparaît évident que les Américains sont très mal préparés, tant politiquement que militairement, pour réaliser les grands desseins des « faucons de la guerre ». Au Canada, en revanche, on les attend de pied ferme. À Québec, l'état-major constitue un véritable lieu de planification stratégique et tactique, pensée par des officiers spécialisés supervisés par le gouverneur général, lui-même officier supérieur de l'armée régulière. On peut compter sur des effectifs peu nombreux, mais très bien entraînés et rompus à la discipline particulièrement sévère de l'armée britannique - à l'opposé des Américains.
La stratégie des Britanniques est simple. Dans le Haut-Canada, les troupes commandées par le général Isaac Brock devront retarder les Américains le plus longtemps possible. Au Bas-Canada, la plupart des troupes seront postées au sud de Montréal. Cette ville étant le pivot stratégique de tout l'intérieur du pays, l'état-major britannique prévoit qu'elle sera la première cible. Si, par malheur, le Haut-Canada et Montréal viennent à tomber aux mains des ennemis, les troupes qui resteront se réfugieront dans la ville forteresse de Québec, espérant parvenir à soutenir un siège jusqu'à l'arrivée de renforts anglais.
Avancée à l’Ouest du général Hull
À la surprise générale, au lieu de l'attaque prévue sur Montréal, c'est aux antipodes qu'a lieu la première offensive américaine. Le 12 juillet 1812, le général William Hull, gouverneur du Michigan, conduit ses troupes depuis Detroit jusqu'au village de Sandwich (en Ontario), qui ne possède pas de garnison. Il annonce officiellement qu'il viendra bientôt libérer tous les habitants de la tyrannie et que ceux qui ne voudront pas être libres seront sujets « à toutes les horreurs et calamités de la guerre ». Il commande une armée de 1200 hommes, comprenant 400 soldats réguliers du 4e régiment d'infanterie, ainsi que des miliciens de l'Ohio et du Michigan. Peu fiables, ceux-ci pourraient néanmoins être stimulés par un bon général. Or, Hull est indécis et il reste finalement sur place, au lieu d'envahir la partie ouest du Haut-Canada.
Fiascos américains. La Grande Bretagne s’empare du fort Mackinac
Soldat du 10e Bataillon royal des vétérans, vers 1812
Le Bataillon royal des vétérans consistait en des unités de troupes de garnison formées de soldats plus âgés toujours en mesure de monter la garde et de rendre d'autres services. Le 10e Bataillon a été levé en 1806 au Canada. Même si ce bataillon n'était pas censé combattre, ces vétérans composaient les seules troupes régulières britanniques présentes au fort Saint-Joseph au début de la guerre de 1812. Il a participé à l'attaque surprise qui a permis aux Britanniques de prendre le fort Mackinac aux Américains. Les membres de ce régiment portaient l'uniforme standard de l'infanterie britannique, lequel, conformément aux régiments royaux, était orné de parements bleus. Un nouvel uniforme a été ordonné en 1812. L'homme représenté sur cette image porte le plus ancien, à savoir un modèle de shako qui date de 1806, une culotte blanche et des demi-guêtres. Il aura fallu au moins un an avant que le nouvel uniforme arrive aux frontières canadiennes. À l'arrière-plan se trouvent un sergent-major (à l'extrême gauche), trois soldats (au centre) et un sergent (à l'extrême droite) qui tient un esponton.
Plus au sud, Britanniques, Canadiens et Amérindiens se préparent à passer à l'attaque contre Hull et ses troupes cantonnées à Detroit. Le 13 août, le général Brock se rend au fort Malden avec une partie du 41e régiment, des miliciens et des Amérindiens, et y rencontre le grand chef Tecumseh. Ces deux hommes, l'un et l'autre d'une stature imposante, éprouvent immédiatement un grand respect l'un pour l'autre. La légende veut que Tecumseh se soit tourné vers ses braves en déclarant : « Voilà un homme », c'est-à-dire un vrai chef, tout comme lui.
Brock décide alors que le moment est venu d'aller assiéger Detroit. À la tête de 300 soldats du 41e régiment et du Royal Newfoundland Fencibles, de 400 miliciens et d'environ 600 Amérindiens, il arrive à proximité de la ville le 16 août. À la vue de cette troupe, les Américains cèdent presque à la panique tant ils redoutent le sort que pourraient leur réserver les Amérindiens. De plus, ils supposent l'armée régulière britannique plus considérable qu'elle ne l'est en réalité, grâce à une ruse de Brock qui a fait distribuer de vieux uniformes du 41e régiment à ses miliciens. Lorsque l'artillerie britannique ouvre le feu, de nombreux miliciens américains, effrayés, désertent. Complètement dépassé par les événements, le général Hull capitule. L'invasion du Canada par l'ouest repoussée, c'est le Michigan qui est à son tour envahi !
Invasion repoussé à Quennston
À Niagara, une autre armée américaine se regroupe lentement. Après plusieurs retards dus à des conflits entre les généraux de l'armée régulière et de la milice de l'État de New York, près de 7 000 combattants sont rassemblés au début du mois d'octobre. Du côté canadien, la petite armée du général Brock est bien inférieure en nombre : il faut compter presque quatre Américains pour un Britannique ou un Canadien ! Le 13 octobre, le général Solomon van Renssalaer traverse la rivière Niagara avec ses hommes et se retranche sur une colline à Queenston. Brock attaque immédiatement afin de ne pas laisser aux Américains le temps de s'établir pour faire passer le reste de leur armée. Le 41e, le 49e, les milices de Niagara, des volontaires torontois et des Amérindiens donnent l'assaut. La position américaine est ébranlée, mais Brock meurt d'une balle en pleine poitrine. La relève est prise par le général Roger Hale Sheaffe, qui met les Américains en déroute.
Cette défaite soulève le problème majeur des Américains : l'absence d'homogénéité de leurs armées. En effet, la milice new-yorkaise, prise de panique, invoque son droit constitutionnel de servir uniquement à l'intérieur des limites de l'État de New York et refuse de traverser la rivière ! Par milliers, ces miliciens regardent donc sans broncher leurs compatriotes les appelant vainement à l'aide pendant qu'ils succombent sous les balles ennemies ou se constituent prisonniers.
Ailleurs, les attaques prévues n'auront pas lieu, et c'est ainsi que se termine la grande invasion de 1812. Les Américains ont été mis en déroute partout et le Michigan tombe aux mains des Anglo-Canadiens. Mais, face à l'adversité, les Américains ne sont pas de ceux qui jettent le gant facilement, bien au contraire...
Nouvelles invasions à l'ouest. Échec des Américains pour reprendre Detroit
Pendant l'année 1813, les Américains vont donc se ressaisir, réorganiser et augmenter les effectifs de leur armée régulière, puis raffermir leurs milices, tout en poursuivant leur offensive contre le Canada. Leur priorité consiste à reprendre Detroit. Dès la fin de 1812, une nouvelle armée d'environ 7 000 hommes, comptant de nombreux miliciens du Kentucky et de l'Ohio, s'achemine vers le Michigan sous le commandement du général William Henry Harrison. En janvier 1813, une partie de cette armée, sous les ordres du général James Winchester, s'empare de Frenchtown (à Monroe, dans le Michigan) sur la rivière Raisin, au sud de Detroit. Le commandant britannique de la région, le colonel Henry Procter, réussit toutefois à encercler Frenchtown sans être découvert. Le 22 janvier, il attaque les 1 000 hommes de Winchester avec 200 soldats britanniques, 300 miliciens du comté d'Essex et marins canadiens-français, et 450 Amérindiens. Le 17e régiment d'infanterie régulière et trois régiments de milice du Kentucky sont annihilés. Les guerriers amérindiens se vengent alors cruellement de ces hommes qui ont incendié leurs habitations et leurs récoltes peu auparavant. Les pertes américaines s'élèvent à 958 hommes dont 397 tués ; seuls 33 combattants parviennent à s'échapper. À la suite de ce désastre, les Américains se rabattent sur la défensive.
Contre-attaques britanniques neutralisées
Procter reprend l'offensive à la fin d'avril et assiège le fort Meigs (près de Perrysburg, dans l'Ohio) avec environ 1 000 soldats et miliciens canadiens et 1 500 Amérindiens conduits par Tecumseh. Le général Harrison y est retranché avec 1 100 hommes. Le 5 mai, un renfort de 1200 miliciens du Kentucky attaque les lignes anglaises. Au premier choc, les hommes de Procter fléchissent volontairement, afin d'attirer l'ennemi dans une embuscade. Le stratagème réussit et les miliciens du Kentucky se lancent à leur poursuite. Les Amérindiens de Tecumseh les attaquent alors de flanc et seuls moins de 200 hommes leur échappent. Malgré ce succès, Procter est contraint de se retirer quelques jours plus tard, les guerriers de Tecumseh refusant de poursuivre le siège.
En juillet, Procter lance une seconde offensive infructueuse contre le fort Meigs, puis tente d'enlever le fort Stephenson, défendu par quelque 2 000 hommes sous les ordres du major George Croghan. L'assaut britannique tourne mal et Procter perd près du tiers de ses soldats réguliers, soit 96 hommes, morts ou blessés. Au même moment, des milliers d'Américains arrivent en renfort. Ne parvenant pas à les contenir, Procter se retire de l'Ohio.
Les Américains à l'assaut du Haut-Canada. Défaite navale britannique suivie d'un désastre sur terre
La bataille de Thames et la mort de Tecumseh (à droite), 5 novembre 1813
Cette gravure américaine, plutôt romantique, de 1839 représente la mort du chef Shawnee Tecumseh lors de la bataille de Thames le 5 novembre 1813. Le général américain William Henry Harrison (1773-1841), brandissant une épée, et le gouverneur du Kentucky, Shelby, se trouvent au centre de l'œuvre. Harrison a en partie gagné les élections présidentielles américaines de novembre 1840 grâce à sa réputation de militaire.
C'est alors que les forces navales entrent en jeu. Depuis février 1813, les Américains préparent une flottille à Erie, en Pennsylvanie, sous le commandement du commodore Oliver Hazard Perry. Leur objectif est d'obtenir la suprématie navale sur le lac Érié, de façon à rendre la position des Britanniques intenable. Commandée par le capitaine Robert Heriot Barclay, la petite escadre britannique du lac Érié est moins puissante que celle de Perry. Le 10 septembre a lieu un rude combat naval, dont les Américains sortent vainqueurs.
Ce revers met Procter dans une fâcheuse position en le privant de son principal moyen de communication avec le reste des forces britanniques, et de ses sources de ravitaillement. De plus, les Américains peuvent désormais débarquer une armée sur la rive nord du lac Érié pour lui couper la retraite. Ne disposant que d'environ 900 hommes, Procter se voit obligé d'abandonner l'ouest du Haut-Canada le plus rapidement possible. Il se retire d'abord de Detroit et de fort Maiden. Le 27 septembre, à l'approche des 6 000 hommes de l'armée d'Harrison, Procter et ses soldats, avec Tecumseh et ses guerriers, accompagnés de nombreux réfugiés qui ralentissent leur marche, amorcent leur retraite vers l'est en longeant la rivière Thames. Quelque 3 000 Américains se lancent à leur poursuite et les rattrapent à Moraviantown, le 5 octobre. Harrison fait alors charger le régiment des carabiniers à cheval du Kentucky, commandé par le lieutenant-colonel Richard Johnson. C'est un désastre pour les forces britanniques, épuisées et prises au dépourvu. Le 41e régiment est taillé en pièces et Tecumseh succombe avec 33 de ses guerriers. Pas moins de 634 officiers et soldats britanniques sont tués, blessés ou faits prisonniers. Avec une perte de seulement 12 morts et 17 blessés, les Américains s'emparent en outre de six canons. Cependant, Procter parvient à s'échapper avec 246 officiers et soldats, en emportant les drapeaux du 41e ; douze jours plus tard, il se retranche plus à l'est, à Ancaster. Malgré leur grande supériorité numérique, les Américains n'osent l'attaquer et restent sur leurs positions.
Nouveau leadership américain
Entre-temps, les défaites de l'année 1812 ont modifié bien des choses à Washington. Le général John Armstrong a été nommé secrétaire d'État à la Guerre. C'est un militaire et un diplomate chevronné qui a séjourné pendant plusieurs années en France, où il a eu l'occasion de rencontrer Napoléon et d'étudier le fonctionnement de l'armée française, alors à son apogée. Sous sa gouverne, l'organisation de l'armée américaine fait de grands progrès. Mais Armstrong doit souvent composer avec des troupes mal dirigées et imparfaitement entraînées. Ne disposant pas d'un véritable état-major, il est accaparé par de menus détails administratifs et doit souvent se mêler de la conduite des campagnes au lieu de concentrer son énergie sur la stratégie proprement dite. C'est pourquoi les Américains, en 1813, consentent à des efforts considérables pour conquérir le Haut-Canada alors qu'ils négligent l'objectif principal, Montréal. Cet éparpillement de leurs forces ne peut que favoriser les défenseurs du Canada.
Raid américain sur York
La mort du général américain Pike lors de la bataille de York, 27 avril 1813
La ville de York (aujourd'hui Toronto en Ontario) est tombée aux mains des Américains après une bataille menée le 27 avril 1813. Le brigadier Zebulon Pike (1779-1813) était le commandant adjoint des forces de l'armée américaine qui ont participé à cette bataille. Mieux connu en raison de la montagne nommée en son honneur (Pike's Peak), cet officier a été tué par des débris projetés par l'explosion d'une poudrière détruite par les forces britanniques qui battaient en retraite. Les structures représentées sur la gravure américaine de 1839 ressemblent peu aux véritables fortifications que York avait à cette époque. En effet, la ville, en soi, n'était pas à portée de vue et se trouvait davantage vers l'est.
Depuis l'automne 1812, la marine américaine effectue d'importants travaux à Sackets Harbor. Au printemps 1813, son escadre, sous le commandement du commodore Isaac Chauncey, est devenue la plus puissante sur le lac Ontario. Cette situation permet au général Dearborn d'embarquer un contingent de 1 700 soldats réguliers sur la flotte de Chauncey et d'attaquer York (Toronto). Le 27 avril, bien qu'elle se soit honorablement défendue, la petite garnison composée d'environ 200 soldats, appuyée par 500 miliciens et une cinquantaine d'Amérindiens, doit se replier. Mais cette victoire va coûter cher aux Américains. Peu après leur entrée dans la ville, en effet, un magasin de poudre explose accidentellement, causant la mort du général de brigade Zebulon Montgomery Pike, officier prometteur et fort apprécié, ainsi que celle de 38 soldats. Cette explosion blesse en outre 222 hommes, de sorte qu'au total les pertes américaines s'élèvent à environ 320 tués et blessés. Dearborn, qui croit d'abord à une trahison des Britanniques, préfère fermer les yeux sur le pillage de la ville par ses soldats et marins. Ceux-ci ont toutefois la décence de respecter les femmes - aucun viol ne sera rapporté par la suite - et ne pillent que les maisons abandonnées par leurs occupants. Avant de repartir, les Américains incendient le parlement et les édifices publics.
Les Britanniques chassés de la péninsule de Niagara
Un mois plus tard, le 27 mai, Dearborn attaque le fort George, principale place forte britannique de la presqu'île du Niagara. Devant la supériorité numérique des Américains, les soldats et miliciens anglo-canadiens abandonnent le fort après une défense vigoureuse. Le général britannique John Vincent se replie alors avec ses troupes jusqu'à la baie de Burlington, non loin d'Hamilton. Les Américains lancent un contingent d'environ 3 500 hommes à sa poursuite. Peu après, des éclaireurs rapportent à Vincent que le camp américain à Stoney Creek n'est gardé que par quelques sentinelles. Le 6 juin, en pleine nuit, le 49e régiment et cinq compagnies du 8e font irruption dans le camp américain, baïonnette au canon ! Le général Winder, avocat de Baltimore qui devait son rang militaire à ses relations politiques, est capturé avec son artillerie, et ses soldats se dispersent dans le désordre.
Le fort George, Haut-Canada. En 1794
Échec du raid britannique sur Sackets Harbor
Pendant ce temps, à l'est du lac Ontario, l'arrivée à Kingston de sir James Lucas Yeo accompagné de marins de la Royal Navy permet à l'escadre britannique de reprendre le dessus. Disposant maintenant d'une certaine maîtrise navale, le gouverneur en chef Prévost prend le commandement d'un raid contre Sackets Harbor, principale base navale américaine sur le lac. L'attaque est déclenchée le 28 mai par une colonne de 750 hommes débarqués des navires du commodore Yeo. La place n'est défendue que par 400 hommes de l'armée régulière et par 500 miliciens accourus pour les aider, qui sont sous les ordres d'un jeune et brillant général de la milice new-yorkaise : Jacob Brown. Durant deux jours, celui-ci aiguillonne ses hommes et parvient à résister aux assauts. Les pertes britanniques sont importantes : 47 morts et 1954 blessés, contre 41 tués et 85 blessés chez les Américains. La conduite de Brown lui vaut un brevet de général de brigade dans l'armée régulière.
Laura Secord et Beaver Dams. Un secret dévoilé
Laura Secord découverte par des Amérindiens alliés aux Britanniques, 22 juin 1813
Le 22 juin 1813, Laura Secord, après son fameux périple de 30 kilomètres, tombe sur un camp amérindien. Étant les alliés des Britanniques, ces Amérindiens ont amené Mme Secord jusqu'à un détachement de troupes britanniques qui se trouvait à la maison DeCew, sur l'escarpement du Niagara, près de ce qui est aujourd'hui la ville de Sainte-Catherine, en Ontario. Une fois arrivée, elle a pu informer les Britanniques d'une attaque imminente des Américains. Cette gravure nous donne une image plutôt romantique de l'héroïne. Au moment de son exploit, Mme Secord avait 38 ans; elle était donc relativement plus âgée que la dame représentée sur cette image. Toutefois, d'après un témoin oculaire de l'époque, « elle était mince et avait une apparence délicate ».
Dans la péninsule du Niagara, après leur déconfiture à Stoney Creek, les soldats américains se regroupent à Forty Mile Creek. Mais, le 7 juin, la flottille de Yeo bombarde leur camp, provoquant leur retraite précipitée vers le fort George. Cet endroit devient dès lors le dernier de la péninsule qui abrite encore des militaires américains. Dearborn envoie néanmoins un contingent de 575 hommes, sous les ordres du colonel Charles Boerstler, pour attaquer par surprise l'avant-poste britannique de Beaver Dams (Thorold). C'est sans compter avec une véritable héroïne canadienne Laura Secord. Humble ménagère du village de Queenston, Laura Secord, née Ingersoll, compose, comme tant d'autres femmes de son temps, avec les affres de la guerre. En ce début d'été de 1813, sa vie n'est pas facile, son mari, James, étant devenu invalide à la suite d'une blessure subie à Queenston Heights. Le 21 juin, des officiers américains se présentent chez eux, réclamant à manger. Durant le repas, les Secord les entendent discuter de l'attaque-surprise qu'ils préparent. Laura décide alors d'aller prévenir les Britanniques à Beaver Dams. Elle part le lendemain, à l'aube, et fait un grand détour afin d'éviter les patrouilles américaines. Suivant le cours d'un ruisseau à travers bois, elle marche toujours à la nuit tombante, incertaine du chemin, lorsqu'elle arrive à un campement amérindien. Par chance, il s'agit d'éclaireurs de l'armée britannique qui la conduisent au lieutenant James FitzGibbon, commandant d'un petit détachement d'une cinquantaine d'hommes du 49e régiment à Beaver Dams. Fitz Gibbon fait immédiatement disposer des éclaireurs de façon à couper la route aux Américains.
Terrorisés par les Iroquois, les Américains se rendent
Le lendemain, à la première heure, des éclaireurs amérindiens commandés par le capitaine Dominique Ducharme repèrent les Américains. Dès neuf heures du matin, Ducharme, avec quelque 300 Iroquois bien embusqués, ouvre le feu sur l'arrière de la colonne américaine. Une centaine d'autres Iroquois, commandés par le capitaine William Johnson Kerr, arrivent en renfort. Pendant trois heures, ils canardent les Américains en poussant leurs terribles cris de guerre. Terrorisés, Boerstler et ses soldats désirent se rendre, mais pas aux Amérindiens. C'est alors que se présente FitzGibbon avec son détachement du 49e, juste à temps pour leur permettre de le faire ! Pas moins de 462 officiers et soldats de l'armée régulière avec 30 miliciens américains se constituèrent prisonniers. Les drapeaux du 14e régiment d'infanterie et deux canons sont également pris. FitzGibbon recueille presque toute la gloire de cette victoire, tandis que les Amérindiens ainsi que Ducharme et Kerr, sont pour ainsi dire « oubliés »...
On a dit, à propos de cet épisode, que les Amérindiens combattirent et que FitzGibbon en récolta tous les honneurs. Quant à Laura Secord, sans laquelle ce fait d'armes n'aurait pu se produire, son récit ne fut connu qu'à la fin de sa vie. Son exploit en vint à symboliser non seulement la résistance du Haut-Canada, mais aussi le patriotisme et l'abnégation de nombreuses femmes canadiennes durant ces sombres années d'invasions répétées.
Pendant l'année 1813, la péninsule du Niagara demeure le théâtre de plusieurs autres batailles et escarmouches qui ne peuvent néanmoins à elles seules sceller le sort du pays. À l'automne, toutefois, le danger s'intensifie, lorsque les Américains décident d'envoyer non pas une, mais deux armées pour attaquer Montréal ! L'opération sera conduite par le général James Wilkinson, vétéran de longue date qui vient de remplacer Dearborn comme général en chef de l'armée américaine. Il commandera l'armée principale, forte de 8 800 hommes et équipée de 38 canons de campagne et de 20 canons de siège ; celle-ci avancera vers Montréal par l'ouest, en longeant le Saint-Laurent. La seconde armée, commandée par le général Wade Hampton, compte 5 500 hommes et 10 canons de campagne. Elle remontera la rivière Châteauguay jusqu'à Montréal, où elle se joindra à la première. Ces deux armées sont composées essentiellement de troupes régulières, appuyées de volontaires.
La menace est de taille : clé stratégique du Canada, Montréal n'a pourtant pas de fortifications. Les vieux murs croulants qui en tiennent lieu datent du Régime français et ont été rasés en 1810. Quoi qu'il en soit, ils ne pourraient en aucun cas résister à une armée nombreuse et bien équipée d'artillerie de siège. Pour défendre Montréal, c'est à ses avant-postes qu'il faut arrêter l'ennemi. Environ 6 000 Britanniques et Canadiens s'y emploient au sud de la ville, de Laprairie jusqu'à l'île aux Noix.
Objectif Montréal. La milice du Bas-Canada participe à la défense
Lorsque le commandement britannique apprend que l'armée d'Hampton se prépare à traverser la frontière, quelque 8 000 hommes de la milice sédentaire du Bas-Canada sont mobilisés pour le service actif. C’est d'excellents miliciens, selon William Dunlop, chirurgien du 89e, qui croise plusieurs de leurs régiments sur sa route, un jour d'octobre 1813.
« Ils présentaient tous une apparence satisfaisante. Ils avaient été bien entraînés et leurs armes, qui provenaient de la tour de [Londres], étaient en parfait état. Leur troupe n'avait pas l'aspect désordonné qu'aurait eu un tel contingent de gens mobilisés dans tout autre pays. Leurs capots et leurs pantalons en étoffe du pays étaient tous semblables et de la même couleur, de même que leurs tuques bleues, ce qui leur donnait une apparence uniforme et ajoutait beaucoup à leur air martial... Ils marchaient gaiement, en chantant leurs chansons de voyageurs et quand ils nous virent approcher portant l'uniforme britannique, ils lancèrent le cri de guerre amérindien suivi d'un retentissant « Vive le Roi » ! Sur toute leur ligne de marche.
La bataille de Châteaugay. Des barricades le long de la Châteauguay
Les soldats américains du général Hampton sont également en marche. Le 21 octobre, ils traversent la frontière en longeant la rivière Châteauguay. Le lendemain, le général Louis de Watteville, officier suisse au service des Britanniques qui commande le secteur au sud-ouest de Montréal, en est informé. Il ordonne au lieutenant-colonel de Salaberry d'aller immédiatement établir un avant-poste le long de la rivière avec des compagnies de Voltigeurs canadiens, la compagnie légère des Canadian Fencibles, des détachements de la milice et quelques Amérindiens : en tout, environ 1 800 hommes. Salaberry fait aménager sept lignes successives d'abattis, au travers de l'étroite route qui longe la rive ouest de la rivière près du site actuel d’llan’s Corner. De plus, bien que l'autre rive soit entièrement boisée, il y dispose néanmoins deux compagnies de milice.
Carte de la bataille de Châteauguay, 26 octobre 1813
La bataille de Châteauguay s’est déroulée le long des rives est et ouest de la rivière Châteauguay. La rive ouest offrait une mince clairière (vers le haut de cette carte publiée en 1815), où les défenseurs canadiens ont dressé leurs abattis (barricades composées d’arbres abattus) et combattu le 26 octobre 1813. Le gros des affrontements a eu lieu sur la rive ouest, mais une tentative par les Américains de contourner les abattis a donné lieu à de féroces et chaotiques combats sur la rive est. Le terrain accidenté a joué en faveur des défenseurs en empêchant les envahisseurs de se rendre compte qu’ils étaient 10 fois plus nombreux que les Canadiens.
Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry, lieutenant-colonel, Voltigeurs canadiens, vers 1813-1815
Charles-Michel d’Irumberry De Salaberry (1778-1829) était un officier vétéran de l’Armée britannique ayant servi aux Antilles et aux Pays-Bas. Il appartenait à l’une des familles les plus influentes du Canada français, qui jouissait d’une amitié de longue date avec le prince Edward Augustus, duc de Kent et futur roi William IV. Le jeune Canadien a obtenu son premier commandement, au sein du 60e Régiment de fantassins (royal d’Amérique), grâce à l’influence du prince. Il a mis sur pied le Corps provincial d’infanterie légère (les Voltigeurs canadiens) en 1812 et il a acquis une renommée durable au Canada lorsque 300 à 400 de ses hommes ont vaincu une force de plus de 5 000 Américains à Châteauguay le 26 novembre 1813. Cette gravure, postérieure à la guerre de 1812, montre Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry portant l’uniforme d’un officier des Voltigeurs canadiens. La médaille circulaire à sa poitrine est la Médaille d’or d’officier supérieur, une décoration très rare à l’époque. Cette même médaille se trouve aujourd’hui dans la collection du Musée canadien de la guerre.
300 contre 3000
Dans la matinée du 26 octobre, l'armée d'Hampton débouche dans une clairière face au premier abattis que défendent environ 175 hommes. La brigade d'infanterie américaine du général Izard se place en formation d'attaque. Un officier américain à cheval s'approche de la barricade et invite, en français, les « Braves Canadiens » à se joindre aux soldats de la Liberté pour secouer le joug britannique. En guise de réponse, Salaberry monte sur un tronc d'arbre, épaule le fusil d'un de ses Voltigeurs et met fin à son discours ! La fusillade éclate alors de toutes parts. Pendant qu'une partie de l'armée américaine s'avance vers la première ligne d'abattis de la rive ouest, une colonne de 1 500 hommes sous les ordres du colonel Purdy, plus ou moins égarée, se faufile dans les bois de la rive est afin de contourner la position canadienne. Ces hommes se heurtent soudain aux deux compagnies de milice canadienne qui, sans hésiter, tirent une salve et chargent la colonne américaine. Surpris et confus, les Américains hésitent, puis commencent à fléchir, et plusieurs débouchent sur les berges de la rivière pour être aussitôt pris sous le feu des Canadiens placés sur l'autre rive, ce qui les force à battre en retraite.
De son côté, une partie de la brigade américaine d'Izard tente de contourner le premier abattis. Ce mouvement semble réussir, car les soldats canadiens commencent à se retirer. Mais à peine les Américains sont-ils arrivés à proximité du bois que jaillissent les cris de guerre des Amérindiens embusqués qui ouvrent le feu sur eux ; en même temps, des clairons sonnent de toutes parts et les clameurs de centaines d'hommes tapis au-delà, dans les bois, s'élèvent. Salaberry a en effet demandé au lieutenant-colonel George Macdonell, qui commande les lignes d'abattis situées à l'arrière, de faire le plus de bruit possible. Il n'en faut pas plus pour que les Américains croient les bois envahis d'Amérindiens et toute l'armée britannique à leurs trousses ! Ils battent en retraite. Le lendemain, Hampton et son armée reprennent la route des États-Unis. C'est ainsi que tourne court l'offensive américaine contre Montréal.
Disposant d'environ un homme contre dix, la victoire paraît d'abord improbable à Salaberry et Watteville. Pendant trois jours, ils s'attendent même à un nouvel assaut. Les Canadiens - aucun corps britannique n'a participé à l'engagement - n'ont eu que 4 morts et 8 blessés dans leurs rangs sur 300 hommes ayant pris part au combat. Les Américains, qui ont déployé environ 3 000 hommes au cours de l'affrontement, déplorent au moins une cinquantaine de tués. Cette bataille devait avoir un énorme retentissement parmi la population canadienne-française qui y voit la preuve incontestable de sa valeur militaire.
La bataille de Crysler
Carte de la bataille de la ferme Crysler, 11 novembre 1813
La bataille s’est déroulée dans un décor à l’européenne, au milieu des vastes champs de la ferme de John Crysler, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Parmi les soldats, en majorité des Britanniques, réunis à cet endroit le 11 novembre 1813 pour défendre le pays, on comptait John Crysler lui-même, lieutenant dans la 1re Milice de Dundas.
Les Britanniques s’emparent du fort Niagara. Retrait américain et incendie des villes
Afin de protéger la base navale de Sackets Harbor, la majeure partie de l'armée américaine cantonnée dans la péninsule du Niagara y est transférée; les troupes demeurées dans la région, désormais insuffisantes, doivent, au milieu de décembre, abandonner le fort George dont elles ne peuvent assurer la défense. Elles s'exécutent cependant de mauvaise grâce, incendiant Newark (aujourd'hui Niagara-on-the-Lake) et une bonne partie de Queenston, acte cruel qui laisse les civils sans abri pour affronter l'hiver.
Cette dévastation n'est cependant pas l'œuvre des seuls soldats américains. En effet, des Canadiens jouèrent un rôle majeur dans cette affaire en maniant la torche avec enthousiasme : il s'agit des Canadian Volunteers, commandés par le lieutenant-colonel Joseph Willcocks. Ce dernier, député à l'Assemblée du Haut-Canada au moment où il s'était joint aux Américains, en juillet 1813, s'était vu attribuer immédiatement un brevet d'officier pour recruter un corps composé de Canadiens. Les Canadian Volunteers de l'armée régulière américaine comptaient une centaine d'hommes qui servaient d'éclaireurs dans la péninsule du Niagara, mais aussi d'informateurs dans la zone occupée par les Américains. Ce corps de renégats devait exister jusqu'à la fin de la guerre.
Les Britanniques se vengent
Les incendies de Newark et de Queenston scandalisent les Britanniques, qui ripostent promptement. Au petit matin du 16 décembre, quelque 550 hommes des 1er, 41e et 100e régiments traversent silencieusement la rivière Niagara sur des bateaux conduits par des miliciens, et prennent d'assaut le fort Niagara, à la baïonnette. Les Américains y perdent 67 soldats et les Britanniques 5 seulement. Le village voisin de Lewiston est ensuite incendié, comme Newark l'a été quelques jours auparavant. Le 29 décembre a lieu une nouvelle incursion de 1 500 Britanniques contre Black Rock et Buffalo, sur le lac Érié. Les Américains ne peuvent résister : les villages sont brûlés, de même que quatre petites canonnières de la marine et les magasins d'approvisionnement militaire. Le 12 janvier 1814, le gouverneur en chef Prévost invite les Américains à se conduire dorénavant de façon plus civilisée, tout en avertissant qu'il n'hésitera pas à venger immédiatement tout nouvel acte barbare. Les belligérants feront preuve de plus de modération par la suite.
Levée de renforts canadiens
La Grande-Bretagne se trouve à cette époque dans l'impossibilité de dépêcher des renforts nombreux au Canada pour la bonne raison qu'une grande partie de son armée combat les troupes napoléoniennes en Espagne. Elle envoie cependant, en 1813, six régiments d'infanterie et deux bataillons d'infanterie de marine en Amérique du Nord. Un régiment supplémentaire de Fencibles est aussi recruté au Nouveau-Brunswick. Le nombre d'officiers et de soldats réguliers en Amérique du Nord est ainsi porté à environ 18 000, dont 14 000 sont déployés dans le Haut et le Bas-Canada. En 1813, l'armée régulière américaine approche, pour sa part, des 25 000 hommes, sans compter quelques milliers de volontaires.
Des volontaires ou des conscrits canadiens sont donc également nécessaires pour renforcer l'armée régulière britannique. Le Bas-Canada forme un cinquième bataillon de milice d'élite incorporée à Montréal en septembre 1812, puis un sixième bataillon en mars 1813, ce dernier devant monter la garde à Québec. On dénombre également trois compagnies d'infanterie légère, autant de cavalerie légère, une compagnie de conducteurs d'artillerie, une demi-compagnie d'artillerie et 200 ou 300 éclaireurs amérindiens. Enfin, ce sont environ 400 hommes qui appartiennent à un corps tout à fait typique du pays, celui des Voyageurs canadiens. Au total, quelque 5 500 officiers et soldats composent la petite armée du Bas-Canada.
Dans de nombreux comtés du Haut-Canada, les compagnies d'élite des régiments de milice sont mobilisées. Plusieurs serviront avec les troupes britanniques jusqu'à la fin de 1812, année au cours de laquelle ces soldats-citoyens pourront enfin regagner leurs foyers. Il faut cependant compter sur des troupes plus stables pour servir jusqu'à la fin de la guerre. Au printemps de 1813, on met donc sur pied un bataillon de milice volontaire incorporée ainsi qu'une compagnie d'artillerie, une de conducteurs d'artillerie, une d'artificiers, deux autres de cavalerie légère et un corps de Western Rangers, pour un total d'environ 1 000 officiers et soldats, auxquels s'ajoutent quelques centaines d'Amérindiens - il est difficile de les dénombrer - mobilisés pour des périodes indéterminées.
L'invasion du Canada de 1814. Isolement américain
Au printemps de 1814, le président James Madison et les « faucons de la guerre » reçoivent de très mauvaises nouvelles. Une succession d'événements majeurs a bouleversé la conjoncture internationale : la Grande Armée de Napoléon s'est enlisée dans les neiges de la Russie et la France a été envahie. Le 31 mars 1814, en effet, les armées alliées sont entrées dans Paris, accueillies en triomphe par une population fatiguée des guerres de l'Empire. Le 11 mai, Napoléon abdique et se retire dans l'île d'Elbe. La paix a été proclamée et la monarchie des Bourbons rétablie. Les Américains ont donc perdu leur plus grande « alliée », bien qu'il n'y ait jamais eu d'alliance formelle avec la France, et l'Angleterre pourra à présent concentrer tous ses efforts contre les États-Unis.
C'est la raison pour laquelle les Américains vont s'appliquer à marquer des points le plus rapidement possible et à envahir le Canada avant que de nombreux renforts n'y parviennent. Le plan d'invasion fait cependant l'objet de débats houleux au sein du Cabinet américain et il n'est adopté que le 7 juin. L'objectif principal consiste à envahir le Haut-Canada par la péninsule du Niagara.
Avant même que ce plan ne soit adopté, les choses commencent à se gâter. À la fin de mars, cherchant à redorer son blason après le fiasco de l'automne précédent, le général Wilkinson franchit la frontière du Bas-Canada à la tête d'environ 2 000 hommes afin de prendre position au sud de Montréal. Arrivé à Lacolle, Wilkinson se trouve confronté à une farouche résistance. Devant tant de détermination, les Américains décident de retraverser la frontière, laissant derrière eux 154 hommes, morts, blessés et disparus alors que les Britanniques et les Canadiens ont subi 59 pertes.
Enfin des généraux américains compétents
Peu après l'échec de Lacolle, Wilkinson est relevé de son commandement. Dernier représentant d'une espèce en voie de disparition, celle des vieux généraux incompétents de l'armée américaine qui se disputaient constamment entre eux, ne manifestaient guère de talents en stratégie ou en tactique guerrière, mais excellaient en manœuvres dans les antichambres du pouvoir politique, il fut sans doute le pire de tous, car il était aussi un traître. Cependant, en 1814, le vent tourne, car les politiciens veulent absolument des généraux jeunes et énergiques. Ils peuvent déjà compter sur William Henry Harrison qui commande dans l'ouest du Haut-Canada, et sur Izard et Macomb, qui en font autant à Plattsburgh. Dans la péninsule du Niagara, le grade de général en chef est confié à Jacob Brown, assisté de Winfield Scott, James Ripley et Peter Porter, tous d'excellents officiers.
Même s'ils ne disposent que de 3 500 hommes au lieu des 8 000 escomptés pour envahir le Haut-Canada, Brown et ses généraux sont confiants. Pour la première fois, les Américains se préparent convenablement au combat par des exercices tactiques, sous l'œil vigilant de Winfield Scott. Selon ce dernier, il faut absolument que les soldats américains parviennent à se mesurer avec succès aux soldats britanniques dans des batailles rangées à l'européenne, sinon, toute invasion du Canada demeurera une tentative illusoire. Bien qu'il ait enfin identifié le nœud du problème tactique, il n'en reste pas moins que réussir à mettre en déroute les « habits rouges » demeure un grand défi. À l'invitation de Scott, l'armée américaine du Niagara adopte l'exercice français de 1791, qui a fait ses preuves en Europe Quelques semaines d'entraînement redonnent finalement confiance aux soldats américains, qui n'attendent plus que l'occasion de se mesurer aux Britanniques.
Engagements sanglants à Chippawa et Lundy's Lane
Fin stratège, Brown évite d'attaquer le fort Niagara et force les Britanniques à se déployer le long de la frontière. Le 3 juillet, il fait traverser son armée au Canada de chaque côté du fort Érié qui, défendu par à peine deux compagnies de soldats britanniques, se rend immédiatement. En apprenant cette nouvelle, le général britannique Phineas Riall part du fort George avec 1 800 hommes, dont 1 500 soldats réguliers. La rencontre a lieu le 5 juillet, à Chippawa, alors que les Britanniques se heurtent au général Winfield Scott à la tête d'environ 2 000 hommes. Riall fait avancer les ler, 8e et 100e régiments vers les lignes ennemies. Mais, cette fois, la débandade habituelle ne se produit pas. Parfaitement disposée, la ligne américaine tient bon et ses salves, à la fois ordonnées, rapides et très meurtrières, forcent les Britanniques à se retirer. Scott fait alors avancer ses régiments et les Britanniques sont vaincus, perdant plus de 500 hommes dont 148 tués, contre seulement 48 morts et 227 blessés chez les Américains.
Cette défaite ne manque pas d'inquiéter le général Gordon Drummond qui commande les troupes britanniques dans le Haut-Canada. Parmi les trois régiments engagés dans la bataille, deux - le 1er, le réputé Royal Scotts, et le 8e, celui du roi - sont des corps renommés pour leur bravoure et leur excellence. Quelque chose a donc manifestement changé du côté américain. Drummond demande immédiatement des renforts du Bas-Canada et fait venir des troupes de Kingston au fort George et à York (Toronto).
Le 25 juillet, les brigades de Riall et de Scott se rencontrent de nouveau à Lundy's Lane, non loin des chutes du Niagara, et engagent la bataille la plus sanglante de la guerre. Des renforts arrivent bientôt dans les deux camps, de même que les généraux en chef Drummond et Brown. La bataille se poursuit avec acharnement peu après le coucher du soleil. Malgré la fumée qui masque le clair de lune, les bataillons attaquent et contre-attaquent dans la nuit, éclairés par les lueurs des décharges de fusils et de canons. Les généraux Riall, Drummond, Brown et Scott subissent tous de graves blessures. Le combat cesse après minuit, les deux armées étant à bout de force. Le bilan s'avère lourd : 853 Américains et 878 Britanniques manquent à l'appel, mais l'issue de la bataille est nulle. Cependant, les Britanniques continuent de recevoir des renforts, contrairement aux Américains. Le général Ripley ordonne donc la retraite vers le fort Erie.
Le siège du fort Érié
Officier portant le drapeau de son régiment, 9e Régiment de fantassins (de East Norfolk), 1814. Après avoir participé à la victoire du duc de Wellington en Espagne, le 1er Bataillon du 9e Régiment de fantassins (de East Norfolk) a combattu au Canada de 1814 à 1815. Il ne s’agissait pas du premier séjour au pays du régiment, qui avait fait partie de l’armée du général Burgoyne durant la Révolution américaine. Cette illustration contemporaine montre un officier portant le drapeau du régiment (sa veste arbore les parements jaunes du régiment). Le drapeau carré de 183 centimètres de côté n’est déployé que partiellement afin de faciliter son transport. Un sergent-fourrier armé d’un esponton accompagne l’officier. Créé en 1813, le grade de sergent-fourrier constituait le grade le plus élevé auquel pouvait aspirer un sous-officier dans une compagnie de fantassins. Le sergent-fourrier avait le devoir spécial de protéger les drapeaux durant le combat et portait comme marque distinctive un insigne de grade spécial au bras droit.
Les deux armées vont rapidement se retrouver face à face, car le général Drummond encercle le fort Erie, dont il commence le siège le 13 août. Après deux jours seulement de bombardements, les Britanniques tentent de le prendre d'assaut avec environ 1 300 soldats, mais se heurtent à la détermination des Américains. Ils ont déjà subi des pertes élevées quand un magasin de poudre souterrain explose, leur fauchant des centaines d'hommes. Il ne leur reste alors d'autre choix que de se retirer. Ils ont perdu plus de 900 hommes, tués, blessés ou manquant à l'appel, contre 84 seulement du côté américain. Drummond reçoit cependant des renforts et poursuit le siège.
Plan du fort Érié, septembre 1814
Après avoir arraché le fort Érié aux Britanniques durant l’été de 1814, les Américains l’ont considérablement reconstruit. Cette image constitue une représentation du fort tel qu’il était après la reconstruction, en septembre 1814, entouré du campement des Américains.
Le 17 septembre, une sortie de quelque 1 600 Américains prend par surprise les Britanniques, dont les lignes ne sont pas suffisamment protégées. L'attaque américaine n'est finalement refoulée qu'au terme d'âpres combats. Les pertes s'avèrent plus lourdes pour les Britanniques, avec 115 morts, que pour les Américains, avec 79. En outre, ces derniers ont détruit six gros canons britanniques.
Après ce carnage, Drummond décide de lever le siège et ses troupes se retirent à Chippawa, le 21 septembre. Le 5 novembre, les Américains font sauter le fort Erie après en avoir évacué leurs troupes, qui se replient à Buffalo. Ainsi se termine cette troisième tentative d'invasion du Canada par la péninsule du Niagara...
La bataille du Nord-Ouest
D'après leur plan d'invasion de 1814, les Américains doivent s'emparer du fort Mackinac. Les Britanniques se montreront cependant plus agressifs qu'eux et s'empareront du petit poste de Prairie du Chien (Wisconsin), sur le Mississippi, que les Américains rendront sans combat le 17 juillet.
Pendant ce temps, un corps de quelque 700 soldats réguliers et miliciens américains, sous le commandement du lieutenant-colonel George Croghan, arrive dans les parages de l'île Mackinac. Après avoir rasé le petit poste sans défense de Sault-Sainte-Marie (Ontario), ils décident d'attaquer le fort Mackinac. Croghan débarque ses troupes, mais le lieutenant colonel Robert McDouall ne l'attend pas dans le fort même, ayant dissimulé sa garnison dans un bois bordant une clairière. Les Américains s'y engagent sans se méfier et les hommes de McDouall ouvrent le feu sur ces cibles faciles, faisant 15 morts et 51 blessés. Les Américains se rembarquent le lendemain pour Detroit, mais laissent deux canonnières, le Scorpion et le Tigress, pour empêcher la garnison de s'approvisionner. Sur le chemin du retour, le reste de la flottille américaine détruit le seul navire britannique sur le lac Huron, la goélette Nancy. Son commandant, le lieutenant Miller Worsley, réussit néanmoins à s'échapper avec ses marins et à rejoindre le fort Mackinac. Au début de septembre, avec l'aide de ces derniers et des soldats du Michigan Fencibles, Worsley capture le Scorpion et le Tigress, assurant ainsi une certaine puissance navale aux Britanniques sur le lac Huron.
Une course à la construction de navires
Alors que les Américains se font une fois de plus refouler de l'Ouest et de la péninsule du Niagara, chaque camp décide, dans le but de s'assurer la suprématie navale sur le lac Ontario, de construire en un temps record de gros navires de guerre, chacun rivalisant avec son voisin. Kingston et Sackets Harbor se transforment en grands chantiers navals, et le conflit pour le contrôle du lac Ontario prend l'allure d'une course à la construction de gros vaisseaux.
En mai, le HMS Prince Regent et le HMS Princess Charlotte, dotés respectivement de 58 et de 40 canons, sortent de Kingston pendant que les Américains achèvent le USS Superior de 62 canons, à Sackets Harbor. Les Britanniques envoient des renforts de la Royal Navy à Kingston et investissent d'importants capitaux. Durant l'été de 1814, une énorme structure s'élève sur leur chantier naval; c'est le HMS St. Lawrence qui prend forme, navire géant pouvant porter 110 canons. Lancé en septembre, ce voilier, le plus important jamais construit au Canada, nécessite un équipage de 800 hommes.
Les Britanniques, qui ont déjà deux autres vaisseaux plus imposants encore en chantier, (dotés d'une capacité de 120 canons) disposent donc d'une nette avance. Les Américains tentent de les rattraper en entreprenant, eux aussi, la construction de deux navires de la même capacité, à Sackets Harbor. Mais, de tout temps, la construction de grands navires de guerre a été une entreprise très onéreuse. L'Europe étant en paix, l'Angleterre peut se permettre d'investir des sommes immenses dans cette opération et d'y employer des milliers d'hommes, puisque telle est la solution pour reconquérir la supériorité navale sur les Grands Lacs. Dès l'automne 1814, deux canonnières destinées au lac Érié sont mises en chantier à Chippawa. On projette aussi de construire des canonnières et une frégate à Penetanguishene, sur le lac Huron. Les Britanniques sont donc sur la bonne voie pour reprendre le contrôle des Grands Lacs... et pour gagner la course !
Stratégie britannique plus belliqueuse
Le retour de la paix en Europe permet, durant l'été de 1814, de dépêcher un grand nombre de soldats britanniques en Amérique. Dans le Haut et le Bas-Canada, l'armée passe d'environ 15 000 officiers et soldats réguliers, en mai 1814, à quelque 28 000 hommes au mois d'août. Durant le même laps de temps, la garnison entretenue dans les provinces maritimes passe d'environ 4 300 à 7 500 hommes. Par voie de conséquence, les Britanniques adoptent une stratégie nettement plus belliqueuse.
Sir George Prevost rassemble quelque 11 000 hommes au début de septembre afin de prendre Plattsburgh et d'occuper le nord-est de l'État de New York. La plupart appartiennent à des régiments de l'armée britannique, mais les Voltigeurs canadiens, les Chasseurs canadiens et les quatre bataillons de la milice d'élite incorporée du Bas-Canada sont également de la partie. Du côté américain, le général Alexander Macomb ne dispose que d'environ 3 000 miliciens et soldats pour défendre la petite ville. Le 7 septembre, l'armée anglo-canadienne arrive en vue de Plattsburgh. Mais, au lieu d'attaquer, Prevost décide d'attendre que la flottille britannique arrive de l'île aux Noix pour neutraliser la flottille américaine ancrée dans la baie de Plattsburgh. Erreur tactique majeure ! L'ennemi profite en effet de ce délai pour mieux se retrancher, alors qu'une attaque immédiate aurait eu rapidement raison des fortifications en bois de la ville, et que la flottille aurait été forcée d'évacuer la baie pour ne pas être prise. L'inaction de Prevost a pour conséquence de lier le sort de la campagne terrestre à celui d'une bataille navale.
Un désastre naval qui contrecarre l'invasion britannique
Batailles du lac Champlain et de Plattsburg, 11 septembre 1814
Les vaillants efforts du capitaine Thomas Macdonough ont permis aux Américains de défendre Plattsburg contre la flotte britannique. Cette gravure américaine réalisée en 1839 rend fidèlement l’assortiment de navires à voiles et à rames dont étaient composées les deux flottes. Au centre gauche, la frégate britannique HMS Confiance réplique, de ses 39 canons, aux tirs des 26 canons du navire amiral américain, la frégate USS Saratoga.
La flottille anglaise du capitaine George Downie arrive le 11 septembre et, sur l'ordre de Prevost, attaque les canonnières américaines du capitaine Thomas Macdonough dans la baie de Plattsburgh. Downie aurait préféré que le combat ait lieu sur le lac Champlain, car il craint d'être bloqué dans le port, mais il doit se soumettre. Les Américains l'attendent de pied ferme et l'issue du combat naval s'avère désastreuse pour les Britanniques. Downie est tué et sa flottille anéantie. Prevost rappelle alors la brigade, qui commençait à peine à donner l'assaut sur la ville, et reprend le chemin du Bas-Canada le soir même. Les Américains jubilent ! Une poignée des leurs ont arraché la victoire aux soldats aguerris qui avaient chassé les Français d'Espagne ! Quelle aubaine extraordinaire pour leur propagande ! La preuve en était donc définitivement établie : malgré ses capacités politiques et administratives, Prevost se montrait un piètre général sur le champ de bataille. Or, à cette époque, la toute première qualité que l'on exigeait du gouverneur en chef du Canada était surtout sa compétence militaire. Prevost tomba donc en disgrâce et fut rappelé en Angleterre.
La guerre sur mer. Combat entre frégates
Arrivée au port de Halifax du HMS Shannon et du USS Chesapeake, 1813
La frégate britannique HMS Shannon arrive à Halifax devant sa prise, la frégate américaine USS Chesapeake, qui arbore le pavillon britannique au-dessus du drapeau américain en signe de reddition. Le combat qui a opposé le Shannon au Chesapeake en juin 1813 s’inscrit dans une série de duels de frégates ayant ponctué la guerre de 1812. Les puissants navires américains ont remporté la majorité de ces combats spectaculaires, qui ont toutefois eu peu d’influence sur le déroulement de la guerre, en général.
La guerre de 1812 se déroule non seulement sur terre et dans l'enceinte des Grands Lacs, mais aussi sur mer. Contrairement à la situation qui prévaut dans l'armée, la modeste marine américaine possède d'excellents officiers et des marins parfaitement entraînés. Au début des hostilités, la Royal Navy essuie plusieurs défaites dans des combats singuliers entre frégates, au grand étonnement des Britanniques. Ceux-ci se ressaisissent cependant, et, le let juin 1813, la frégate HMS Shannon capture la frégate américaine USS Chesapeake. L'honneur de la Royal Navy est sauf !
Officiers et aspirants de la Marine royale, 1787-1812
Cette gravure du début du XXe siècle montre l’évolution de l’uniforme des officiers de la Marine royale durant la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Les officiers à gauche portent l’uniforme de 1787-1795, tandis que ceux à droite portent celui de 1795-1812. L’uniforme écarlate du marin du centre est celui que portaient les officiers des Royal Marines vers 1795. Le quatrième homme à partir de la droite est l’amiral Horatio Nelson, vicomte (1758-1805), encadré d’un capitaine à gauche et d’un lieutenant à droite. Le deuxième homme à partir de la droite est un aspirant (un officier de marine en formation); il porte à son col les bandes blanches caractéristiques de son grade.
Ces combats de frégates - que les Américains assimilent encore aujourd'hui à de grandes batailles navales - n'étaient cependant que des duels singuliers, sans effet sur l'issue de la guerre. La sécurité des provinces maritimes et du golfe du Saint-Laurent ne fut jamais réellement compromise, car les Américains n'avaient pas de vaisseaux susceptibles d'affronter l'escadre britannique de l'Atlantique-Nord installée à Halifax, avec des bases secondaires à St. John's, Terre-Neuve, et aux Bermudes.
Blocus britannique sur la côte américaine
Carabinier, 60e Régiment de fantassins (royal d’Amérique), vers 1814-1815
Les soldats des 5e et 7e Bataillons du 60e Régiment de fantassins (royal d’Amérique) avaient reçu une formation de tirailleurs et employaient des mousquets à âme rayée, qui étaient plus précis, mais plus longs à charger, que les mousquets traditionnels à âme lisse. Ils portaient des pourpoints verts au lieu des justaucorps écarlates habituels. Le 7e Bataillon a combattu à Halifax en 1814-1815 et a participé à la capture d’une partie de l’État du Maine.
Les Britanniques ne décrètent le blocus des côtes américaines que le 27 novembre 1812. Au début, cette mesure affecte uniquement le littoral compris entre les baies de Delaware et de Chesapeake. Mais, le 30 mars 1813, la Royal Navy l'étend de Savannah, en Georgie, jusqu'au nord de la ville de New York, ainsi qu'en Louisiane. Puis, le 16 novembre, le blocus s'élargit encore, allant du Connecticut à la Floride, alors possession espagnole. Enfin, en mai 1814, les navires de la Royal Navy se mettent à patrouiller au large des côtes, à partir du Rhode Island jusqu'au Nouveau-Brunswick. Dès lors, tout le littoral atlantique des États-Unis, depuis le Nouveau-Brunswick jusqu'au Mexique, fait l'objet d'un blocus qui étouffe le commerce international américain.
Mais les Britanniques ne se contentent pas de bloquer les côtes ; ils lancent aussi des raids de plus en plus ambitieux contre les villes côtières américaines, notamment Washington et Baltimore. En août et septembre 1814, ils s'emparent de Castine (dans le Maine) qu'ils occupent jusqu'à la fin des hostilités.
Les corasires prennent les navires marchands pour cibles
Qui dit guerre en mer dit également corsaires. Dans les deux camps, on ne se prive pas de recourir à leurs services. Ainsi, les Américains arment en course plus de 500 navires, qui s'emparent de près de 1 330 navires marchands britanniques. Bilan moins impressionnant qu'il n'y paraît puisque la marine marchande britannique compte environ 25 000 bâtiments à cette époque.
Du côté britannique, les navires de la Royal Navy qui patrouillaient le long des côtes américaines saisissent des centaines de navires marchands ennemis. Et ils n'agissent pas seuls ! Dès que la guerre éclate, les armateurs de la Nouvelle-Écosse se montrent particulièrement intéressés à obtenir des « lettres de marque », c'est-à-dire un brevet officiel permettant à un navire-corsaire de pourchasser les navires ennemis en temps de guerre. Sans ce document, le corsaire est considéré comme un pirate et mis hors la loi. Les lettres obtenues, plusieurs petits navires parmi les plus rapides s'arment en course, obtenant des succès remarquables ! Environ 50 navires corsaires, partis surtout de Liverpool et de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, capturent au moins 207 navires américains, ce qui se compare avantageusement aux prises des corsaires américains. Le plus redoutable des corsaires canadiens est sans doute le Liverpool Packet qui s'empare, à lui seul, de près de 50 navires, au terme d'exploits dignes des meilleurs films d'aventure.
Des pressions pour la paix
Cependant, aux États-Unis, les pressions s'accentuent pour négocier un traité de paix avec les Britanniques, particulièrement parmi les États du nord-est, qui se montrent les plus hostiles aux conflits. Même si la guerre qu'elle livre en Amérique n'est pas le centre de ses préoccupations, la Grande-Bretagne considère la paix d'un oeil favorable pour mettre fin à cette situation de crise et renouer ses liens commerciaux avec les États-Unis. Le 24 décembre 1814, les diplomates britanniques et américains réunis à Gand, en Belgique, concluent la Paix.
D'après le traité qui s'ensuit, les deux nations belligérantes conviennent de maintenir le tracé des frontières d'avant 1812 et de reporter la négociation des points épineux à une date ultérieure. Les Anglo-Canadiens doivent donc évacuer l'Ouest et le Maine et on en revient au statu quo. La nouvelle du traité de paix parvient à New York le 8 février 1815 et le Sénat l'entérine unanimement le 16 du même mois. L'annonce de cette mesure parvient au Canada au début du mois de mars, et des ordres sont donnés pour dissoudre les corps de volontaires et démobiliser les milices.
Les guerres Napoléoniennes et la guerre de 1812. L'héritage de la guerre de 1812
De nos jours, cette « Guerre de 1812 » est presque tombée dans l'oubli. Au Canada même, c'est à peine si on l'évoque dans les écoles. Et pourtant, elle constitue un événement crucial pour l'histoire de ce pays. En effet, c'est elle qui assura la survie d'un pays différent au nord des États-Unis, cette puissante nation aux ambitions continentales grandioses. En outre, il s'agit du premier conflit qui amène Canadiens français et Canadiens anglais à s'unir, malgré leurs profondes différences, contre un ennemi commun. C'est, par ailleurs, le dernier au cours duquel les Amérindiens de l'est auront l'occasion d'exercer leur pouvoir militaire. Autre particularité, c'est à cette époque que les premières unités de miliciens canadiens de race noire font leur apparition.
Si les Américains étaient parvenus à leurs fins, il est certain que cette nouvelle conquête aurait presque immanquablement entraîné la mort des valeurs loyalistes des anglophones et très probablement remis en question les valeurs culturelles des francophones au Canada. Ceux-ci se seraient vu engloutir, de gré ou de force, dans le « melting pot » américain, et ç'eût été la mort de nombre de leurs droits. Quel aurait été le sort des Noirs qui se réfugiaient au nord de la frontière américaine pour échapper à l'esclavage qui se pratiquait à grande échelle dans le sud ? Et celui des Amérindiens du Canada aux mains des soldats américains ? Auraient-ils été déportés comme leurs frères américains qui marchèrent et succombèrent le long du « sentier des larmes 7»? Ou, encore, seraient-ils tombés, victimes des guerres interminables qui sévirent contre eux durant tout le XIXe siècle, alors que les soldats américains répétaient à qui voulait l'entendre que le seul Amérindien qui avait de la valeur à leurs yeux était un Amérindien mort ?
Les Américains qualifient parfois la période 1812-1815 de « seconde guerre d'indépendance » contre la Grande-Bretagne. Quelle distorsion ! Chaque année, pendant trois ans, le Canada eut à se défendre contre plusieurs tentatives d'invasion de leur part. Il serait plus juste de dire qu'elle fut la guerre d'indépendance canadienne contre l'envahisseur américain !
La démobilisation
Des compressions en matière de défense
En 1815, c'est un monde épuisé par plus de vingt ans de conflits qui accueille avec satisfaction la fin des guerres napoléoniennes. Au cours de la longue période de paix qui s'ensuit, tous les États ayant participé à ces affrontements sont soulagés de pouvoir réduire massivement leurs dépenses militaires, dans lesquelles s'engloutit la plus grande part de leur budget. En Grande-Bretagne, la Royal Navy passe de 140 000 à 17 000 hommes. Les effectifs de l'armée sont ramenés à 110 000 hommes, soit le minimum nécessaire pour maintenir les garnisons métropolitaines en Grande-Bretagne et dans les colonies. À l'exception de l'Inde, la plupart des troupes régulières coloniales sont licenciées.
Certains croient, à juste titre, que les habitants de l'Amérique du Nord britannique se désintéresseront des problèmes de la défense, à moins qu'un ou plusieurs régiments canadiens ne soient maintenus en activité. Mais la Grande-Bretagne s'en tient à ses mesures de stricte économie et les applique rigoureusement. Tous les régiments de Fencibles, ainsi que le 104e régiment, qui a été levé au Nouveau-Brunswick, sont licenciés entre 1816 et 1817. Désormais, tout relèvera des régiments de l'armée britannique métropolitaine envoyés sur place.
La menace américaine. Guerre à l’européenne
L'armée américaine, quant à elle, est réduite à 10 000 hommes et soumise à une profonde réforme pour devenir une force véritablement professionnelle. De nombreuses causes d'animosité subsistent cependant entre les États-Unis et la Grande-Bretagne et l'éventualité d'une nouvelle guerre n'est pas encore écartée. À Londres, dès la signature de la paix, l'état-major se penche sur le problème de la défense de l'Amérique du Nord britannique.
Déjà, le conflit de 1812 s'était surtout déroulé selon les règles de l'art de la guerre européenne. Au début, les armées se déplaçaient encore sur de grandes distances par les rivières et les lacs, mais, au fil du temps, des mouvements de troupes par voie de terre étaient devenus possibles à certains endroits. De plus, les armées se composaient désormais non seulement de fantassins, mais aussi d'artillerie, de cavalerie, d'un train et de bagages. Par conséquent, les combats à venir auraient lieu de plus en plus fréquemment en terrain ouvert, comme en Europe, et non plus dans les bois où les Canadiens excellaient.
Les Américains ont l’avantage
Fort Montgomery - fort américain construit à l'intérieur du Canada
Le Corps of Engineers des États-Unis entreprend la construction du fort Montgomery en 1816, après la guerre de 1812. Il est situé près de Rouses Point (New York), à l’extrémité nord du lac Champlain, à l’embouchure de la rivière Richelieu. Ce fort devait servir, en cas de nouvelle guerre, à protéger la frontière nord des États-Unis contre des intrusions britanniques ou canadiennes, en plus d’offrir une base à l’armée américaine pour procéder à l’invasion du Canada dans cette région. Toutefois, les travaux ont dû être abandonnés après deux ans, car le fort se trouvait un peu à l’intérieur du territoire canadien. Fort Montgomery a été surnommé « Fort Blunder » et a finalement été terminé. Le site a été rendu aux Américains en 1842, en signe de cordialité entre la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, qui sont demeurés des alliés jusque dans les grands conflits du 20e siècle.
Les grandes fortifications. La défense des positions stratégiques
Canons à boulets de 32 livres montés sur une plat-forme de place de pointage en bois
Les pièces d’artillerie britannique du début du 19e siècle sont montées sur des plates-formes pour permettre au canon de pivoter sur un grand axe et ainsi suivre une cible mouvante, comme un navire. Ces affûts reconstitués se trouvent au lieu historique national de Coteau-du-Lac près de Montréal (Québec). Les fortifications ont été construites dans le but de protéger l’écluse, la première en Amérique du Nord.
La défense d'une bande territoriale allant de l'Atlantique à l'ouest des Grands Lacs entraîne des choix difficiles. Que défendre en priorité ? Où situer les grands forts ? Dès les premières propositions, Québec, Kingston et Montréal sont identifiés comme les points stratégiques pour la sauvegarde du pays, qu'il faut tenter de rendre quasi imprenables. Il s'agit donc de construire des citadelles à Québec et à Kingston. Quant à Montréal, des forts situés au sud et une armée en campagne la défendront. On peut améliorer les communications par divers travaux de canalisation sur la rivière Richelieu et dans l'île de Montréal mais, surtout, avec la construction d'écluses sur l'Outaouais et la canalisation de la rivière Rideau. On désire même créer un second lien navigable entre Montréal et Kingston au cas où les Américains prendraient le contrôle du fleuve Saint-Laurent entre ces deux villes. En outre, on prévoit effectuer des travaux secondaires qui consisteront à renforcer presque tous les forts existants et ériger une citadelle dans la péninsule du Niagara, afin que « ses habitants ne croient pas que nous les abandonnions.
Mortier de fer britannique, vers 1810
Les mortiers étaient conçus pour tirer des obus explosifs avec un angle de 45 degrés ou plus. Ils étaient utilisés pour le siège et la défense de fortifications. L’obus explosif tiré dans les airs retombait à l’intérieur de la zone de défense de l’ennemi. Lorsque la mèche de l’obus terminait de brûler, ce dernier explosait. Ces projectiles sont les « bombes explosant dans le ciel » de l’hymne national américain, tirées par la flotte britannique pendant l’assaut de Baltimore.
Fort Henry, Kingston, 1839
Fort Henry est le plus grand fort construit par l’armée britannique au Haut-Canada, ainsi que le plus moderne. Il a été surnommé la « citadelle du Haut-Canada ». Cette aquarelle a été peinte en avril 1839, à la suite des rébellions de 1837-1838 qui ont eu lieu au Canada. Restaurée dans les années 1930, cette construction de Kingston (Ontario) compte parmi les principaux lieux historiques du Canada.
DES DÉBUTS MODESTES
Officier, 52e Régiment de fantassins (Oxfordshire; infanterie légère), 1825
Au cours des années 1820, l’armée britannique adopte des uniformes plus ajustés de style prussien. Pendant les longues années de paix qui ont suivi le renversement de Napoléon en 1815, les uniformes de cérémonie britanniques prennent une allure de plus en plus théâtrale. La longue plume d’oiseau pendant arboré par cet officier du 52e Régiment de fantassins (Oxfordshire; infanterie légère) en est un parfait exemple. Le 52e Régiment a acquis une excellente réputation auprès de l’armée du duc de Wellington, en Espagne, pendant les guerres napoléoniennes. Le Régiment a été stationné dans la région de l’Atlantique entre 1823 et 1831.
L'estimation de ce programme ambitieux provoque toutefois une révision à la baisse et on décide de s'en tenir à l'essentiel. Grâce à l'insistance du duc de Wellington, des fonds sont immédiatement mis à la disposition de l'armée et, dès 1819, plusieurs travaux débutent : la construction du fort Lennox, dans l'île aux Noix, et celle d'un autre fort dans l'île Sainte-Hélène, face au port de Montréal, destiné à abriter tous « les magasins et édifices militaires » de la ville. En mai 1820, la citadelle de Québec est mise en chantier.
Fort Lennox, 1896
Étant situé sur l’Île-aux-Noix, le fort Lennox a subi peu de modifications depuis l’époque de sa construction, qui a débuté en 1819. Il a été construit en réponse à la construction du fort Montgomery par les Américains à 15 kilomètres au sud. Cette image la présente telle qu’il était en 1896. Après le départ de sa garnison permanente à la fin des années 1860, le fort a été utilisé comme lieu d’entraînement, comme école et comme camp de détention au cours des deux guerres mondiales. Il a maintenant retrouvé son apparence des années 1820 et 1830 et est classé lieu historique national.
Les années passent et, en avril 1825, le duc de Wellington, impatient, envoie une commission militaire au Canada sous le commandement du colonel James Carmichael-Smyth. Elle a pour mandat d'identifier les causes du retard et de recommander les solutions appropriées. De retour en Angleterre après un été et un automne passés en inspections, les commissaires présentent leur rapport. Le fort Lennox et celui de l'île Sainte-Hélène sont quasiment achevés, mais la citadelle de Québec n'est construite qu'au tiers. Enfin, sur la rivière Rideau et à Kingston, tout reste encore à faire. Il faut non seulement compléter le plan de 1819, soutient la commission, mais encore construire une citadelle à Halifax. Il est en effet inadmissible que cette ville, qui constitue le principal port d'attache de la Royal Navy dans l'Atlantique Nord, soit si mal fortifiée. Avec ce rapport à l'appui, le duc de Wellington revient à la charge auprès du gouvernement. Il soutient qu'il faut avoir non pas deux, mais bien trois grandes citadelles, l'une à Halifax, l'autre à Québec et la troisième à Kingston, et, selon lui, le canal Rideau doit être construit coûte que coûte. Bien qu'effrayé, non sans raison, par les frais exorbitants que représentent ces travaux, le gouvernement accepte le plan en 1826.
Photographie aérienne de Fort Lennox
Fort Lennox a été construit entre 1819 et 1826 sur l’Île-aux-Noix, tout juste au nord de la frontière américaine. Il avait pour objet d’arrêter toute force ennemie arrivant du lac Champlain sur la rivière Richelieu et se dirigeant vers Montréal.
Des sommes colossales! Dépassement des coûts à Québec et à Halifax
La citadelle de Québec
La redoute d'York construite à l'est d'Halifax la redoute d’York, construite à l’est de Halifax, est le premier fort d’importance qui surveille l’entrée du port. Les premières batteries de cet endroit ont été construites en 1793. Au cours des années, des améliorations ont été apportées au site. Cependant, des progrès en matière de technologie de l’armement l’ont rendu désuet dans les années 1860, et un plan de reconstruction majeur a été mis en œuvre dans lebut d’y intégrer des canons rayés à chargement par la bouche. Cette gravure présente la redoute en 1882. Ce site est maintenant classé lieu national historique.
Canons de fer bitanniques montés sur un affût de fer, vers 1815
Les affûts de fer ont été introduits dans l’artillerie britannique en 1810. Ils devaient être placés « aux endroits des fortifications les moins exposés aux tirs ennemis », car on craignait qu’ils volent en éclat s’ils étaient touchés par l’artillerie ennemie. Les exemples illustrés sur cette photographie se trouvent dans les fortifications de la ville de Québec, classées lieu national historique.
Canons du début du 19e siècle montés sur un affût de place et une plate-forme de place de pointage en fer, Québec
Il n’est désormais possible de trouver de tels groupements d’armes britanniques d’origine sur affût de place en fer qu’à quelques endroits dans le monde, notamment dans les batteries qui surplombent la ville de Québec. Les affûts et les plates-formes de fer n’étaient pas l’idéal pour les combats, mais pouvaient assez bien servir pour l’entraînement en temps de paix. Contrairement aux affûts de bois, les affûts de fer ne pourrissaient pas, ce qui permettait de justifier l’importante dépense initiale sur un certain nombre de décennies. Le fait que ce type d’affût ait été utilisé pour les fortifications de Québec illustre à quel point ces travaux étaient prévus pour être permanents.
Un canal très coûteux
Entrée du canal Rideau à Ottawa, vers 1838
L’entrée du canal Rideau à Sleigh Bay est composée d’une suite spectaculaire de huit écluses qui permettent de grimper les 25,3 mètres qui séparent le niveau de la rivière du plateau en amont. Cette aquarelle, datant d’environ 1838, présente l’entrée vue du côté du Québec de la rivière des Outaouais. Les travaux de construction du canal ont débuté ici en 1827. Le long des écluses, on peut voir deux édifices de pierre, soit le bâtiment de l’intendance du côté ouest (ici, à droite) et le bureau des Royal Engineers du côté est. Le premier bâtiment est aujourd’hui devenu le Musée Bytown. Sur la Colline des Casernes, immédiatement à l’ouest des écluses, se trouvent maintenant les bâtiments du Parlement canadien, dont la construction a commencé en 1859.
Québec, et surtout à Halifax, la construction des citadelles soulève des problèmes imprévus, qui exigent des changements considérables par rapport aux plans initiaux et occasionnent de nombreux et coûteux retards. Cependant, c'est probablement la réalisation du canal Rideau qui causera le plus de difficultés aux officiers et soldats du génie. Des écluses sont d'abord aménagées à Carillon, sur l'Outaouais, avant que la construction du canal lui-même ne débute en 1827, tout près de l'actuel parlement fédéral, à Ottawa. L'entreprise se révèle des plus ardues et des centaines d'ouvriers y trouvent la mort, victimes, en particulier, de la malaria, transmise par les moustiques des marais. Des problèmes de toutes sortes accablent le lieutenant-colonel John By, officier du Corps of Royal Engineers en charge des travaux. Mais il persévère et, en mai 1832, le canal Rideau, comportant 47 écluses en maçonnerie et 52 barrages, est enfin inauguré. Cependant, la question du montant soulève une tempête politique au Parlement britannique, d'autant plus que l'Angleterre traverse alors une dure crise économique. Les prévisions initiales de £ 169 000 ont déjà été revues à la hausse et portées à £ 474 000. Malgré tout, une fois achevée, le canal Rideau revient à plus d’un million de livres sterling ! Somme phénoménale pour l'époque : à titre de comparaison, durant cette même année 1832, le budget total de la Royal Navy est de cinq millions de livres ! Convoqué en Angleterre pour s'expliquer, By parvient à se défendre des accusations portées contre lui, d'autant plus que le duc de Wellington lui a ordonné d'aller de l'avant sans attendre les crédits votés par le Parlement. Il est néanmoins victime des querelles politiques et sa réputation, définitivement compromise, ne sera jamais rétablie officiellement.
Colonel John By, Royal Enginers, vers 1830
Cette reproduction en demi-teintes, tirée du Dominion Illustrated de 1891, est inspirée de portraits en silhouette commandés par le colonel John By. À ce jour, aucun portrait certifié authentique n’a été trouvé.
Il reste que la Grande-Bretagne a doté le Canada d'une chaîne de fortifications redoutable, et qui ne manque pas de produire l'effet escompté sur les principaux intéressés : les Américains ! Pour s'emparer de ces forteresses, érigées sur des élévations de terrain, il faudrait mettre en oeuvre d'immenses moyens, dont ne dispose pas leur armée. Un militaire de ce pays, en visite à Québec, fortement impressionné par la citadelle de cette ville, déclare que la seule façon de la prendre d'assaut serait d'y faire descendre des troupes aéroportées par ballons.
Colonel John By supervisant la construction du canal Rideau, 1826
Le colonel John By (1779-1836) du Corps of Royal Engineers (génie royal britannique) a été chargé de construire un canal qui relierait le lac Ontario (à Kingston) à la rivière des Outaouais. Sur cette image, les travaux de construction pour la spectaculaire série d’écluses qui mènent à la rivière des Outaouais sont en cours. On peut y voir des soldats du Corps of Royal Sappers and Miners dans leurs uniformes de travail à l’arrière-plan. Le travail a été en grande partie accompli par des ouvriers civils, parmi lesquels des centaines sont morts de la malaria au cours du projet.
Les Grands Lacs, territoire neutre. L'Accord Rush-Bagot démilitarise les Grands Lacs
Ces fortifications sont d'autant plus nécessaires qu'elles constituent désormais la première ligne de défense à l'intérieur du pays, rôle auparavant assuré par les flottilles de navires de guerre sur les Grands Lacs. Or, la Grande-Bretagne et les États-Unis veulent, l'une comme l'autre, éviter toute répétition de la coûteuse course à la construction de navires de l'année 1814. En 1817, le secrétaire d'État américain, Richard Rush, et l'ambassadeur britannique à Washington, Charles Bagot, concluent une entente diplomatique à cette fin. Selon l'entente « Rush-Bagot », chaque pays n'entretiendra plus, dorénavant, qu'un petit navire armé d'un seul canon de 18 livres sur les lacs Champlain et Ontario, et deux navires semblables sur les lacs Érié, Huron et Supérieur. Les bâtiments existants seront désarmés et aucun autre ne sera construit.
Il est entendu en outre que la Royal Navy maintiendra de petites bases navales à l'île aux Noix, à Kingston et à Penetanguishene jusqu'au milieu des années 1830. Si un conflit devait éclater, l'amirauté britannique détacherait des petits navires de l'escadre de l'Atlantique Nord vers les Grands Lacs, en les faisant passer par les canaux nouvellement construits. En fait, l'entente proclame la neutralité militaire sur les Grands Lacs, ce qui convient très bien aux deux pays.
Malgré quelques accrocs au cours de certaines périodes de tension, l'esprit de l'entente Rush-Bagot fut globalement respecté et contribua puissamment au maintien de l'harmonie qui règne aujourd'hui encore entre le Canada et les États-Unis.
Persistance du besoin d’une solide garnison
Colonel John By supervisant la construction du canal Rideau, 1826
Le colonel John By (1779-1836) du Corps of Royal Engineers (génie royal britannique) a été chargé de construire un canal qui relierait le lac Ontario (à Kingston) à la rivière des Outaouais. Sur cette image, les travaux de construction pour la spectaculaire série d’écluses qui mènent à la rivière des Outaouais sont en cours. On peut y voir des soldats du Corps of Royal Sappers and Miners dans leurs uniformes de travail à l’arrière-plan. Le travail a été en grande partie accompli par des ouvriers civils, parmi lesquels des centaines sont morts de la malaria au cours du projet.
Les Grands Lacs, territoire neutre. L'Accord Rush-Bagot démilitarise les Grands Lacs
Ces fortifications sont d'autant plus nécessaires qu'elles constituent désormais la première ligne de défense à l'intérieur du pays, rôle auparavant assuré par les flottilles de navires de guerre sur les Grands Lacs. Or, la Grande-Bretagne et les États-Unis veulent, l'une comme l'autre, éviter toute répétition de la coûteuse course à la construction de navires de l'année 1814. En 1817, le secrétaire d'État américain, Richard Rush, et l'ambassadeur britannique à Washington, Charles Bagot, concluent une entente diplomatique à cette fin. Selon l'entente « Rush-Bagot », chaque pays n'entretiendra plus, dorénavant, qu'un petit navire armé d'un seul canon de 18 livres sur les lacs Champlain et Ontario, et deux navires semblables sur les lacs Érié, Huron et Supérieur. Les bâtiments existants seront désarmés et aucun autre ne sera construit.
Il est entendu en outre que la Royal Navy maintiendra de petites bases navales à l'île aux Noix, à Kingston et à Penetanguishene jusqu'au milieu des années 1830. Si un conflit devait éclater, l'amirauté britannique détacherait des petits navires de l'escadre de l'Atlantique Nord vers les Grands Lacs, en les faisant passer par les canaux nouvellement construits. En fait, l'entente proclame la neutralité militaire sur les Grands Lacs, ce qui convient très bien aux deux pays.
Malgré quelques accrocs au cours de certaines périodes de tension, l'esprit de l'entente Rush-Bagot fut globalement respecté et contribua puissamment au maintien de l'harmonie qui règne aujourd'hui encore entre le Canada et les États-Unis.
Persistance du besoin d’une solide garnison
Officier et canonnier, Régiment royal d'artillerie, 1828
On trouvait des détachements d’artillerie dans tous les grands forts du Canada. Cette reproduction montre l’uniforme que portaient les officiers (gauche) et les canonniers (droite) du Régiment royal d’artillerie en 1828. Le shako en forme de cloche exagérée est digne de mention. Au cours des longues années de paix qui ont suivi les guerres napoléoniennes, les uniformes militaires britanniques ont pris un aspect de plus en plus théâtral.
Néanmoins, l'existence d'imposantes fortifications et le fait que les Grands Lacs soient reconnus territoire neutre, beaucoup d'hommes sont nécessaires pour défendre l'Amérique du Nord britannique. La Grande-Bretagne entretient un contingent de 3 000 à 3 500 soldats dans le Haut et le Bas-Canada, et de 2 000 à 2 500 dans les colonies maritimes. Toutefois, ce qui est suffisant pour affronter l'armée régulière américaine ne le serait absolument pas face aux hordes de miliciens qui, dans l'hypothèse d'un nouveau conflit, déferleraient sur le pays. Nul doute que ces envahisseurs seraient mieux préparés qu'en 1812.
Le rôle de la milice canadienne
Les théoriciens militaires qui étudient alors les moyens de défense du pays en arrivent tous à la même conclusion : il est essentiel d'avoir une milice nombreuse, bien disposée et bien entraînée. Or, à cette époque encore, la plupart des hommes susceptibles de faire partie de cette milice en Amérique du Nord britannique sont de souche française, et la majorité d'entre eux habitent le Bas-Canada. Au début des années 1820, cette colonie compte environ 80 000 hommes en état de porter les armes, alors que le Haut-Canada n'en compte que quelque 17 000 et les colonies maritimes environ 30 000. On estime être en mesure d'armer le quart des miliciens.
En 1820, lorsque Lord Dalhousie arrive à Québec en qualité de gouverneur en chef, le perfectionnement de la milice est l'une de ses priorités. Administrateur de talent agissant dans un contexte autocratique, il n'a cependant pas la patience de concilier les factions politiques. Il prend parti pour les oligarchies des grands bourgeois, qu'il s'agisse de « Family Compact » dans le Haut-Canada ou de la « Clique du Château » dans le Bas-Canada, et s'oppose aux politiciens progressistes tels Louis-Joseph Papineau et William Lyon Mackenzie, qui réclament des réformes et l'abolition des privilèges.
Dalhousie considère que pour être efficace, la milice haut et bas-canadienne doit correspondre en tous points à sa vision idyllique des milices volontaires d'Angleterre : de braves « Yeomen », c'est-à-dire des fermiers prospères, conduits par leurs « Squires », sortes de seigneurs bienveillants, les uns et les autres vêtus d'uniformes rutilants, se rendant à la guerre un peu comme on va à la chasse à courre !
Étant donné sa familiarité avec les institutions anglaises, le Haut-Canada s'adapte mieux à ce programme que le Bas-Canada. Durant les années 1820, plusieurs compagnies de volontaires se forment en divers points de la province et, en mai 1829, on ordonne même à chaque régiment d'avoir deux compagnies de carabiniers volontaires. Le premier souci de tous ces hommes est de courir se procurer des uniformes à leurs frais afin d'obtenir des armes du gouvernement, car... sans uniforme, pas d'armes ! Tel est le principe !
À première vue, ces volontaires actifs semblent renforcer la milice, mais ce n'est qu'une illusion. Issus habituellement des classes aisées, ils ne représentent qu'une faible proportion parmi les hommes en état de porter les armes. Quant à la masse des miliciens, on la néglige complètement, sauf à l'occasion de la revue annuelle.
La démobilisation. La revue annuelle de la milice du Haut-Canada
Le capitaine George Denison, York Dragoons, années 1820
George Taylor Denison (1783-1853) est le fondateur d’une dynastie militaire canadienne et d’un régiment de milice canadien qui existe encore au 21e siècle. Également connus sous le nom de York Light Dragoons ou York Cavalry, les York Dragoons ont été créés en 1822 et détachés auprès du 1er Régiment de milice de York Ouest (qui deviendra Toronto). Après avoir subi de nombreux changements de nom, l’unité porte maintenant le nom de Governor-General’s Horse Guards et est devenue un régiment de réserve situé à Toronto. L’uniforme des années 1820 était une veste bleu foncé munie de garnitures chamois, ainsi que de boutons, de cordons et d’ailerons argent.
Pour chaque volontaire en uniforme et armé qui s'enrôle, des dizaines d'autres citoyens délaissent une milice qui est en train de devenir un club social réservé aux bien-pensants de leur comté. La plupart se contentent de se présenter à la revue annuelle de la milice sédentaire, événement naguère relativement sérieux, mais qui, sous l'effet de ce nouvel esprit, se transforme en une sorte de fête champêtre, pour ne pas dire en un véritable cirque.
Veste du capitaine William Wells, Régiment de Grenville, milice du Haut-Canada, vers 1820
De 1814 aux années 1830, les officiers de l’infanterie de milice du Haut-Canada devaient porter, sauf en de rares exceptions, un uniforme écarlate à la devanture bleu foncé, pourvu de boutons dorés et orné de cordons autour du cou et des poignets. Cette veste d’époque, datant d’environ 1820, appartenait au capitaine William Wells (1809-1881) du Régiment de Grenville. Elle est conservée au lieu national historique de Fort Wellington. Wells était lui-même un éminent politicien réformiste.
Le 4 juin de chaque année, le régiment de milice s'assemble donc dans un pré. Mais peut-on parler de régiment ? Il s'agit plutôt d'une bande hétéroclite d'hommes, habillée de toutes les façons imaginables, et armées de fourches, de bâtons, de parapluies... et même de vieux fusils ! Les officiers, pour leur part, font de leur mieux pour avoir l'air d'officiers, tout en essayant de ne pas trébucher sur le fourreau de leur épée ! Après avoir séparé les hommes par groupes - par exemple, ceux qui sont armés de parapluies formant un groupe, ceux qui ont de vieux fusils de chasse en formant un autre - on tente de leur faire exécuter des manœuvres. Il en résulte habituellement un chassé-croisé de groupes allant et venant dans toutes les directions, au grand désespoir des officiers qui s'époumonent à crier des ordres que personne n'écoute... ou n'entend. Car dans les rangs, on lance des blagues, on rit et on discute à qui mieux mieux. Pour finir, les hommes vont étancher leur soif en terminant la journée passablement éméchée, et intimement convaincue qu'un Canadien vaut 10 Yankees ! Parfois, l'alcool aidant, une dispute éclate et l'assemblée se termine en bagarre générale...
La milice du Bas-Canada. Une institution toujours viable
Au Bas-Canada, la population francophone semble conserver une vision plus respectueuse et plus pragmatique de la milice, car, à cette époque, elle joue encore chez eux un rôle social de première importance. En faire partie est obligatoire, mais y être sous-officier ou officier constitue toujours un motif d'honneur et de fierté. D'ailleurs, une bonne partie de l'élite canadienne-française détient un brevet d'officier.
Certes, durant les années 1820, participer aux exercices et aux travaux de la milice peut s'avérer une corvée comme dans les autres colonies. Toutefois, les assemblées de milice ressemblent encore à des concours de tir au fusil de chasse, et se tiennent habituellement le premier mai, comme sous le Régime français. La rencontre se termine par une véritable fête chez le capitaine (voir Le Patrimoine militaire canadien, tome 1). Le jour de la Saint-pierre, les miliciens se rassemblaient après la messe, à la porte de l'église. Une fois alignés, le capitaine leur faisait crier « Vive le roi ! » et... « Le pays était sauf, la paix assurée ».
Beaucoup de miliciens canadiens-français pratiquent donc encore le tir, et leurs relations avec les officiers sont cordiales. L'organisation est relativement égalitaire et ne compte pas véritablement de « volontaires » dans le sens britannique ou américain du terme ; faire partie de la milice est plutôt considéré comme un devoir communautaire. Hormis au sein des états-majors et de quelques compagnies des villes, les miliciens canadiens-français, officiers et soldats confondus, ne voient guère l'utilité du port de l'uniforme.
Tantatives officielles de réformes
Cavalier, Montreal Royal Cavalry, 1824
Cette silhouette d’un cavalier de l’unité Royal Montreal Cavalry, datant de 1824, est l’une des premières images connues d’une unité canadienne. Ces unités de cavalerie légère de milice étaient habillées dans le même style que les dragons d’unités légères de l’armée britannique. L’uniforme était bleu à la devanture écarlate, et garnie de boutons et de cordons dorés. La silhouette originale se trouve dans la collection du Musée d'Argenteuil, à Carillon (Québec). La Royal Montreal Cavalry recrutait parmi les anglophones de la classe moyenne de Montréal, et constituait, en quelque sorte, une version militaire du Montreal Hunt Club.
En présence de cette institution d'un type particulier, Lord Dalhousie ne croit pas avoir affaire à une véritable milice, mais « en vérité, à une police similaire à la gendarmerie en France - plutôt qu'à une milice de formation britannique ». Perception qui découle du fait que les devoirs de la milice au Bas-Canada incluent l'aide au pouvoir civil, ainsi que l'escorte des prisonniers et des criminels. Il se déclare fort déçu d'y déceler si peu d'émulation « comme on en voit presque partout ailleurs dans l'Empire britannique ». Lord Dalhousie pense évidemment aux volontaires en uniforme de la « Yeomanry » anglaise. Il décide donc d'encourager la formation de compagnies de miliciens volontaires à Québec et à Montréal.
Cependant, il commet une première erreur majeure, celle de n'y admettre que les jeunes gens de la bourgeoisie anglophone. Ainsi, le Royal Montreal Cavalry sera une version militaire du très huppé Montreal Hunt Club - un club de chasse à courre. Alors que les Gregory et les Molson sont priés de former leurs compagnies, Son Excellence croit préférable « pour plusieurs raisons [non spécifiées] de ne pas accepter » les offres des bourgeois canadiens-français de former des compagnies de carabiniers et d'artilleurs volontaires. De quelle façon ces notables pourraient-ils se distinguer au sein de cette nouvelle milice, alors qu'on ne les autorise pas à mettre sur pied leurs propres compagnies de volontaires ? Cette expérience a de quoi mortifier profondément ceux d'entre eux qui s'intéressent aux questions militaires.
Mais ce n'est encore là qu'un début ! On décide ensuite de substituer des noms anglais aux noms français des comtés, la milice de Terrebonne, par exemple, devenant la milice d'Effingham. De plus, en 1828, Dalhousie ordonne qu'à l'avenir celles des villes soient divisées par quartiers, ce qui signifie, dans beaucoup de cas, que les postes d'officiers iront à des Canadiens anglais, tandis que la plupart des miliciens seront Canadiens-français. Cette décision relance la question délicate de l'usage du français comme langue de commandement. Mais le pire survient lorsque le gouverneur en chef, dans un accès de fureur contre l'Assemblée législative, supprime les brevets d'officiers de milice d'un grand nombre de députés de l'opposition. Peut-être espère-t-il ainsi discréditer les députés auprès des électeurs... Mais, c'est plutôt la milice elle-même qui s'en trouve déconsidérée. Il en résulte un profond mécontentement, qu'une commission d'enquête spéciale confirme dans un rapport daté de 1829.
La démobilisation. La démobilisation de la milice canadienne française
Bien sûr, la milice francophone du Bas-Canada existe toujours sur le papier et elle continue à se rassembler. En 1828, à la demande du gouverneur en chef, certains hommes se sont même pourvus d'uniformes. Plus encore, dans le comté de Dorchester, en Beauce, une compagnie francophone à cheval, vêtue de gris avec collets et parements noirs et armée par le gouvernement, pourchasse les déserteurs, comme une gendarmerie le ferait. Mais toute cette activité ne peut masquer un profond Malaise.
En réalité, la population canadienne-française remet sérieusement en question les valeurs même de la milice. Le contrôle de cette institution, naguère si proche de ses préoccupations et si chère à sa fierté, lui échappe de plus en plus. Finalement, les Canadiens français se détournent de cette organisation qui ne les représente plus. Puisqu'on cherche à les assimiler et à les humilier, ils s'isoleront socialement afin de pouvoir conserver et promouvoir leur identité, tout en n'adhérant réellement qu'aux institutions qu'ils contrôlent leur Église et leurs partis politiques. La milice et, plus généralement, l'idée même du service militaire, deviennent l'affaire « des autres », et seule la défense du territoire immédiat les concerne désormais. En 1830, bien que son organisation subsiste, la milice canadienne-française est pratiquement anéantie dans les faits. Cette situation, aggravée par un terrain politique miné, favorisera l'éclosion des rébellions de 1837 et de 1838.
Affrontements politiques et sociétés secrètes. Polarisation politique
Matthew Whitworth-Aylmer, 5e baron d'Aylmer et gouverneur général du Canada, 1830-1835 Matthew Whitworth-Aylmer, 5e baron d’Aylmer (1775-1850), porte l’uniforme réservé aux gouverneurs coloniaux. Jusqu’en 1824, les gouverneurs et les gouverneurs généraux portaient des uniformes de généraux d’armée. Par la suite, on leur a attribué un uniforme spécial de cérémonie de style militaire de couleur bleue et écarlate, dont le dernier au porter a été le gouverneur général Roland Mitchener au début des années 1970. Aylmer a connu une éminente carrière militaire au cours des guerres napoléoniennes. Coïncidence digne de mention, pendant quelque temps, il a fait partie du 49e Régiment de fantassins (le Hertfordshire) alors stationné aux Pays-Bas, sous le commandement d’Isaac Brock, futur héros de la guerre de 1812. Lorsqu’il a été nommé gouverneur, Aylmer n’avait que peu d’expérience comme politicien et s’est retrouvé au beau milieu d’un conflit ethnique amer au Bas-Canada. Finalement, malgré que son vœu fût de convaincre les Canadiens français de ses bonnes intentions, il a adopté une série de griefs qui ont mené à la rébellion de 1837.
Durant les années 1820 et 1830, la situation politique dans le Haut et le Bas-Canada se dégrade. Dans chaque colonie, des groupes réformistes réclament davantage de pouvoirs pour les assemblées législatives. Mais, même s'ils remportent la majorité dans les parlements, ils voient tous leurs projets de loi rejetés par les conseils législatifs que contrôlent les coteries en place.
La garnison britannique est liée, bien malgré elle, à cette situation politique explosive puisqu'elle doit, le cas échéant, assurer l'ordre public. À l'occasion d'élections, un premier incident sérieux survient en 1832, à Montréal. Appelé à l'aide du pouvoir civil, un détachement du 15e régiment ouvre le feu sur une foule déchaînée qui refuse de se disperser, tuant trois francophones, parmi lesquels le rédacteur d'un journal de l'opposition. Pour de nombreux Canadiens français, l'armée en sort discréditée.
Louis-Joseph Papineau, 1840.
Le chef du mouvement patriote selon une lithographie de 1840. En ce temps-là il était en France, ayant fui le Canada au début de la rébellion de 1837.
La situation se radicalise à mesure que les partisans des réformes, conduits par Louis-Joseph Papineau, multiplient les demandes pour l'autonomie politique. Ils prennent le nom de « Patriotes ». La plupart sont de souches françaises, mais on trouve aussi parmi eux des nationalistes irlandais et quelques Américains. La majorité des Canadiens d'origine anglaise s'identifient, pour leur part, aux éléments conservateurs en place, même si une partie d'entre eux souhaite aussi des réformes. En 1834 et 1835, on assiste à la naissance de clubs politiques qui nourrissent le projet de prendre les armes. À la fin de 1835, le British Party, prenant une orientation ouvertement paramilitaire, forme le British Rifle Corps, fort de 393 membres, et réclame des armes au gouvernement. Le nouveau gouverneur en chef, Lord Gosford, conscient du danger représenté par une telle formation, ordonne sa dissolution le 15 janvier 1836.
Affrontements politiques et sociétés secrètes. Des bandes armées
Un vieux Patriote de 1837
Cette représentation d’un Patriote âgé de 1837 est bien connue au Québec. Elle a été réalisée en 1887 par Henri Julien, qui travaillait alors comme illustrateur au Montréal Star. Elle fait partie d’une série de 110 illustrations. Beaucoup plus tard, cette image est devenue un symbole pour le mouvement indépendantiste du Québec. Mis à part sa célébrité, elle constitue une excellente reconstitution de l’aspect d’un patriote, si l’on se fie aux dessins de l’époque. Cet homme porte des vêtements de tous les jours que portaient les habitants du Bas-Canada à cette époque. La célèbre ceinture fléchée autour de sa taille a été empruntée aux Amérindiens par les voyageurs canadiens français.
Les factions opposées réagissent en formant des sociétés semi-secrètes. Les conservateurs fondent le Doric Club et les Patriotes créent leur propre association paramilitaire, les Fils de la Liberté. Officiellement, cette dernière s'affiche comme une association politique civile, mais, en réalité, toute sa structure est militaire. Ses sections sont organisées en compagnies et en bataillons, les chefs de chaque palier portant un grade. Et les échauffourées se multiplient de plus belle. L'été de 1837 voit de grands rassemblements politiques organisés par les politiciens patriotes, alors que l'Église exhorte au calme, condamnant toute idée de rébellion contre l'autorité légitime et les lois. Mais les passions sont exacerbées au plus haut point.
Face à cette agitation et aux rumeurs de plus en plus persistantes d'un soulèvement armé, le général John Colborne, commandant des forces britanniques au Canada, prend discrètement des dispositions pour mettre les troupes en état d'alerte dans la région de Montréal. Il demande aussi la création d'une force de police composée de constables dans cette ville et à Québec, car, à l'automne de 1837, seules les troupes britanniques sont en mesure de maintenir l'ordre. Le Haut-Canada, cherchant à accéder à une plus grande autonomie, vit également des tensions politiques. Ce qui n'empêche pas, en 1837, le lieutenant-gouverneur sir Francis Bond Head de croire tout danger écarté et d'envoyer la garnison de Toronto prêter main-forte aux troupes de Colborne, à Montréal...
L'insurrection de 1837 au Bas-Canada. Flambée de violence
Carte de la région montréalaise à l’époque des rébellions de 1837-1838.
Les rébellions ont eu lieu principalement dans la vallée du Richelieu à Saint-Denis et à Saint-Charles, ainsi qu'à Saint-Eustache et dans les environs de Beauharnois.
Le 6 novembre 1837, à Montréal, des membres du Doric Club attaquent des Fils de la Liberté et l'affrontement devient général. Appelées d'urgence pour faire cesser l'émeute, les troupes du lieutenant-colonel George Augustus Wetherall parviennent à disperser la foule. La réaction des Fils de la Liberté ne se fait pas attendre : des escouades de Patriotes en armes surgissent de toutes parts pour garder la maison de leur chef Papineau et, dans les comtés environnants, des centaines d'autres se mobilisent, désarmant les partisans du gouvernement, intimidant les magistrats et demandant la neutralité des officiers de milice. La situation devient dès lors incontrôlable.
Sir John Colborne, vers 1820.
Vétéran de campagnes au Portugal et en Espagne, le général sir John Colborne (1778-1863) pris des mesures efficaces pour étouffer les rébellions au Canada durant 1837 et 1838. Cette gravure montre Colborne portant l’uniforme d’un officier du 52nd (Oxfordshire) Regiment of Foot (Light Infantry) vers 1820.
Le gouverneur en chef réclame des renforts et, le 16 novembre, émet des mandats d'arrêt contre 26 chefs patriotes. Les compagnies de miliciens volontaires sont mobilisées pour procéder aux arrestations. Averti à temps, Papineau et Edmund Bailey O'Callaghan parvient à s'enfuir, mais le président des Fils de la Liberté, André Ouimet, est arrêté et emprisonné. Le jour même, un détachement du Royal Montreal Cavalry, qui ramène à Montréal des Patriotes arrêtés à Saint-Jean, est attaqué et contraint de libérer ses prisonniers. Dans les rangs des Patriotes, il est devenu évident que les forces de l'ordre prennent fait et cause pour l'oligarchie au pouvoir. Aux yeux de sir John Colborne, il importe avant tout de rétablir l'ordre. Mais, pour y parvenir, il ne peut recourir à la milice qui, discréditée, s'écroule.
Sanctions contre les loyaulistes volontaires
Officier, Queen's Light Dragoon, 1838-1849.
Cet escadron de cavalerie légère fut levé à Montréal par le capitaine Thomas Walter Jones au début du mois de décembre 1837. Quarante-cinq volontaires du corps fesaient partie des forces du général Colborne à Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Colborne garda l’unité en service actif durant le reste de la période des rébellions et on leur présenta un guidon en avril 1838. De 1839 jusqu’à 1849, l’unité patrouilla la frontière avec les États-Unis afin d’intercepter les déserteurs. En 1849, quand de violentes émeutes éclatèrent à Montréal suite au passage du projet de loi concernant les compensations des pertes dues à la rébellion de 1837, un détachement des Queen’s Light Dragoons protégea le gouverneur général Lord Elgin des émeutiers lançant des pierres. Cette gravure de l’époque montre un officier en grande tenue.
La population montréalaise est alors composée à part égale de francophones et d'anglophones. Peter McGill, fondateur de l'université du même nom, président de la Banque de Montréal et de la première compagnie de chemins de fer au pays, propose à Lord Gosford de lever des compagnies de volontaires dans les divers quartiers de la ville. Cette mesure libérerait l'armée, qui pourrait ainsi aller rétablir l'ordre dans les campagnes. Lord Gosford accepte et, en un temps record, des unités de volontaires sont formées. Enfin ! Tous les partisans « loyaux sujets », qui n'attendaient que ce moment, peuvent s'armer et s'organiser pour venir à bout de leurs opposants patriotes, accusés de trahison ! Évidemment, la grande majorité de ces volontaires étaient des Canadiens anglais, même si quelques Canadiens de souche française en faisaient partie.
Saint-Denis et Saint-Charles. Première victoire des Patriotes
Patriotes prenant une pièce d'artillerie britannique au cours de la bataille de Saint-Denis, le 22 novembre 1837
Cette image montre des Patriotes en train de célébrer la prise d’une pièce d’artillerie abandonnée par les Britanniques après la victoire de la bataille de Saint-Denis, le 22 novembre 1837. Cette reconstitution de 1887 par Henri Julien donne une excellente idée des différents vêtements portés par les rebelles, ainsi que de leurs armes. À noter, l’homme qui brandit sa fourche au centre droit et qui porte un capot et une tuque. La seule petite erreur est que l’arme illustrée est un canon à tube long, au lieu de l’obusier à tube court qui a été pris ce jour-là.
S’agit donc dans l'immédiat de soumettre les comtés patriotes aux alentours de Montréal. Une colonne de 300 soldats britanniques, composée de détachements des 24e, 32e et 66e régiments, d'artilleurs avec un obusier de 12 livres et de cavaliers du Royal Montreal Cavalry, quitte Sorel sous le commandement du lieutenant-colonel Charles Stephen Gore. Elle doit rejoindre à Saint-Charles, au coeur du pays patriote, une autre colonne venue de Chambly sous les ordres du lieutenant-colonel Wetherall. Mais, le 23 novembre, parvenu à Saint-Denis, Gore se trouve face à environ 800 Patriotes barricadés, sous le commandement du docteur Wolfred Nelson ! Bien que seulement 200 d'entre eux disposent d'un fusil, leur tir précis force bientôt les éclaireurs britanniques à rebrousser chemin. Gore décide alors de bombarder le village, mais, même à quelque 320 mètres, quatre artilleurs sont touchés avant que l'obusier ne tire un premier coup ! Les Britanniques réussissent néanmoins à s'emparer de quelques maisons. Enfin, au terme de six heures de combat, Gore est contraint d'ordonner la retraite, abandonnant l'obusier aux Patriotes. Les pertes ne sont pas lourdes : 6 morts, 10 blessés et 6 hommes manquant à l'appel chez les Britanniques; 12 morts et 7 blessés chez les Patriotes. Les hommes de Nelson jubilent ; des fermiers armés de faux et de vieux fusils, dont certains datent même du Régime français, ont eu raison de soldats britanniques bien entraînés et bien armés !
Des troupes régulières britanniques tentent d‘approcher Saint-Denis le 23 novembre 1837.
Une colonne composée de détachements de trois régiments britanniques fit face à une défense opiniâtre de la part des Patriotes à Saint-Denis. Grâce au mauvais temps, les 300 soldats furent repoussés par quelques 800 Patriotes piètrement armés mais déterminés.
Le docteur Nelson (1791-1863) commandait les forces victorieuses des Patriotes à Saint-Denis en novembre 1837. Cette aquarelle fut faite lors de son exil aux Bermudes.
La bataille de Saint-Charles le 25 novembre 1837.
Cette illustration d’époque montre la charge du 1st, or The Royal Regiment of Foot, durant la bataille de Saint-Charles. À gauche se trouve le manoir seignieurial de Pierre-Dominique Debartzch, le point fort des Patriotes. Un incendie ravage la maison Dupuis à gauche.
Mais le triomphe des Patriotes sera de courte durée. Le 25 novembre, la colonne du lieutenant-colonel Wetherall, composée de 420 soldats des ler et 66e régiments avec deux pièces d'artillerie de campagne, et d'un détachement du Royal Montreal Cavalry, arrivent à Saint-Charles. Près de 200 à 250 Patriotes, dirigés par Thomas Storrow Brown, y est retranchés. Bien que prévenu de la défaite de Gore, Wetherall décide d'attaquer immédiatement, surprenant quelque peu les Patriotes par sa hardiesse. Au bout de deux heures de fusillade, Wetherall ordonne aux trois compagnies du ler régiment de charger à la baïonnette. Les Patriotes, qui ne disposent pas de baïonnettes à leurs fusils, sont bientôt désavantagés. C'est alors que survient un incident aux conséquences désastreuses : une cinquantaine d'entre eux, feignant de se rendre pour mieux tirer sur les soldats, tuent un sergent et blessent plusieurs hommes. Ce geste déloyal provoque la rage de leurs adversaires qui passeront un grand nombre de Patriotes au fil de la baïonnette, puis mettront le village à sac avant de l'incendier. La bataille de Saint-Charles fit trois morts et 18 blessés seulement dans leurs rangs, alors que les Patriotes eurent à déplorer jusqu'à 150 morts.
Sir George Augustus Wetherall (1788-1868).
Le lieutenant-colonel Wetherall, du 1st, or The Royal Regiment of Foot, gagna la bataille de Saint-Charles le 25 novembre 1837. Cette gravure le montre quelques années plus tard, portant l’uniforme d'un général britannique.
Cette victoire redonne l'initiative aux troupes britanniques et, deux jours plus tard, la colonne de Wetherall met en fuite un corps d'environ 300 Patriotes en se contentant de tirer quelques coups de feu. Le 2 décembre, une nouvelle colonne commandée par Gore, comprenant des détachements des 24e, 32e, 66e et 83e régiments, avec trois canons, entre sans difficulté dans Saint-Denis et incendie une partie du village. Au sud-est de Montréal, la rébellion était bel et bien matée.
Saint-Eustache. Les britanniques contre-attaque au Nord de Montréal
La bataille de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837
À la fin de la bataille de Saint-Eustache, en décembre 1837, les Patriotes qui fuient sont interceptés sur la rivière gelée de Mille-Îles par les volontaires loyalistes de Saint-Eustache (dont la plupart sont des Canadiens français). Cette gravure de 1840 reprend un croquis de l’incident réalisé par un officier britannique qui a participé à la bataille. À noter, les vêtements d’hiver portés par les deux camps. À l’arrière-plan, l’église de Saint-Eustache, le principal bastion des Patriotes, est la proie des flammes.
Mais les Patriotes du nord de la ville ne sont pas encore soumis. L'arrivée du 83e régiment à Montréal fournit à Colborne les hommes et les moyens dont il a besoin pour marcher sur Saint-Eustache, leur chef-lieu. Colborne rassemble alors les ler, 32e et 83e régiments, 79 artilleurs avec cinq pièces d'artillerie et des fusées Congreve, le Royal Montreal Cavalry, une compagnie des Montreal Rifles et une compagnie de volontaires loyaux de Saint Eustache ; au total, quelque 1 280 soldats britanniques et environ 220 volontaires. Du côté des Patriotes, l'organisation n'est guère élaborée et plusieurs d'entre eux ne disposent même pas d'armes à feu. On pense être en mesure de rassembler 800 combattants, mais, finalement, seulement 200 hommes, dirigés par le docteur Jean-Olivier Chénier, s'embusquent dans le couvent, l'église, le presbytère et le manoir, au centre du village. À ceux qui lui réclament des armes, Chénier répond : « Soyez tranquilles, il y en aura de tués et vous prendrez leurs fusils. »
Colborne dispose ses troupes autour du village, puis fait avancer ses soldats systématiquement de façon à resserrer l'étau sur les défenseurs. Vers midi, il commande à l'artillerie d'ouvrir le feu sur le centre du village, puis lui fait remonter la rue principale afin d'ouvrir une brèche dans les portes de l'église où se trouvent de nombreux Patriotes. Deux compagnies du ler régiment parviennent à s'emparer du presbytère, situé à proximité, et l'incendient afin que la fumée gêne la vision des défenseurs de l'église. Les grenadiers du ler régiment prennent ensuite le manoir d'assaut, mettent également le feu, puis parviennent à entrer dans l'église par la sacristie, où ils promènent leur torche avant de se retirer sous le tir nourri des Patriotes embusqués dans le jubé. Bloqués dans l'église en flammes, ceux-ci tentent d'en réchapper en sautant par les fenêtres. Les troupes britanniques donnent alors l'assaut final, dans un combat sans merci. Cet engagement, désastreux pour les Patriotes, ne dure au bas mot que quatre heures ; soixante-dix d'entre eux, dont Chénier, y trouvent la mort, contre à peine trois soldats britanniques.
Une répression brutale
Pour finir, les troupes régulières et les volontaires incendient les maisons qui avaient servi de repaires aux Patriotes. La nuit venue, ils se livrent à une véritable débauche de saccage et de pillage. Le sac de Saint-Eustache fut d'une telle violence que le capitaine Swinburne, du 83e régiment, relata plus tard qu'il « égala sinon surpassa ce qu'il avait vu durant le sac de Badajos ». Le lendemain, Colborne et ses troupes envahissent le village voisin de Saint-Benoît où les Patriotes se rendent sans résistance, ce qui n'empêche pas Colborne de faire incendier le village, ainsi que celui de Saint-Hermas (aujourd'hui Mirabel).
Au cours des jours suivants, d'autres corps de volontaires arrivés sur les lieux après la bataille de Saint-Eustache pillent les fermes des environs. Habituellement, après s'être emparés de tout ce qu'ils pouvaient transporter, ils « faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leurs maisons embrasées». Partie à pied, une compagnie de volontaires loyaux revient même sur des chevaux « français », que l'on baptise les « chevaux de Papineau ». Dans l'ensemble, la discipline des volontaires laisse à désirer. Selon un Patriote fait prisonnier, ils « étaient des partisans fanatiques ou des immigrants ignorants et grossiers, croyant s'attirer les faveurs du pouvoir en se montrant impitoyables. Les soldats réguliers britanniques, au contraire, étaient disciplinés et savaient à l'occasion se montrer humains. Ils soulagèrent autant que possible les souffrances de ceux qui étaient confiés à leur garde.
Les horreurs de la guerre
On s'imagine parfois que la guerre au temps de nos ancêtres était peut-être plus noble qu'aujourd'hui. Les lignes qui suivent, écrites au temps des uniformes rutilants, remettent en question ces idées reçues.
La scène se déroule à Saint-Charles, le dimanche 26 novembre 1837, lendemain de la bataille entre les Patriotes et les troupes britanniques. Sur les lieux se trouve le capitaine George Bell, du let régiment britannique, qui voit avec tristesse des parents et amis venir chercher les dépouilles des leurs. Deux jeunes filles à l'allure distinguée s'approchent de Bell et lui demandent s'il peut les aider à retrouver leur père, ce qu'il accepte de faire.
« Je les accompagnai et, hélas ! nous le trouvâmes en effet, la tête broyée, le corps présentant un aspect des plus horrifiants, gelé comme un billot, les membres étendus raides comme à l'instant où il tomba, le sang et la cervelle congelés ensemble et formant une masse horrible. Ces pauvres filles, avec de l'aide, le firent placer sur un traîneau et le recouvrirent. L'une d'elles ne versa pas une larme, l'autre était à l'agonie. Je pouvais imaginer leurs sentiments et j'eus pitié d'elles de tout mon cœur, pauvres âmes ! Ce sont de telles scènes qui rendent la guerre si épouvantable... »
La rébellion du Haut-Canada. Les radicaux de Mackenzie dispersés par la milice loyaliste
Dans le Haut-Canada, en apprenant la nouvelle de la révolte bas-canadienne, les réformistes radicaux, appelés eux aussi « Patriots » et regroupés autour de William Lyon Mackenzie, décident de renverser le gouvernement et de proclamer une république. L'occasion est d'autant plus belle qu'il n'y a pas de troupes régulières dans la capitale, Toronto (qui, en 1834, avait troqué le nom de York pour son nom d'origine amérindienne). Le 5 décembre, Mackenzie s'approche de la ville par la rue Yonge avec quelque 800 partisans mal armés et indisciplinés, quand éclate une échauffourée avec quelques Loyalistes, qui se solde par deux morts. L'incident provoque la mobilisation générale de la milice et des volontaires de la ville, la grande majorité des citadins ne voulant pas de révolution.
Deux jours plus tard, environ 900 miliciens torontois équipés de deux canons attaquent les quelque 500 insurgés - des centaines d'autres ont déjà déserté le camp de Mackenzie, tribun superbe mais soldat déplorable - à leur lieu de rassemblement de la rue Yonge, la taverne Montgomery. Le combat est bref et se solde par la fuite de la plupart des révolutionnaires improvisés dès les premiers coups de canon. On ne déplore que deux morts dans le camp des rebelles. Mackenzie parvient à se réfugier aux États-Unis, mais plusieurs de ses lieutenants sont capturés.
Ces événements mettent la province sens dessus dessous, car des rumeurs d'attaques par les rebelles affluent de toutes parts. Des groupes de Patriots se rassemblent dans la région de London, mais se dispersent sans livrer combat à l'approche d'une colonne de volontaires loyaux commandés par le colonel Allan Napier MacNab.
Incident frontalier
Les milices de la péninsule du Niagara se mobilisent également, car Mackenzie et ses partisans, avec l'aide de sympathisants américains, installent le gouvernement provisoire de la république du Haut-Canada dans la petite île de Navy, du côté canadien de la rivière Niagara, à environ quatre kilomètres en amont des célèbres chutes. Le Caroline, petit navire à vapeur américain acquis par les Patriots, assure leur ravitaillement. Le soir du 29 décembre, une cinquantaine de volontaires canadiens, commandés par le capitaine Andrew Drew, de la Royal Navy, montent à l'abordage du navire et le prennent en quelques minutes, du côté américain de la frontière. Seul un Américain partisan de Mackenzie est tué. Le navire, incendié, part à la dérive. Le Caroline en flammes approchant des grandes chutes dut certes fournir un spectacle inoubliable aux habitants des deux rives, ce soir-là. Toutefois, il ne plongea pas dans l'abîme, comme plusieurs journaux l'ont prétendu, mais s'échoua sur une petite île, au sommet des chutes, où il se désintégra.
Après cette violation manifeste de son territoire, la réaction diplomatique américaine est tout aussi spectaculaire, et les ambassadeurs à Washington et à Londres échangent quelques missives acerbes. Cependant, les Américains sont bien obligés d'admettre que plusieurs de leurs citoyens avaient fomenté l'invasion du Haut-Canada. Le président Martin Van Buren condamne cette attitude et ordonne aux troupes régulières du général Winfield Scott de patrouiller le côté américain de la frontière du Niagara. Le 13 janvier 1838, réalisant qu'ils ne pouvaient envahir le Haut-Canada, les hommes de Mackenzie évacuent l'île de Navy. Le 9 janvier, à l'ouest de la colonie, d'autres Patriots, partis de Detroit, viennent bombarder Amherstburg. Cependant, leur navire dérive avant d'être abordé par les miliciens canadiens. Ainsi se termine la rébellion de 1837 au Haut-Canada, révolte mouvementée, mais infiniment moins sanglante que celle du Bas-Canada.
Nouveaux préparatifs. Renforcement précipité des forces militaires
Appui américain aux rebelles
De leur côté, les insurgés réfugiés aux États-Unis, partisans de Papineau comme de Mackenzie, trouvent de nombreux appuis auprès des Américains. Ils fondent une société secrète, les Frères-Chasseurs, dont le but est d'organiser des contingents d'invasion aux États-Unis et de mettre sur pied au Canada des groupes secrets, qui se soulèveront contre les Britanniques au moment de l'invasion. Les Frères-Chasseurs prêtent serment, se reconnaissent entre eux par des signes convenus et des mots de passe, et possèdent une hiérarchie de commandement assez pittoresque. Un « grand aigle » désigne un genre de général qui commande toute une région, un « aigle » étant le colonel d'un régiment de 500 hommes, un « castor », le capitaine d'une compagnie comptant six « raquettes », chaque « raquette » commandant à son tour neuf « chasseurs ». Plusieurs Américains se joignent à cette société secrète qui vise à libérer le Canada. Mais au Canada même, certains doutent du désintéressement de leurs intentions, ce qui n'aide pas la cause des Patriotes canadiens.
Début des rébellions de 1838. Une suite d'incidents sur la frontière
Durant toute l'année 1838, les insurgés tiennent les deux provinces en alerte. Le 28 février, environ 250 hommes en armes, conduits par le docteur Wolfred Nelson, traversent la frontière à Week's House, proclament l'indépendance du Bas-Canada... et regagnent aussitôt le Vermont à l'approche des volontaires et des troupes britanniques ! De retour aux Etats-Unis, ils sont désarmés par l'armée américaine. Dans le Haut-Canada, au début du mois de mars, des Patriots occupent l'île de Pelee, non loin de Windsor. Le 3 mars, un détachement des 32e et 83e régiments, appuyé de volontaires loyaux, les attaque et les disperse après un bref et vif combat. Huit Patriots sont tués, tandis que les Britanniques perdent six soldats et un volontaire. En mai, un petit navire canadien, le sir Robert Peel, est pris et incendié dans les Mille-Îles. En juin, entre 40 et 70 Patriots, cachés dans les Short Hills de la péninsule du Niagara, capturent un détachement d'une douzaine de cavaliers des Queen's Lancers. Mais l'alarme est donnée et une battue, effectuée par des centaines de miliciens, les met en fuite.
Au Bas-Canada, la situation étant redevenue plus calme, sir John Colborne démobilise, au début de l'été, une grande partie des volontaires loyaux, se réservant la possibilité de les rappeler en cas d'urgence. Il peut d'ailleurs compter sur les renforts de troupes régulières venues de Grande-Bretagne et de Gibraltar.
Crainte d’un soulèvement des patriotes
En réalité, ce calme n'est qu'apparent. De nombreuses rumeurs circulent à propos des sociétés secrètes patriotes et le nouveau gouverneur en chef lui-même, Lord Durham, croit qu'elles pourraient regrouper jusqu'à 3 000 partisans pour la seule ville de Montréal. En effet, le surintendant de la police nouvellement créée à cet endroit, Pierre-Édouard Leclère, reçoit quotidiennement des bribes d'informations selon lesquelles un grand et terrible soulèvement se préparerait.
Ces craintes sont certes fondées. La stratégie des Frères-Chasseurs, mise au point par leur chef, Robert Nelson, prévoit la prise de Sorel par une partie de leurs membres, qui se joindront ensuite à une armée patriote venant des États-Unis pour s'emparer des forts Chambly et Saint Jean. Pendant ce temps, à Montréal, d'autres Frères-Chasseurs désarmeraient les troupes durant les services religieux du dimanche, période où les soldats ne sont armés que de leurs baïonnettes. Des soulèvements devront éclater simultanément en plusieurs points. Mais, le 2 novembre, le complot est éventé et les Britanniques sont en état d'alerte. Dès le lendemain, un important contingent de troupes régulières se dirige vers la frontière américaine. Au même moment, toutefois, des citoyens loyaux se présentent au fort Lennox pour s'y réfugier : des Patriotes ont traversé la frontière et se sont emparés de Napierville !
En effet, Nelson, proclamé président de la république du Bas-Canada, a installé son quartier général dans cette petite ville. Rejoint par les forces républicaines du docteur Cyrille Côté, il se prépare à avancer vers Montréal. Les Frères-Chasseurs sortent alors de l'ombre et commencent à se rassembler dans plusieurs localités, au sud de Montréal. Toutefois, malgré les plans concoctés au Vermont, l'organisation de l'opération est loin d'être au point. Elle « consistait tout bonnement, rapporta un Chasseur, dans la promesse d'un certain nombre [d'hommes] de se rendre en armes à l'appel des chefs alors à peine désignés. Quant à notre armement..., nos partisans [à Saint-Timothée] pouvaient réunir environ 100 fusils de chasse, dont la plupart dataient du temps des Français ; les autres étaient armés de fourches de fer, en guise de piques, et [de lames de] faux transformées en sabre ».
Le dimanche 4 novembre au matin, environ 600 Patriotes, dont la moitié sont armés de fusils, prennent le contrôle de la petite ville de Beauharnois, au sud-ouest de Montréal. Dans la ville même, Colborne ordonne à la milice des comtés de Glengarry et de Stormont, situés à l'est du Haut-Canada, de s'y rendre, met la garnison sur le pied de guerre et lance un ordre de mobilisation aux volontaires. En moins de quelques heures, 2 000 volontaires se retrouvent sur place, surveillant les entrées de la ville et sillonnant les rues. Toute action des Frères-Chasseurs contre la garnison est neutralisée. D'ailleurs, plusieurs suspects sont interpellés par la police et les volontaires, car la loi martiale est entrée en vigueur. Soldat prudent, Colborne attend les renforts, car on estime à environ 5 000 le nombre de Patriotes au sud de Montréal. En réalité, ils sont entre 2 500 et 3 000, déjà divisés par des conflits internes et des trahisons.
Napierville
Conformément au plan de Colborne, les forces britanniques s'approchent des rebelles par trois directions différentes. Venus de l'ouest, les 7e hussards, les Grenadiers Guards, le 71e régiment et les miliciens du comté de Glengarry longent le Saint-Laurent et investissent successivement Saint-Timothée et Beauharnois, pour se joindre finalement aux miliciens de Stormont et aux volontaires de Huntingdon qui remontent la rivière Châteauguay. À Baker's Farm, le 9 novembre, ils dispersent rapidement les Patriotes, puis se dirigent vers Napierville, à l'est, au son des cornemuses, sous le commandement du général James Macdonell.
Au sud, près de la frontière américaine, les volontaires loyaux des villages environnants mettent les Patriotes en déroute à Lacolle, le 7 novembre, puis à Odelltown, le 9 du même mois. Ils sont rejoints par le King's Dragoon Guards et le 73e. Régiment. Sous le commandement du colonel George Cathcart, volontaires, fantassins et cavaliers britanniques prennent la direction de Napierville, au nord.
Enfin, au nord-est, Colborne lui-même s'est rendu à Saint-Jean et marche vers Napierville à la tête des 15e et 24e régiments. Au total, près de 3 300 soldats britanniques et volontaires loyaux convergent sur la petite ville. L'armée patriote s'évapore dans une débandade générale, tous craignant d'être encerclés et massacrés par les troupes britanniques. L'épisode de l'invasion et de l'insurrection de 1838 au Bas-Canada est clos.
L’invasion du Haut-Canada
Pendant ce temps, dans le Haut-Canada, la tentative d'invasion se poursuit plus résolument que jamais. À l'est du Haut-Canada, le 11 novembre, un puissant contingent d'environ 400 Patriots et volontaires américains fait irruption tout près de Prescott. Relativement bien armés, ils sont sous le commandement d'un aventurier finlandais qui se prétend polonais, Nils von Schoultz. Environ 140 volontaires et miliciens des environs se trouvent alors au fort Wellington, à Prescott. L'alarme générale est donnée dès que les Patriots abordent au Canada. Réalisant qu'il ne pourra prendre le fort Wellington, où on l'attend de pied ferme, von Schoultz se retire avec ses hommes dans un grand moulin à vent en pierre, près du fleuve Saint-Laurent, à un kilomètre à l'est du fort. Le 13 novembre, la place est encerclée par quelque 500 soldats et miliciens qui l'attaquent par voie de terre, pendant que deux bateaux à vapeur, le Queen Victoria et le Coburg, la bombardent. De nombreux Patriots et volontaires américains parviennent à s'échapper et à regagner les États-Unis, mais 131 d'entre eux se constituent prisonniers dans la soirée du 16. Une vingtaine de Britanniques et de volontaires loyaux sont tués dans cet engagement contre une trentaine d'insurgés.
Le 4 décembre, quelque 250 Patriots et volontaires américains, partis de Detroit, s'emparent de la ville de Windsor. Leur victoire est cependant éphémère puisqu'un contingent d'environ 130 miliciens du comté d'Essex les attaque et les repousse presque aussitôt. Les miliciens déplorent quatre morts parmi leurs membres et les Patriots environ 27. Excédé par les raids des insurgés et ébranlé par la mort de son ami le docteur John James Hume, le colonel John Prince, qui commandait les miliciens, fait exécuter sur-le-champ cinq prisonniers, geste appelé à provoquer un scandale. L'arrivée de troupes britanniques et d'Amérindiens dépêchés du fort Malden achève la déroute des rebelles.
L’héritage des rébellions. Le patriotisme du Haut-Canada
Le fort York, à Toronto, août 1839.
Le fort de Toronto, aussi connu sous le nom de fort York, fut reconstruit suite à sa destruction par les Américains en 1813. Comme on peut le constater par ce tableau de P.J. Bainbridge daté de 1839, le fort était situé au bord de l’eau, à l’entrée du port de Toronto. Un soldat écossais du 93rd (Highland) Regiment of Foot est à l’avant-plan.
Cette seconde rébellion plonge le Haut-Canada dans une mobilisation générale sans précédent. Le 30 novembre, 19 318 volontaires sont en service actif à travers la colonie, sans compter quatre bataillons et une compagnie de cavalerie de milice incorporée totalisant quelque 2 800 hommes. La peur avait gagné une grande partie de la population. Indépendamment des convictions politiques, la perception générale des événements basculait dans la crainte d'une ruée d'aventuriers de tout acabit. Treize Patriots et sympathisants américains, parmi lesquels von Schoultz, sont exécutés, et 86 autres déportés en Australie.
Rétrospectivement, la mémoire collective ontarienne en est venue à considérer cet épisode de ralliement général comme un témoignage de patriotisme. Cette interprétation est d'autant plus crédible que, contrairement à ce qui eut lieu durant la Guerre de 1812, les rébellions firent très peu de morts et de dommages dans le Haut-Canada, probablement parce que la population ne voulait pas des changements qu'auraient apportés la révolution et l'invasion.
Les Canadiens français traumatisés
Au Bas-Canada, la situation est différente. L'insurrection de 1837 y avait été sanglante, occasionnant la mort d'environ 300 Patriotes et d'une dizaine de volontaires, ce qui représente environ 10 fois plus de tués que le nombre de Voltigeurs et de miliciens du Bas-Canada tombés durant la Guerre de 1812. En outre, les destructions par le feu de villages et de fermes, plongeant les familles dans la misère, pratique couramment employée, traumatisèrent la population française.
La répression se prolongea d'ailleurs dans les localités favorables au mouvement patriote. À la fin de 1838, on lève un corps de Rural Police (ou de police rurale), sorte de force paramilitaire se déplaçant surtout à cheval, armée de bâtons, de fusils, de pistolets et de sabres. En dehors du fait qu'il pourchasse les criminels de droit commun, ce corps policier surveille et rapporte les agissements des habitants des villages « où l'insatisfaction et le mécontentement semblaient avoir pris profondément racine ». De nombreux postes, ayant chacun un sous-officier et quelques constables, sont aménagés dans les localités environnant Montréal, jusqu'à Hull au nord-ouest, Nicolet au nord-est et Saint-Jean au sud. Des corps policiers aux objectifs similaires étaient déjà en place à Montréal et à Québec depuis l'été de 1838.
D'autre part, les procès se succèdent : douze Patriotes montent sur l'échafaud et 58 autres sont déportés en Australie. Contrairement à ceux du Haut-Canada, les coupables étaient presque tous des fils du pays de souche française, de sorte que les condamnations furent ressenties par les Canadiens français avec douleur et consternation. La grande majorité d'entre eux n'avaient pas répondu à l'appel aux armes. Ces condamnés, qui s'étaient soulevés pour défendre leurs droits, n'étaient pas considérés comme des traîtres par la population.
Du point de vue militaire, la pertinence des initiatives et le professionnalisme des troupes britanniques ne font pas l'ombre d'un doute, ainsi que le fait que ce furent eux qui combattirent le plus. Quant aux volontaires, s'ils ne se montrèrent pas toujours comme des modèles de discipline et de modération, ils firent preuve à maintes reprises de bravoure et de hardiesse. Ils avaient, il est vrai, l'avantage d'être bien armés.
Tel n'était pas le cas de leurs compatriotes qui levèrent l'étendard de la révolte. Les politiciens qui avaient poussé leurs concitoyens à l'insurrection armée manquèrent totalement à leurs responsabilités lorsque éclatèrent les combats, n'ayant rien de plus pressé à faire que de se réfugier aux États-Unis. Livrés à eux-mêmes, sans armes, sans stratégie et sans tactique, placés sous le commandement de chefs improvisés, des milliers de gens n'eurent d'autre choix que de se barricader pour se défendre à l'approche des troupes. Ils étaient eux aussi fils du pays, au même titre que leurs opposants, et beaucoup de ces civils se comportèrent avec tout le sens de l'honneur dont sont capables les meilleurs soldats. Au combat, en définitive, seule la valeur compte, et à ce titre, certains Patriotes canadiens démontrèrent une bravoure exemplaire dans des circonstances désespérées.
La « guerre d'Aroostook ». Nouvelle menace américaine
Cependant, tout ce déploiement guerrier a miné la défense de l'Amérique du Nord britannique face aux États-Unis. En apparence, le pays est militairement plus puissant que jamais. Au ler janvier 1839, si l'on excepte les colonies maritimes, il y a 31 848 hommes en armes dans le Haut et le Bas-Canada, dont 10 686 soldats britanniques. Mais, en réalité, les deux Canadas sortent affaiblis de cette dure période. La plupart des volontaires loyaux se trouvent dans le Haut-Canada ; au Bas-Canada, il n'est plus question de songer à mobiliser la population, qui représente pourtant environ la moitié du potentiel d'hommes valides en Amérique du Nord britannique. Or, c'est précisément du côté de cette colonie que se profile une nouvelle menace américaine.
La frontière entre l'État américain du Maine et les colonies du Bas-Canada et du Nouveau-Brunswick avaient toujours été très floue. Or, en février 1839, le gouverneur du Maine revendique vivement la région d'exploitation forestière d'Aroostook et mobilise 8 000 miliciens pour occuper le territoire en question. C'est presque une déclaration de guerre, et l'incident est d'ailleurs qualifié comme la « guerre d'Aroostook ». Les prétentions américaines se heurtent à la résistance du Nouveau-Brunswick qui lui-même mobilise 1200 miliciens. Ne pouvant plus compter sur la milice du Bas-Canada, on envoie quatre compagnies du lle régiment au lac Témiscouata depuis Québec, afin de protéger la route utilisée l'hiver par les militaires circulant entre Québec et le Nouveau-Brunswick.
Une solution diplomatique
Heureusement, personne ne désire réellement déclencher une guerre et, en mars, une trêve diplomatique prévoit le retrait des troupes en attendant qu'une solution soit négociée. Mais d'autres incursions américaines surviennent au cours de l'été et de l'automne, de sorte qu'en novembre 1839, deux compagnies du lle sont renvoyées au lac Témiscouata. Cette fois, les soldats britanniques construisent un fortin en bois, le fort Ingall (à Cabano, au Québec). La controverse se règle finalement en août 1842, avec la signature d'une entente britannico-américaine délimitant la frontière entre le Maine et l'Amérique du Nord britannique. Les Américains obtiennent une partie de la région contestée, mais le chemin militaire demeure territoire des colonies britanniques.
À Québec, on ne se fait cependant pas d'illusions sur les intentions pacifiques des Américains. Dès novembre 1840, le remplaçant de Colborne au poste de commandant en chef des troupes de l'Amérique du Nord britannique, sir Richard Downes Jackson, juge que les nouvelles fortifications construites alors par les Américains près de la frontière sont « évidemment destinées à servir de bases pour de futures opérations offensives » contre le Canada...
Politique canadienne et replie britannique. Changement d’optique
Durant les années 1840 et 1841, on abolit les colonies distinctes du Haut et du Bas-Canada pour former le Canada-Uni. Celui-ci reste cependant divisé en deux parties, le Canada-Est et le Canada-Ouest, qui correspondent aux provinces actuelles du Québec et de l'Ontario.
En dépit de cette mesure, la situation politique de l'Amérique du Nord britannique demeure tendue et confuse. À Londres, on se demande sérieusement si le Canada-Uni est défendable sans le soutien d'une importante partie de ses habitants. Le duc de Wellington se rend compte de l'impossibilité pour la Grande-Bretagne de défendre efficacement les populations sous sa tutelle. Il est d'avis que si les colonies de l'Amérique du Nord ne peuvent mener une défense vigoureuse en cas d'attaque, il est « plus sage, bénéfique et juste» d'évacuer la garnison britannique et de les laisser négocier elles-mêmes le meilleur arrangement possible avec les Américains !
Impensable à peine quelques années auparavant, l'idée d'évacuer le Canada, lancée par le chef suprême de l'armée, séduit plus d'un Britannique. Le Canada n'est plus un enjeu stratégique central et il coûte au moins le double de ce qu'il rapporte en taxes. La Grande-Bretagne oriente donc sa politique dans ce sens et tend à se désengager dans la question de la défense du Canada-Uni.
Réduction et restructuration de la présence militaire
Au pays même, à mesure que s'estompe la menace d'une nouvelle rébellion, on procède à la démobilisation des volontaires. Évalués à environ 21 000 en 1839, ceux-ci passent à 4 879 l'année suivante et à 2 766 en 1841 et 1842. Finalement, en 1843, toutes les troupes provinciales sont licenciées, hormis trois compagnies de cavalerie au Canada-Est et une compagnie d'infanterie au Canada-Ouest, qui seront encore maintenues pendant sept ans.
Au Canada-Est, la Rural Police et les corps de police de Montréal et de Québec passent peu à peu de l'état de police politique paramilitaire à celui de force civile. Mais les coûts que représentent ces compagnies et, surtout, leur origine répressive sont des raisons suffisantes pour les supprimer. En décembre 1842, l'Assemblée législative ordonne la dissolution de tous les corps de police levés durant la rébellion. Cette décision crée cependant un vide au niveau de la lutte contre la criminalité, de sorte que d'autres forces policières devront, par la force des choses, être créées.
En 1842 et 1843, les régiments amenés d'urgence en 1838 se retirent. En 1844, toutefois, la garnison régulière britannique au Canada-Uni, avec ses 7 700 soldats, est encore trois fois plus importante qu'en 1837. Mais, chaque année, quelques centaines de soldats en sont retranchés. Certains n'attendent d'ailleurs pas que leur régiment retourne en Angleterre pour quitter le Canada, préférant passer aux États-Unis ! C'est pour enrayer ce mouvement qu'est organisé le Royal Canadian Rifle Regiment - le régiment des carabiniers royaux canadiens - en 1840 et 1841. Il ne s'agit pas d'un régiment canadien, comme son nom pourrait le laisser entendre, mais d'une unité composée de vétérans des régiments de ligne et faisant partie de l'armée régulière. Cependant, son service ne fait pas l'objet d'une rotation : c'est un régiment sédentaire dont les compagnies sont détachées le long de la frontière, pour surveiller les États-Unis, bien sûr, mais surtout pour empêcher les déserteurs de s'y rendre...
La réorganisation de la Milice. La crise de l'Oregon déclenche des réactions
La question de la milice canadienne reste très confuse durant ces années. Au Parlement, il est presque impossible d'aborder le sujet, tant les querelles qu'il provoque sont vives. Telle est la situation en 1845 lorsque éclate une crise majeure avec les États-Unis, celle de l'Oregon. Élu au cri de « Fifty-four Forty or Fight », le président James Knox Polk incite les Américains à se battre si la Grande-Bretagne refuse de céder le territoire compris à l'ouest des Rocheuses, au sud du 54e degré 40 minutes. Cette forte poussée de fièvre de la « destinée manifeste » des Américains, durant laquelle ils annexeront le Texas et déclareront la guerre au Mexique, incite les législateurs canadiens à voter enfin, en juin 1846, une nouvelle loi de la milice. Celle-ci tend à harmoniser et à reconduire la plupart des dispositions des lois antérieures. Dorénavant, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans seront astreints au service militaire au sein de régiments de milice sédentaire, mais ils seront divisés en deux classes, la première se composant des hommes de moins de 40 ans. En cas d'urgence, jusqu'à 30 000 miliciens pourront être appelés dans des bataillons de milice incorporée.
Cette loi innove, dans la mesure où elle reconnaît officiellement l'existence de corps de volontaires. Elle régularise ainsi une situation existante et consacre le principe du volontariat au profit de l'obligation universelle de porter les armes. Il est en effet assez judicieux de compter sur des hommes désireux de servir leur communauté en tant que citoyen soldats. Toutefois, le gouvernement canadien ne leur fournira presque aucune aide. Ils devront d'abord s'entraîner, puis s'équiper à leurs frais d'uniformes, ainsi que de chevaux, avant d'obtenir de lui des armes. Ces conditions limitent le nombre de candidats potentiels à une minorité disposant du temps et de l'argent nécessaires pour se porter volontaires.
Tentatives de faire revivre une milice de francophones
Il n'en reste pas moins qu'un effort notable est fait pour remettre sur pied la milice, spécialement celle du Canada-Est qui n'a pas organisé de revue depuis 1837. Le français s'impose comme langue officielle au même titre que l'anglais à l'Assemblée législative, et l'adjudant général adjoint de la milice pour le Canada-Est doit désormais avoir deux commis « suffisamment versés dans la connaissance du français » pour pouvoir correspondre dans cette langue avec les officiers des bataillons. À compter de septembre 1846, l'état-major de la milice commence à répartir les quelque 246 000 miliciens dans 57 régiments comptant 334 bataillons et à nommer les officiers supérieurs qui, à leur tour, proposeront les officiers de leurs bataillons.
Pour rendre les Canadiens français des villes moins hostiles à la milice, on abolit les mesures du temps de Lord Dalhousie. De nouveau, les bataillons peuvent être composés en fonction de chaque groupe linguistique, dont le nombre d'officiers doit être équitable au sein des régiments mixtes, comme l'apprend à ses dépens l'état-major du 4e bataillon de la milice du comté de Carleton, à Bytown (Ottawa). En effet, lorsque le gouverneur en chef découvre que tous les officiers de ce régiment sont des Canadiens anglais, alors que la moitié des miliciens sont de souche française, il révoque simplement tous les brevets d'officiers ! La législation de 1846 se veut donc un début de réconciliation. Elle est toutefois accueillie plutôt froidement au Canada français, ce qui ne devrait guère étonner. Exclus depuis un quart de siècle, les Canadiens français demeurent méfiants.
Objet de risée sur le terrain
Sur le terrain proprement dit, l'efficacité guerrière de la milice est-elle vraiment améliorée par ces mesures ? Le poète Louis Fréchette rapporte ainsi comment se déroulait une revue de miliciens à Lévis, après la messe, lorsqu'il était enfant. D'après lui, on procédait d'abord à l'appel nominal, puis : «après cela vint l'exercice - Oh ! L’exercice réduit à sa plus simple expression : - Face à droite!... Face à gauche!... Trois pas en avant !... Trois pas en arrière !... Ce à quoi les gamins ajoutaient : « Si vous êtes pas contents, allez faire vot' prière ! »... Ils aimaient la rime, les gamins de mon temps. Je les entends encore frapper du pied, en cadence, en criant aux miliciens « Face ! Face ! Face ! ... à la boutique à Gnace!... » La « boutique à Gnace » était la forge d'un nommé Ignace Samson, qui se trouvait juste à faire pendant à l'église, de l'autre côté de la place publique. Après quelques instants de parade et d'exercice, les miliciens rompirent les rangs, allumèrent leurs pipes et se dispersèrent, pendant qu'un gamin, plus effronté que les autres, malgré les chut ! Chut ! Chut ! Prenait la fuite en criant : « Hourrah pour Papineau! ».
La situation de la milice sédentaire n'est guère plus reluisante au Canada-Ouest. Le comté de Waterloo, par exemple, possède aussi ses farceurs. Un jour de parade, alors que l'on procède à l'appel nominal, un milicien lance un ballon de football sur le terrain... En quelques minutes, la revue se transforme en un gigantesque match ! À une autre occasion, un officier du régiment, agriculteur de son état, est en train de donner des ordres au bataillon en marche. Ne se souvenant plus du commandement « Halte ! », il lança « Who-a ! Who-a! », Comme à ses bœufs ! La ligne de miliciens s'écroule dans un éclat de rire général et la revue est annulée ! Décidément, bien des efforts devraient être déployés pour se protéger contre la menace américaine...
Équilibre changeant
Fort heureusement, au fil des ans, les tensions entre la Grande-Bretagne et les États-Unis s'estompent. La crise de l'Oregon se règle par une entente prolongeant la frontière du 49e degré jusqu'au Pacifique. En 1846, les troupes américaines déployées le long de la frontière canadienne sont presque toutes envoyées au combat contre les Mexicains.
La Grande-Bretagne continue donc à réduire sa garnison régulière en Amérique du Nord, d'autant plus qu'en Europe la situation s'aggrave sérieusement pour la première fois depuis 1815. En 1854, la guerre de Crimée révèle aux Anglais que leur armée, bien que brave et disciplinée, est dans un état pitoyable et qu'elle doit être modernisée de toute urgence.
Tous ces événements ont des retentissements au Canada-Uni. La garnison britannique déployée en Amérique du Nord passe de plus de 6 000 hommes, en 1853, à moins de 3 300 deux ans plus tard. Par ailleurs, la milice sédentaire augmente en nombre. Au cours des années 1840, l'arrivée au Canada-Uni de centaines de milliers d'immigrants venus surtout d'Irlande et d'Écosse augmente considérablement la population du Canada-Ouest. En 1851, le Canada-Uni compte 534 000 hommes de 18 à 60 ans, dont 317 000 au Canada-Ouest. Il en résulte que les Canadiens français ne sont plus majoritaires au pays.
Des politiciens canadiens hésitants
Paradoxalement, ce revirement démographique favorise l'établissement d'un gouvernement responsable. Accordé en 1849, il consacre le principe de la suprématie de l'Assemblée législative. Désormais, le gouverneur général du Canada « régnera », mais la Chambre, pour sa part, gouvernera politiquement. En ce qui concerne la défense nationale, cependant, les parlementaires canadiens se montrent d'une réserve exceptionnelle, laissant à la Grande-Bretagne le soin d'en assumer la responsabilité et les frais.
Néanmoins, en novembre 1854, le gouvernement canadien nomme une commission chargée d'enquêter sur les moyens d'améliorer la milice. Au Canada français, certains souhaitent même la création d'un corps canadien permanent « destiné à remplacer les troupes régulières que le gouvernement anglais a dû rappeler du pays », peut-on lire dans La Patrie de Montréal. Le rédacteur ajoute que « ce serait une nouvelle carrière ouverte à la jeunesse canadienne. Nous sommes certains que plusieurs de nos jeunes compatriotes préféreraient les épaulettes de capitaine, avec tous leurs dangers possibles, à la toge [d'avocat] ou à la simarre [de notaire] si recherchées maintenant ». Ainsi, refait surface, ni plus ni moins, le vieux rêve d'un régiment canadien-français, proposé dès 1763 pour remplacer les Compagnies franches de la Marine.
Les volontaires de 1885
Les conclusions de la commission, entérinées dans une loi de la milice adoptée en 1855, sont loin d'aller dans le sens de cette proposition, en s'opposant à ce que le Canada-Uni entretienne des troupes régulières. Cependant, les législateurs consentent enfin à débloquer quelque argent pour aider les volontaires, qualifiés de « milice active ». Désormais, le gouvernement se charge de fournir les armes et les munitions, de payer les journées d'exercice, et alloue une somme compensatoire pour couvrir les frais d'uniforme des 5 000 volontaires répartis dans un certain nombre de compagnies de carabiniers, de cavalerie et d'artillerie.
Ces mesures sont accueillies avec beaucoup d'enthousiasme. Toutes les compagnies prévues sont rapidement recrutées, alors que des centaines d'autres volontaires réclament du gouvernement le droit de former des compagnies supplémentaires, ce qui leur est accordé en 1856. Désignées comme la classe « B », on leur fournit les armes et on paie des frais compensatoires pour l'uniforme, mais, par souci d'économie, on ne rémunère pas les journées d'exercice.
Il n'en reste pas moins que dès 1857, un nombre sans précédent de volontaires, soit quelque 5 300 hommes, sont enrôlés, armés, habillés et entraînés. Le nouveau système exigeait que ces compagnies soient toutes enregistrées au bureau de l'adjudant général de la milice pour pouvoir jouir des avantages consentis par les lois de 1855 et 1856. Cette obligation entraîna des situations « injustes » au niveau de la préséance et de l'ancienneté. Par exemple, une compagnie de carabiniers, formée en 1854 à Montréal, s'enregistrait la première et devenait, par le fait même, la compagnie de milice volontaire possédant le plus... d'ancienneté, alors qu'il existait depuis 1812 dans la même ville une compagnie de cavalerie volontaire ! De nos jours encore, des retombées inattendues de cette loi mettent parfois dans l'embarras les fonctionnaires du ministère de la Défense et les commandants d'unités.
Indépendamment de leur ancienneté, on arme convenablement toutes ces compagnies. Les carabiniers reçoivent le fusil rayé Enfield, modèle 1853, récemment adopté par l'armée régulière. Les cavaliers obtiennent, avec leurs sabres, le tout nouveau revolver Colt à six coups. Les pièces d'artillerie sont également les derniers modèles en usage dans l'armée régulière.
Dans les maritimes. Une institution plus efficace
Les provinces maritimes étant, à cette époque, des colonies distinctes, la milice de chacune d'elles est régie par ses propres lois et règlements. Mais ces lois se ressemblent dans leurs grandes lignes. Elles prévoient l'obligation pour les hommes, âgés de 18 à 60 ans, de s'inscrire au régiment de milice de leur comté et de participer aux revues. En outre, elles permettent aux autorités en place de mobiliser des hommes pour le service actif et aux citoyens zélés de former des compagnies de volontaires en uniforme.
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le développement des milices dans les provinces maritimes suit globalement la même voie que dans le centre du Canada. Cependant, les revues des régiments de milice sédentaire semblent y avoir été exécutées plus sérieusement qu'au Canada central, les témoignages étant habituellement élogieux quant aux efforts déployés par ces miliciens. Dans les villes, particulièrement, les régiments de milice de comtés comptent en général une ou plusieurs compagnies d'élite, qui se pourvoient d'uniformes à leurs frais. Tout comme au centre du Canada, les volontaires prennent de l'importance durant les années 1840 et 1850. Le « Volunteer Movement »,qui se développe en Grande-Bretagne en 1858, exerce une influence particulièrement marquée dans les Maritimes, dont la population est très anglophile, si bien qu'à partir de l'année suivante, on y adopte des lois pour promouvoir la formation de corps de volontaires. Ces mesures connaissent un grand succès et, dès le début des années 1860, environ 4 000 à 5 000 volontaires bien armés, aux uniformes des plus variés, s'entraînent aux manœuvres militaires dans cette région.
Le Nouveau-Brunswick compte environ 14 000 miliciens sédentaires en 1825 et 27 000 en 1844. Les rébellions de 1837-1838, la « guerre d'Aroostook » et la crise de l'Oregon aiguillonnent la milice qui, à partir de cette époque, encourage la formation de corps volontaires dans le sud de la colonie en fournissant des armes et des uniformes en échange d'une somme forfaitaire. Par la suite, on assiste à un certain laisser-aller jusqu'en 1859, année où sont adoptées des mesures semblables à celles qui ont cours en Nouvelle-Écosse pour encourager la formation de compagnies de volontaires. Celles-ci connaissent un succès immédiat et, dès le milieu de l'année suivante, 1 237 volontaires répartis en 23 compagnies, dont deux de cavalerie et sept d'artillerie, font l'exercice deux fois par semaine.
La milice sédentaire de l'Île-du-Prince-Édouard regroupe tous les hommes âgés de 16 à 60 ans habitant dans les trois comtés de la petite colonie. Cette milice se compose principalement de compagnies d'infanterie, mais on trouve également quelques compagnies d'artillerie et de cavalerie à Charlottetown. En 1829, la milice totalise 5 400 hommes. La plupart n'ont pas d'armes, situation qui ne change guère durant les trente années suivantes. En 1859, la création de compagnies de volontaires est fortement stimulée par l'envoi de 1 000 fusils rayés Enfield dans la colonie. Dès l'année suivante, l'île compte 800 volontaires bien armés et habillés d'uniformes très variés.
Terre-Neuve
À Terre-Neuve, colonie maritime par excellence, la population est tellement dispersée et accaparée par les besoins de la pêche en haute mer qu'aucune milice sédentaire organisée ne verra le jour. Des corps de volontaires sont levés de temps à autre, tels les St. John's Volunteer Rangers de 1805 à 1814. À compter de 1824, même les troupes régulières ne comptent plus que des vétérans, répartis dans les trois Royal Newfoundland Companies, pour accomplir un service de surveillance sédentaire. Le « Volunteer Movement » de Grande-Bretagne conduit, en 1860, à la création de quatre compagnies de volontaires à St. John's, habillées de rouge, et d'une compagnie de carabiniers à Harbour Grace, vêtue de bleu. Mais ces unités sont très éphémères, car la véritable protection de Terre-Neuve n'a pas lieu sur terre, mais bien sur mer, grâce aux navires de guerre de la Royal Navy surveillant l'île et ses pêcheries. En fait, la Royal Navy défend non seulement Terre-Neuve mais toutes les côtes de l'Amérique britannique du Nord, sur trois océans.