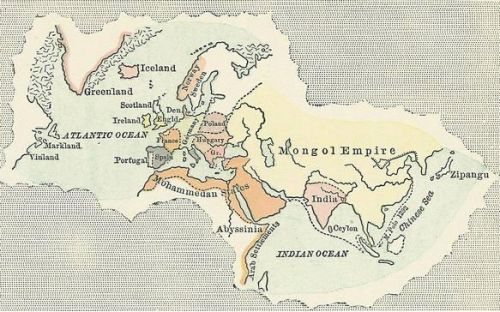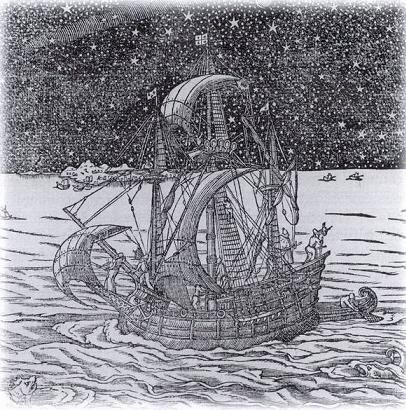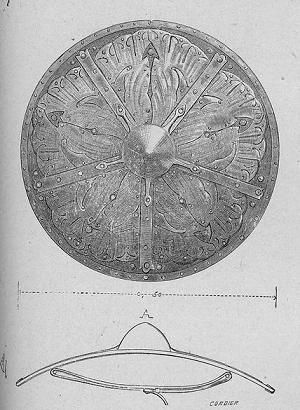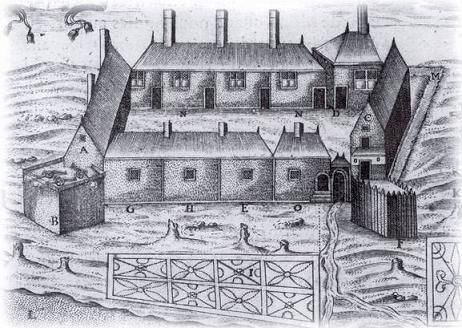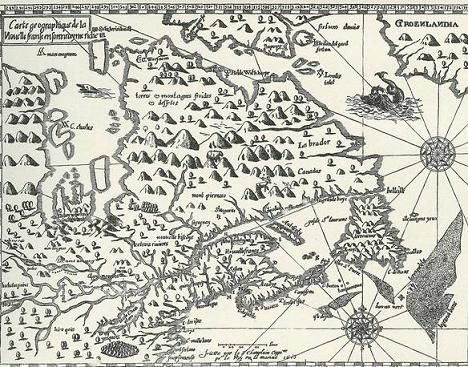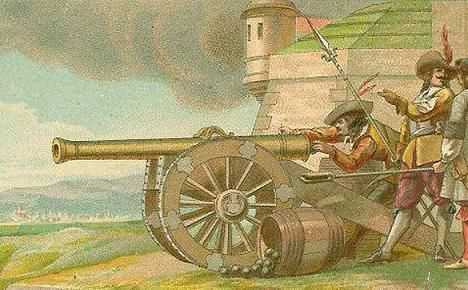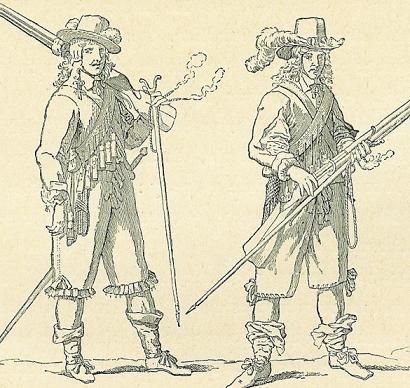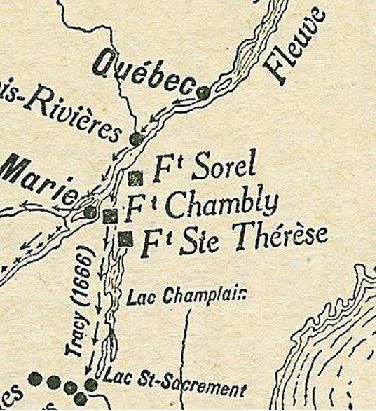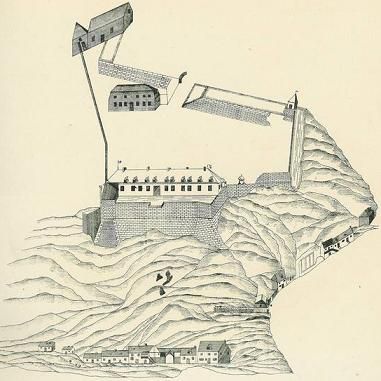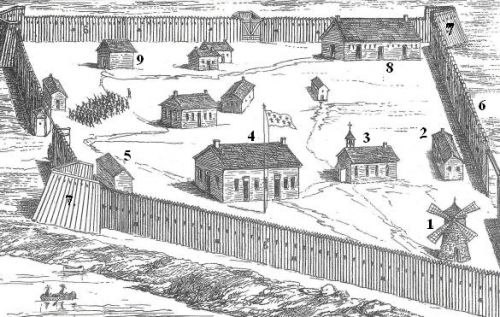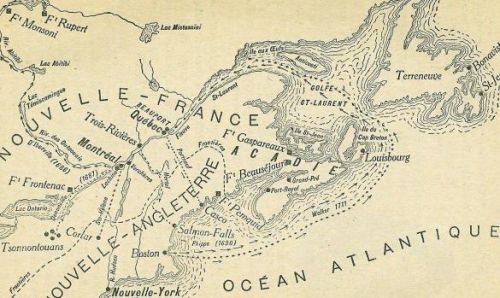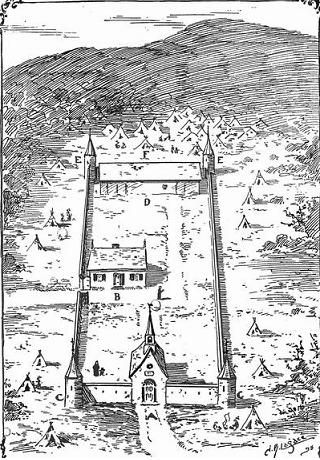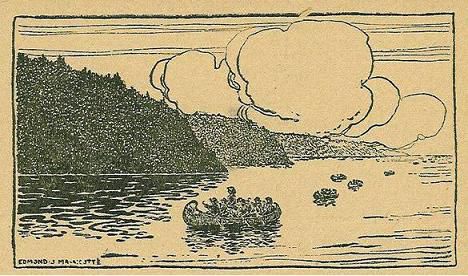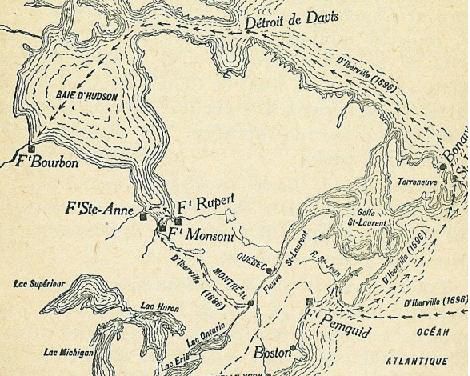1000-1754
Les défis de la nature1000-1754
Les défis de la nature Paysages canadiens
L'espace canadien est immense. Il s'étend de l'Atlantique au Pacifique, se divise en plusieurs zones horaires de l'est à l'ouest et son climat, tempéré au sud, est arctique au nord. Au total, ce vaste territoire pourrait facilement englober l'Europe occidentale. Il a fallu des siècles d'explorations - celles-ci souvent menées par des militaires - pour en établir la géographie précise, depuis les premières cartographies esquissées par les découvreurs du XVIe siècle jusqu'aux grands relevés aériens exécutés par l'Aviation royale canadienne.
L'environnement y est resté pratiquement inchangé depuis quelque 3 500 ans. De l'Atlantique jusqu'à l'extrémité ouest des Grands Lacs, une vaste forêt couvre le sud du pays. Viennent ensuite des centaines de kilomètres de prairies, qui ne prennent fin qu'aux montagnes Rocheuses. Le versant du Pacifique est le plus tempéré avec sa dense forêt bordant la côte jusqu'à l'Alaska. Au nord du Saint-Laurent, des Grands Lacs et des Prairies, la végétation devient peu à peu boréale, puis se transforme en toundra à mesure que l'on approche de l'océan Arctique.
La zone habitable se limite, du moins en ce qui concerne l'agriculture, à la partie la plus méridionale du pays. Les établissements se feront donc surtout au sud, puisque la taïga et la toundra subarctiques ne permettent pas de faire subsister une population nombreuse. Au Moyen Âge, le climat du Canada était plus tempéré. Il l'est resté jusqu'au XIVe siècle, alors que débutait le petit âge glaciaire, dont l'apogée se situe entre la fin du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ce phénomène de refroidissement ne s'est d'ailleurs pas produit uniquement au Canada, il a affecté tout l'hémisphère nord de la planète. Les cultures furent bouleversées et les populations, y compris les militaires, durent transformer leurs façons de se nourrir, de se vêtir et de se déplacer pour tenir compte de nouveaux facteurs, telle la neige, qui constitue, notamment dans le domaine des transports, un obstacle de taille. Dans la vallée du Saint-Laurent, où les températures annuelles varient énormément, pouvant descendre à - 40° C en hiver pour remonter à 35° C en été, les Européens empruntèrent aux Amérindiens une foule de moyens de survie pour pouvoir affronter un environnement présentant des écarts de température aussi extrêmes. Ce facteur influença également leurs méthodes de combat.
Les voies navigables
Une autre particularité de l'immense territoire canadien est d'être arrosé par de nombreux cours d'eau. Aussi le contrôle des rivières et des fleuves, qui, jusqu'au milieu du XIXe siècle, étaient les seules véritables grandes voies de communication, revêtira-t-il pour les Européens, dès le début, une importance stratégique de premier ordre. Tant qu'il n'y eut pas de routes terrestres, naviguer représenta, pour les explorateurs, l'unique façon de pénétrer à l'intérieur des terres. Afin d'atteindre le cœur du continent, ils adoptèrent, rapidement, le canot d'écorce des Amérindiens, embarcation légère et maniable. Pendant très longtemps, la navigation estivale resta le seul moyen de transporter des tonnes de matériel et des centaines d'hommes sur de grandes distances. Lorsque, vers 1730, sera construite la première route reliant Montréal et Québec, le chemin du Roy, elle sera surtout utilisée pour les déplacements légers. Le transport des marchandises et des troupes continuera de se faire par les cours d'eau jusqu'à ce que le chemin de fer soit suffisamment développé pour prendre la relève, ce qui se produira durant la seconde moitié du XIXe siècle.
Un monde déjà habité. Cultures nomades
Perishka-Ruhpa, guerrier Moennitari (ou Hidatsa) costumé pour la danse du Chien
Bodmer et le prince Maximilien de Wied (principauté allemande) rencontrent Perishka-Ruhpa, un chef Moennitari (ou Hidatsa), pendant un séjour à Fort Clark à l'hiver 1834. Bodmer esquisse à l'aquarelle Pehrishka-Rupa dans son costume de la danse du Chien, pour ensuite préparer l'image à la gravure et faire prendre à son sujet une position de danse.
En effet, quand les Européens « découvrirent » l'Amérique, ils ne mirent pas le pied dans un monde désert, mais sur un continent où se trouvaient déjà, depuis quelque 12 000 ans, les descendants de nomades venus d'Asie. Dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord, les vastes plaines de l'ouest, les régions essentiellement boisées du centre et de l'est, la côte rocheuse du Labrador, depuis l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'aux zones arctiques, tout cela, qui deviendrait un jour le Canada, était habité par divers peuples qui constituaient presque autant de groupes culturels. Dans la zone arctique, les Inuit étaient arrivés depuis à peu près l'an 1000 de notre ère. La partie du Québec située au nord du Saint-Laurent, le centre et le nord de l'Ontario, ainsi que de grandes régions du Manitoba et de la Saskatchewan, étaient occupés par le groupe algonquien (Cris, Ojibwas, Algonquins, Montagnais). L'île de Terre-Neuve était le territoire des Béothuks. La péninsule de Gaspé, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard formaient le domaine des Micmacs, des Malécites et des Abénaquis. Celui des Amérindiens des Plaines commençait à l'ouest du lac Winnipeg, au Manitoba, où se trouvaient d'abord les Ojibwas et les Cris des plaines, puis, un peu plus loin, jusqu'aux montagnes Rocheuses, les Assiniboines, les Gros Ventres, les Pieds noirs et les Sarsis.
Un village de tentes d'Indiens Assiniboins dans les années 1830
Les Amérindiens des grandes plaines, des nomades, habite ces tentes coniques faciles à transporter. Elles sont faites de longues perches et de peaux d'animaux
Premières nations déjà établies
Village typique d'Amérindiens du Nord-Est.
Presque tous ces villages sont constitués de longues maisons à toit d'écorce défendues par une palissade en rondins. Gravure inspirée des rendus réalisés par John White à la fin du XVIe siècle.
Tous ces peuples, essentiellement nomades, vivaient de chasse et de pêche, tandis que, dans la vallée du Saint-Laurent, au sud du Québec et de l'Ontario, et à l'ouest de ce qui est maintenant l'État de New York, se trouvaient les Iroquois (Hurons, Iroquois, Neutres, Pétuns ), qui, dépendant déjà largement de l'agriculture, étaient sédentarisés et habitaient dans des villages.
Parmi les peuplades du nord-est, celles qui appartenaient au groupe iroquois apparurent comme les plus militarisées. Elles étaient aussi les seules à avoir formé des associations : la Confédération huronne, fondée vers 1440, et la Ligue des Cinq Nations iroquoises, qui remonte aux alentours de 1560. Cette dernière joua un rôle prépondérant dans l'histoire de la colonie française. Elle regroupait les Agniers, que les Anglais appelèrent Mohawks, les Goyogouins (Cayugas), les Onontagués (Onondagas), les Onnéiouts (Oneidas) et les Tsonnontouans (Senecas).
Les Iroquois et les Hurons vivaient dans des villages fortifiés, entourés de palissades. Ces ouvrages défensifs étaient des constructions fort développées. Ainsi, la bourgade de Hochelaga, qui occupe le site sur lequel s'élève aujourd'hui la ville de Montréal, est « toute ronde et close de bois à trois rangs, en façon d'une pyramide croisée par le haut », d'environ neuf mètres de hauteur. Le sommet de la palissade est parcouru « de manières de galeries et échelles à y monter, lesquelles sont garnies de roches et de cailloux ». Il n'y a qu'une seule porte, qui « ferme à barre ». De même, un village iroquois est habituellement solidement fortifié de « quatre bonnes palissades de grosses pièces de bois, entrelacées les unes parmi les autres... de la hauteur de trente pieds, et les galeries, comme en manière de parapets ». Il s'agit bien, dans les deux cas, du type de fortifications commun aux villages hurons et iroquois. Les fouilles archéologiques confirment qu'un rang de pieux doublait parfois, à l'extérieur, la palissade principale et qu'à l'intérieur l'enceinte était toujours tracée selon un plan ovale ou rond. Ces constructions, d'une façon générale, ne sont pas sans rappeler les forts de bois érigés dans le nord de l'Europe occidentale durant le haut Moyen Âge.
Les bourgades de moindre importance et les postes isolés étaient aussi fortifiés, mais plus modestement. Un fortin en bois que les Iroquois avaient construit « est fait de puissants arbres, arrangez les uns sur les autres en rond » 3, de sorte que la palissade qui l'entoure est relativement basse. La description de l'attaque de cette petite place forte par les Hurons révèle quelques-uns des moyens qu'utilisaient les Amérindiens pour assiéger un camp ennemi. Les Hurons s'approchèrent d'abord des murs qu'ils voulaient saper en se cachant derrière de grandes parois mobiles en bois. Ils abattirent les arbres les plus grands, à proximité de la palissade, de manière au faire tomber sur celle-ci. Toujours abrités derrière leurs parois mobiles, ils tentèrent ensuite d'attacher des cordes aux piliers de soutien et de renverser ceux-ci à la force des bras.
Les Iroquois ne furent pas les seuls à ériger des fortifications aussi imposantes en Amérique du Nord. Dans la vallée du Mississippi, foyer de multiples civilisations précolombiennes, des peuples, disparus avant l'arrivée des Blancs, bâtirent de nombreux forts. Vers l'an 1200 de notre ère, la grande cité de Cahokia, qui se trouvait près de la ville actuelle de Collinsville, en Illinois, était ceinte d'une palissade de quatre à cinq mètres de hauteur, ponctuée de nombreuses tours de garde et entourée d'un fossé. Ces fortifications assuraient la protection d'une population de quelque 20 000 habitants. De récentes fouilles archéologiques, menées au fort de Kitwanga, en amont de la rivière Skeena, en Colombie-Britannique, confirment que les nations amérindiennes de la côte du Pacifique construisaient également des fortifications imposantes. L'idée même de fortifier ne se limitait pas aux peuples sédentaires. Les Amérindiens nomades du nord des grandes plaines, par exemple, érigeaient occasionnellement des huttes en bois entourées de petites palissades en guise de fortification temporaire.
Les rites amérindiens. Guerre chez le peuple Autochtone
La guerre jouait un rôle primordial dans la vie de tous les peuples de l'Amérique du Nord précolombienne. Se distinguer au combat représentait pour le jeune homme la manière par excellence de gagner l'estime et le respect des autres guerriers et d'attirer l'attention des femmes. Par ailleurs, le dogmatique « crois ou meurs » des guerres de religion européennes était inconnu dans les sociétés amérindiennes du Canada. Il en allait de même de l'adhésion à un parti de guerre. Le guerrier n'était pas soumis à une discipline rigide. Il pouvait décider à son gré de se battre ou non, ou cesser à n'importe quel moment de guerroyer, s'il le jugeait ainsi. La raison en était que, pour l'Amérindien, le sens de la vie réside en grande partie dans la liberté individuelle, liberté des croyances, liberté des êtres.
Néanmoins, c'était surtout la vengeance d'actes commis par d'autres tribus qui constituait le motif de guerre par excellence. Un conflit iroquois traditionnel avait généralement pour origine la réparation exigée par la famille d'un guerrier tué. Le conflit pouvait couver pendant un certain temps, puis dégénérer en une série de raids, ou d'attaques et de contre-attaques qui étaient autant de revanches, dont la dernière se justifiait toujours par la précédente. Ainsi se perpétuait un climat de violence et d'hostilité à peu près permanent entre les diverses nations. La décision de mener une expédition guerrière pouvait également être la conséquence d'un songe qu'avait fait un chef ou un prêtre de guerre, appelé à tort sorcier par les Blancs.
La plupart des mâles devenaient guerriers dans les sociétés amérindiennes de l'Amérique du Nord. Très tôt, le jeune garçon s'entraînait à maîtriser les armes de trait, arc, javelot et fronde, s'exerçait à lutter corps à corps, apprenait à se déplacer furtivement, à se camoufler et à 7 l'ennemi par des cris. En cas d'hostilités, des bandes plus ou moins importantes se formaient, puis se divisaient en escouades de cinq ou six hommes. Les guerriers reconnus comme les plus braves étaient élus chefs de guerre et constituaient une sorte d'état-major. C'était eux qui, réunis en conseil, débattaient et traçaient le plan de campagne. Avant le combat, ils établissaient une stratégie sommaire prévoyant une certaine disposition des guerriers sur le terrain et la tactique à suivre.
Partie de guerre
Toute expédition guerrière faisait l'objet de préparatifs méticuleux. D'abord, il fallait réunir tous les hommes entre 15 et 35 ans pour former le parti de guerre. On accordait la préférence aux guerriers expérimentés qui voulaient s'y joindre. Cependant, il fallait composer avec les jeunes guerriers, pressés de se distinguer, qui se présentaient sans invitation. On les acceptait aussi, mais à la condition qu'ils se soumettent à l'autorité du chef. À l'approche du territoire ennemi, il devenait parfois difficile de contenir ces adolescents dont l'impétuosité pouvait compromettre l'attaque surprise. Ensuite, il fallait rassembler tout le matériel nécessaire pour la durée de l'expédition, dont une partie était camouflée en cours de route, en prévision du retour. On apportait des vivres, de la colle pour réparer les canots et les armes, des mocassins de rechange, de la peinture sèche, des armes, des boucliers et des armures de bois.
Lorsqu'ils arrivaient à proximité du territoire de l'ennemi, les guerriers laissaient leurs canots et continuaient à pied à travers bois. Ils marchaient toujours à la suite les uns des autres, « en file indienne », le chef ouvrant le défilé, suivi des guerriers d'expérience, puis des jeunes. Entre l'aube et le crépuscule, ils pouvaient parcourir ainsi jusqu'à 40 kilomètres, selon les difficultés qu'ils rencontraient. À l'approche du camp ennemi, ils se préparaient pour le combat en s'enduisant le corps de peinture, pour se donner une apparence hideuse, revêtaient leurs armures et prenaient leurs armes. Ils invoquaient ensuite les Esprits pour les rendre favorables à leur combat, puis se dirigeaient vers leurs victimes éventuelles sans laisser de trace et sans faire le moindre bruit.
Même quand ils attaquaient en bandes, les Amérindiens privilégiaient le combat de type individuel. Au cours de la mêlée, les chefs se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer un contrôle rigoureux sur les combattants, de sorte qu'ils leur donnaient très peu de directives. Quand une bataille mettait aux prises deux groupes assez nombreux d'autochtones, ils s'affrontaient d'abord avec des armes de trait, puis en venaient au corps à corps en terrain relativement dégagé. Telles furent aussi les premières batailles entre Amérindiens et Européens. Mais les engagements pouvaient prendre également une toute autre forme, telle l'attaque surprise perpétrée par une escouade en maraude contre des guerriers ennemis isolés ou même contre des gens sans défense. Dès leurs premiers échanges militaires avec les Européens, les Amérindiens comprirent la futilité de se battre en rangs serrés contre des opposants mieux armés qu'eux, rompus à cette discipline sur les champs de bataille européens. Grâce à leur intelligence de la guerre, ils saisirent que leur principal avantage résidait dans leur plus grande mobilité. Ils se concentrèrent dès lors sur les attaques surprise et misèrent sur la tactique du harcèlement, que les Français du XVIIIe siècle nommèrent « la petite guerre » - terme dans lequel on perçoit toute leur lassitude - et qui n'est rien d'autre que la guérilla moderne, cette méthode de combat qui tient en échec les armées les mieux équipées au monde.
Armes et armures des Amérindiens
L'équipement offensif du guerrier autochtone se composait essentiellement d'un arc et de flèches ainsi que d'un gourdin. Celui-ci était soit un casse-tête, pièce de bois sculptée d'un seul tenant, dont la tête, un peu courbée, comportait une boule, soit une hache de guerre faite d'une pierre solidement fixée au bout d'un manche de bois. On se servait aussi de frondes et, plus rarement, de lances. Le guerrier amérindien possédait également un attirail défensif, c'est-à-dire une armure, qui lui protégeait le devant et l'arrière du corps, de même que les jambes. Elle était faite « de baguettes blanches, serrées l'une contre l'autre, tissées et entrelacées de cordelettes fort durement ». La mobilité constituant l'atout majeur à la guerre, l'armure, à l'instar des canots d'écorce, se devait d'être légère. Son usage était manifestement très répandu chez les Amérindiens partout en Amérique. Un bouclier plus ou moins imposant, désigné souvent sous le terme de « rondache » , sans doute par affinité avec un petit bouclier rond, de ce nom, en usage en Europe au XVIe siècle, la complétait.
Toutes ces pièces d'armement étaient surtout utiles pour les batailles en terrain découvert, mais elles servaient probablement aussi pendant les embuscades. Les armures ainsi fabriquées étaient à l'épreuve des pointes de flèche en pierre, « mais non toutefois de [nos pointes en] fer », et certainement pas des balles. L'usage croissant des armes à feu européennes entraînera leur disparition. Cependant, les boucliers resteront en usage, durant le XVIIe siècle, parmi plusieurs nations amérindiennes, notamment les Hurons, les Iroquois, les Montagnais et les Algonquins. Armures et boucliers pouvaient comporter des armoiries peintes. Chez les Hurons, celles-ci indiquaient le village du porteur. Par exemple, celles du village de Quieunonascaran représentaient un canot.
Un acte rituel de rétribution. Torture
Torture dans un tribunal de l'Inquisition, au XVIe siècle.
Les Européens connaissent bien la pratique de la torture. Elle est couramment employée par les autorités judiciaires pour obtenir des aveux de suspects. Les tribunaux de Nouvelle-France recourent parfois à ces pratiques. En Europe, les exécutions publiques de condamnés peuvent donner lieu à d'horribles spectacles de torture. Les tribunaux de l'Inquisition l'appliquent sans merci à de présumés hérétiques au nom du christianisme, comme le montre cette gravure.
Si, chez plusieurs peuples amérindiens, il suffisait de « toucher » un ennemi sans le tuer pour prouver sa bravoure, l'un des principaux objectifs de la guerre consistait à capturer et à ramener vivants quelques guerriers de l'autre camp. Le captif savait ce qui l'attendait et c'était avec stoïcisme qu'il subissait des tourments qui pouvaient se prolonger durant plusieurs jours. La torture était considérée, dans la plupart des sociétés amérindiennes, comme un acte rituel de rétribution et, comme telle, demeura absolument hors de la compréhension d'un Français ou d'un Anglais du XVIIe siècle.
Le sort que les Amérindiens réservaient à leurs prisonniers a été le sujet d'innombrables récits depuis 500 ans, récits d'une lecture insoutenable, la plupart du temps, tant est grande la cruauté qui s'y manifeste. Les Iroquois et les Sioux n'allaient-ils pas jusqu'à crucifier des enfants captifs ? Encore faut-il faire des distinctions. Chez les Iroquois, où la torture rituelle était la plus répandue, nombre de prisonniers ne terminaient pas leurs jours au poteau de supplice, mais était tout bonnement adoptés par les familles de leurs ennemis et jouissaient des mêmes privilèges que les membres de ces dernières. Quant aux Abénaquis, ils préféraient garder leurs prisonniers comme esclaves plutôt que de les faire périr à petit feu.
Cannibalisme et scalpage
Guerrier amérindien brandissant un scalp
Cette gravure montre une vision européenne classique de la pratique du scalp. Cette pratique, répandue chez les Amérindiens des forêts et des plaines, remonte au début du XVIe siècle au moins. Les scalps sont considérés comme des trophées de guerre et font partie d'un rite de châtiment des ennemis.
Il est une autre pratique amérindienne sur laquelle les Européens jetèrent l'anathème : le cannibalisme. Les Amérindiens consommaient parfois le cœur ou d'autres parties du corps d'un ennemi qu'ils avaient jugé particulièrement brave face à la souffrance et à la mort, au lieu de simplement le jeter aux ordures, afin de s'approprier son courage et parce qu'ils le croyaient digne d'être perpétué de cette manière. Si cette macabre coutume pouvait avoir un sens dans certains cas, il y eut d'autres occasions où la déraison l'emporta. Tel cet infortuné prisonnier qu'ils éventrèrent sans rituel afin de pouvoir s'abreuver de son sang et manger son cœur « encore chaud ».
La coutume de lever des scalps, c'est-à-dire d'arracher la chevelure d'un ennemi en découpant le cuir chevelu, semble très ancienne. Dès 1535, un explorateur remarqua « les peaux de cinq têtes d'hommes » à Hochelaga. Cette pratique était fort répandue, aussi bien chez les Amérindiens des forêts que chez ceux des plaines. Le scalp était de toute évidence un trophée de guerre. S'il était prélevé sur un blessé, la victime avait peu de chances de survie. On préférait couper la tête du vaincu et l'emporter; mais si l'on était trop encombré, on enlevait simplement la chevelure. Telle aurait été l'origine de cette horrifiante coutume.
Horrifiante aux yeux des Européens, qui la condamnaient à grands cris. Il se pratiquait pourtant à ce sujet une morale bien douteuse durant les guerres coloniales. En effet, à partir de la fin du XVIIe siècle, les autorités de la Nouvelle-Angleterre offrirent des primes importantes pour les scalps de leurs ennemis. Les Français, dont les chevelures se trouvaient ainsi mises à prix, rétorquèrent en faisant de même pour celles des Britanniques, bien que la valeur de leurs primes n'ait été qu'un dixième de celles payées par les Anglais. En fait, ils préféraient consacrer leur argent à racheter aux Amérindiens les Blancs qu'ils gardaient en captivité. Enfin, il arriva que des combattants blancs des deux côtés s'adonnèrent eux-mêmes à lever des scalps. En réalité, sous leurs protestations officielles, les autorités coloniales perpétuaient donc cette pratique dont ils faisaient porter l'odieux aux Amérindiens.
Massacre de la Saint-Barthélémy, 24 août 1569
Le massacre du 24 août et les journées sanglantes qui suivent montrent au monde entier les horreurs que des Chrétiens « civilisés » peuvent commettre dans la ville de Paris, l'un des centres de la civilisation occidentale. Ces horribles scènes de torture et de carnage se répètent partout en Angleterre, en Allemagne, en France et dans d'autres pays durant les guerres de religion d'Europe.
L’habillement et les parures
Guerriers amérindiens du Canada central, au XVIe siècle
Trois types de costumes communs à toutes les tribus amérindiennes sont montrés ici. Reconstitution de David Rickman.
L'habillement de la plupart des Amérindiens des forêts de l'Est, à l'époque de leurs rencontres initiales avec les Européens, était relativement simple. L'été, ils allaient torse nu, mais portaient le brayet, sorte de pagne ou de bande-culotte qui passait entre les jambes, retenu à la taille par une ceinture. Ils se chaussaient de mocassins en cuir souple et, à l'occasion, enfilaient des mitasses, longues jambières attachées aussi à la ceinture. L'hiver, ils se couvraient d'un vêtement de fourrure à longues manches. Toutes les pièces de leur habillement étaient taillées dans des peaux que leurs femmes tannaient, apprêtaient et cousaient.
Les Hurons portaient sur la tête, « principalement quand ils allaient à la guerre », des panaches « faits de poils d'élan, peints en rouge et collés à une bande de cuir large de trois doigts ». Les Iroquois, eux, arboraient dans les mêmes circonstances un genre de casque consistant en un bandeau de bois mince, pourvu d'un arceau passant par le milieu de la tête, muni de petites douilles destinées à recevoir des plumes dont la longueur distinguait les chefs des simples guerriers. D'autres s'arrachaient « tous les cheveux de la tête, à l'exception d'une petite touffe » qu'ils laissaient croître et qu'ils ornaient de plumes colorées. Pour se donner un aspect terrifiant, Hurons et Iroquois s'appliquaient diverses couleurs sur la figure. Il arrivait aussi qu'ils aient sur le corps des tatouages multicolores, souvent pour des raisons religieuses et traditionnelles, mais aussi afin de faire peur à ceux qui n'y étaient pas habitués.
Les Skraelings
Navires vikings, vers 1000
Grâce à leurs lignes pures, ces navires sont, à leur époque, les plus rapides et les plus aptes à naviguer en mer.
D'après les premiers explorateurs européens, les divers peuples disséminés en Amérique avaient tous une tradition guerrière. Les plus anciens récits connus, les Sagas islandaises, traitent des rapports qui s'établirent entre les Vikings et les autochtones - rapports de force surtout -, au cours d'événements survenus vers l'an 1000 de notre ère. Longtemps considérés comme des légendes, les récits qui forment la trame de la Saga des Groenlandais et de la Saga d'Éric le Rouge ont été confirmés depuis quelques décennies par d'importantes découvertes archéologiques, notamment la localisation d'un établissement viking à l'Anse-aux-Meadows, à l'extrémité de la péninsule nord de l'île de Terre-Neuve. Il semble bien qu'il s'agisse là du « Vinland » des Sagas.
À quel groupe ethnique appartenaient donc ces guerriers assez audacieux pour s'attaquer aux colonies vikings ? Certaines indications laissent croire qu'il s'agissait d'Inuit, d'autres, d'Amérindiens. Les Scandinaves les désignaient par le mot Skraelings, terme qui englobe tout indigène, sans distinction. La Saga d'Éric le Rouge les décrit comme étant des hommes de petite taille, vêtus de peau, au teint foncé, aux cheveux raides, dotés de grands yeux et de pommettes saillantes. Ces autochtones qui occupaient le Vinland - Terre-Neuve et une partie de l'est du Québec - vers l'an 1000 seraient-ils les ancêtres des Béothuks et des Algonquiens de la période historique ?
Maison en terre et en bois reconstruite à l'Anse aux Meadows, Terre-Neuve
Cette maison en terre et en bois a été reconstruite dans le style de celles que les Vikings ont construites à l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve, vers l'an 1 000.
Selon la Saga des Groenlandais, une attaque des Vikings contre neuf autochtones, qu'ils auraient trouvés couchés sous leurs trois embarcations de peau, aurait marqué le premier échange entre les deux peuples. Un seul des Skraelings aurait échappé au massacre et serait parvenu à fuir. D'une façon générale, les Vikings ne faisaient pas de prisonniers à moins d'avoir quelque profit en vue. Une de leurs coutumes les plus redoutables était le strandhogg, raid qu'ils effectuaient sur un village côtier afin de se saisir de bétail et de vivres. Ils enlevaient par la même occasion les jeunes filles et les enfants robustes afin de les vendre comme esclaves. Les autres habitants, s'ils n'avaient pas réussi à fuir, étaient souvent massacrés sur place. L'attaque dont auraient été victimes les neuf Skraelings était possiblement un strandhogg. Quelque temps après cet événement, d'autres indigènes, venus « dans un grand nombre de bateaux en peau », attaque le navire des Vikings. Ils sont armés d'arcs et savent s'en servir habilement, car ils tuent d'une flèche Thorvald, le chef de leurs ennemis. Malgré cet affrontement, les Vikings restent encore deux ans au Vinland avant de retourner au Groenland.
Vue d'un établissement viking en Amérique
Cette vue a été élaborée durant les années 1930 par l'artiste-historien Fergus Kyle. Bien que l'on sache aujourd'hui que les casques vikings étaient dépourvus de cornes, contrairement à ce que l'on voit ici et dans d'innombrables représentations populaires, cette illustration donne pourtant une idée assez réaliste de ce à quoi cet endroit aurait ressemblé. Les Vikings pouvaient aussi bien construire des maisons en bois que des maisons en terre.
Puis, quelques années passent et une nouvelle colonie viking, composée de 60 hommes et de cinq femmes, s'installe au Vinland, avec du bétail, sous la direction d'un chef nommé Karlsefni. Peu de temps après leur arrivée, des Skraelings sortent du bois. Ils demandent à échanger leurs fourrures contre des armes, ce que Karlsefni défend formellement aux siens d'accepter. On troquera donc les pelleteries contre du tissu rouge que les autochtones s'enrouleront autour de la tête en guise de coiffure. Ces relations amicales tournent au vinaigre quand un indigène est tué pour avoir tenté de voler des armes. Un combat s'ensuit. D'après la Saga d'Éric le Rouge, les Skraelings sont armés, cette fois, d'arcs et de flèches ainsi que de frondes, et les projectiles « pleuvent comme de la grêle » sur les Vikings. Les autochtones font usage, en outre, d'un curieux objet sphérique, d'un bleu-noir prononcé, qu'ils lancent à l'aide d'une perche dans le camp ennemi. Pendant sa retombée, l'objet tournoie en émettant un son hideux. Frappés de terreur, les Vikings, qui se croient encerclés, n'ont qu'une seule pensée, s'enfuir. Voyant la débandade des siens, l'épouse de Karlsefni, Freydis, se saisit de l'épée d'un Viking, tué d'une pierre plate dans le crâne, et fait face aux autochtones. Son courage rallie les siens et la situation est finalement renversée. Néanmoins, à la suite de ce combat, les colons jugent la situation intenable et peu de temps après abandonnent leur village.
La baie à l'Anse aux Meadows, Terre-Neuve
Vers l'an 1 000, l'Anse aux Meadows accueillait un établissement Viking. Cet endroit est aujourd'hui site du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Façon de faire la guerre des Skraelings
Si brefs soient-ils, ces récits des Sagas corroborent plusieurs renseignements sur l'art militaire des Skraelings. De toute évidence, ils semblent assez bien organisés, militairement parlant, puisqu'ils peuvent réunir un grand nombre de guerriers en peu de temps. Ils sont courageux, puisque prêts à s'attaquer à des inconnus rassemblés sur des navires ou groupés à l'intérieur d'une colonie. La bravoure à la guerre est même l'une des valeurs qui comptent le plus pour eux, peut-on penser. Puis, ils font preuve d'une grande mobilité, qu'ils doivent certainement, en bonne partie, à la légèreté de leurs embarcations. Ils sont capables également d'une retraite rapide, ce qui n'est pas nécessairement la déroute à laquelle conclut les Vikings. Comme les Européens l'apprendront au fil des combats qui les opposeront pendant des siècles aux autochtones, une attaque éclair suivie d'un repli tout aussi brusque est typique de leur manière de guerroyer. Enfin, ils manient leurs armes de façon redoutable et connaissent même la psychologie du combat, pour inventer et utiliser des objets destinés à effrayer l'ennemi, comme ces boules bleu-noir lancées avec le résultat escompté contre les Vikings. De plus, ceux-ci ne semblent pas avoir découvert les bases ou les villages des Skraelings, alors que les autochtones ont repéré les établissements européens assez rapidement, ce qui dénote, chez eux, l'existence d'un système de surveillance efficace.
L'expansion des Vikings vers l'ouest
Le monde tel qu'il était connu par les savants européens vers 1350, transposé sur une carte moderne
Au Moyen Âge, les connaissances géographiques, qui remontent pour l'essentiel à l'antiquité grecque, sont complétées par divers récits, dont les voyages des Vikings dans les mers nordiques et de Marco Polo en Extrême-Orient au cours du XIIIe siècle. Jusqu'aux découvertes de Christophe Colomb en 1492, les cartes ressemblent presque toutes à celle-ci. Chez les Européens, les Asiatiques et les Africains, personne ne se doute que d'autres continents peuvent exister. Carte tirée de la Ridpath's Cyclopedia, 1885.
Les Skraelings pourraient être les premiers autochtones à avoir rencontré l'homme blanc en Amérique du Nord, il y a de cela près de 1000 ans. Les envahisseurs, pour leur part, étaient issus de l'un des peuples les plus agressifs et les plus guerriers du haut Moyen Âge européen. Navigateurs intrépides, les Vikings avaient abordé le continent au terme d'un long périple. Partis à l'aventure sur les mers, ils avaient mis le cap vers l'ouest - qui représentait l'inconnu - et avaient atteint l'Islande vers 860. Ils commencèrent à coloniser cette île dès la fin du IXe siècle, et c'est de là qu'en 982 Éric le Rouge mit la voile pour découvrir le Groenland, « Terre Verte », où deux colonies s'établirent. Quelques années plus tard, un navire, commandé par Bjarni, entrevit une nouvelle terre, à l'ouest - le Canada actuel. Bjarni fut bientôt suivi par Lief Erickson, qui longea les côtes du « Helluland », du « Markland », et du « Vinland », qui pourraient être, respectivement, l'île de Baffin, la côte du Labrador et Terre-Neuve. La découverte de ruines à l'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve, confirme d'ailleurs que des tentatives d'établissement de petites colonies eurent lieu.
Équipement du guerrier viking
L'équipement du guerrier viking était plus ou moins important selon ses moyens, mais tous possédaient des armes offensives. Au premier rang, se trouvait la hache de guerre, qu'ils maniaient d'une façon redoutable. Au début, ils étaient les seuls à se servir de cette arme, mais leurs adversaires l'adoptèrent rapidement. L'épée était également fort prisée et le javelot était une pièce d'armement d'usage courant. Enfin, chaque guerrier portait un couteau à la ceinture. Pour les combats à distance, on utilisait l'arc et les flèches. Les Sagas rapportent que les colons vikings, au Vinland, avaient en leur possession des épées, des haches et des javelots. Toutefois, elles ne disent pas qu'il y ait eu d'archers dans leurs rangs.
En ce qui concerne les armes défensives, le bouclier occupait la place d'honneur. Tout guerrier en possédait un. De forme circulaire, en bois, il pouvait être recouvert de cuir peint en rouge et encerclé de métal. Au centre se trouvait l'ombon, sorte de bosse de fer destinée à protéger le poing. Il semble que la plupart des guerriers aient possédé un casque. Habituellement très simple, de forme conique, il était souvent prolongé par une languette servant à couvrir le nez. Les cornes, appendices qui font généralement partie de cette pièce d'équipement dans les représentations contemporaines des terribles guerriers nordiques, sont le fait de l'imagination populaire. Elles n'ont jamais surmonté leurs casques. La cotte de mailles était peu portée, en raison de son coût fort élevé. Il est probable que seuls les chefs et les hommes les plus prospères du groupe pouvaient se l'offrir, sans oublier ceux qui en avaient dépouillé des soldats ennemis. La découverte, au cours de fouilles archéologiques récentes, effectuées dans le nord-ouest du Groenland et dans l'est de l'île Ellesmere, de deux fragments datant respectivement des XIe et XIIe siècles prouve que ce vêtement de protection s'est rendu jusqu'en Amérique. Cotte de mailles et casques étaient en fer.
Casque normand (ou viking), Xe siècle
Les casques normands (ou vikings) étaient généralement pourvus d'un protège-nez, comme on peut le voir ici. Contrairement à la croyance populaire, il n'y avait pas de cornes sur les casques vikings. Gravure d'après Viollet-le-Duc.
La tenue vestimentaire du Viking se composait d'une tunique, de pantalons de laine, de chaussures en cuir souple, d'une ceinture sur laquelle était enfilé le fourreau de l'épée, et peut-être d'un couvre-chef. Par temps froid, son habillement se complétait d'une cape de laine, retenue à l'épaule droite par une grosse épingle de métal.
Le retrait des Vikings
Est-ce le rapport de force qui s'est établi dès le premier contact avec les populations locales qui a amené les Vikings à quitter l'Amérique ? Les autochtones étaient certainement nombreux, et les nouveaux venus, malgré leurs armes de fer, ne pouvaient espérer en avoir raison. Comme le dit la Saga d'Éric le Rouge, les Vikings, au Vinland, « réalisèrent que, bien que ce fut une bonne terre, leur vie à cet endroit serait toujours dominée par la peur et les combats ». Ils décidèrent donc de retourner chez eux, de sorte que la première incursion européenne armée au Canada fut repoussée. Après l'échec des tentatives de colonisation vikings, il faudra attendre quelque 500 ans pour qu'arrive du vieux continent une nouvelle vague d'explorateurs.
Les soldats du XVIe siècle1000-1754
Les soldats du XVIe siècle. Voyages de découvertes
John Cabot embarquant en costume de cérémonie sur le Matthew à Bristol, le 20 mai 1497.
Après s'être embarqué à Bristol en mai 1497, Cabot navigue vers l'ouest pour apercevoir la terre le 24 juin. Il s'agit probablement de Terre-Neuve, mais peut-être aussi de l'île du Cap-Breton. Il prend possession de sa découverte au nom de l'Angleterre, qui peut ainsi revendiquer ses premiers territoires d'outre-mer. Gravure d'après E. Board.
Un peu avant la fin du XVe siècle, l'attrait des terres inconnues, à l'Ouest, se fit sentir de nouveau et l'Amérique fut redécouverte par les Européens, qui tentèrent, tout au long du XVIe siècle, d'y fonder des colonies : les Espagnols et les Portugais optèrent principalement pour l'Amérique du Sud, tandis que les Français et les Anglais s'intéressèrent surtout à l'hémisphère nord. Parmi toutes ces nations, seule l'Espagne en tirera des profits importants. Le Canada fut à cette époque la visée de nombreuses explorations, depuis celle de Jean Cabot, en 1497, jusqu'à celles de Jacques Cartier, mais aucune implantation n'en résulta. Ce territoire demeura donc, jusqu'au XVIIe siècle, l'apanage exclusif des autochtones. Néanmoins, les prises de possession effectuées par Cartier dans la vallée du Saint-Laurent furent reconnues, et les terres découvertes désignées sur les cartes européennes comme la « Nouvelle-France ».
Ces intrépides explorateurs ne se seraient jamais lancés à la recherche de terres inconnues, peut-être peuplées d'indigènes aux dispositions incertaines, mais supposées féroces, sans s'assurer un minimum de sécurité avec de bonnes armes et des gens qui en connaissaient le maniement et l'entretien. Aussi, quelle que soit leur nationalité, les marins qui signaient leur engagement pour ces expéditions devaient-ils être capables de se transformer en « hommes d'armes » face au danger. Chaque galion était équipé, dans cette éventualité, d'une réserve d'épées, de piques et d'arquebuses, et pourvu de quelques pièces d'artillerie. La distinction entre « navire de guerre » et « navire marchand » restait cependant assez vague. D'une façon générale, le galion ordinaire, qui faisait du commerce une année, pouvait être armé « en guerre » l'année suivante pour une campagne militaire, puis être affecté de nouveau au transport des denrées. Il y avait quelques notables exceptions, comme le Great Harry, grand galion de guerre britannique.
Pour avoir développé un type de navire capable d'effectuer de longs voyages océaniques, les Européens du XVIe siècle jouissaient d'un avantage révolutionnaire sur tous les peuples de leur temps. Ce ne fut pas seulement l'Amérique que leur avance technique mit à leur portée. À la même époque, ils réussirent également à contourner l'Afrique. Les Portugais, qui dominaient à ce moment-là la scène maritime, atteignirent l'Inde en 1500, puis se rendirent jusqu'en Extrême-Orient.
Galion du XVIe siècle
Les membres d'équipage de ce galion du XVIe siècle utilisent plusieurs instruments pour connaître leur position. Des outils comme le bâton de Jacob et le nocturlabe sont utilisés la nuit pour mesurer la position des étoiles dans le ciel. Avec ces mesures, les navigateurs peuvent savoir à quel endroit de la planète ils se trouvent.
De la piétaille au soldat
Aux XIVe et XVe siècles, de profondes transformations touchèrent également l'armement et la tactique. Elles entraînèrent l'avènement d'un nouveau type d'homme de guerre : le soldat professionnel. Au Moyen Age, le prototype du guerrier, sur les champs de bataille européens, c'est le chevalier. Il se déplace à cheval, comme son nom l'indique; revêtu d'abord d'une cotte de mailles et d'un heaume, il sera, par la suite, enfermé de pied en cap dans une armure d'acier. Les gens à pied, la « piétaille », comme on dit dédaigneusement, ce sont habituellement les archers et les piquiers. Ils sont mal équipés- on leur interdit les armes de gentilshommes, comme l'épée, qui pourraient leur sauver la vie dans les mêlées - et très peu protégés, bien que sévèrement exposés tout au long du combat.
La situation changea après que des armées de chevaliers, ayant pour opposants de simples gens de pied, eurent essuyé de cuisantes défaites. Cela se passa au XIVe siècle, quand une série de batailles mit la chevalerie aux prises avec des bandes de rudes montagnards suisses armés d'arcs, d'arbalètes, de longues piques et d'hallebardes, ces piques terminées par une tête de hache comme en porte encore de nos jours la garde suisse du pape. Rassemblés en formation serrée, piquiers et hallebardiers formaient une sorte de monstrueux hérisson que les chevaliers et leurs montures étaient impuissants à pénétrer. La noblesse subit alors des pertes terribles et les Suisses acquirent, grâce à cette technique qui bouleversait les règles du jeu, une notoriété militaire qu'ils conservèrent durant des siècles.
Le XIVe siècle vit aussi l'arrivée des armes à feu sur les champs de bataille, sous la forme des lourdes bombardes, ancêtres des canons, qui se signalaient surtout durant les sièges. Il fallut attendre encore une centaine d'années avant qu'apparaissent les premières armes à feu portatives : les arquebuses. Elles étaient capables de percer les armures.
Au Moyen Age, chevaliers et seigneurs comptaient dans leur suite, sur une base régulière, des « sergents » et des « archers », dont la tâche consistait à encadrer les autres sujets à qui obligation était faite de servir sous les armes pendant 40 jours par campagne. Avec l'accession de l'infanterie au rang de « reine des batailles », l'importance des gens de pied s'accrût, ainsi que, proportionnellement, leur nombre et la durée de leur service. Rarement payés, ces hommes vivaient souvent de rapines ou d'exactions commises sur les petites gens, aux environs des champs de bataille. La campagne terminée, certains devenaient de véritables dangers publics.
On les qualifiait même de « pilleurs et mangeurs de peuple ». Pour éviter ces abus, les princes en vinrent graduellement à « solder » les hommes qui se vouaient à la pratique de la guerre. D'où, en France, « ce beau nom de soldat » qu'on leur donna. Au XVe siècle, le principe de payer les hommes qui embrassaient le métier des armes s'établit solidement.
L'enrôlement des soldats
Archer portugais et, à gauche, arbalétrier, début du XVIe siècle
On trouve fréquemment des archers et des arbalétriers sur les navires et dans les premiers établissements d'outre-mer, durant la première moitié du XVIe siècle. Ces soldats ont très probablement participé aux incursions des Portugais à Terre-Neuve et à l'île du Cap-Breton. Museu de Arte Antiguo, Lisbonne (Photo : René Chartrand).
La compagnie est l'unité tactique de base, au XVIe siècle. Elle regroupe un nombre variable de soldats, en moyenne une cinquantaine, mais quelquefois bien plus. Ils sont commandés par des officiers : le capitaine, assisté d'un ou de plusieurs lieutenants et d'un enseigne porte-drapeau. Tandis que les officiers proviennent habituellement de la petite noblesse, les sous-officiers se recrutent parmi les soldats les plus expérimentés ou les plus instruits. Ce sont les « anspessades » - à peu près l'équivalent du lance-caporal ou première classe moderne -, les caporaux, les sergents et les fourriers. Il y a au moins un tambour et souvent un fifre par compagnie, ainsi qu'un « soldat frater », dont la tâche est de donner les premiers soins aux blessés. Les compagnies peuvent se composer uniquement de piquiers, d'arbalétriers ou d'arquebusiers, ou d'un mélange de ces diverses spécialités. Comme on peut le voir, si l'on exclut les changements dus à l'évolution des armes et l'appellation de certains grades, la compagnie, telle qu'elle était constituée il y a 500 ans, présente de nombreuses similitudes avec celle d'aujourd'hui.
À la Renaissance, le capitaine recrute généralement lui-même les hommes qu'il lui faut pour remplir ses effectifs, mais il peut déléguer cette tâche à son représentant- le lieutenant ou le sergent « recruteur » -, qui fait les premières approches. Celles-ci doivent déboucher sur une entente. Lorsqu'elle sera conclue, la recrue se trouvera liée au capitaine par un contrat, parfois oral, et recevra alors « la prime », somme d'argent versée au soldat au moment de son enrôlement.
Le nouveau venu doit prêter serment aux « Articles de la guerre », qui définissent ses devoirs et ses obligations, notamment la fidélité au drapeau, et l'avertissent de ce qui l'attend en cas de mutinerie ou de désertion - habituellement la peine capitale. Quand il recevra sa solde, elle sera déjà entamée par divers paiements que retiendra le capitaine pour assumer les frais de son équipement et de son armement, s'il n'en possède pas. L'officier, en général, se repaye avec profit. La nourriture et le vêtement peuvent faire l'objet de semblables déductions. Si la recrue arrive, par ailleurs, armée, équipée et vêtue, diverses conditions de son contrat seront à son avantage. Il semble d'usage que les soldats envoyés outre-mer bénéficient de certains privilèges pour l'achat de leur fourbi, ce qui représente sans doute une forme de compensation.
Les soldats des expéditions au Canada
Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les diverses expéditions à destination du Canada ne furent pas accompagnées de détachements des troupes royales, mais d'hommes levés par les compagnies d'exploration et de commerce qui finançaient l'opération. Pour avoir le droit de recruter des soldats, ces compagnies, anglaises ou françaises, devaient obtenir la permission du souverain, condition qui s'appliquait également au droit de couler des canons et de faire la guerre. Elles s'engageaient à assumer tous les frais de l'expédition, dont ceux du recrutement, de l'entretien et de l'équipement des troupes, en échange d'un monopole exclusif, la traite des fourrures, par exemple. Le chef de l'expédition recevait en outre une commission royale de lieutenant-général, ou de gouverneur, qui lui donnait autorité pour agir au nom du roi - souvent un des actionnaires importants de l'entreprise - dans les affaires de la colonie.
Qui sont-ils donc, ces soldats qui accompagnent les expéditions se dirigeant vers le Canada ? Il est probable que plusieurs, sinon la majorité, étaient des vétérans de l'armée royale ayant à leur actif, déjà, plusieurs campagnes. En fait, la composition des premiers corps militaires envoyés en Amérique du Nord dut ressembler à celle des troupes transportées par les Espagnols au sud. Il y a « parmi nous des soldats qui avaient été dans plusieurs parties du monde, à Constantinople, dans toute l'Italie et à Rome... », Écrit l'un deux. En période de paix, surtout, ces soldats, démobilisés, arpentaient les divers royaumes d'Europe en quête d'un engagement, et l'aventure outre-mer n'était certes pas à dédaigner.
Par ailleurs, les soldats ne sont pas les seuls hommes d'armes que l'attrait de ces expéditions amène en Amérique. Des gentilshommes s'y joignent pour participer aux explorations, dans l'espoir de trouver de l'or ou de se procurer des terres. Cartier en prend quelques-uns sur ses bateaux en 1535 ainsi qu'en 1541-1543. Dans certains cas ils sont relativement nombreux. Par exemple, lors de la seconde expédition de Martin Frobisher, en 1577, on compte « 11 autres gentilshommes » en sus des officiers réguliers. Ce sont, en quelque sorte, des surnuméraires, dont l'épée et les connaissances peuvent s'avérer utiles.
Les documents du XVIe siècle sont vagues quant à la présence et au nombre de soldats dans les corps expéditionnaires. En 1504, un galion français vogue vers le Brésil. C'est l'une des premières fois que la France envoie des hommes outre-mer. Les écrits sur ce voyage ne mentionnent pas l'occupation de chacune des 60 personnes à bord, mais rapportent cependant qu'elles sont bien armées, avec quelque 40 « harquebuses et autres tels bastons à feu », sans compter des piques, des pertuisanes et des dagues. Une mention selon laquelle « Jacques L'Homme, dit La Fortune, soldat », a été enlevé, de même qu'un marin, par les Amérindiens, prouve qu'il y avait des hommes d'armes à bord.
Les soldats de Cartier et de Roberval. Une présence militaire croissante
Roberval et ses soldats en Nouvelle-France, 1542
Les hommes ayant accompagné Roberval dans son expédition de 1542 sont montrés dans plusieurs points figurant sur cette carte de la Nouvelle-France de 1546 réalisée par Pierre Descelliers.
À son premier voyage, en 1534, Jacques Cartier ne semble pas avoir emmené de soldats de métier ni de gentilshommes autres que ses officiers. Cependant, il y a certainement au moins un canonnier parmi l'équipage de ses deux navires, car on tire du canon. La relation du second voyage, l'année suivante, mentionne qu'il y a à bord « tous les gentilshommes » de l'expédition et des soldats. Ils sont si bien armés que le chef Donnacona s'inquiète, lorsqu'ils descendent à terre, de ce que « le capitaine et ses gens portaient tant de bastons de guerre » alors que les Amérindiens n'en avaient aucun. Ces « bastons de guerre » étaient probablement des piques et des hallebardes. C'est que les Français sont sur leurs gardes. Ils ne se rendront à Hochelaga que menés par « le capitaine et les gentilshommes et 25 soldats bien armés ». De plus, lorsqu'ils décident d'hiverner au Canada, cette même année, pour la première fois, comme ils craignent « quelque trahison » de la part des Amérindiens, ils érigent un petit fort « tout clos de grosses pièces de bois plantées deboute t tout alentour garni d'artillerie ». Ils le renforcent, en sus, « de gros fossés, larges et profonds, avec porte à pont-levis ».
Jacques Cartier ordonnant des tirs de canon pour impressonner les Indiens
Les Iroquois sont d'abord surpris et effrayés par les canons de Cartier, mais cet effet ne dure pas très longtemps. Gravure d'après H. Sandham
Les considérations d'ordre militaires, jusque-là limitées à l'essentiel, revêtiront leur pleine importance lorsque Cartier entreprendra son troisième voyage au Canada, quelques années plus tard, en compagnie du sieur de Roberval. Le but visé, cette fois, n'est pas seulement l'exploration, mais la colonisation. Un projet, rédigé par Cartier à cette époque, mentionne qu'il lui faut « 40 hommes de guerre Harquebuziers ». En avril 1541, toutefois, un espion à la solde de l'Espagne, posté à Saint-Malo, observe que les préparatifs laissent supposer une expédition beaucoup plus importante. Le sieur de Roberval, rapporte-t-il, commande 300 « hommes de guerre », le capitaine Jacques Cartier est à la tête de 400 marins et de 20 maîtres pilotes, et il y aura à bord quelque 160 gentilshommes. Sans parler des artisans, ouvriers et autres personnes de métier nécessaires à l'établissement d'une future colonie. Au total, quelque « 800 à 900 personnes » De plus, ces soldats sont armés, dit-il, d'arquebuses et d'arbalètes et ont aussi des « rondelles », c'est-à-dire des petits boucliers ronds. Il avance des chiffres : 400 arquebuses, 200 arbalètes, 200 « rondelles », et plus de 1 000 piques et hallebardes. Il y aurait aussi plusieurs pièces d'artillerie. Bref, de quoi armer non seulement les soldats et les gentilshommes, mais même les marins et les futurs colons.
Jacques Cartier prend possession du Canada au nom de la France, 1534
Cartier pointe du doigt les armoiries de la France sur la croix pendant une cérémonie de prise de possession du Canada par la France. Des hommes d'armes font partie des premiers explorateurs. Gravure d'après Louis-Charles Bombled
Une « rondelle » du XVIe siècle.
Quelque 200 « rondelles » - des boucliers ronds portés par des fantassins armés d'épées, plus communément appelés « rondaches » - font partie de l'armement apporté au Canada en 1541. Les épées servent toujours d'arme à une grande partie des contingents d'infanterie des armées européennes au milieu du XVIe siècle. Gravure d'après Viollet-le-Duc
Une cohabitation difficile
Ruse de guerre des Canadiens par A. Thévet, publié en 1575
Cette gravure est probablement la première représentation publiée d'un engagement avec des Indiens au Canada.
Enfin, en mai 1541, on met les voiles. Jacques Cartier part le premier. Il y a probablement, sur ses cinq navires, une compagnie de soldats. Arrivé à ce qui est maintenant Québec, et qu'il nomme Charlesbourg-Royal, il fait construire deux forts, l'un au pied du cap Rouge et l'autre, sans doute plus petit, au sommet, car l'endroit commande toute la région. On se met à l'œuvre rapidement. Tandis que les uns s'installent et commencent à cultiver la terre, les autres partent explorer. Ils découvrent bientôt ce qu'ils croient être de l'or, de l'argent et des diamants - l'eldorado français ! Malheureusement, les relations se gâtent avec les Amérindiens iroquoiens. De cordiales qu'elles étaient au début, elles se font ouvertement hostiles durant l'hivernement de 1541-1542. Ceux-ci se vanteront même à des pêcheurs espagnols d'avoir tué quelque 35 Français. La situation est suffisamment sérieuse pour que Cartier abandonne Charlesbourg-Royal. En juin 1542, il retourne en France avec ce qu'il lui reste de monde. Et avec ses trésors...
Parti à son tour, en 1542, Roberval vogue vers le Canada avec trois navires. Y ont pris place 200 personnes dont quelques gentilshommes. Mais voilà qu'en arrivant à Terre-Neuve, à l'emplacement de la ville actuelle de St. John's, il croise Cartier toutes voiles vers la France ! Il a beau lui faire valoir que les Français possèdent maintenant des forces suffisantes pour pouvoir affronter les Amérindiens, et lui ordonner de retourner au Canada, la soif de l'or et de la gloire ont gain de cause sur le sens du devoir. À la faveur de la nuit, Cartier se sauve pour rentrer à Saint-Malo où l'attend une grosse déception : ses trésors ne sont que des cailloux ! De plus, sans doute parce qu'il a désobéi à Roberval, plus jamais le roi de France ne lui confiera le commandement d'une expédition.
Malgré l'abandon de Cartier, Roberval continue sa route et arrive à son tour à la hauteur de Québec. Les fortifications érigées l'année précédente semblent avoir été rasées, car il lui faut tout reconstruire à neuf. Un fort « d'une grande force, situé sur une montagne », et comportant « une grosse tour » et des corps de logis, se dresse bientôt au sommet du cap Rouge. Un autre est édifié au pied de la dite montagne, « dont une partie formoit une tour à deux étages, avec deux bons corps de logis ». Le nouvel établissement est baptisé France-Roy. Les Amérindiens ne semblent pas trop hostiles à ce nouveau contingent, mais ils se tiennent à l'écart. Durant l'hiver de 1542-1543, le scorbut frappe : le quart des Français succombe à l'épidémie. Sa colonie décimée, n'ayant pas trouvé d'or, Roberval abandonne lui aussi et les survivants sont de retour en France au début de septembre 1543.
D'autres expéditions infructueuses
Marin anglais, années 1570
Le bonnet en fourrure et les culottes amples sont caractéristiques de l'habillement du marin anglais à la fin du XVIe siècle.
Après les expéditions de Cartier et de Roberval, de 1541 à 1543, le reste du XVIe siècle voit diverses tentatives françaises et britanniques pour trouver le passage du nord-ouest ou un autre eldorado : toutes se soldent par des échecs.
Les explorations les plus importantes seront celles que conduira le Britannique Martin Frobisher, entre 1576 et 1578. Comme Cartier, Frobisher recherche, mais beaucoup plus au nord, le fameux passage vers l'Asie, et de l'or. Sa deuxième expédition, en 1577, comprend une centaine d'hommes, incluant une trentaine de soldats et 11 gentilshommes. Au cours de ce voyage, les relations entre Anglais et Inuit se dégradèrent rapidement. Les premiers voulurent prendre des autochtones en otage et une bataille s'ensuivit. Les soldats européens se servirent alors de leurs arquebuses et de leurs arcs. Quelques-uns, et Frobisher lui-même, furent blessés par les flèches des Inuit. L'endroit où se déroula cet engagement, le premier à se produire dans le Grand Nord, fut baptisé « The Bloody Point ».
Chasseur inuit en kayak tel qu'il a été vu pendant l'expédition de Frobisher
Les illustrations et les descriptions des Inuits réalisées à la fin des années 1570 par George Beste offrent une perspective humaine et pénétrante de cette culture du Grand Nord.
D'un point de vue militaire, les blessures subies par les Britanniques, lors de ce combat, dénotent qu'ils ne portaient pas d'armures ou de vêtements protecteurs, ou que ceux-ci étaient insuffisants. Par ailleurs, les soldats anglais de cette époque disposaient à peu près des mêmes armes que leurs confrères français, exception faite du grand arc qu'ils étaient les seuls à utiliser. Eux aussi portaient souvent la livrée, mais les soldats et les marins des expéditions de Frobisher n'en avaient peut-être pas.
Sir Humphrey Gilbert extrayant la première motte d'herbe à Terre-Neuve, en août 1583
La colonie britannique de Sir Humphrey Gilbert à Terre-Neuve échoue, notamment parce que les colons se préoccupent davantage de trouver des gisements d'argent que de cultiver la terre. Le 5 août 1583, Sir Humphrey revendique l'île lors d'une cérémonie par laquelle il tient une brindille de noisetier et une motte d'herbe. Cet hiver-là, l'explorateur se rembarque pour l'Angleterre et disparaît le jour où son navire sombre dans une tempête.
Croyant avoir découvert de l'or dans l'île Kodlunarn, Frobisher revient l'année suivante à la tête d'une flotte de 15 navires transportant quelque 400 hommes. C'est, à l'époque, la plus importante expédition jamais entreprise dans l'Arctique. Sur ce nombre, il devait y avoir, toutes proportions gardées, 200 marins et une centaine de soldats, puisque, sur la centaine d'hommes censés hiverner cette année-là dans l'île de Baffin, on dénombrait 40 marins et 30 soldats. Le reste se composait des officiers réguliers, de gentilshommes et, bien sûr, de mineurs, puisque, durant l'été, plus de 1 300 tonnes de minerai « d'or » étaient extraites du sol. Devant un tel trésor, Frobisher, comme Cartier, décide de s'en retourner plutôt que d'hiverner sur place. Analysé à son retour en Angleterre, le minerai se révèle être... du gneiss.
D'autres expéditions succédèrent à celles de Frobisher, quoique beaucoup plus modestes et apparemment non armées, comme celles qu'entreprit, entre 1585 et 1587, John Davis, découvreur du détroit qui porte aujourd'hui son nom. Davis et ses marins se heurtèrent eux aussi aux Inuit et ne purent aller plus loin que Frobisher. Quelques années auparavant, en 1583, Sir John Gilbert avait eu tout juste le temps de prendre officiellement possession de Terre-Neuve, une fois de plus, au nom du souverain britannique, avant de disparaître dans une tempête.
L'or des mers septentrionales. Flottes baleinières des Basques sur les côtes du Labrador
Navire du milieu du XVIe siècle, gravé sur une planche du galion San Juan, qui a coulé à Red Bay, au Labrador, en 1565.
De récentes découvertes confirment que la côte du Labrador connut aussi son heure de gloire durant la seconde moitié du XVIe siècle, alors que des baleiniers du pays basque espagnol y venaient, saison après saison. Ces intrépides marins étaient les seuls Européens à posséder la technique et l'audace voulues pour chasser ces énormes cétacés. L'huile qu'ils en tiraient, utilisée principalement pour l'éclairage, rapportait des sommes importantes. Chaque printemps, environ 2 000 d'entre eux arrivaient à bord d'une vingtaine de galions et s'établissaient pour la saison sur la côte du Labrador, plus particulièrement à un endroit nommé « Butus », face au détroit de Belle-Isle qui faisait alors partie de la « Provincia de Terranova ». C'est aujourd'hui Red Bay. Compte tenu que la flotte espagnole aux Antilles, chargé de ramener l'or et l'argent des peuples conquis, se composait de 70 à 80 navires, la présence d'une vingtaine de galions au Labrador semble surprenante. Elle démontre bien l'importance de la « Terranova ». L'huile de baleine, c'était en quelque sorte l'or des mers septentrionales.
Les établissements des Basques espagnols au Labrador n'avaient rien de permanent. Il s'agissait de stations temporaires, faites pour durer la saison. À l'occasion, quelques baleiniers se voyaient forcés d'y passer l'hiver. Parfois, un galion faisait naufrage. Ce fut le cas, par exemple, du San Juan, qui coula en 1565 et fut retrouvé dans les eaux de Red Bay au cours des années 1970. Des relevés archéologiques sous-marins minutieux y furent effectués, car ce type de navire joua un rôle considérable dans l'histoire mondiale.
Conflit chez les Basques
Arquebusier, XVIe siècle
Les armes à feu portatives, comme celle qu'utilise cet arquebusier, se répandent dans les armées européennes au XVIe siècle, mais elles sont difficiles à manier et lentes à faire feu. La pique, l'arbalète, l'arc et l'épée sont toujours utilisés sur les champs de bataille de l'ancien comme du nouveau monde. Gravure d'après Vecellio.
Des conflits éclataient parfois entre les équipages des bateaux de pêche montés par les « Basques du Sud », comme on appelait les gens du pays basque espagnol, et ceux des « Basques du Nord », qui étaient français. En 1554, ceux-ci prennent quatre navires à leurs cousins espagnols, au large de Terre-Neuve. La riposte ne tarde pas à venir. La même année, le Sancti Spiritu se transforme de baleinier en navire-corsaire et se tient à l'affût des bateaux battant pavillon français. Une partie de la flotte de pêche française sera détruite à Terre-Neuve, au cours d'une attaque espagnole. La France et l'Espagne sont alors en guerre et d'autres escarmouches se produisent. Le 21 avril 1557, une ordonnance du roi Philippe II d'Espagne oblige tous les navires allant à Terre-Neuve, morutiers, baleiniers ou autres, à s'armer d'au moins quatre canons et huit pierriers. Plusieurs le sont déjà. Dès 1550, le galion Madalena, jaugeant 130 tonneaux, possède six canons et huit pierriers. La même année, le San Nicolas, 250 tonneaux, est armé de six canons et de 12 pierriers. Le Santa Ana, grand navire de 650 tonneaux, a 10 canons et 20 pierriers, tandis que le San Juan, environ 300 tonneaux, coulé en 1565, était équipé de huit canons et de 10 pierriers.
Casque et plastron espagnols en acier, XVIe siècle
Ce type d'armure a été trouvé sur les galions espagnols qui se rendaient au Labrador durant la deuxième moitié du XVIe siècle. Museo Casa Pizarro, Trujillo, Espagne
En général, les galions des Basques espagnols étaient des navires assez grands, jaugeant de 200 à 650 tonneaux, environ, et comportant un équipage de 50 à 120 hommes. Les documents de l'époque ne signalent aucunement la présence de soldats, ni à bord des navires ni à terre. Cependant, officiers et marins pouvaient prendre les armes, au besoin, et se transformer en un genre d'infanterie de la marine. Chaque galion était muni de pièces d'artillerie en fer, ce qui laisse supposer la présence de marins-canonniers. Pour voir à l'entraînement de ces hommes et au bon entretien des canons, l'état-major de chaque navire comprenait un officier-canonnier.
Galions espagnols affrontant une tempête dans l'Atlantique Nord, vers 1560-1580
Les baleiniers basques, basés au Labrador, doivent affronter les mêmes intempéries que ces navires espagnols. Parfois, des navires sont perdus. L'un d'entre eux, le San Juan, sombre à Red Bay, au Labrador, en 1565.
Néanmoins, un document relatif à une entente de prêt, datant de 1571, pour la construction du San Cristobal, galion de 500 tonneaux, mentionne que les armateurs devaient mettre à bord 24 arquebuses, autant d'arbalètes et de boucliers, 26 casques, 20 cuirasses avec leur dos, et 144 petites et grandes piques, le tout destiné à armer la centaine d'hommes qui y monteront. En cas de bataille, l'équipage de ce navire se répartissait donc comme suit : près de la moitié utilisait les arquebuses et les arbalètes, un quart ou un cinquième portait armure et pique, tandis que le reste servait dans l'artillerie ou exécutait les manœuvres. À cet armement s'ajoutaient les armes personnelles des membres de l'équipage et des officiers, épées, dagues, haches. Un tel arsenal ne représentait pas une précaution inutile. Ce navire courait, comme tous ceux de l'époque, de grands risques d'être attaqué en mer. Et quand les hommes descendaient à terre, ils se heurtaient à l'hostilité des Inuit provoquée vers 1550 par l'enlèvement de la femme d'un chef. Geste irréfléchi qui rendit la côte du Labrador, déjà peu accueillante, avec ses rochers dénudés et ses conifères rabougris, encore plus inhospitalière pour des générations de marins basques.
Le déclin
Par ailleurs, il semble que la défaite aux mains des Anglais de « l'invincible Armada », orgueil de la marine espagnole, ait joué un grand rôle dans le déclin des pêcheries à Terre-Neuve, car les Basques y perdirent un nombre considérable de navires, et aussi de marins, mobilisés par ordre de Philippe II. Les dures pertes infligées à la flotte espagnole se traduisirent par une baisse importante de la sécurité en mer et par l'apparition en force de pirates, surtout anglais, au tournant du XVIIe siècle. Le plus célèbre de ceux-ci fut sans doute Peter Easton. Sa base était à Terre-Neuve. Prise par la flotte basque espagnole, elle fut reprise par Easton et ses hommes à la suite d'un combat épique. Vers la même époque, le quasi-monopole des Basques espagnols sur la chasse à la baleine s'effondra au profit des Hollandais et des Anglais. Cette activité n'étant plus aussi profitable, « la provincia de Terranova » fut oubliée...
L'échec européen
Du côté de la France, une dernière tentative de colonisation eut lieu, juste avant la fin du siècle, cette fois à l'île de Sable, au large de la Nouvelle-Écosse, en 1598. Nommé vice-roi de la Nouvelle-France, le marquis de La Roche-Mesgouez ne se risqua pas à venir en personne sur ce banc de sable à fleur d'eau, battu par des vents que rien n'arrêtait. Il envoya une quarantaine de colons, recrutés dans les prisons et escortés par une dizaine de soldats, y fonder l'établissement. Seuls 11 survivants furent rescapés en 1603, les autres ayant péri au cours d'une mutinerie. De plus, après un hiver désastreux, l'« Habitation » édifiée à Tadoussac en 1600 par Pierre Chauvin de Tonnetuit fut abandonné.
Au Mexique et au Pérou, face à des civilisations amérindiennes beaucoup plus avancées qu'au nord, les Conquistadores ont pu avoir gain de cause principalement parce qu'ils pouvaient affronter leurs armées en terrain ouvert. Mais au Canada, où les opposants ont pour grande tactique de se rendre insaisissables et bénéficient du couvert, pour le moment incontournable, que leur fournissent la nature du territoire et les affres du climat, les vagues successives d'arrivants européens se voient réduites, l'une après l'autre, à une guerre défensive. Comment se lancer militairement à l'assaut de l'intérieur d'un pays inconnu, quand déjà on tremble pour sa vie dans le fortin côtier ou le galion duquel on n'ose débarquer ? Cette insécurité chronique explique pour une bonne part la faillite des établissements européens au Canada, au XVIe siècle. Même l'activité semi-permanente des Basques espagnols tire à sa fin. Depuis l'ère des Vikings, la rencontre des Européens avec les Amérindiens s'est souvent faite dans la violence et, malgré leur grande supériorité technologique, les Blancs ne semblent pas capables de faire des gains durables. Quand Cartier abandonne Charlesbourg-Royal, en 1542, il allègue ne pouvoir « avec sa petite bande, résister aux Sauvages qui rodoient journellement et l'incommodois fort ». Aveu très clair de l'efficacité tactique de la guérilla amérindienne. Dans l'Arctique, les Inuit tiennent également les Blancs en échec. Les chroniqueurs anglais ne cessent de se plaindre de la vaillance au combat de ces « Savages » et de leur adresse dans le maniement des armes.
Enfin, un nouvel élément, qui commence à se manifester pendant la première moitié de ce siècle, intervient avec plus de force durant la seconde : les diverses nations européennes, sans délaisser leurs champs de guerre traditionnels, ont commencé à se battre entre elles outre-mer, essaimant ainsi leurs conflits armés aux quatre coins du monde.
Un siècle s'est écoulé depuis que Jean Cabot a pris possession de Terre-Neuve. Il ne reste rien de la présence française, anglaise ou basque, en Amérique du Nord... Une page est tournée.
Les premiers soldats de la Nouvelle-France1000-1754
Les premiers soldats de la Nouvelle-France. Une période de changements
Une nouvelle prise la fourrure
Quand débute le XVIIe siècle, les nations du nord-ouest de l'Europe se sont rendues à l'évidence découvrir, comme l'Espagne, des pays dans lesquels se trouvent des montagnes d'or et des rivières de diamants relève désormais de l'utopie. Mais l'exploitation de ressources naturelles plus conventionnelles peut néanmoins rapporter des profits appréciables. Au premier rang viennent les fourrures. Conscients de ce nouvel intérêt pour les pelleteries, les Iroquois tenteront résolument d'exercer le contrôle sur ce commerce, et, pour l'obtenir, viendront en guerre avec les tribus alliées des Français. Parallèlement, interviennent divers conflits entre les nations européennes qui se disputent le nord de l'Amérique. C'est dans ce climat fort difficile que commence l'établissement de petites colonies en Nouvelle-France.
Nouvelles armes en mer et sur terre
La recherche d'un équipement et d'un armement toujours plus efficaces entraînera, durant cette période mouvementée, de nombreuses améliorations sur le plan technique. Ainsi, toutes les nations maritimes de l'Europe établissent alors une distinction de plus en plus nette entre navires de guerre et navires marchands. Une invention, due aux Anglais, accélère le processus : celle de l'affût de canon naval, genre de chariot à roulettes qui permet de recharger les canons facilement et augmente considérablement le nombre de coups qu'ils peuvent tirer pendant une bataille. Les galions « armés en guerre » du siècle précédent disparaissent donc pour laisser la place à des vaisseaux spécialement conçus pour le combat, capables de mieux résister aux boulets, équipés d'un grand nombre de canons, et pouvant naviguer plus rapidement. L'appellation « vaisseaux de ligne » est donnée aux navires portant plus de 50 canons. Ils sont secondés par les frégates, plus petites et plus rapides, mais qui ont moins d'artillerie à bord.
Cette révolution de l'art naval se fait sentir également dans la marine marchande. La capacité de fret des navires de commerce se trouve augmentée. Ils peuvent aussi effectuer plus facilement des voyages à très long cours. Se rendre en Chine est encore une aventure, mais ce n'est plus un exploit. Les Hollandais, grâce à leur politique économique des plus énergiques, supportée par une grande flotte marchande, dominent le commerce avec l'Orient à la place des Portugais.
Sur terre, l'art de la guerre est aussi en pleine évolution. La période d'un siècle qui s'ouvre avec le début des guerres de religion, vers 1550, pour se terminer avec la fin de la Guerre de Trente Ans, en 1648, est témoin de très rapides progrès techniques et tactiques. À l'époque de Cartier, les armes blanches, principalement les épées et les piques, dominent sur les champs de bataille. Un siècle plus tard, ce sont les armes à feu portatives, tels l'arquebuse et le mousquet, qui l'emportent. L'artillerie enregistre également des gains appréciables. On rationalise les calibres, les canons s'allègent et le déplacement des pièces lourdes requiert moins d'hommes et de chevaux. Le mortier, très utile durant les guerres de siège pour lancer des bombes explosives pardessus murs et fortifications, se taille une place dans le parc d'artillerie, bien que son emploi soit particulièrement dangereux.
De l'arquebuse au mousquet
Soldats français du début du XVIIe siècle
Ces soldats français sont habillés dans un style qui est répandu dans presque toute l'Europe occidentale au début du XVIIe siècle. Noter le porte-couteau de l'homme à gauche, et la pique dont est armé l'homme en arrière-plan. Gravure du milieu du XIXe siècle, d'après un dessin d'Alfred de Marbot.
C'est durant le dernier tiers du XVIe siècle que le mousquet commencera à se substituer à l'arquebuse. Son implantation sera cependant lente à se faire. L'arquebuse était une arme relativement légère, mais d'une efficacité meurtrière limitée en raison de son faible calibre. Le mousquet conférait à l'arme à feu toute la force de pénétration possible, mais son gros calibre en faisait une arme trop lourde. Vers 1590, un mousquet pèse quelque 7,5 kg et tire une balle d'environ 21,7 mm de diamètre. Pour mettre en joue, il faut soutenir le canon, où se loge surtout le poids, au moyen d'une sorte de fourche d'appui, la fourquine. Ce qui, évidemment, représente un inconvénient majeur.
Les Hollandais allégeront un peu ce canon miniature. Vers 1600, ils utilisent un mousquet à fourquine pesant de 6 à 6,5 kg, tirant une balle d'environ 18,5 mm. Cette arme va continuer à s'améliorer, profitant des progrès réalisés dans les techniques de fabrication des canons. L'armée du roi Gustave-Adolfe le' de Suède, considérée comme la plus novatrice du premier tiers du XVIIe siècle, sera la première à adopter ces nouvelles armes. En effet, en 1632, un chroniqueur rapporte avoir vu une compagnie de soldats suédois « ayant parmi eux des mousquetaires armés avec le nouveau et très léger mousquet sans fourquine ». Pour obtenir ce résultat, c'est surtout à la crosse de bois et au canon qu'on a apporté des modifications. La réduction de poids n'est obtenue, toutefois, qu'au prix d'une diminution du calibre de la balle, qui n'est plus que de 16 mm. Enfin, vers 1650, les améliorations apportées au mousquet permettent d'obtenir une arme ne pesant plus que 4,5 à 5 kg environ, et n'ayant plus besoin de fourquine.
Mousquet à mèche, vers 1665
Ce mousquet est le type d'arme porté par les hommes du régiment de Carignan-Salières durant leur service au Canada. Le tireur, lorsqu'il appuie sur la détente (le levier qui se trouve sous l'arme) fait tomber le serpentin (le bras de métal courbe à droite). Un segment de corde qui brûle lentement, appelé « mèche lente » (non montré), est attaché au sommet du serpentin. Lorsque le serpentin tombe, la mèche allumée descend dans le bassinet (au centre), petite cuvette dans laquelle est déposée une petite quantité de poudre. Quand cette poudre explose au contact de la mèche, le feu se rend jusqu'au canon et fait explosé une deuxième charge de poudre. Cette dernière explosion propulse la balle hors du canon (dont une partie est visible à droite). Ce système peut faire défaut de diverses façons, mais quand tout fonctionne, il est très bruyant et spectaculaire.
Le mousquetaire évolue sur le champ de bataille en formation de peloton, de compagnie ou de bataillon. Protégé par les piquiers contre les charges de cavalerie, il tire des « salves » à la cadence d'à peu près deux coups à la minute. Cela semble bien peu comparé à l'archer qui peut décocher de nombreuses flèches dans le même laps de temps. Mais exceller à l'arc est l'oeuvre d'une vie d'entraînement, alors que le mousquetaire peut acquérir les rudiments de son métier en une semaine d'exercices. Quant à la précision du tir, elle ne revêt pas une importance primordiale durant les batailles rangées des XVIIe et XVIIIe siècles.
Sauf chez les piquiers, dont le nombre va en diminuant, la transition de l'arquebuse au mousquet entraînera progressivement l'abandon des casques et cuirasses, qui, lourds à porter, offrent une protection de moins en moins efficace contre des projectiles de plus en plus meurtriers. L'agilité que requiert le maniement du mousquet provoquera également des transformations dans l'habillement.
Les soldats des compagnies commerciales
Les quelques soldats français qui débarquent au Canada, à partir de 1604, sont pour la plupart des vétérans des conflits qui ne cessent de déchirer l'Europe. Ils ont été recrutés et embauchés par les compagnies commerciales qui ont obtenu des monopoles en Nouvelle-France, c'est-à-dire le droit exclusif d'exploiter certaines ressources de ce territoire et d'en faire le commerce. En échange de ce privilège, ces compagnies ont contracté certains engagements envers le roi : coloniser le pays, faire évangéliser les autochtones, gouverner et défendre les intérêts de Sa Majesté. Ces activités exigent une certaine protection armée qu'elles s'engagent également à fournir. Comme ces compagnies doivent une obéissance et une loyauté absolues au souverain, les militaires qu'elles payent sont, en un sens tout au moins, des soldats au même titre que leurs confrères à la solde du trésor royal : les uns comme les autres doivent combattre les ennemis du royaume, peu importe qui ils sont et où ils se trouvent.
Si on dénombre peu de soldats durant les premières décennies du Régime français au Canada, la raison en est fort simple : ils coûtent cher. Souvent au bord de la banqueroute, les compagnies commerciales en engagent le moins possible. Une autre explication plausible, c'est que les membres de ces expéditions clairement identifiés comme soldats dans les documents sont rarissimes. Manifestement, les militaires ne font pas que leur métier, ils en ont aussi un second et l'un cache fréquemment l'autre. À l'inverse, il est souvent fait mention de gens, simplement désignés comme le « compagnon » de quelqu'un, de Champlain, par exemple, qui sont intervenus lors d'une bataille. Cette polyvalence des rôles était une nécessité dans la colonie naissante. Elle n'empêchait pas les activités militaires d'occuper une place importante parmi les autres occupations des soldats et des « compagnons ».
Au temps des compagnies, le rang et le pouvoir en Nouvelle-France s'exercent d'une façon tout à fait militaire. Le gouverneur de la colonie est aussi commandant suprême. En l'absence d'un conseil, qui pourrait s'opposer a lui, il jouit d'une autorité absolue. Ce mode de gouvernement autocratique garde essentiellement cette forme durant tout le Régime français.
L'Acadie
Abitasion ou habitation de Port-Royal, construite en 1605
Cette habitation fortifiée est construite par Samuel de Champlain et ses hommes en 1605 pour remplacer l'établissement précédent de Sainte-Croix. On cherche ainsi à profiter d'un climat un peu plus doux après avoir passé un hiver au cours duquel 35 des 80 colons meurent du scorbut. Le bâtiment est détruit en 1613 par des colons anglais venus de Virginie.
Le sieur de Monts, lieutenant général et vice-amiral de la colonie, obtint le monopole des ressources naturelles de la Nouvelle-France durant plusieurs années. Il fut à l'origine des premiers établissements français permanents, tant en Acadie, où il fit élever les forts de Sainte-Croix et de Port-Royal, que dans la vallée du Saint-Laurent, par l'érection du premier fort de Québec. Les colonies acadiennes développèrent des relations de bon voisinage avec les tribus amérindiennes qui occupaient déjà le territoire, les Micmacs et les Abénaquis, mais furent confrontées à des disputes entre les nations européennes qui voulaient s'approprier ce bout de pays. Quant à celles situées dans la vallée du Saint-Laurent, elles furent perpétuellement entraînées dans des conflits avec les autochtones.
Les établissements acadiens connurent une histoire des plus mouvementées, ponctuée d'abandons, de prises et de reprises. En 1604, le sieur de Monts, dont le monopole ne couvre alors que l'Acadie, envoie une première expédition qui met le cap sur Sainte-Croix et y édifie un fort. Une épidémie de scorbut ayant emporté 35 des 80 résidents, les survivants déménagent à Port-Royal où ils construisent une nouvelle Habitation. En 1613, les Anglais de la Virginie rasent tous les postes français d'Acadie. Port-Royal renaîtra de ses cendres en 1620 et une nouvelle Habitation apparaîtra à Miscou, plus au nord, à l'entrée de la baie des Chaleurs. Mais à compter de 1621, les colonies britanniques sont en plein essor, tant et si bien qu'en 1629 le drapeau britannique flotte à nouveau sur le fort de Port-Royal. Le traité de 1632 rendra l'Acadie à la France... pour un certain temps seulement, car les Britanniques revendiquent toujours ces terres.
Carte de la Nouvelle-France par Samuel de Champlain, 1613
Cette carte, réalisée par Champlain en 1613, montre Terre-Neuve (terreneuve), l'Acadie (Acadye) et le Labrador, entre autres lieux. Remarquer l'inscription « Canadas » sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent.
Plan de l'établissement français à l'île Sainte-Croix en 1604
En juin 1604, les hommes faisant partie de l'expédition française dirigée par le Sieur de Monts et Samuel de Champlain commencent à construire un poste de traite et un établissement sur une île qu'ils appellent Sainte-Croix, un emplacement choisi par souci de sécurité. Les choses tournent plutôt mal, car quelque 35 des 79 hommes qui s'y trouvent meurent du scorbut pendant l'hiver de 1604-1605. En outre, les relations avec les Indiens au sud sont tendues. Par conséquent, à la fin de l'été, les Français abandonnent Sainte-Croix pour aller construire un établissement fortifié à Port-Royal (aujourd'hui Annapolis-Royal, Nouvelle-Écosse).
Mme Françoise-Marie Jacquelin de la Tour (1602-1645)
Dans les années 1640, les établissements français d'Acadie sont l'objet d'un dur conflit féodal entre Charles Menou d'Aulnay et Charles de Saint-Étienne de La Tour, deux nobles revendiquant un pouvoir exclusif sur la colonie. En avril 1645, Menou d'Aulnay profite de l'absence de La Tour pour attaquer son fort sur la rivière Saint-Jean (aujourd'hui St. John, N.-B.) avec 200 hommes et de l'artillerie. Mme Françoise-Marie Jacquelin de La Tour se montre à la hauteur de la situation et commande pendant trois jours la petite garnison du fort, composée de 45 hommes. Le quatrième jour, le fort tombe à cause d'une trahison. Mme de La Tour est épargnée dans le massacre qui en résulte, mais mourra trois semaines plus tard de cause inconnue mais probablement naturelle. Cette femme courageuse et déterminée est l'une des premières héroïnes canadiennes et la première femme européenne à élever une famille dans ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Adam Sherriff-Scott.
Peu de soldats pour faire la guerre aux iroquois. Aggravation des relations avec les Iroquois
Piquier français, vers 1635
Des armures et des armes de piquier sont envoyées à Québec durant les années 1620. Il semble que ces armures sont portées par certains soldats jusqu'à la fin des années 1630, même si les piques sont de toute évidence presque jamais utilisées. En Europe, les piquiers, qu'on voit de moins en moins sur les champs de bataille, disparaissent vers la fin du siècle. En Amérique, les piques et les hallebardes sont parfois utilisées, mais à des fins cérémoniales uniquement.
La paix de 1622, léguée par Champlain, s'effrite peu à peu au fil des années trente, alors que les Iroquois obtiennent des Hollandais, établis à Fort Orange (aujourd'hui Albany, dans l'État de New York), des armes à feu en échange de leurs peaux de castors. Les Français, pour leur part, refusent ce genre de troc, ou le font de façon très limitée avec des Hurons convertis au christianisme. Désireux de se venger des défaites qu'ils ont subies aux mains des Français, et désormais armés pour le faire, les Iroquois se montrent de plus en plus hostiles. Le conflit larvé éclate finalement en 1641, quand le gouverneur Montmagny, accompagné de toute sa suite, part en chaloupe à la rencontre de leurs chefs près de Trois-Rivières, afin de parlementer avec eux. Dans le plus pur style européen, il fait monter dans un canot un guidon - le porte-étendard de la compagnie - et un héraut - le messager protocolaire. « Le canot, et le guidon, et le héraut » sont reçus avec mépris par les Iroquois, qui huent les émissaires, tirent des flèches sur leurs embarcations, arborent le scalp d'un Algonquin allié aux Français. Outré de « toutes ces insolences », Montmagny répond par des décharges de pierriers et de mousquets. C'est le début d'un quart de siècle d'hostilités.
Officier français, vers 1635
Les militaires, comme cet officier français, sont habillés de vêtements civils. Leurs armes dénotent leur appartenance au « métier des armes ». D'anciennes homologations de testaments montrent que les soldats font de même et portent des vêtements civils en même temps que des armes et du matériel militaire. Au Canada, les officiers sont généralement armés d'épées et de pistolets.
Expension de la colonie
Le fort de Ville-Marie en 1645. Sa construction commence en 1642, et il est démoli en 1672. Les détails sont rares, mais on sait qu'il a été construit selon un plan en carré et qu'il était doté de bastions à chaque coin. Ce dessin du XIXe siècle est une supposition de son apparence.
La situation en est à ce point quand, en mai 1642, un groupe de colons, sous la direction d'un ancien officier, Paul Chomedey de Maisonneuve, se rend à l'île de Montréal pour y fonder un établissement. Il faut pour cela une bonne dose de témérité, car l'endroit, situé à proximité du territoire des Iroquois, est particulièrement exposé à leurs attaques. Les nouveaux arrivants construisent un fort et, l'année suivante, y installent l'artillerie. Si les habitants de Québec connaissent une relative sécurité, il n'en va pas de même pour ceux des établissements de TroisRivières et de Montréal, d'où l'on ne sort jamais « sans avoir son fusil, épée et son pistolet ». En fait, le danger est tel que chaque habitant doit se constituer son propre défenseur. Il n'est pas étonnant dès lors que l'on préfère demander au roi des colons qui soient « tous gens de cœur pour la guerre », sachant manier « la truelle d'une main et l'épée de l'autre ».
La défense de la colonie s'organise néanmoins. Au mois d'août 1642, le gouverneur Montmagny, ayant reçu de France un contingent d'une quarantaine de soldats, ordonne la construction d'un fort à l'embouchure de la rivière Richelieu, là où se trouve aujourd'hui la ville de Sorel, afin de bloquer la route traditionnelle des invasions iroquoises. De plus, la reine de France, Anne d'Autriche, qui s'intéresse aussi aux affaires canadiennes, quoique surtout du point de vue de la protection des missions, débourse 100 000 livres pour lever et équiper une compagnie de 60 soldats. Ce qui fut fait durant l'hiver de 1643-1644. « Laquelle compagnie fut distribuée dans les différents quartiers de ce pays », rapporte une chronique de l'époque.
Artillerie française, années 1640
L'artillerie des premiers forts défendant les villes est généralement montée sur ce type d'affût. On voit ici un canonnier nettoyer la lumière à l'aide d'une pointe effilée. La pique fourchue sert à tenir une mèche lente qui allume la poudre contenue dans la lumière qui, à son tour, fait exploser la charge de poudre propulsant le boulet.
Ces soldats arrivèrent à Québec en juin 1644. Le 7 septembre, ayant parcouru 1 300 kilomètres à pied et en canot, 22 d'entre eux parvinrent « aux Hurons », c'est-à-dire à la mission de Sainte-Marie, sur les rives du lac Huron, où ils logèrent chez les jésuites et partagèrent leur table. En septembre 1645, ils revinrent à Ville-Marie, escortant un convoi de quelque 60 canots « chargés de quantité de castors ». Cette expédition fut remarquable à plusieurs points de vue. D'abord, c'était la première fois qu'une garnison française, ou même européenne, était envoyée défendre un poste aussi loin dans l'ouest. Ensuite, les soldats montèrent la garde non pas dans un fort solidement construit, pourvu de canons, mais dans une mission protégée d'une simple palissade à la mode amérindienne. Enfin, l'impact économique du convoi de pelleteries, rendu à bon port grâce à la vigilance de leur escorte, fut considérable.
Ces « soldats de la reine » étaient cependant en nombre insuffisant pour garantir la sécurité des Français et de leurs alliés. Passé 1645, leur détachement semble se fondre dans la garnison régulière, car il n'en est plus fait mention. À cette époque, la colonie compte peut-être une soixantaine de soldats, répartis entre Montréal, Trois-Rivières et Québec.
La pression de la part des Iroquois prend de l'ampleur
Soldats français des années 1640, armés de mousquets à platine à mèche
Au XVIIe siècle, une majorité croissante de soldats utilisent des armes à feu, comme ces troupes françaises des années 1640 armées de mousquets à platine à mèche.
Maintenant bien pourvus en mousquets et d'autant plus agressifs, les Iroquois s'en prennent, en 1642, au fort Richelieu qui vient d'être mis en travers de leur route. Leur habileté à se servir de leurs nouvelles armes surprendra les Français. De plus, malgré l'exposition du lieu, on manque tellement de soldats qu'il faut réduire la garnison de ce fort, stratégiquement vital, à une dizaine d'hommes. La guérilla est constante. Tout soldat qui s'aventure en dehors des fortifications, serait-ce pour chasser, court vers une mort quasi certaine. Finalement abandonné vers la fin de l'année 1646, le fort Richelieu est brûlé par les Iroquois en février 1647.
La destruction de la Huronie
Des guerriers mohawks attaquent le groupe du père Jogues, 1646
Le père Isaac Jogues, le frère Jean de la Lande et des Hurons convertis sont attaqués par des guerriers Mohawks sur la rivière Richelieu en octobre 1646. Capturés et emmenés à un village iroquois, ils sont tués le 18 octobre. À cause des Iroquois, les déplacements sur la plupart des cours d'eau sont très dangereux et la petite garnison française ne peut rien y faire.
Les nations indigènes sont alors ravagées depuis un certain temps déjà par des épidémies apocalyptiques qui n'épargnent aucune des tribus en contact avec les Blancs. Les Iroquois, comme les Hurons, sont durement touchés. Mis à part ce fléau, cependant, ils jouissent d'avantages indéniables sur les Hurons. Alors que, majoritairement, ils ont refusé les missionnaires, les Hurons, dont une partie s'est faite chrétienne sous l'influence des jésuites et l'autre est restée fidèle à ses croyances traditionnelles, sont divisés entre eux. Ensuite, ils sont tout près des Hollandais du fort Orange, avec qui ils font affaires, tandis que les Hurons doivent parcourir des centaines de kilomètres pour échanger leurs fourrures contre les objets de traite des Français. Enfin et surtout, d'un point de vue de stricte logistique militaire, depuis 1640 environ, ils obtiennent des armes à feu des Hollandais, et les Hurons n'en ont pas. Forts de tous ces avantages, les Iroquois sentent le moment venu de mettre à exécution un vaste projet : détruire les Hurons, alliés des Français.
Peut-être parce qu'on sent la menace dans l'air, en août 1648, un détachement formé de huit soldats de la garnison de Trois-Rivières et de quatre de celle de Montréal escorte un grand convoi de canots allant au pays des Hurons. Ces 12 soldats apportent avec eux une petite pièce d'artillerie, destinée à la défense de la mission de Sainte-Marie.
Au printemps de 1649, plus de 1 000 guerriers iroquois, armés jusqu'aux dents et équipés d'armes à feu, envahissent la Huronie. C'est l'assaut final après des années de harcèlement. Plusieurs villages hurons, dont les missions de Saint-Louis et de Saint-Ignace, succombent aux attaques. Les pertes du côté des assiégés sont énormes : seulement trois des 400 habitants de Teanaostaiaé échappent à la mort, alors que les Iroquois n'y perdent que 10 guerriers. D'autres Hurons quittent leurs villages, sans espoir de retour, et se dispersent. Finalement, la plus importante mission, celle de Sainte-Marie, est abandonnée, ce qui présage la fin de la Huronie. Ses habitants, Français comme Hurons, se réfugient dans l'île aux Chrétiens - en Amérindien, Gahoendoe - où, en mai 1649, les quelques soldats de la garnison, avec l'aide des hommes valides, transportent le canon arrivé l'année précédente. Tous se mettent à la construction d'un fortin bastionné, qui sera nommé Sainte-Marie II. Mais, durant l'hiver de 1649-1650, la famine frappe durement la petite colonie de rescapés, emportant des centaines de Hurons. Finalement, le 10 juin 1650, après avoir enterré dans l'île non seulement leurs morts, mais le canon, les quelque 300 survivants Hurons, et les rares Français qui demeurent, prennent le chemin de Québec, où ils arrivent le 28 juillet. C'est la fin de la Huronie, mais non pas des Hurons, car, le 15 octobre de la même année, note le supérieur des jésuites à Québec, « partirent les Hurons pour la guerre ».
Guérilla iroquoise au coeur de la colonie française
Guerriers iroquois rôdant près d'établissements français, années 1650
Jusqu'aux années 1660, et dans la région de Montréal en particulier, aucun habitant des établissements français ne peut vraiment se sentir à l'abri d'attaques suprises menées par des guerriers iroquois. De nombreux colons canadiens, y compris des femmes, apprennent à manier les armes à feu durant les années 1650.
La chute de la Huronie permet désormais aux Iroquois de concentrer leurs activités guerrières contre les établissements français de la vallée du Saint-Laurent. En effet, toutes les missions et tous les postes à l'ouest de Montréal ont été abandonnés, tandis qu'au sud-est le fort Richelieu est en cendres : les principales voies d'accès vers Montréal - le Richelieu et le Saint-Laurent en amont -, sont donc plus ou moins sous leur contrôle. L'intensité de leurs incursions augmente et une guérilla à peu près permanente s'installe. Contrairement aux colons de la Nouvelle-Angleterre ou de la Nouvelle-Hollande, c'est au cœur même de leurs établissements que les habitants de la Nouvelle-France doivent maintenant affronter la guerre.
Pour pallier la situation, il n'y a guère que les minuscules garnisons et le « camp volant », composé de soldats réguliers et de volontaires. En 1651, on décide de renforcer celui-ci en portant ses effectifs à 70 hommes. Puis on le supprime l'année suivante pour raison d'économie. Il renaît en 1653 pour prêter main-forte à la garnison de Trois-Rivières, aux prises avec de violentes attaques iroquoises, avant de disparaître définitivement. À partir de 1652, la garnison permanente aurait dû se composer de 15 soldats à Québec, 10 à Trois-Rivières et 10 à Montréal, avec « 14 soldats supplémentaires aux Trois-Rivières ». Mais, en fait, elle ne compte que 35 soldats. Néanmoins, une paix est conclue au cours de l'automne 1653, même si elle sera de courte durée.
Soldat de la Compagnie des cent associés au Canada, vers 1650
Cet employé des Cent associés porte un mousquet (ou fusil) à platine à silex, d'un type apparu dans la colonie à la fin des années 1640. Ce fusil est plus léger que l'ancienne arme à mèche et son système de mise à feu est plus fiable, ce qui en fait une arme idéale pour le Canada. L'acquisition d'armes à feu par les Iroquois modifie les tactiques militaires en Nouvelle-France. Les casques et les plastrons deviennent inutiles et les soldats français se mettent tout simplement à porter leurs vêtements habituels. Cet homme est habillé selon les modes civiles existant à l'époque en France. Ce soldat porte en bandoulière des charges individuelles de poudre contenues dans des fioles appelées à la blague « les douze apôtres ».
L'établissement de la mission française de Sainte-Marie de Gannentaha, en plein cœur de l'Iroquoisie, durant le mois de juillet 1656, peut surprendre à première vue. Mais cela répondait à un voeu exprimé trois ans plus tôt par les Iroquois de la nation des Onontagués. Un groupe de soldats commandés par Zacharie Dupuy accompagne les cinq missionnaires jésuites. Ceux-ci fondent la mission sur les bords du lac Gannentaha, aujourd'hui Onondaga, dans l'État de New York, au sud-est de la ville de Syracuse. Il semble que la troupe ait compté une vingtaine d'hommes, qui auraient été recrutés en France par Dupuy lui-même. L'établissement de la mission de Sainte-Marie n'a pas l'heur de plaire à tout le monde. Les Agniers, en particulier, n'approuvent pas cette ouverture envers les Français et font quelques raids en vue de rompre la paix. À l'automne de l'année 1657, les escarmouches redoublent un peu partout. La situation des Français de la mission devient intenable. Ils savent que, tôt ou tard, inévitablement, les Onontagués devront se rallier aux autres nations de la Confédération iroquoise. Rester équivaut pour eux à une condamnation à la torture et à la mort. C'est donc secrètement, à la faveur de la nuit, qu'ils évacuent le camp, le 20 mars 1658.
Reprise de la guerre iroquoise
Attaques surprises des Iroquois
Puisque les Iroquois lancent constamment des attaques-surprises contre les colons à Montréal entre 1660 et 1665, les sœurs hospitalières font elles aussi le guet et sonnent leur cloche pour donner l'alarme chaque fois qu'elles aperçoivent quelque chose de suspect.
Dès lors, la guerre reprend de plus belle et les Iroquois ont l'avantage du point de vue stratégique. À l'ouest, ils ont défait leurs ennemis, les Ériés, et n'ont plus rien à craindre. Les Hurons sont pratiquement anéantis et les autres alliés amérindiens des Français ne sont pas de taille à leur résister. Ils ont aussi l'avantage du nombre, car ils ne peuvent pas ignorer que la garnison française ne compte guère qu'une cinquantaine d'hommes. Bien fournis en armes par les Hollandais, ils connaissent une décennie de victoires.
L'inquiétude, pour ne pas dire la panique, transpire des pages des chroniqueurs français. Les Iroquois sont partout. Ils frappent, disparaissent aussitôt, téméraires, toujours insaisissables. Le sort de leurs victimes a de quoi faire frémir les âmes françaises, même bien trempées. Une mort rapide est une grâce, comparée à la lente agonie de ceux qui ont été scalpés ou, pis encore, qui seront suppliciés à petit feu, dans une orgie de tortures. Cette peur qui s'empare des Français est une victoire iroquoise de plus et cette façon de tenir l'ennemi sur les dents serait qualifiée aujourd'hui de « guerre psychologique ».
Les Français rétorquent du mieux qu'ils peuvent à ces raids. En 1658, le gouverneur Voyer d'Argenson, à la tête d'une troupe d'une centaine d'hommes, se lance à la poursuite des iroquois. Il a l'intention de les affronter dans une « bataille rangée » qu'il est confiant de remporter. De nombreux habitants sont venus grossir les rangs des rares soldats dont il dispose, et leur prêter main-forte. Mais l'ennemi semble se volatiliser dans la nature... Autre motif d'inquiétude, aucun renfort n'arrive de France, malgré les appels à l'aide. En désespoir de cause, le gouverneur se rabat sur des mesures défensives en encourageant les habitants, portés à se disperser, à se regrouper dans des villages fermés et fortifiés. C'est ainsi que s'érigent les villages de Saint-Pierre, à l'île d'Orléans, près de Québec, de Sainte-Marie, au Cap-de-la-Madeleine, non loin de Trois-Rivières. Même les moulins à vent sont fortifiés. Une mentalité d'état de siège gagne peu à peu du terrain chez les colons.
La bataille du Long-Sault. Une bataille légendaire
C'est dans cette atmosphère que s'inscrit l'aventure d'Adam Dollard, sieur des Ormeaux, et de ses 16 compagnons, qu'une vague d'historiographes canadiens a consacrés « sauveurs de la Nouvelle-France » et pratiquement canonisés, qu'une seconde a ravalé au rang de simples profiteurs en quête d'un chargement de fourrures ! Le débat s'est heureusement calmé. Vue dans une perspective militaire, l'expédition entreprise par le sieur des Ormeaux, jeune commandant de la garnison de Montréal, n'excluait pas, loin de là, la possibilité de profits à réaliser si lui et ses compagnons faisaient main basse sur les pelleteries. À cette époque, il était considéré comme normal et tout à fait légitime que les vainqueurs prélèvent un butin, et, depuis les militaires jusqu'au roi, personne ne s'en privait. On était encore loin de la solde régulièrement payée des armées d'aujourd'hui et c'était là un genre de boni, d'ailleurs réglementé par l'usage des parts proportionnelles aux rangs militaires.
L'expédition de Dollard sieur des Ormeaux fut surprise
La bataille du Long-Sault, en mai 1660
Cette gravure du début du XXe siècle montre le point culminant de la bataille livrée en 1660 par Adam Dollard des Ormeaux et ses hommes pour défendre Long-Sault contre les Iroquois. On voit ici un défenseur français tenir au-dessus de sa tête un tonnelet de poudre à canon. Cette bombe de fortune allait retomber à l'intérieur du fort et tuer presque toute la garnison.
Au printemps de 1660, Dollard et ses hommes quittent Montréal et empruntent la rivière des Outaouais, en direction nord-ouest. Il semble qu'ils veuillent protéger le convoi de fourrures des Outaouais, qui descend du nord-ouest. Arrivés à un fort abandonné, au Long-Sault, construit par les Algonquins l'automne précédent, ils sont rejoints par un parti de guerre formé de 40 Hurons et de quatre Algonquins. Survient alors, à l'improviste, un autre parti de guerre, non plus allié, cette fois, mais ennemi, et bien plus puissant, puisque constitué d'environ 200 guerriers iroquois. Ceux-ci sont fort surpris de trouver les Français sur leur route, et les Français ne le sont pas moins de les rencontrer. A cette saison, les Iroquois sont ordinairement dispersés sur l'Outaouais, pour chasser, et c'est sans doute à de telles petites bandes que Dollard voulait tendre un piège. Exceptionnellement, ils se trouvent rassemblés, en mai de cette année-là, pour aller rejoindre un autre corps, d'environ 400 guerriers, dans les îles situées à l'embouchure du Richelieu, aujourd'hui appelées îles de Sorel. Les Iroquois, des Onontagués, attaquent immédiatement, mais sont repoussés. Quelques-uns d'entre eux atteignent le Richelieu et le remontent en canot afin de demander du renfort aux Agniers et aux Onnéiouts. Ceux-ci arrivent avec des Hurons « iroquoisés », qui vont réussir à persuader une trentaine de leurs frères, dans le camp de Dollard, de les rejoindre. Les Iroquois, renforcés par les Hurons transfuges, s'approchent du fortin. Les défenseurs - ce qu'il en reste - tirent une salve et en abattent plusieurs. L'assaut général est donné, mais n'a pas plus de succès. Voyant cela, les Iroquois recourent aux méthodes qu'ils utilisent pour faire le siège de villages amérindiens : ils tentent de renverser la palissade. Pour les repousser, les Français leur lancent d'abord, en guise de grenades improvisées, deux canons de pistolets remplis de poudre, puis un baril de poudre. Et c'est la catastrophe. Le baril heurte un obstacle, retombe à l'intérieur du fortin et explose, fauchant une bonne partie de la petite garnison. Les Iroquois n'ont plus qu'à investir le fort. Il n'y reste, de vivants, que cinq Français et quatre Hurons.
Coutumes Amérindiennes au champ de bataille
la suite de cette bataille, les Iroquois décidèrent de rebrousser chemin et de rentrer chez eux. Leur retraite incita les chroniqueurs de l'époque à interpréter cette bataille du Long-Sault comme une victoire française due à l'héroïsme des défenseurs, qui infligèrent des pertes importantes à l'ennemi. Tout au contraire, ce fut, bien évidemment, une défaite française, puisque le fort fut pris et toute la garnison perdue. Quant aux pertes iroquoises, un rapport hollandais indique que les Iroquois mentionnèrent avoir eu 14 guerriers tués et 19 autres blessés en attaquant un « fort défendu par 17 Français et 100 sauvages ». On est loin de l'hécatombe !
Et ce n'est pas, non plus, la déroute quand, conformément aux coutumes amérindiennes, les guerriers, après avoir fait quelques prisonniers, décident simplement de retourner dans leurs villages. Un autre événement contribua un peu plus tard à alimenter la légende selon laquelle Dollard et ses hommes auraient sauvé la colonie au prix de leur vie. Durant l'automne, quelque 600 guerriers se mirent de nouveau en route vers la colonie française, mais rebroussèrent chemin à la suite d'un accident qu'ils attribuèrent au mauvais sort. Annuler une expédition de grande envergure pour de telles raisons est aussi naturel pour les Amérindiens qu'impensable dans la logique militaire européenne.
Des renforts isuffisants
La milice du Massachusetts commence à s'entraîner, 1637
Lorsque la colonie du Massachusetts forme des régiments de milice en 1637, les nouveaux miliciens imitent le plus fidèlement possible l'organisation et les tactiques européennes. Ces méthodes contrastent nettement avec celles des miliciens de Nouvelle-France. Reconstitution par Don Troiani.
En 1661, après l'accalmie de l'hiver, les raids reprennent de plus belle et font une centaine de victimes chez les Français. Les appels à l'aide trouvent quelque oreille à Paris et la Compagnie des Cent-Associés consent à envoyer au Canada une centaine de soldats. Ils arrivent en même temps que le nouveau gouverneur, Pierre Du Bois d'Avaugour, militaire d'expérience, ancien colonel de cavalerie et maréchal de camp ayant servi sous le maréchal Turenne. Le soulagement que ces quelques soldats apportent n'est guère ressenti dans la colonie, face aux centaines d'Iroquois qui sont à l'affût dans les bois. En 1662, les raids continuent de faire impunément d'autres victimes, dont Lambert Closse, major de Montréal.
On décide alors en haut lieu, au cours de cette année, de lever une autre centaine de soldats pour le Canada. Ils arrivent en octobre, répartis en deux compagnies, à bord de L'Aigle d'or et de La Flûte royale. Ces navires sont chargés, en outre, « des marchandises et munitions que l'on envoye pour les magasins ». Tout cela est encore bien insuffisant, face aux besoins de la colonie, mais un nouvel élément s'est ajouté au dossier : c'est sous la direction d'un nouveau conseiller d'État et intendant des finances, Jean-Baptiste Colbert, que ces soldats ont été levés et équipés. Cet homme d'envergure est également en charge de la Marine royale, dont ces deux navires ont été détachés. Il ne s'agit pas encore cependant de l'envoi d'une véritable troupe royale, mais plutôt d'une forme de subvention accordée par le roi à la Compagnie des Cent-Associés. Cette aide constitue, surtout, la première manifestation d'un nouvel intérêt royal pour les colonies en général, et le Canada en particulier.
D'autre part, c'est le 27 janvier 1663, en attendant les renforts promis, qui n'arrivent pas, que se forme à Montréal le premier corps de volontaires : la milice de la Sainte-Famille de Jésus-Marie-Joseph. Son but est de venir en aide à la garnison qui ne compte alors qu'une douzaine d'hommes, notamment pour monter la garde. Quelque 139 hommes s'y enrôlent. Ils forment 20 escouades de sept hommes chacune, incluant un caporal élu par ses camarades. De ces 20 caporaux, quatre seulement ont une expérience militaire. Ce corps sera dissous à l'arrivée des renforts, en 1665, et remplacé par une milice permanente.
Des colonies fragiles
En 1660, malgré tous leurs efforts pour s'implanter en Amérique du Nord, les Français ne peuvent guère se réjouir des résultats obtenus. Les Relations des Jésuites, publiées en France, dépeignent le Canada comme un endroit peu accueillant. La description du martyre des missionnaires n'a rien pour inciter la venue de nouveaux colons ! Pour protéger une colonie aussi exposée, il faudrait beaucoup de soldats. Or, la garnison est squelettique. L'Acadie offre peu d'attraits, avec son territoire trop convoité qui, finalement, glisse entre les doigts de la France et passe aux Anglais de Boston.
Il reste, néanmoins, qu'à travers tous ces avatars une Nouvelle-France a pris racine en Amérique du Nord. Elle vivote tant bien que mal, et sur un pied de guerre à peu près permanent, car personne n'y est à l'abri des Iroquois. Elle n'est pas la seule, cependant, à s'enraciner sur ce continent, pendant la première moitié du XVIIe siècle. Vers 1660, la Nouvelle-Hollande compte environ 10 000 habitants et les colonies anglaises quelque 90000.
La Nouvelle-France, elle, ne rassemble en tout et pour tout que 3 500 âmes... Il faudra une solution énergique pour qu'elle puisse prospérer et s'étendre sur de vastes territoires. Celle qu'adoptera la France sera essentiellement d'ordre militaire.
Les soldats du roi1000-1754
Les soldats du roi. Le contrôle royal remplace les compagnies privées
Tambour du régiment de Carignan-Salières 1665-1668, représenté pendant le service de ce régiment en Nouvelle-France. Il porte la livrée du prince de Carignan. Les armoiries de Carignan sont peintes sur le cylindre du tambour; l'écu central est une croix blanche sur fond rouge. Le tambour a pour rôle de communiquer les ordres du commandant par les roulements de son instrument. Reconstitution de Michel Pétard.
Quand meurt le cardinal Mazarin, en mars 1661, le jeune roi Louis XIV décide de gouverner par lui-même et prend les rênes du pouvoir. Jetant un regard critique « sur toutes les parties de l'État », il conclut que « de désordre régnait partout » dans son royaume. Ou bien la France est absente des terres nouvellement découvertes, ou bien son drapeau flotte sur de petits postes sans défense, à la merci des indigènes. Un vent de réformes, auquel l'armée n'échappe pas, s'abat immédiatement sur toutes les institutions françaises. C'est une véritable révolution que le souverain de 22 ans accomplit ainsi, « sans peine et sans bruit ».
Dès 1663, les grandes réformes étant bien amorcées dans la métropole, le roi et ses ministres s'attaquent au problème colonial. La première mesure qui s'impose est de briser le monopole des compagnies de commerce et de leur substituer l'autorité royale. Pour les remplacer on met sur pied les Compagnies des Indes occidentales et orientales. À la différence de celles qui les ont précédées, celles-ci sont des créations royales où le trésor de l'État se joint au capital privé, où la marine royale escorte la marine marchande, et où le roi exerce un droit de regard accru sur la gestion des colonies.
Cette importante mesure administrative ne change cependant rien au fait que les colonies restent toujours aussi faibles. Le roi en prend conscience et décide alors de donner une puissante impulsion au monde colonial français en jetant dans le jeu son armée.
L'envoi de troupes royales. La première priorité des Antilles
Pour la première fois de l'histoire militaire française, on va donc détacher des troupes de l'armée royale pour servir outre-mer. En 1664, 200 soldats se rendent aux Antilles. Ils accompagnent le marquis Prouville de Tracy, nommé lieutenant général de toute l'Amérique française, qui fait route vers la Guyane et la Martinique. Ces soldats, les premiers du contingent destiné aux colonies, appartiennent à quatre compagnies d'infanterie tirées des régiments de Lignières, de Chambellé, de Poitou et d'Orléans. L'année suivante, en 1665, quatre autres compagnies quitteront la France, cette fois à destination de Madagascar et des îles de l'océan Indien.
Un régiment pour le Canada
Dans cette nouvelle politique coloniale, le Canada se voit attribuer « la part du lion ». Durant l'été 1665, un régiment entier - 1 000 hommes répartis en 20 compagnies - débarque à Québec : le régiment de Carignan-Salières, devenu quasi légendaire dans l'histoire de notre pays.
Ce corps militaire tenait son nom du colonel Thomas-François de Savoie, prince de Carignan, qui, en 1644, le leva au Piémont, dans le nord de l'Italie. Au cours de la décennie suivante, on fit du recrutement en France, et ce caractère piémontais fut noyé graduellement. La paix des Pyrénées de 1659, signée entre l'Espagne et la France, entraîna dans l'armée la réduction du nombre de régiments. Au lieu d'être dissous, celui de Carignan fut fusionné avec un autre. Le 31 mai de cette année-là, le prince de Carignan fut avisé, fort civilement, qu'en son absence le commandement avait été donné « à une personne d'expérience et de capacité ... le sieur de Salières ... colonel d'un régiment d'infanterie qui est à présent incorporé dans le vôtre ». Le régiment de Salières avait été levé en 1630.
Offensives contre les Iroquois. Un nouvel équilibre du pouvoir?
Fantassins français au camp, 1667
Les troupes françaises du régiment de Carignan-Salières stationnées au Canada à partir de 1665 ont vraisemblablement la même apparence que les soldats montrés dans cette image de 1667.
La présence d'un tel corps de troupes au Canada ne pouvait que changer radicalement la situation, jusqu'alors fort précaire, de la colonie. Enfin, on peut pourvoir les villes de garnisons ! Enfin, on peut construire les forts qu'il faut pour contrôler le Richelieu, route traditionnelle des Iroquois ! L'enthousiasme est tel que de nombreux volontaires canadiens se mobilisent pour appuyer le régiment de Carignan-Salières. En quelques semaines, la petite colonie française, que la nécessité avait obligée depuis un quart de siècle à se replier dans une attitude défensive, modifie sa mentalité d'assiégée au profit de l'esprit d'offensive. On envisage une nouvelle tactique : attaquer l'Iroquois chez lui !
Le premier fort Chambly, construit en 1665
Cette maquette représente le premier fort Chambly. L'édifice original en billots de bois, construit en 1665, est typique des plus anciens forts du Canada.
Une attaque contre les Iroquois
Carte des campagnes menées par le régiment de Carignan-Salières en 1665-1666
En 1665 et en 1666, le régiment de Carignan-Salières fait campagne contre les Iroquois dans la région montrée par la carte. Après être débarqué à Québec, le régiment se rend à Montréal, construit plusieurs forts sur la rivière Richelieu, mène sans succès un raid hivernal contre les Iroquois au sud, puis réussit dans une deuxième tentative en septembre.
L'idée ne manque pas d'audace. Les nouveaux arrivés ne sont pas familiers avec le pays, ni avec les distances, les tactiques amérindiennes et le climat. Tout ceci rend l'entreprise périlleuse, mais les commandants ne veulent pas perdre l'initiative de l'action. Dès janvier 1666, quelque 300 soldats, auxquels se sont joints 200 volontaires canadiens, partent à pied de Québec, sous le commandement du gouverneur Courcelles, et, marchant péniblement dans la neige, entreprennent de se rendre au pays des Iroquois. Campagne étonnante, étant donné qu'à cette époque ni les Européens ni les Amérindiens ne se battent habituellement en hiver. Au fort Sainte-Thérèse, un groupe de volontaires montréalais vient grossir les rangs de cette troupe et l'expédition se remet en marche, connaissant à peine sa position exacte. Et le 17 février, les Hollandais du village de Schenectady ont la surprise de voir surgir du bois un grand nombre de soldats français, certains chaussés de raquettes, plusieurs tirant des « traînes sauvages » (toboggans) sur lesquelles sont empilées de maigres provisions... N'étant pas en guerre, ils veulent bien les tolérer le temps qu'ils refassent leurs forces. Mais les événements se précipitent. À peine les Français se sont-ils arrêtés qu'éclate une escarmouche avec les Agniers, jusqu'alors introuvables. Puis survient une délégation qui demande à Courcelles le pourquoi de cette incursion si près des postes du roi d'Angleterre ! Courcelles va de surprise en surprise : il se trouve chez les Hollandais alors qu'il se croyait chez les Iroquois, il apprend que la NouvelleHollande est devenue la colonie de New York et qu'Orange se nomme maintenant Albany... C'est qu'en effet le territoire hollandais est passé aux mains des Anglais l'année précédente, nouvelle qui n'était pas encore parvenue à Québec avant son départ. Les villages agniers ne sont plus désormais qu'à trois jours de marche de Schenectady, mais les Français sont épuisés et près de la famine. Ils obtiennent des Hollandais du pain et des pois, et, la rage au cœur, prend le chemin du retour...
Résultats variés
Les pertes furent difficiles à évaluer de part et d'autre. Les Agniers prétendirent avoir tué une douzaine de soldats français, en avoir capturé deux et en avoir trouvé cinq autres morts de faim et de froid, tout en déclarant n'avoir eu que trois guerriers tués et cinq blessés. Ils ajoutèrent n'avoir pu causer de sérieux dommages à l'expédition française, qui était très mobile. Ceci concorde avec les rapports français. On croit d'abord avoir perdu une soixantaine d'hommes, mais on se ravise, car on signale par la suite « que la plupart des soldats qu'on croyait perdus reviennent tous les jours ».
En définitive, cette première sortie du régiment de Carignan-Salières fut un fiasco par rapport aux objectifs qu'elle poursuivait, à savoir la destruction des villages iroquois. D'autre part, on y a accompli quelque chose de quasiment impensable : mener une expédition guerrière en plein hiver canadien, déplaçant plus d'un demi-millier d'hommes sur des centaines de kilomètres, en pays vierge et en terrain accidenté, ceci dans un des environnements les plus hostiles qui soient.
Les Français tirèrent de nombreuses leçons de cette expédition hivernale d'envergure, la première à n’avoir jamais été tentée en Nouvelle-France. Ils y apprirent, notamment, l'importance cruciale d'avoir des guides fiables, car, pour ajouter aux difficultés de la chose, les 30 Algonquins qui devaient mener la troupe en Iroquoisie ne furent d'aucune utilité durant près de trois semaines, s'étant enivrés. Ils comprirent aussi la nécessité d'avoir une logistique solide ainsi qu'un équipement et un habillement permettant de survivre dans des conditions aussi difficiles. Toute cette expérience leur servira plus tard.
La lutte se poursuit
Fantassins français en marche, 1667
Aux XVIIe et aux XVIIIe siècles, les armées ne marchent pas nécessairement en rangs, et même la marche au pas est peu commune jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Les soldats français du régiment de Carignan-Salières stationnés au Canada à partir de 1665 auraient eu le même genre de démarche.
Durant le printemps et l'été 1666, les rapports entre Français et Iroquois alternent entre escarmouches et tentatives de pourparlers de paix. En juillet, le capitaine Sorel, à la tête de 200 soldats et volontaires accompagnés d'environ 80 Amérindiens alliés, parvient à se rendre à proximité d'un village iroquois. Ceux-ci envoient une ambassade de paix et libèrent quelques captifs français, avec lesquels Sorel rentre à Québec. Cette expédition apprend à ses chefs qu'on peut pénétrer facilement le pays iroquois. Fatigué des longs palabres ponctués d'incidents sanglants, le marquis de Tracy se prononce alors en faveur d'une expédition majeure. Celle-ci a lieu en septembre 1666. À la tête d'une petite armée composée de 700 soldats, de 400 volontaires canadiens - dont un bataillon de Montréalais, les plus expérimentés dans la guerre amérindienne - et d'une centaine d'alliés hurons et algonquins, Tracy, Courcelles et Salières marchent, tambour battant, jusqu'au cœur du territoire des Iroquois. Ceux-ci se cachent dans la forêt et n'opposent aucune résistance, laissant les Français brûler quatre de leurs villages et leurs récoltes de maïs. Ces fiers guerriers, invincibles à la guérilla mais impuissants quand on les attaque chez eux, se rendent alors compte que leurs voisins et amis, les Anglais et les Hollandais, ne les appuient pas militairement. D'autres considérations assombrissent encore leurs perspectives d'avenir. Leurs forêts se dégarnissent tandis que les Outaouais, dont le territoire, au nord, abonde en animaux à fourrure, sont en train de s'emparer du marché. Enfin, la famine engendrée par la destruction de leurs récoltes a fait périr des centaines d'Agniers. Toutes ces raisons incitent les Iroquois à refaire leurs forces en attendant des jours meilleurs. Leurs chefs se décident alors à conclure la paix et amorcent des pourparlers avec les Français. On déplore peu d'incidents par la suite, et celle-ci est signée en juillet 1667, après de longues et tortueuses négociations.
La paix
Le succès de la mission du régiment de Carignan-Salières assure à la Nouvelle-France une ère de paix et de prospérité. Ses colons peuvent maintenant s'établir et travailler sans craindre constamment pour leur vie. Les forts qui se dressent tout le long du Richelieu sont destinés non seulement à gêner tout mouvement venant du sud, mais à servir de bases pour porter la guerre jusqu'au cœur de l'Iroquoisie. C'est donc dire que l'initiative de l'offensive a changé de camp. Devant les explorateurs et les commerçants français s'ouvre toute grande la route vers l'Ouest, aux territoires riches en fourrures. Enfin, aux nations que les Iroquois ont anéanties se substituent les Outaouais, les Ojibwés et les Algonquins, à titre de partenaires commerciaux et d'alliés militaires.
La colonisation militaire
Le roi réservait cependant une autre mission pour ses troupes au Canada. Prévue avant leur départ pour la colonie, elle avait été tenue secrète jusqu'à la fin des hostilités. La Nouvelle-France est peu peuplée. Pour corriger la situation, le roi désire que l'on incite les soldats des 24 compagnies « à demeurer dans le pays » en leur procurant les moyens « de s'y établir ». Ainsi, les officiers se voient offrir des seigneuries. Offre alléchante puisque posséder ses propres terres, c'est-à-dire devenir seigneur, est presque impossible en France. Quelque 30 officiers se prévaudront de ce privilège en 1667 et 1668. Les titres de la plupart des nouvelles seigneuries seront officiellement concédés à leurs propriétaires cinq ans plus tard. Plusieurs porteront le nom de leur titulaire. Ainsi, les villes actuelles de Berthier, Chambly, Contrecoeur, Boisbriand, Saint-Ours et Sorel commémorent leurs premiers seigneurs, auparavant capitaines du régiment de Carignan-Salières ; Lavaltrie, Soulanges et Varennes rappellent le souvenir d'anciens lieutenants, tandis que les enseignes Brucy et Verchères ont enrichi de leurs noms la toponymie québécoise.
Pour les simples soldats il y a également de nombreux avantages à rester. Posséder sa propre terre et s'y établir avec une aide substantielle sous forme de bétail et de vivres, au lieu de s'en retourner et possiblement travailler comme serf, quoi de plus tentant ? Aussi, 404 d'entre eux et 12 sergents se laisseront-ils gagner. En France, le sentiment de confiance engendré par l'action vigoureuse des troupes du roi favorise sans aucun doute l'émigration vers le Canada, car, à la même époque, plus de 2 000 Français se décident à partir. Avec tous ces apports, le chiffre de la population double, de 1665 à 1672, et passe à 7 000 personnes.
Ces mesures n'entraînent pas la dissolution complète du régiment de Carignan-Salières. Les deux compagnies colonelles rentrent en France avec le colonel Salières, en juin 1668, et le régiment y fait un nouveau recrutement.
Une garnison « royale »
Louis de Buade, comte de Frontenac (1622-1698)
On ne connaît aucun portrait contemporain de Louis de Buade, comte de Frontenac (1622-1698). Cette statue du célèbre gouverneur général de Nouvelle-France (1672-1682, 1689-1698) provient de la façade de l'hôtel du Parlement à Québec, conçue par Eugène-Étienne Taché (1836-1912). On la voit ici dans une gravure du début du XXe siècle.
Au Canada, on garde sur pied quatre compagnies de 75 hommes chacune, officiers compris. Deux de ces compagnies sont affectées à Montréal et deux à Chambly. De ces dernières, 30 hommes seront détachés à Saint-Jean et 20 autres au fort Sainte-Anne. Ces quatre compagnies montent la garde jusqu'en 1670, alors qu'elles sont renforcées par cinq compagnies de 50 hommes chacune, envoyées de France et commandées par des officiers du régiment de Carignan-Salières. Il semble que ces troupes maintiennent la filiation avec le régiment par un genre de statut de compagnies détachées outre-mer. L'intendant Talon note que le capitaine Laubia « de Carignan-Salières » commande l'une des « compagnies... renvoyées en Canada en 1670 ». Cependant, en 1671, on licencie toutes ces troupes, enjoignant les officiers à ne pas revenir en France et encourageant « fortement tous les soldats à travailler au défrichement et à la culture des terres».
Le licenciement des compagnies, décision favorable au peuplement, ne laisse cependant sur place qu'une très mince garnison à Québec, deux sergents et 25 soldats; dans chacune des villes de Trois-Rivières et de Montréal, 10 soldats seulement. Avec les 20 gardes du gouverneur général et les 10 soldats du fort Frontenac, que le sieur de La Salle a l'obligation d'entretenir « à ses dépens », à partir de 1675, on obtient un total de 77 hommes. Cette pénurie de soldats de métier laisse les forts sur le Richelieu pratiquement sans défense. Aussi, durant cette période, assiste-t-on à une lente détérioration des relations franco-iroquoises.
Les Iroquois, observant l'affaiblissement de la défense militaire canadienne, songent en effet à reprendre la guerre. Pour se venger des humiliations qu'ils ont subies, ils cherchent, depuis que la paix est conclue, à neutraliser les nouveaux alliés amérindiens des Français et à s'emparer de leur commerce de fourrures. Dans la colonie, d'autre part, on a de bonnes raisons de craindre que les 2 500 guerriers des Cinq Nations, bien pourvus en fusils britanniques, ne détruisent les tribus de l'Ouest avec qui les rapports sont bons, comme ils l'ont fait des Hurons, ainsi que les postes de traite et les missions jésuites récemment établies à Michillimakinac et dans les Illinois. La situation s'aggrave durant les années 1670 mais, grâce en bonne partie à l'habile diplomatie de Louis de Buade, comte de Frontenac, le danger est contenu. À peine celui-ci est-il remplacé au poste de gouverneur général, en 1682, par Joseph-Antoine Lefebvre de La Barre, que les Illinois, les Miamis et les Outaouais, attaqués, se voient forcés de demander la protection française. Pour défendre ce vaste territoire et venir en aide à ses alliés, de La Barre, dont le projet de conférence générale a essuyé le refus dédaigneux des Iroquois, ne dispose que d'une poignée de soldats. Mais il peut aussi compter sur environ 1 000 miliciens car, au cours de la décennie qui vient de se terminer, la colonie s'est dotée de cette importante ressource, appelée à jouer un rôle décisif dans la défense du pays : une milice.
La fondation de la milice canadienne
Le château Saint-Louis et son fort à Québec, en 1683
Les murs du fort surmontant le cap Diamant sont construits en 1636 et démolis en 1693. Cette gravure de l'époque montre le premier château Saint-Louis en 1683. Il est construit en 1647 et démoli en 1694 pour faire place à un édifice plus grand. C'est dans le deuxième château qu'un messager va présenter, de la part de Sir William Phips, une sommation à se rendre au comte de Frontenac, qui répond par la phrase célèbre : « Je vous répondrai par la bouche des mes canons. » Durant le siège de 1690, le fort sert de citadelle des fortifications de Québec. Les maisons à droite bordent un chemin étroit (aujourd'hui la rue du Petit-Champlain) qui mène à la basse ville. Gravure d'après Jean-Baptiste Franquelin.
Avant 1669, à moins de situations d'urgence, le colon français au Canada n'était pas obligé de servir à l'occasion en tant que soldat. Il n'existait pas, non plus, d'organisation militaire permanente visant à regrouper les hommes. Une lettre de Louis XIV va changer tout cela. Le 3 avril 1669, en effet, le roi ordonne à Courcelles, alors gouverneur, de « diviser » ses sujets au Canada par compagnies « ayant égard à leur proximité, qu'après les avoir ainsi divisés, vous établissiez des capitaines, lieutenants et enseignes pour les commander... vous donniez les ordres qu'ils s'assemblent une fois chaque mois pour faire l'exercice du maniement des armes ». On doit prendre soin, ajoute-t-il, qu'ils soient « toujours bien armés, et qu'ils aient toujours la poudre, plomb et mèches nécessaires pour pouvoir se servir de leurs armes dans les occasions ».
Ces quelques lignes signent l'acte de naissance de la milice canadienne. Elles sont l'équivalent d'un programme général d'organisation et de mobilisation dont la réalisation va demander plusieurs années d'efforts. C'est surtout au comte de Frontenac, qui succédera à Courcelles en 1672, qu'incombera la tâche de mettre en place cette considérable organisation à travers le pays. Pour ce faire, il s'inspira certainement de la milice garde-côte telle qu'elle existait en France à l'époque, car la milice canadienne offre beaucoup de parenté avec elle.
Il lui semble tout naturel, par exemple, d'utiliser la paroisse comme point de ralliement. Chacune possédera donc sa propre compagnie de milice, et les plus populeuses en auront même plusieurs. La composition de ces compagnies est exactement calquée sur celle des troupes régulières : à la tête, un capitaine, assisté d'un lieutenant et d'un enseigne, ensuite quelques sergents et caporaux, puis de simples soldats. En tout, une cinquantaine d'hommes.
Chaque paroisse se trouve rattachée à l'un des trois districts gouvernementaux de la colonie : Québec, Trois-Rivières ou Montréal. Dans chacun d'eux se trouve un état-major de milice comportant un colonel, un lieutenant-colonel et un major. Le gouverneur du district détient le commandement supérieur, tandis que le gouverneur général du pays est en même temps le commandant suprême de toute la milice. L'intendant peut, cependant, requérir les miliciens pour des causes civiles.
Tous les hommes en état de porter les armes, âgés de 16 à 60 ans, doivent faire partie de la compagnie de milice de leur paroisse et participer à ses activités, ce qui représente entre le cinquième et le quart de la population totale de la colonie. Il y a environ 3 500 miliciens en 1710; on en compte 11 687 en 1750, et ils sont divisés en 165 compagnies commandées par 724 officiers et 498 sergents. Seuls les religieux et les seigneurs sont exemptés de ce service, encore que ces derniers soient presque tous officiers dans les troupes régulières ou dans la milice.
Franc-tireur et voyageur endurci
Le colon français de la seconde moitié du XVIIe siècle était un homme qui, par son mode de vie même, avait développé de multiples habiletés. L'ensemble de la population de la Nouvelle-France était alors groupé le long des rives du Saint-Laurent, où plusieurs possédaient des terres. Il n'était pas rare de voir le cultivateur de l'été se métamorphoser en chasseur l'automne venu, puis s'adonner à quelque petit métier, peut-être à la trappe ou à la traite, durant l'hiver, ce qui l'obligeait à parcourir de grandes distances en raquettes, pour ensuite retourner à ses champs au printemps. Sans parler des excursions de pêche qui lui fournissaient maintes occasions de s'entraîner au canotage ! Un observateur donne des Canadiens de cette époque la description suivante : ils sont « bien faits, agiles, vigoureux, jouissant d'une parfaite santé, capables de soutenir toutes sortes de fatigues... et belliqueux ... nés dans un pays de bon air, nourris de bonne nourriture et abondante... ils ont la liberté de s'exercer dès l'enfance à la pêche, à la chasse et dans les voyages en canot où il y a beaucoup d'exercices ». Un autre ajoute que le « Canadien est très brave » et qu'il est plus habile à tirer du fusil « que tout autre au monde ».
Voilà qui annonce un type d'hommes possédant une aptitude exceptionnelle pour la guerre de raids ! On décèle pourtant chez les Canadiens une certaine réticence à participer aux activités militaires. Frontenac note que, comparés aux soldats de métier, les miliciens ne veulent guère quitter leurs foyers et ne peuvent être très utiles pour les expéditions. Mais ceci concerne la période paisible des années 1670. Vingt-cinq ans plus tard, on constatera chez eux un changement d'attitude considérable, engendré par la guerre intermittente menée contre les Iroquois depuis le début des années 1680. Aux côtés de leurs alliés amérindiens, les robustes Canadiens sont alors de tous les raids, et ces excursions militaires sont si pénibles qu'il « n'y a pas 300 hommes dans les troupes régulières capables de les suivre »
L'Acadie
Dans sa nouvelle politique coloniale, Louis XIV n'oublie pas l'Acadie. Elle aussi recevra ses « soldats du Roy », mais il faudra d'abord attendre qu'elle soit rétrocédée à la France par le traité de Bréda, en 1667, car les miliciens du Massachusetts l'occupent depuis 1654. La prise de possession effective n'a lieu que trois ans plus tard, en août 1670, quand le sieur de Grandfontaine, débarquant en Acadie en qualité de gouverneur, exige et obtient des Anglais la restitution de la colonie, conformément au traité. Il est escorté d'une compagnie de 50 soldats dont il est le capitaine. Celle-ci se trouve être la sixième du contingent de soldats de Carignan-Salières renvoyés en Nouvelle-France, et le sieur de Grandfontaine est lui-même un vétéran des campagnes de 1665 et 1666 contre les Iroquois. C'est la première fois que des troupes royales sont envoyées en Acadie.
Tout comme les cinq compagnies affectées au Canada, celle de Grandfontaine est licenciée en 1671 et ses membres peuvent choisir de s'établir au pays. La perspective semble leur plaire car plusieurs font déjà de la pêche et « presque tous les soldats se disposent à s'habituer et même à se marier, s'il leur vient des filles de France ».
Ils auront peu de temps pour le faire. En 1672, Louis XIV déclare la guerre à la Hollande. Deux ans plus tard, un corsaire battant pavillon de ce pays mouille dans les eaux acadiennes. Aucun navire français n'assure la défense des côtes et celle des forts est faible également. Les Français résistent de leur mieux, mais ne peuvent empêcher que Pentagoët et Jemsec ne soient pris et pillés. Le capitaine Chambly, qui est alors gouverneur, et ses officiers sont fait prisonniers et emmenés à Boston. Libérés peu après, sans doute en raison de la neutralité des Anglais dans le conflit franco-hollandais, ils retournent en Acadie, mais la colonie, n'ayant pas de troupes régulières ni encore de milice, est pratiquement sans défense, situation qui persistera tout au long des années 1680.
Plaisance, Terre-Neuve
Au milieu du XVIIe siècle, on ressent de plus en plus fortement, tant du côté anglais que français, le besoin d'avoir une base navale permanente à proximité des grands bancs de Terre-Neuve, afin que les morutiers puissent faire escale pour approvisionner leurs navires et trouver protection contre les navires ennemis. En 1651, Olivier Cromwell, alors « Seigneur-Protecteur » de la Grande-Bretagne, nomme un gouverneur à St. John's, établissement situé dans la partie est de l'île.
Le havre de Plaisance, au sud-est de Terre-Neuve, déjà fréquenté par les pêcheurs français, sembla tout indiqué à la France de Louis XIV pour y établir sa propre base. Une première colonie y fut fondée en 1660 et fut pourvue d'une petite garnison en 1662. Mais bientôt les soldats se mutinèrent, assassinèrent le gouverneur, Du Perron, et pillèrent le fort avant de s'entre-tuer. Les huit survivants tentèrent d'atteindre les établissements anglais, de sorte que, l'année suivante, lorsque les navires amenèrent de France une vingtaine de colons et de soldats, ils trouvèrent la colonie dévastée et le fort abandonné. D'autres soldats arriveront en 1667, mais la garnison semble quasi inexistante par la suite. C'est dans cet état que vivotera la base jusqu'à l'arrivée des troupes de la Marine, en 1687.
Une ère de progrès
La période marquée par l'envoi du régiment de Carignan-Salières apporta à la colonie française une paix que l'on désespérait de voir jamais se réaliser et donna un essor extraordinaire à la colonisation. Elle a été l'une des plus déterminantes de l'histoire de la Nouvelle-France. Le licenciement des troupes, s'il affaiblit la défense du pays, donna lieu à une autre initiative royale qui se révéla tout aussi profitable, la fondation d'une milice canadienne. Sur ces acquis solides, qui permirent une première percée vers l'ouest et vers le sud, commença à prendre forme un rêve à la mesure de l'Amérique : la création d'un grand empire français. Cependant, le contrôle de l'accès au continent par le Saint-Laurent, particulièrement en Acadie et à Terre-Neuve, demeura faible. De plus, un autre ennemi pointait à l'horizon : les colonies britanniques, déjà populeuses et de plus en plus agressives.
Les Compagnies franches de la Marine du Canada1000-1754
Les Compagnies franches de la Marine du Canada.Le changement commence dans les Antilles
En 1674, au cours de la guerre que Louis XIV livre à la Hollande, une flotte commandée par l'amiral Ruyter arrive en vue de la Martinique, qui est pratiquement sans défense. L'attaque est repoussée, par miracle, mais l'alerte a été chaude ! À Versailles, on se rend compte que l'on est passé à deux doigts de perdre la plus importante des îles françaises des Caraïbes, faute d'y avoir entretenu une garnison convenable. Le ministère de la Marine, auquel incombe, depuis sa création en 1669, non seulement la responsabilité de la flotte de guerre du pays, mais celle des colonies d'Amérique, lève en toute hâte 470 hommes et huit officiers. Ils arrivent à la Martinique avant la fin de l'année. Durant les années 1670, on comblera la même lacune dans toutes les îles françaises ainsi qu'à la Guyane. C'est le début de l'armée coloniale française.
Le ministère de la Marine prend le contrôle. Militarisation de la Nouvelle-France
Fort Lachine (aussi appelé Fort Rémy)
Cette structure, construite à partir de 1671, est typique des forts à palissade en billots de bois servant à protéger les établissements à l'ouest de Montréal. Le fort Lachine (ou Fort Rémy) est caractérisé par : 1) un moulin à vent, 2) la maison du prêtre, 3) une chapelle, 4) la maison de Jean Milot, antérieurement occupée par l'explorateur Robert Cavelier de la Salle, 5) une grange, 6) des palissades, 7) des bastions, 8) les casernes, 9) une poudrière.
En Nouvelle-France, les milices, qu'on vient de mettre sur pied, ne peuvent suffire à assurer la sécurité de la colonie, en butte aux menaces et aux attaques ennemies tout au long des années 1670 et 1680. Afin de pallier la situation et pour favoriser l'expansion française en Amérique, Louis XIV opte pour l'établissement de fortes garnisons entretenues par le trésor royal. Au Canada, leurs effectifs seront recrutés progressivement à même la population de gentilshommes du pays. C'est la naissance des Forces armées canadiennes.
La société de la Nouvelle-France sera profondément transformée par cette nouvelle expression de la volonté royale. En effet, tandis que les soldats démobilisés deviendront la principale source d'approvisionnement en nouveaux colons, une bonne partie de l'élite coloniale se composera désormais d'officiers militaires et ceux-ci acquerront de ce fait une influence considérable dans tous les aspects de la vie du pays. Mais c'est surtout par l'épée que ces militaires vont se distinguer, en mettant au point une tactique de combat originale et terriblement efficace.
Cet important volet de l'histoire militaire et sociale du Canada débute vers la fin de l'année 1683. En juin de cette année-là, de La Barre, incapable de freiner la nouvelle montée de l'hostilité iroquoise, expédie d'urgence en France une lettre dans laquelle il demande des troupes et des armes pour contrer une situation militaire quasi désespérée. Ce n'est qu'au mois d'août que le marquis de Seignelay, ministre de la Marine, prendra connaissance de l'appel à l'aide du gouverneur général de la Nouvelle-France. À cette date, le convoi de navires à destination du Canada est déjà en route, mais on recrute immédiatement 150 soldats à Rochefort et on les embarque aussitôt sur la frégate La Tempête. Au début de novembre, le navire jette l'ancre à Québec et trois « Compagnies franches de la Marine » - ainsi qu'on appelle ces troupes appelées à servir outre-mer, par opposition à l'armée « de terre », active uniquement en Europe - débarquent en Nouvelle-France.
Des officiers canadiens. Des officiers font la différence
Couleurs de colonel et d'unité des Compagnies franches de la Marine, XVIIIe siècle
Couleur blanche de colonel et couleurs bleue et rouge d'unité des Compagnies franches de la Marine au XVIIIe siècle.
L'apport des troupes de la Marine fera grimper jusqu'à 1 500 le nombre d'officiers et de soldats de la colonie au cours des années 1680. Ce nombre se stabilisera autour de 900 pendant la première moitié du XVIIIe siècle. De 1689 à 1749, il y aura 28 compagnies en garnison.
Les compagnies de la Marine établies au Canada se distinguent très tôt par la forte proportion d'officiers qu'on y compte par rapport au nombre de soldats. Dès 1687, on passe, théoriquement, de deux à trois officiers par compagnie. Dans les faits, il y en aura aussi un quatrième, recruté parmi les familles de gentilshommes canadiens : l'enseigne en second ou « petit officier ». Ce sera là une initiative du gouverneur Denonville, qui a noté les excellentes dispositions guerrières des jeunes hommes issus de la nouvelle élite canadienne. Un geste qui aura, au fil des années, des répercussions considérables sur la vie militaire et sociale de la colonie.
Une autre pratique, qui débute probablement au cours des années 1680, favorise l'intégration de militaires coloniaux dans l'armée régulière : la coutume, chez les familles d'officiers établies au pays, de fournir l'armée en cadets afin que leurs jeunes fils s'acheminent vers la carrière des armes et obtiennent à leur tour leur brevet d'officier. Au début du XVIIIe siècle, on trouve dans les troupes « une belle jeunesse de qualité... fils d'officiers... ayant la paye de soldat », dont on encourage la promotion. Un quart de siècle plus tard, cependant, on constate qu'il y a dans les compagnies trop de cadets qui ne sont « que des enfants » et qui prennent la place de véritables soldats. Le roi ordonne de corriger la situation en restreignant leur nombre, puis, en 1731, émet une ordonnance royale établissant officiellement le rang de cadet dans les troupes du Canada, à raison d'un par compagnie. En signe distinctif, ils portent à l'épaule, sur leur uniforme, un cordon bleu et blanc, d'où le nom de « cadets à l'aiguillette » qu'on leur donne. Mais les 28 places disponibles au sein des Compagnies franches de la Marine ne suffisent pas à loger tous ces fils d'officiers et l'on voit apparaître, officieusement, des « cadets-soldats », genre de cadets en second, qui seront finalement réglementés à un par compagnie, en 1750.
Les cadets sont comptés au nombre des soldats lors des revues, et ils doivent servir avec eux pour apprendre le maniement des armes. Par ailleurs, ils bénéficient de la protection des officiers (souvent des membres de leur famille), et on leur donne, à l'occasion, la possibilité d'exercer le commandement. Étant proches à la fois des officiers et des soldats, ces jeunes gens s'avèrent d'une grande utilité pour connaître l'esprit des troupes.
Officier des Compagnies franches de la Marine du Canada
Même si les officiers des Compagnies franches de la Marine du Canada ne sont pas tenus de porter un uniforme en particulier, il reste que durant les années 1690, nombre d'entre eux portent les mêmes couleurs que leurs soldats, c'est-à-dire le gris-blanc et le bleu. L'épée et l'esponton (ou demi-pique) sont les armes réglementaires.
Les campagnes au Canada
Carte des principales campagnes menées en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre
Cette carte présente les théâtres d'opérations des campagnes menées en Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre entre 1686 et 1711.
L'arrivée des troupes de la Marine, en réponse à la demande d'aide de De La Barre, provoque un changement immédiat de tactique. En 1684, c'est une véritable petite armée qui part en expédition contre les Tsonnontouans, l'une des cinq nations iroquoises, et se rend au fort Frontenac pour les affronter. Mais ce gouverneur n'est pas aussi hardi que ses prédécesseurs et il consent à accorder la paix sans livrer bataille, ce qui n'impressionne guère les Iroquois.
Aussi, en 1687, le nouveau gouverneur général, le marquis de Denonville, devra-t-il entreprendre une seconde expédition contre ces mêmes Iroquois. Il est à la tête d'une armée de 800 soldats, de 1 100 miliciens et de 400 alliés amérindiens. Dans un ultime effort pour sauver leurs bourgs, les Tsonnontouans engagent la bataille. D'abord effrayés par l'effet de surprise et les cris affreux des autochtones, les Français se rallient et les Compagnies franches chargent, ce qui fait fuir l'ennemi. Dans leur course, les Amérindiens abandonnent fusils et couvertures. À nouveau, les villages et les récoltes sont incendiés. Des détachements des Compagnies franches se rendront ensuite jusqu'à Michillimakinac, à la jonction des lacs Michigan et Supérieur, où leur action empêchera les Iroquois et les Anglais de s'emparer du commerce des fourrures de l'Ouest.
Le problème de la défense stratégique du Canada
Fort de la Montagne, construit en 1685
Le fort de la Montagne était situé à quelques centaines de mètres seulement de Montréal, sur les flancs du mont Royal tel qu'on le voit vers 1690. Il comprenait : A) la chapelle Notre-Dame-des-Neiges; B) la maison des prêtres missionnaires; C) des tourelles, également utilisées comme école par les sœurs de la Congrégation; D) une grange servant d'abri pour les femmes et les enfants pendant les attaques; E) des tourelles; F) un village indien. Les tourelles indiquées en « C » sont toujours visibles aujourd'hui. Dessin tiré de C.P. Beaubien, « Le Sault-au-Récollet », Montréal, 1898.
Les Iroquois ne sont pas les seuls ennemis auxquels auront à faire face les officiers français nouvellement arrivés au cours de cette décennie de 1680-1690, alors que se multiplient les signes avant-coureurs d'un conflit entre la France et l'Angleterre comment repousser une éventuelle invasion britannique, quand la colonie est aussi étendue et que l'on dispose d'aussi peu d'hommes ? Telle est la question cruciale à laquelle ils devront trouver réponse.
Du côté défensif, de solides fortifications demeurent, certes, la mesure fondamentale à prendre. Or, quand elles existent dans la colonie, elles sont dans un état déplorable. On décide donc de remettre en état le fort Frontenac et d'entourer Montréal d'une palissade, ces deux endroits étant les plus exposés aux attaques des Iroquois, alliés des Anglais. Quant à la ville de Québec, qui a l'avantage d'être une forteresse naturelle, elle est dépourvue d'enceinte et possède seulement quelques batteries et un mauvais fort, le château Saint-Louis, qui sert aussi de résidence au gouverneur général. Bien qu'on ne croie guère, à Versailles, que Québec puisse être attaquée par le Saint-Laurent, on se ravisera, en 1690, et on pourvoira la ville d'une enceinte comportant 16 redoutes reliées par une palissade. Ce sera le premier des nombreux ouvrages défensifs à être élevé sur ce site.
La tactique européenne impraticable au Canada
Si l'officier français chargé de vérifier l'état des fortifications en Nouvelle-France peut s'inspirer des usages prescrits dans les ouvrages militaires et tenir compte des avis que lui font parvenir ses pairs de la métropole, il en va tout autrement pour le stratège qui réfléchit aux problèmes que pose, dans les vastes étendues sauvages de l'Amérique du Nord, la défense du territoire. Car, aux complications causées par la dimension géographique, s'ajoute le problème d'un hiver rigoureux qui n'a son pareil en Europe occidentale que dans certaines parties de la Scandinavie et de la Russie.
De plus, les traités sur l'art de la guerre dont il pourrait s'inspirer sont rédigés pour des armées qui font campagne en France, en Allemagne ou en Italie, selon la tactique européenne de combat qui exige des masses compactes d'unités de mousquetaires, appuyés de piquiers pour le combat à pied. De nos jours encore, l'image de lignes d'infanterie qui s'avancent en terrain découvert vers celles de l'ennemi dans le rutilement des uniformes aux couleurs voyantes et l'éclat des armes qui brillent au soleil nous semble suicidaire. Pourquoi ne se cachent-ils pas ? Parce que l'efficacité limitée des armes à feu commandait de telles tactiques. Ce n'est qu'à une centaine de mètres que le feu commençait à être redoutable, s'il était utilisé par salves, car les armes étaient encore trop imprécis pour atteindre efficacement des cibles choisies. Ce qu'il fallait, c'était tout simplement une masse qui tirait sur une autre masse.
Au Canada, rien de cet art militaire n'est applicable. Il n'y a pas de routes, donc pas d'artillerie de campagne ni de cavalerie à envoyer au-devant des envahisseurs pour freiner leur avance. Et si, par malheur, les soldats anglais et les milices de la Nouvelle-Angleterre parvenaient jusqu'à la Nouvelle-France, les troupes qu'on leur opposerait ne pourraient probablement pas les contenir. Pour toutes ces raisons, et bien que l'ennemi potentiel, cette fois, pratique l'art de la guerre à l'européenne, l'officier français des années 1680 constate rapidement que l'essentiel de ses connaissances et de son expérience de la guerre ne lui sera d'aucune utilité dans la colonie.
Des tacticiens canadiens
Il ne reste, en définitive, d'autre solution que de concevoir une nouvelle façon de faire la guerre, étroitement adaptée au pays. Et ce sont des Canadiens, ayant longuement observé les habitudes de combat des Amérindiens, ayant acquis par l'expérience une connaissance approfondie de l'environnement géographique, qui vont mettre au point cette tactique. Parmi ceux-ci, Charles Le Moyne et Joseph-François Hertel de La Fresnière exerceront une influence déterminante.
Alors qu'ils étaient jeunes soldats dans les garnisons, l'un de Montréal et l'autre de Trois-Rivières, Le Moyne et Hertel de La Fresnière prirent part à de nombreuses escarmouches mettant aux prises Français et Iroquois. Capturés et adoptés par ces derniers, tous deux mirent à profit leur temps de captivité pour apprendre la langue et étudier les mœurs iroquoises.
Sa liberté retrouvée, Charles Le Moyne se tourna vers le commerce et y réussit. Il agit aussi comme interprète auprès des gouverneurs, sans pour autant délaisser les activités militaires. C'est lui qui commandait les volontaires montréalais, en 1666, au moment des expéditions du régiment de Carignan-Salières. Il fut le père de nombreux fils, auxquels il transmit ses observations sur l'art de la guerre tel qu'il devait se pratiquer ici. Plusieurs d'entre eux moururent d'ailleurs l'épée à la main. Ils se nommaient Le Moyne de Longueuil, de Sainte-Hélène, de Maricourt, de Châteaugay, d'Iberville... les grands noms de l'histoire militaire canadienne.
Joseph-François Hertel de La Fresnière, pour sa part, naquit à Trois-Rivières, en 1642, dans les armes, pour ainsi dire, puisque son père, arrivé de France en 1626, faisait partie de la garnison. Le jeune Hertel devint donc soldat à son tour, avant de se lancer, comme Charles Le Moyne, dans le commerce. Lui aussi fut interprète et servit comme milicien durant les campagnes du régiment de Carignan-Salières. Lui aussi engendra de nombreux fils qui suivirent ses traces à la guerre. Parmi eux, Hertel de La Fresnière fils, de Moncours, de Rouville... une dynastie d'officiers de grande valeur.
Une doctrine de guerre originale
Impressionné par son expérience des affaires indigènes, le gouverneur général de La Barre nomma Hertel de La Fresnière commandant des nations amérindiennes alliées. C'est alors que commencèrent véritablement ses exploits militaires qui reposaient avant tout sur sa conception révolutionnaire de l'art de la guerre.
Tout comme Charles Le Moyne, Hertel croit que la seule façon de se battre efficacement en Amérique du Nord est d'assimiler les tactiques de guerre des autochtones et de les allier à la discipline européenne. Le soldat canadien servant au sein d'un corps en mission de raid doit, selon lui, assumer une indépendance et une part de responsabilité individuelle beaucoup plus grandes que son frère d'armes européen qui marche au combat machinalement, en rang et au son du tambour. Au Canada, il faut, au contraire, se déplacer rapidement, par petits groupes, approcher l'ennemi sans se faire voir, à la manière d'éclaireurs, le surprendre, puis disparaître aussitôt. C'est l'attaque surprise classique des Amérindiens, doublée d'une coordination parfaite et d'une discipline raisonnée. Une réflexion rapide et calculée de la part du combattant remplace la réaction « automatique » européenne, que l'on pense trop souvent être la seule forme de discipline militaire. Le commandant, pour sa part, sera appelé à diriger non une armée homogène, mais une force offrant des divergences considérables aux niveaux disciplinaire et culturel, puisqu'elle comprendra à la fois des officiers de métier, des soldats français et des miliciens canadiens, en plus d'Amérindiens alliés. Son habileté à concilier les qualités de chacun et à les diriger dans le sens souhaité devient alors un point de première importance. Enfin, le mouvement de retraite devra être rapide et bien planifié, afin que les forces ennemies ne puissent rattraper la troupe, mais tout au plus la suivre à la trace. Différence de taille, car, si l'on est talonné, c'est une course et un harcèlement continuels. Mais si on se replie rapidement, l'ennemi suit de loin, ce qui laisse éventuellement le temps de lui tendre un guet-apens meurtrier qui le découragera peut-être de continuer. Tels sont, dans leurs grandes lignes, les principes directeurs qui vont permettre aux Canadiens de remporter victoire sur victoire et d'arracher ainsi aux autres nations européennes qui se battent pour l'hégémonie de l'Amérique d'immenses portions du territoire que toutes convoitent.
L'organisation d'une expédition. Une nouvelle façon de faire la guerre
Capitaine Jean-Baptiste Hertel de Rouville
Le soldat canadien Jean-Baptiste Hertel de Rouville (1668-1722) est le fils du tacticien renommé Joseph-François Hertel de La Fresnière (1642-1722). Hertel de Rouville dirige plusieurs raids spectaculaires contre des colonies britanniques durant la Guerre de succession d'Espagne (1701-1713). Son fait d'armes le plus terrible est le raid et le massacre qui détruisent Deerfield, au Massachusetts, en 1704. Plus tard dans sa vie, il participe au développement de la colonie française de l'île Royale (île du Cap-Breton). On suppose que le portrait duquel est tirée cette gravure a été peint avant que Hertel de Rouville ne quitte Québec en 1713. Ce portrait a été modifié pour y inclure la croix blanche de l'Ordre de Saint-Louis quelque temps après que Rouville ait été fait chevalier de l'Ordre en décembre 1721.
Hertel de La Fresnière conçoit qu'une troupe mixte, composée d'hommes familiers avec le climat et rompus aux longs voyages exténuants à travers bois et rivières, peut porter des coups très loin chez l'ennemi. Le « parti de guerre » idéal se compose selon lui d'officiers canadiens connaissant parfaitement le pays et les mœurs des autochtones, de quelques soldats d'élite des troupes régulières, bien endurcis, de coureurs des bois, de « voyageurs canadiens », ainsi qu'on appelle les canotiers et transporteurs, et d'Amérindiens alliés. Enfin, l'officier qui est à la tête de cette troupe devra assouplir sa façon de commander, tout en lui conservant la forme militaire. Les Amérindiens sont des alliés, non des subordonnés, il ne faut pas l'oublier. Ils peuvent changer d'idée en tout temps. Il s'agit donc de savoir user de diplomatie afin d'obtenir d'eux respect et enthousiasme.
La logistique occupe une place très importante dans une expédition de ce genre, où l'on ne peut compter que sur ce qu'on apporte pour survivre. La rapidité étant primordiale, la règle du strict minimum s'impose. Idéalement, on part avec des canots chargés de vivres, d'outils, d'armes et de munitions, et on fait des caches le long de la route en prévision du retour. Le régime, peu alléchant, mais nourrissant, se compose surtout de maïs et de pois secs, de viande séchée, de biscuits durs. On améliore cet ordinaire, à l'occasion, avec quelque gibier ou poisson, mais toute chasse cesse quand on arrive à proximité du territoire ennemi. Il n'y a vraiment alors que la fortifiante ration d'eau-de-vie pour donner du cœur au ventre et soutenir le moral du soldat. À l'approche du fort à attaquer, on dissimule les canots et le reste du trajet se fait à pied, à travers bois, chaque homme portant sa charge. Enfin, si tout va bien, on arrive en vue du fortin de l'adversaire sans avoir été détecté.
Quand l'expédition a lieu en hiver, on remplace les canots par des traîneaux et les hommes chaussent des raquettes. Ils doivent être habillés et équipés à la canadienne, et n'apporter qu'un armement léger et utile : fusils, baïonnettes et hachettes pour les officiers, sous-officiers et soldats ; fusils de chasse, hachettes et couteaux pour les volontaires canadiens. Pas question de tricornes ni de hallebardes !
Ces conditions générales valent aussi pour les Amérindiens qui se joignent au raid. Ceux-ci attaquent avec une fougue extraordinaire, sèment la terreur et sont des éclaireurs sans pareils, mais il est impossible de les plier à la discipline européenne parce qu'« ils n'ont parmi eux aucune subordination et que leurs chefs ne sont pas en droit » de commander aux guerriers, mais seulement de leur proposer une forme d'action. Ils constituent une entité indépendante qu'il ne faut pas songer à intégrer. De plus, si l'Amérindien croit percevoir la défaite, il se retire rapidement du combat, facteur dont le tacticien canadien doit également tenir compte.
Expédition militaire en canoë, en Nouvelle-France, les cours d'eau permettent aux militaires de se déplacer facilement grâce au canoë en écorce de bouleau
Pierre Le Moyne D'iberville
Pierre d'Iberville eut été fait chevalier de l'Ordre de Saint-Louis en 1699. La croix blanche de l'Ordre est visible sur sa poitrine. ierre Le Moyne d'Iberville et d’Ardillières (1661-1706)
Né Pierre Le Moyne, cet officier mieux connu sous le nom de d'Iberville est le plus éminent militaire né en Nouvelle-France. Cette gravure du XIXe siècle reproduit un portrait peint quelque temps après que Le Moyne
De tous les fils de la Nouvelle-France, nul n'est plus célèbre que Pierre Le Moyne, sieur d'Iberville, militaire tantôt sur terre, mais surtout sur mer, explorateur, colonisateur et marchand à ses heures. Baptisé à Montréal, le 20 juillet 1661, il appartenait à l'influente famille Le Moyne. On connaît peu de choses sur sa jeunesse, sinon qu'il semble avoir reçu sa formation militaire et navale dans les Gardes de la Marine, probablement vers la fin des années 1670 et au début des années 1680.
Il fit sa première campagne au Canada, avec le chevalier de Troyes, à la baie d'Hudson, en 1686. Le jeune d'Iberville ne manquait certes pas de bravoure. À Moose Factory, il monta à l'assaut du fort l'épée d'une main et le pistolet de l'autre. Encerclé, il abattit quelques Anglais avant d'être secouru. Au fort Albany, avec seulement 13 hommes, il réussit à s'emparer d'un navire. Il rentra à Montréal en 1687, puis passa en France d'où il revint pour capturer trois navires à la baie d'Hudson, en 1689. De retour à Montréal, il prit part à l'expédition qui détruisit Schenectady en février 1690, puis repartit vers la baie d'Hudson durant l'été pour y prendre le petit poste de New Severn.
Carte des campagnes menées par d'Iberville en 1686 et 1696
Cette carte montre le chemin emprunté par deux expéditions parties de Nouvelle-France pour attaquer des colonies anglaises d'Amérique du Nord. Pierre Le Moyne d'Iberville et d'Ardillières est un jeune homme en 1686, année où Pierre de Troyes conduit 100 hommes par voie de terre à la baie d'Hudson. En 1696, d'Iberville devient lui-même un commandant renommé. Cette année-là, il retourne à la baie d'Hudson et prend aussi des établissements anglais dans le Maine et à Terre-Neuve.
La paix revenue, d'Iberville se rendit dans la baie de Biloxi et construisit le fort Maurepas (aujourd'hui Ocean Springs dans l'État du Mississippi) en mars 1699. Ce fut le premier établissement permanent de la Louisiane. Il revint dans cette colonie au cours des années suivantes, affermit les nouveaux établissements et fonda le fort Saint-Louis-de-la-Mobile (aujourd'hui Mobile, Alabama). De nombreux Canadiens participèrent à toutes ses expéditions.
En 1702, la France et l'Angleterre furent de nouveau en guerre, mais d'Iberville, miné par les fièvres, resta en convalescence à La Rochelle jusqu'au début de 1706. Il fit alors voile vers les Antilles, à la tête d'une flotte de 12 navires, et après une escale aux îles françaises, se dirigea vers l'île britannique de Nevis, qui fut prise sans difficulté, en avril 1706, et pillée.
Il mit ensuite le cap sur La Havane pour disposer du butin, mais, une fois dans la capitale cubaine, ses fièvres reprirent et il succomba le 6 juillet 1706, à deux semaines de ses 45 ans. Il fut inhumé le 9 juillet dans l'église San Cristobal. Certains affirment que sa sépulture fut transférée dans la cathédrale San Ignacio de la Havane, en 1741, à la suite de la démolition de l'église San Cristobal, mais rien ne le prouve et le lieu du repos final du premier véritable héros militaire canadien reste incertain.
Prépondérance de la guerre de raid. Formation d’une nouvelle école
La tactique de guerre « à la canadienne » sera raffinée, mais ne changera pas, fondamentalement, par la suite. À la fin du XVIIe siècle, les soldats réguliers, habitués à rester dans les forts, se révélèrent incapables, dans l'ensemble, de soutenir aussi bien que les miliciens canadiens et les Amérindiens l'effort physique qu'exigaient ces expéditions. Les guerres contre les Renards, dans l'Ouest, leur donnèrent peu à peu l'occasion de s'y accoutumer, et les plus aguerris d'entre eux servirent éventuellement de cadres auprès des miliciens. Les raids eurent en outre un effet d'entraînement. Il arriva souvent, par exemple, que de petits groupes de huit à dix hommes prirent d'eux-mêmes l'initiative d'aller mener des attaques-surprises dans les régions frontalières. C'était presque toujours des Amérindiens allié qui se tenaient ainsi à l'affût. Leur action ajouta à la pression que l'on devait maintenir contre les colonies américaines. En un peu plus d'une dizaine d'années, la guerre se transporta donc, essentiellement, des habitations de la Nouvelle-France à celles de la Nouvelle-Angleterre. Ce revirement de la situation fut dû, lui aussi, à la tactique développée par les Canadiens.
La part que prirent les Compagnies franches de la Marine dans l'élaboration de cette doctrine de guerre originale fut énorme, et ceci grâce surtout au recrutement d'officiers habitant la colonie. Bénéficiant, du fait de leur appartenance à ces troupes, d'un cadre et d'un statut militaires, ces hommes purent, en effet, méditer sur les problèmes reliés à la guerre dans leur environnement propre, et avancer des solutions pouvant faciliter l'issue heureuse des combats.
Récompense et condamnation
Les hautes autorités reconnurent le mérite exceptionnel de Le Moyne et de Hertel. Le premier se vit concéder une seigneurie et jouit pour le reste de ses jours d'une très grande considération. Toutefois, si les faits d'armes de sa famille comptèrent pour beaucoup dans l'obtention des lettres de noblesse que lui accorda Louis XIV, la richesse qu'il avait accumulée dans ses fonctions de commerçant ne fut certainement pas étrangère, non plus, à l'octroi de cet honneur. En témoignent les difficultés que rencontra Frontenac, en 1689, lorsqu'il entreprit des démarches en vue d'obtenir une reconnaissance équivalente pour Hertel de La Fresnière. Les autorités françaises donnèrent leur accord de principe à son anoblissement, mais se demandèrent si le candidat pourrait tenir son rang, vu son peu de fortune. Dans le but de l'aider, on lui concéda une seigneurie, en 1694, mais ce n'est qu'en 1716 que cet officier exceptionnel, le premier véritable tacticien de notre histoire militaire, reçut enfin la récompense de ses mérites.
L'un des constats les plus tristes que l'on puisse dresser à propos de ces tactiques de guerre absolument novatrices pour l'époque, c'est l'indifférence, pour ne pas dire la condamnation unanime qu'en firent les officiers français de l'armée métropolitaine. Quand ils daignèrent leur prêter attention, ce fut pour souligner le manque de discipline - dans le sens d'« automates » - des soldats et miliciens canadiens et conclure que ce genre de tactique ne pouvait convenir que pour des « sauvages ». Opinion qui allait de soi dans l'esprit de certains métropolitains, car, après tout, les officiers canadiens n'étaient que des roturiers, ou alors de bien fraîche noblesse. Cet aveuglement commença à se résorber au milieu du XVIIIe siècle, quand apparurent les chasseurs dans les armées allemandes et autrichiennes, et, ironie du sort, avec le développement de l'infanterie légère britannique en Amérique, pour contrer, avec un succès relatif, les tactiques des Canadiens.
Le traitement des vaincus
Le traitement abominable auquel étaient exposés les vaincus et les captifs fut l'un des grands problèmes de la guerre de raid. Les colons français du Canada vécurent eux-mêmes avec cette hantise du poteau de torture tout au long du XVIIe siècle. Tombés aux mains des Iroquois, certains souffrirent durant « deux, et quelquefois trois jours entiers à rôtir » avant d'être enfin libérés par la mort. Les Montréalais, exaspérés, menacèrent finalement les Iroquois du même traitement et firent même brûler quelques-uns de leurs guerriers, en 1691.
Les autorités françaises tentèrent, avec un succès variable, d'humaniser le traitement des captifs que ramenaient leurs expéditions en essayant de les soustraire à leurs alliés amérindiens à qui ils offraient, notamment, de les racheter. Les nombreux récits de captivité laissés par des prisonniers de la Nouvelle-Angleterre contiennent des descriptions insoutenables des supplices subis par certains malheureux, mais signalent également les efforts déployés par les officiers de la Nouvelle-France pour obtenir leur libération.
Durant les années 1690, il multiplia les exploits. En plus de croiser au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, il reprit York Factory, en 1694, s'empara de Pemaquid et de St. John's (Terre-Neuve) deux ans plus tard. Ce fut toutefois en 1697 que survint sa plus belle victoire. D'Iberville était alors à la tête d'une petite escadre qui se dirigeait vers la baie d'Hudson. Ayant perdu les autres navires dans la brume, le Pélican, frégate de 44 canons à bord de laquelle il se trouvait, arriva à l'embouchure de la rivière Hayes, le 4 septembre. Le lendemain, la vigie signala trois gros navires à l'horizon. Branle-bas de combat ! C'était trois navires de guerre anglais : le vaisseau Hampshire, armé de 56 canons, escorté des frégates Dering, 36 canons, et Hudson's Bay, 32 canons. Pour d'Iberville, un seul espoir : attaquer. Le Pélican s'en prit d'abord au Hampshire, tira quelques salves, et le grand vaisseau anglais commença à tanguer puis coula à pic ! Le Hudson's Bay fut ensuite pris à partie et subit le même sort peu après, tandis que le Dering prit la fuite. Mais le Pélican avait été endommagé et s'enfonçait à son tour dans les eaux ! L'escadre française arriva, enfin... York Factory fut repris et rebaptisé fort Bourbon. La cour française ayant eu écho de ces exploits, d'Iberville fut décoré de la croix de Saint-Louis en 1699, devenant ainsi le premier militaire natif du Canada à recevoir cet honneur.
La milice canadienne
Un milicien volontaire canadien en hiver
À partir du milieu du XVIIe siècle et pendant les deux siècles suivants, les vêtements et le matériel d'hiver des volontaires canadiens ne changent pratiquement pas et ressemblent de près à ce qu'utilisent les commerçants de fourrures et les voyageurs.
On ne manquait pas de miliciens volontaires pour participer aux expéditions, et ceux de Montréal se montraient particulièrement enthousiastes. On disait de la milice de cette ville qu'elle était à la fois la meilleure et la plus insubordonnée de toutes. En fait, il régnait un esprit de corps, au sein des différentes compagnies de milice de chaque ville ou paroisse, qui ne demandait qu'à se développer en rivalité. Ainsi, les intrépides Montréalais qualifiaient de « moutons » les miliciens de Québec. Sur quoi ces derniers, qui se considéraient comme plus civilisés, rétorquaient que les Montréalais étaient des « loups » sauvages, tout juste bons à courir les bois en compagnie des Amérindiens. Épithètes qui renseignent indirectement sur le caractère propre à chaque groupe.
Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les miliciens partant en expédition ne recevaient que les vivres et quelques pièces d'équipement. Ils devaient fournir le reste. Ainsi, tous ceux que d'Iberville et Sérigny enrôlèrent, en 1694, pour les suivre à la baie d'Hudson, devaient avoir leur propre fusil, leur corne à poudre et leur habillement, mais avaient droit, éventuellement, à une part des prises et profits. Conditions qui ressemblent fort à celles du recrutement des corsaires ! Ce fut sans doute sur la base d'ententes semblables que d'Iberville engagea les Canadiens qui l'accompagnèrent à Terre-Neuve, en Louisiane et aux Antilles.
Les grandes mobilisations, celles qu'on lança pour les campagnes au pays des Iroquois ou vers l'Ouest, n'offraient pas autant de garanties de profits ou de butin. Aussi le gouverneur général Frontenac organisa la logistique, durant les années 1690, de façon que chaque milicien reçoive l'habillement et l'équipement. Ce qui consistait généralement en un capot, un brayet, une paire de mitasses, une couverture, des mocassins, un couteau et deux chemises. Les pièces de vêtement ne constituaient pas un uniforme militaire, mais simplement une tenue vestimentaire civile, à la canadienne. Comme ces hommes n'étaient pas payés, c'était une façon relativement économique de soutenir efficacement la milice.
Les mobilisations se faisaient par ordre du gouverneur général, qui fixait lui-même le nombre de miliciens souhaitable pour chaque occasion. On lançait alors un appel afin que des volontaires, provenant des diverses compagnies, se joignent à l'expédition. Les colons qui restaient, dans chaque paroisse, cultivaient bénévolement les terres de ceux qui étaient partis.
Le voyageur « canadien »
Un autre type de milicien spécialisé se développa au pays : le « voyageur ». En effet, ce n'était pas tous les miliciens qui montaient à l'assaut. D'autres étaient mobilisés pour conduire les canots chargés du matériel nécessaire aux grandes expéditions. Cette tâche, dans les conditions qui prévalaient, était ardue et personne d'autre que le « voyageur » canadien, ce colon ou fils de colon rompu dès l'enfance aux fatigues du canotage et de la vie des bois, ne pouvait l'accomplir. Il transportait ainsi des armes, des petits canons, de la poudre, des outils, les bagages de chacun et des vivres en quantité suffisante pour nourrir des centaines d'hommes durant de nombreux mois. Quand on sait que tout cela devait être porté à dos d'homme à chacun des nombreux portages qui ponctuaient la route, on comprend que ces expéditions requéraient d'eux chaque fois presque un miracle de logistique et un exploit humain.
Ce type de service que seuls les Canadiens étaient à même de rendre fut essentiel non seulement à la vie militaire, mais à l'expansion de la Nouvelle-France. Sans ces voyageurs que nulle rivière à remonter, nulle étendue à traverser ne rebutaient, aucun des voyages de découverte qui allaient inscrire l'emprise de la France sur une vaste portion du territoire nord-américain n'aurait pu être effectué. Parmi ces grandes explorations figurent celles qu'accomplirent pendant 15 ans Pierre Gaultier de La Vérendrye, obscur officier canadien sans ressources malgré ses brillants états de service, et ses fils, qui, les premiers, atteignirent les montagnes Rocheuses.
Les armes des miliciens
On ne donnait pas de fusils aux miliciens, car, en principe, chacun possédait le sien. Cependant, les gouverneurs ne cessèrent de se plaindre que les habitants en manquaient. Dès 1684, on est obligé de leur en prêter. Quelque 60 ans plus tard, en 1747, on en est encore au même point : environ le tiers des miliciens n'ont pas de fusils, signalent dans un rapport le gouverneur général et l'intendant. Curieux, tout de même, quand on songe que les Canadiens ont la réputation d'être d'excellents tireurs... L'homme de science scandinave Pehr Kalm, qui visite le Canada en 1749, ne consigne-t-il pas dans ses notes « que tous les gens nés au Canada sont les meilleurs tireurs qui peuvent exister et ratent rarement leur coup » ? Il n'y a « aucun d'entre eux qui ne soit capable de tirer remarquablement, ni qui ne possède un fusil », remarque-t-il.
Cette apparente contradiction peut s'expliquer de deux façons. D'une part, les miliciens des villes sont certainement moins susceptibles que ceux des campagnes d'être ainsi armés. À Québec, par exemple, au XVIIIe siècle, le gibier est devenu rare aux alentours de la ville et un miliciable sur quatre ou cinq n'a pas d'arme à feu tout simplement parce qu'il n'en a pas besoin. D'autre part, il se joue certainement un petit jeu de cachette entre les Canadiens et les autorités. Un fusil coûte cher. Afin d'en obtenir un neuf sans avoir à débourser quoi que ce soit, on peut cacher le vieux ou alors se présenter pour le service avec un fusil « si mauvais » que les autorités sont bien obligées d'en remettre un nouveau au porteur, en bon état. Celles-ci font preuve, d'ailleurs, d'une certaine connivence à ce sujet. Elles savent que beaucoup n'en ont pas parce qu'ils l'ont échangé contre des fourrures, coutume contre laquelle elles s'élèvent. Cependant, mises à part les traditionnelles récriminations des fonctionnaires comptables, les gouverneurs généraux ne sont pas malheureux d'armer à neuf cette excellente milice.
L'arme à feu que préfèrent utiliser les miliciens canadiens est un fusil de chasse sans baïonnette, solide et léger, provenant de la manufacture de Tulle, au centre de la France, au calibre de 28 balles à la livre, soit 14 mm. Calibre un peu faible pour aller à la guerre, mais cet inconvénient est compensé par le tir précis des Canadiens, qui connaissent bien cette arme. Le milicien porte en outre une hachette et souvent plusieurs couteaux : l'un fixé à la taille, l'autre à la jarretière de sa mitasse, et le troisième suspendu au cou par une lanière.
Les miliciens au combat
Les miliciens canadiens aiment les embuscades. Alors que leurs semblables, en Nouvelle-Angleterre, s'exercent aux manœuvres compliquées des batailles rangées à l'européenne, eux n'en tiennent aucun compte. Un milicien américain, prisonnier à Québec, avoue n'avoir jamais vu de milices « si ignorantes des usages militaires ». On s'y demande, s'indigne-t-il, s'il faut mettre le fusil sur l'épaule droite ou gauche... Manifestement, les Canadiens n'ont jamais reçu d'entraînement de ce genre. Le fait est qu'ils trouvent les batailles à l'européenne inutilement dangereuses. Ils ne se battent bien « que dans le retranchement », dira d'eux le gouverneur général Vaudreuil. À l'attaque, ils surgissent de nulle part, tirent une salve sur leurs opposants et se ruent sur eux, hachette à la main, en poussant des cris de guerre à l'amérindienne, hurlements qui servent de signal pour la charge et « à effrayer l'ennemi qu'on surprend », et sur qui on fonce sans lui laisser le temps de se ressaisir.
Certes, les miliciens canadiens subissent des revers à l'occasion, mais si peu que, confiants dans leur bravoure, ils se croient quasiment invincibles. Par ailleurs, la guerre de raids telle qu'ils la pratiquent est tellement dure que peu d'hommes parviennent à la mener. Il arrive qu'ils soient à ce point épuisés et affamés, au retour d'un parti de guerre, que certains se laisseraient mourir au pied d'un arbre si les autres ne les forçaient à suivre. « Quand ils arrivent, ils sont méconnaissables et ils ont besoin de beaucoup de temps pour pouvoir se remettre ».
Les compagnies spécialisées de la milice
En plus des nombreuses compagnies de milice qui fonctionnaient dans le cadre paroissial, il a existé dans les villes et dans les campagnes diverses unités spéciales. Ainsi, durant l'automne 1687, un corps de 120 volontaires fut formé. Cette compagnie de cadets canadiens, que commandait monsieur de Vaudreuil, secondé par quatre « bons lieutenants enfants du pays », servit « à la tête de l'île de Montréal », pour assurer la sécurité de la ville en cas de mouvements de la part de l'ennemi. Les membres de cette milice recevaient une modeste solde, ce que le ministre de la Marine n'approuva pas. Par conséquent, la compagnie fut dissoute l'année suivante.
À mesure que la colonie se développa, les milices des villes se targuèrent d'être des « milices bourgeoises », ce qui n'avait rien à voir avec les clubs sociaux qu'on trouvait souvent en France sous cette appellation. Ici, rien n'était changé à leurs obligations, sinon que certains aspects du service urbain pouvaient exiger des miliciens plus spécialisés. À partir de 1723, on vit apparaître aussi dans la ville de Québec un petit corps d'artillerie de milice, le premier du genre à exister au Canada. Il s'agissait de deux « brigades », comprenant une vingtaine de jeunes gens, bourgeois et habitants, qui étaient entraînés à l'école d'artillerie des troupes régulières. Enfin, en 1752, le gouverneur général Duquesne forma et soumit à l'entraînement une compagnie d'artillerie de milice dans chacune des villes de Montréal et de Québec.
Également mises sur pied en 1752, les compagnies dites « de réserve » étaient un autre type de milice spécialisée qu'on trouvait dans ces deux villes. Elles regroupaient des « commerçants et bons bourgeois » et étaient commandées par des « gentilshommes qui ne servent point ». On assignait à ce genre de corps un service sédentaire : garde des principaux édifices municipaux ou du quartier général, guet, escorte aux cérémonies. Ces milices de « bons bourgeois », partout où elles existent, se dotent généralement d'un uniforme rutilant. Nos élites canadiennes ne firent pas exception à la règle, vêtues qu'elles étaient d'écarlate, avec veste et parements blancs à l'habit.
Le choc de l'attaque sur Lachine
Un événement dramatique mit bientôt les Canadiens à même d'appliquer plus près de chez eux les résultats de leur réflexion sur la tactique militaire qui venait de faire ses preuves au loin avec les exploits de d'Iberville à la baie d'Hudson. À partir de 1689, malgré la sanglante leçon que leur a infligée deux ans plus tôt Denonville, les Iroquois, encouragés par les Américains de la colonie de New York, harcèlent les établissements français. C'est dans ce contexte qu'a lieu l'attaque de Lachine, petit village en amont de Montréal, au mois d'août de cette même année. Le massacre de ses habitants se fait dans une « horreur inouïe et sans exemple », rapporte Frontenac. Passé dans l'histoire comme « le massacre de Lachine », cet événement devint le catalyseur d'une formidable réaction.
En 1689, la guerre vient de se déclarer en Europe entre plusieurs pays, dont la France et l'Angleterre. L'action des Iroquois peut être interprétée comme étant celle d'une société qui, en définitive, est devenue l'instrument des colonies anglaises avoisinantes, au sud. De retour pour un second mandat, Frontenac réunit son état-major. Sur le plan stratégique, c'est le moment de contre-attaquer. Il faut frapper les véritables ennemis chez eux, tranche-t-il, et le plus vite possible, de façon à les placer sur la défensive.
1690: année charnière
Troupes du Massachusetts, vers 1690
Cette reconstitution montre des défenseurs de la colonie anglaise du Massachusetts, vers 1690. À gauche se trouve un milicien; au centre gauche, un porte-étendard tient le drapeau du régiment de Boston; au milieu se tient un officier armé d'une épée et d'un esponton; à droite, un cavalier porte une cuirasse et un casque.
L'état-major français endosse les vues de Hertel et d'autres Canadiens sur la tactique à adopter : attaquer les colonies anglaises par terre en passant à travers les bois, en hiver, et « à la canadienne ». Frontenac ordonne que l'attaque soit menée simultanément à partir des trois villes de Montréal, Trois-Rivières et Québec, et dans les plus brefs délais. Trois corps expéditionnaires mixtes, composés d'officiers canadiens, de quelques soldats, de miliciens volontaires et d'alliés amérindiens, s'apprêtent donc en vue d'un départ imminent.
Le groupe de Montréal, commandé par Jacques Le Moyne de Sainte-Hélène et Nicolas d'Ailleboust, arrive près du village de Schenectady, au nord d'Albany, en janvier 1690. On attend la nuit pour s'approcher des fortifications. L'une des portes est entrouverte, bloquée par la neige. Il n'y a pas de garde. On entre sans bruit et bientôt chaque maison du village est cernée. À un signal - un cri de guerre - les assaillants défonce les portes. La surprise est totale et quelques habitants seulement parviennent à s'échapper. Schenectady est rasé, mais les survivants sont épargnés. Ils ne subiront pas le supplice aux mains des Amérindiens.
Deux mois plus tard, dans la nuit du 27 mars, l'expédition qui a quitté Trois-Rivières, commandée par Hertel de La Fresnière lui-même, attaque le fort et le village de Salmon Falls, près de Portsmouth, au Massachusetts. Deux heures plus tard, il n'en reste rien... Une trentaine de colons ont été tués, une cinquantaine d'autres faits prisonniers. Les miliciens du Massachusetts, accourus, se lancent à la poursuite des attaquants. Ils ne peuvent que les suivre à la trace, de loin. Hertel profite de son avance pour leur tendre un piège. Un pont étroit enjambe la rivière Wooster. Invisibles dans les buissons, le commandant et ses hommes attendent qu'ils s'y engagent. Au signal, ils tirent. Une vingtaine de miliciens tombent, les autres s'enfuient, terrifiés par les cris de guerre. L'expédition va ensuite rejoindre celle du commandant Portneuf, qui a quitté Québec et se dirige vers Casco, dans l'État actuel du Maine. Cette troisième place est prise et rasée en mai.
Détail qui a son importance, le baron de Saint-Castin, venu d'Acadie avec un groupe d'Abénaquis alliés, se joignit à l'expédition contre Casco. Déjà féru de tactiques amérindiennes, il profita certainement de l'occasion pour échanger avec Hertel de La Fresnière des vues et des concepts sur l'évolution de la tactique, idées qu'il rapporta en Acadie et mit bientôt à exécution lors de nombreux raids contre les Américains.
Les colonies américaines attaquent la Nouvelle-France
La violence des raids canadiens de l'hiver et du printemps 1690 détermine les colonies de la Nouvelle-Angleterre à en finir une fois pour toutes avec la Nouvelle-France. En mai, on décide de l'envahir et par terre et par mer. Une armée de 1 000 miliciens des provinces de New York et du Connecticut, auxquels se joignent de nombreux guerriers iroquois, s'assemble au lac Champlain durant l'été. La maladie, les querelles et les désertions déciment leurs rangs, tant et si bien que ce qui reste de l'armée se retire. Seul un petit contingent de miliciens et d'Iroquois, sous le commandement de Peter Schuyler, parvient jusqu'à Laprairie, au sud de Montréal. Il est repoussé par les troupes et les milices canadiennes.
Entre temps, le Massachusetts, alors chef de file des colonies britanniques, organise son offensive. Cette province populeuse et prospère possède une nombreuse milice, dont l'organisation est calquée sur celle de la milice anglaise. Sir William Phips est désigné pour mener une expédition navale contre Port-Royal, en Acadie. On lève un régiment d'infanterie de sept compagnies, comprenant 446 officiers et soldats, sous le commandement du major Edmund Willy, et cette troupe monte à bord des huit navires de Phips. La prise de Port-Royal s'effectuera sans difficulté. Partis de Boston à la mi-avril, tous y seront revenus dès la fin mai.
Fortes de ce succès, les colonies de la Nouvelle-Angleterre décident d'attaquer Québec. Avec une belle assurance, on lève une flotte et une armée à crédit, car on compte se repayer avec le butin que l'on prendra à l'ennemi. Sir William Phips commande cette fois une flotte de 34 navires, ayant à bord sept bataillons de miliciens du Massachusetts, forts de 300 à 400 hommes chacun. Au total, 2 300 hommes. S'ajoutent à cela un détachement d'artillerie, avec six canons de campagne, ainsi qu'un corps d'une soixantaine d'Amérindiens devant servir d'éclaireurs.
Phips devant Québec
Sir William Phips devant Québec en octobre 1690
Sir William Phips (1650-1694) est représenté sur le pont d'un des navires loués par les colonies de Nouvelle-Angleterre pour transporter à Québec des miliciens du Massachusetts. C'est peut-être en arrivant à Québec, en octobre 1690, que Phips et ses officiers se rendent compte à quel point cette ville est une formidable forteresse naturelle.
La flotte arrive le 16 octobre 1690 devant Québec où l'attendent Frontenac et ses troupes. Assez présomptueux, Phips donne une heure au comte pour se décider à rendre les armes, sinon il attaquera. Le tempérament bouillant de Frontenac donne l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire canadienne : « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons ». Ces mots résument parfaitement l'esprit qui règne chez les officiers et les troupes, tant de la marine que de la milice.
Les bataillons du Massachusetts débarquent à l'est de la ville, marchent en ligne, tambours battants, drapeaux flottant au vent - cela donne un assez bel effet, de l'avis des observateurs des deux camps - et se font rosser par les défenseurs embusqués. Les Américains laissent cinq des six pièces d'artillerie sur le terrain dans leur hâte de rembarquer ! On se bombarde de part et d'autre, mais le navire amiral est endommagé et perd son pavillon, qui tombe aux mains des Français. Le 24, la flotte lève l'ancre et retourne à Boston.
Les batteries de Québec ouvrent le feu sur les navires de Phipps en octobre 1690
À Québec, en octobre 1690, des canons ouvrent le feu sur les navires des envahisseurs. La ville haute est bien protégée par un mur entrecoupé de batteries, et grâce à de véritables ouvrages défensifs avoisinant le château Saint-Louis, près du cap Diamant. Dans la ville basse, on trouve deux batteries riveraines équipées de canons lourds de marine de 18 et 24 livres. Du côté de la terre, une ligne de remblais ponctués de 11 redoutes couvre le côté ouest de la ville. Cette gravure du XIXe siècle est inexacte à certains égards, notamment dans le cas du château Saint-Louis, qui n'avait qu'un seul étage en 1690, mais elle donne une bonne idée du cours des événements.
Ainsi se termine cette première tentative d'invasion américaine au Canada. Mais à Boston, ce n'est pas fini... Le butin escompté n'étant pas au rendez-vous, la dette du Massachusetts s'élève à quelque 50 000 livres - une somme énorme pour l'époque ! Les coffres sont vides. Pour « apaiser la clameur des soldats et marins » qui réclament leur solde, les autorités, craignant un soulèvement armé, font imprimer des billets de crédit à l'intention des militaires, tout en haussant fortement les impôts. Malheureusement pour les vétérans de cette aventure, les billets se dévaluent rapidement et ne valent bientôt plus que la moitié de leur valeur nominale. Ces douches froides, à la fois militaires et financières, calment les humeurs belliqueuses. Rien d'aussi ambitieux ne sera désormais tenté contre le Canada sans l'appui des forces régulières et navales de la mère patrie.
L'épuisement des Iroquois. Un raid désastreux contre Montréal
Le gouverneur général Frontenac brandissant une hache de guerre
Le gouverneur général Frontenac est représenté lors d'une visite rendue à des Indiens alliés en 1691. Cette hache de guerre a une valeur symbolique chez les nations amérindiennes des forêts et le gouverneur général de Nouvelle-France y fait toujours référence lorsqu'il appelle ses alliés à la guerre.
Au cours de l'année 1691, le major Schuyler, à la tête d'une troupe de 300 hommes, comprenant des miliciens de New York et des Iroquois, se dirige vers Montréal. Le 11 août, il attaque sans succès le fort de Laprairie, mais inflige néanmoins des pertes importantes aux Français. Tandis que Schuyler, confiant de n'avoir plus rien à craindre, se retire, ceux-ci mobilisent quelque 700 soldats et miliciens et une partie de cette troupe rejoint les Anglais. Un combat acharné s'engage, au terme duquel les New-Yorkais et leurs alliés battent en retraite, laissant 83 morts, dont 17 Amérindiens, sur le terrain, contre cinq ou six blessés, seulement, pour les Français.
L'épuisement des Iroquois. Un problème stratégique
Guerriers amérindiens, première moitié du XVIIIe siècle
On peut voir, sur ces guerriers, quelques-uns des changements intervenus dans l'apparence des Amérindiens au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. Même s'ils adoptent massivement les armes et les vêtements européens, ils conservent une apparence résolument autochtone en intégrant tous ces nouveaux éléments à leurs tatouages et à leurs peintures corporelles. Le personnage central est un chef.
Par la suite, les Iroquois mèneront encore, pour leur compte, quelques petites offensives, dont celle qui donna l'occasion à Madeleine de Verchères d'exercer sa célèbre action défensive, en 1692. En conséquence, les Français contre-attaquèrent les Iroquois chez eux. En janvier 1693, une expédition rasa plusieurs villages agniers, au nord d'Albany, destruction qui survint à un moment critique pour leur nation. Les Iroquois commençaient en effet à penser que leurs alliés ne les appuyaient guère dans les durs moments. Ils voulaient bien monter des raids pour eux, mais ceux-ci à leur tour devaient de nouveau attaquer les Français par mer, car, disaient-ils, « c'est impossible de conquérir le Canada seulement par la terre ». Paroles qui démontrent une parfaite compréhension des problèmes stratégiques et tactiques que posait l'invasion du Canada. Ils constataient aussi que les Amérindiens alliés des Français avaient de la poudre et des armes en quantité, alors qu'eux avaient peu de fusils et manquaient de poudre.
Madeleine
En digne représentante des femmes de la Nouvelle-France du XVIIe siècle, qui n'étaient ni fragiles ni soumises, Marie-Madeleine Jarret de Verchères (1678-1747) organise en 1692 une défense exemplaire du fort Verchères contre une attaque iroquoise, comme sa mère l'a fait deux ans plus tôt. Son récit de 1699, empreint de sobriété mais souvent romancé à la fin du XIXe siècle, fait d'elle une héroïne de notre histoire racontée au quotidien. Tout comme la plupart des femmes de la colonie, elle sait manier les armes dès l'âge de 14 ans. Son contemporain, Bacqueville de la Potherie, affirme qu'« aucun Canadien ni officier ne peut tirer plus juste qu'elle ».
C'est en 1696 que sera menée la plus grande attaque française contre les Iroquois. Sous la conduite du gouverneur Frontenac, qui, âgé de 74 ans, est porté à travers bois dans un canot à dos d'homme, une troupe comprenant plus de 2 000 combattants se rend alors jusqu'au coeur du pays des Onontagués, porter l'incendie dans leurs villages et détruire leurs récoltes. Le succès de cette intervention, s'ajoutant aux récentes victoires françaises, engendre certaines constatations, plutôt moroses, chez les Iroquois : que les Français, d'une part, ont complètement maîtrisé l'art de mener des expéditions vers des objectifs très éloignés de leurs bases, et que les colonies anglaises, d'autre part, n'ont pas levé le petit doigt pour venir à leur aide, bien qu'étant leurs alliées. Pour ajouter à cela, le traité de Ryswick, en 1697, met fin à la guerre entre la France et l'Angleterre. Découragés et épuisés, les Iroquois négocient une paix définitive, qu'ils signent finalement en 1701, dans le cadre d'une paix générale que de nombreuses nations des Grands Lacs concluent avec les Français.
Le traité de Ryswick ne dure que quelques années. Plusieurs pays s'opposent, en effet, à ce que le petit-fils de Louis XIV accède au trône d'Espagne. Philippe d'Anjou devient quand même Felipe V, de sorte que la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Hollande et de nombreux États allemands déclarent la guerre à la France et à l'Espagne. Le conflit s'étend, naturellement, aux colonies.
L'invasion manquée de 1711
Au Canada, on continue d'opter pour la guerre de raids. Les plus importants ont lieu contre Deerfield, en 1704, et contre Haverhill, en 1708, dans le Massachusetts. Ne parvenant pas à se défendre efficacement contre ce genre d'attaques, les colonies américaines, exaspérées, demandent et obtiennent l'aide de la mère patrie. On décide alors d'envahir le Canada par terre et par mer. D'Angleterre, où se prépare l'expédition navale, l'amiral Hovenden Walker se rend d'abord à Boston, puis, au matin du 30 juillet 1711, lève l'ancre et fait voile vers Québec. La flotte qu'il a rassemblée compte neuf vaisseaux de guerre, deux galiottes à bombes et 60 navires servant au transport des troupes, sur lesquels se trouvent 4 500 marins et 7 500 soldats. En tout, on dispose de huit régiments d'infanterie britanniques et de deux régiments de miliciens de la Nouvelle-Angleterre. Comment le Canada pourra-t-il résister à une telle invasion ? se demande-t-on, avec satisfaction à Boston et avec inquiétude à Québec.
À la guerre, le hasard a parfois une grande part. Dans la nuit du 22 au 23 août, alors que le temps est très mauvais et la visibilité presque nulle, la flotte passe au nord de l'île d'Anticosti. Soudain, l'amiral est alerté par de jeunes officiers, dans un état d'énervement complet : droit devant eux, des récifs ! Trop tard... Les coques de huit navires de transport, chargés de soldats, se brisent sur les récifs de l'Île-aux-Œufs. Vers deux heures du matin, le vent tourne, ce qui permet de sauver le reste de la flotte. C'est à l'aube seulement qu'on réalisera l'ampleur du désastre. Il manque à l'appel 29 officiers et 705 soldats appartenant à quatre des huit régiments des troupes régulières, ainsi que 35 femmes de soldats. Ébranlé tout autant que ses hommes, Walker décide de rebrousser chemin.
Pendant ce temps, le général britannique Nicholson s'est rendu à Albany prendre le commandement d'une armée américaine de 2 300 hommes qui doit envahir le Canada par le sud. Bien que la maladie se soit déclarée parmi ses troupes, il s'apprête à remonter le lac Champlain quand la nouvelle du désastre de la flotte de Walker lui parvient, le 19 septembre. De rage, Nicholson aurait jeté sa perruque à terre et sauté dessus ! Calmé par ses officiers, il finit par ordonner le retour à Albany où son armée est licenciée en octobre.
Au Canada, on jubile. Après les prières publiques de remerciement, les fêtes battent leur plein. L'atmosphère est à la liesse ! C'est à la suite de l'invasion ratée de 1711 que l'on a donné à l'église sise à la Place royale, dans la basse-ville de Québec, le nom de Notre-Dame-des-Victoires.
Une puissance militaire
La garnison est désormais bien établie en Nouvelle-France où les militaires ont pris racine et contrôlent le gouvernement. Les miliciens canadiens jouissent d'une bonne organisation et sont redoutables au combat. Les ennemis de la colonie, qu'ils soient britanniques, américains ou amérindiens, ne peuvent s'opposer à leur tactique de combat révolutionnaire. Les militaires de la Nouvelle-France peuvent maintenant aspirer à consolider leurs positions du golfe Saint-Laurent au golfe du Mexique, des Grands Lacs à la mer de l'Ouest, par la mise en place d'un réseau de forts, et balayer toute opposition à leurs visées grandioses.
Le premier corps expéditionnaire
Nous sommes habitués, au XXe siècle, à voir nos soldats partir vers des terres lointaines. Mais quel fut le premier corps canadien à servir hors de l'Amérique du Nord Il est possible que cet honneur revienne à une compagnie de volontaires canadiens qui participa à la prise de l'île de Nevis, dans les Antilles britanniques, en 1706. D'Iberville mentionne ce groupe de « Canadiens ayant fait corps » qui débarque sur l'île avant lui « pour me faciliter le débarquement », dit-il. Tout comme les troupes de la Marine et les volontaires antillais, les Canadiens donnent « des marques essentielles » de bravoure, de discipline et de fermeté durant les combats. Après la reddition de l'île, d'Iberville fait monter à cheval la compagnie de Canadiens et une compagnie de grenadiers, pour l'escorter lors de sa reconnaissance de l'île.
Cette « compagnie des volontaires canadiens » compte 40 hommes sous le commandement de « M. de Mousseau » et semble agir tantôt comme troupe de choc, tantôt comme un genre de garde personnelle auprès de d'Iberville. Tout comme un corps expéditionnaire, elle existe seulement pour le temps de la campagne, et est probablement dissoute à la suite de la mort de d'Iberville à La Havane.