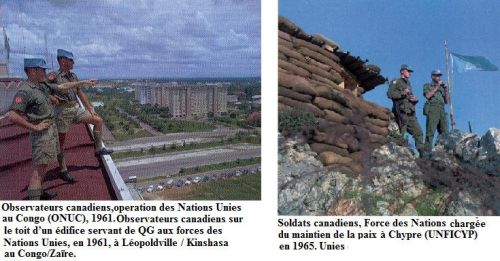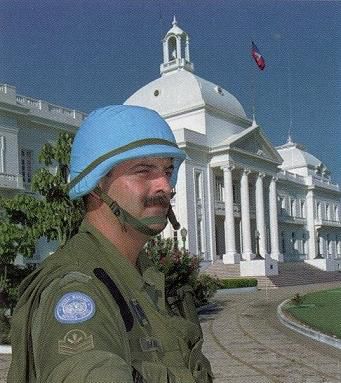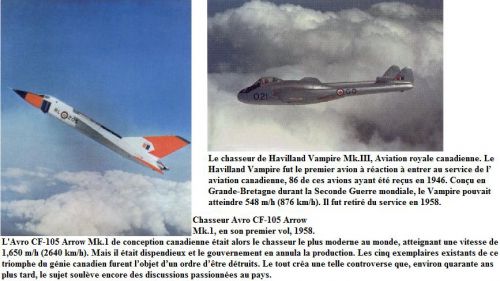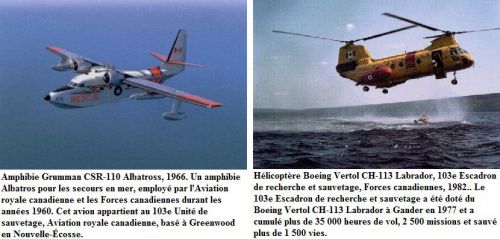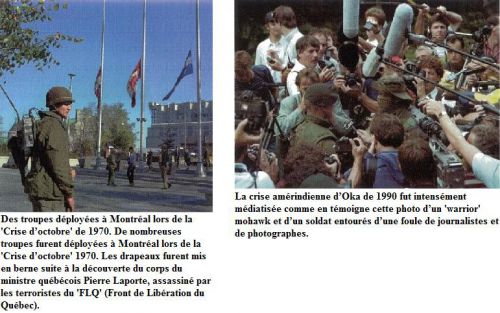De la guerre froide à aujourd'hui
Après la Seconde Guerre mondiale
L'expérience de la Deuxième Guerre mondiale a largement modifié le pays, beaucoup plus centralisé, en 1945, qu'il ne l'était en 1939. Tous les niveaux de gouvernement sont plus interventionnistes. Le Canada a appris, de façon malhabile, il est vrai, à mieux connaître ses minorités (autres que celle de langue française) qui composaient déjà environ 20 pour cent de la population, selon le recensement de 1941 : après 1945, le traitement de ces minorités sera très amélioré. Le Canada est également plus industrialisé, plus américanisé, cette dernière tendance s'approfondissant tout au long de la seconde partie du XXe siècle et, enfin, plus sensible à ses responsabilités internationales et continentales.
Le gouvernement de 1945 est mieux préparé que celui de 1918 à la démobilisation de ses soldats et à assurer l'avenir de son organisation militaire. De la Première Guerre mondiale, les politiciens canadiens avaient retenu la leçon de la gestion politique d'un conflit auquel les Canadiens participaient loin de leur territoire. De la Deuxième Guerre mondiale, ils semblent avoir appris qu'une bonne organisation militaire en temps de paix est essentielle pour un pays qui entend être présent militairement hors de son territoire, ce qui sera le cas de 1945 à nos jours.
Les réorganisations de l'institution militaire. La planification des forces de l'après-guerre
Volontaire des Rangers canadiens, 1988. Volontaire inuit avec des éclaireurs, soient des “Canadian Rangers”, en service dans l’Arctique canadien depuis 1947
Les forces de défense du Canada ont stagné dans l'entre-deux-guerres. Durant la guerre, le comité de hauts fonctionnaires qui s'attaque aux problèmes qui existeront après la fin du conflit propose des niveaux d'effectifs qui permettraient à cette institution militaire de se nourrir elle-même, de s'adapter et d'évoluer.
L'armée de terre professionnelle d'après 1945 pourra atteindre un effectif de 25 000 hommes - la Force mobile (Mobile Striking Force) - avec un effectif de réserve de 180 000 hommes. L'aviation sera constituée de 16 000 personnes (plus 4 500 auxiliaires) avec huit escadrons professionnels et 15 auxiliaires. La marine aura 10 000 hommes, avec deux porte-avions, deux croiseurs et entre 10 et 12 destroyers.
Ces forces armées professionnelles, qui totalisent environ 50 000 hommes, doivent être prêtes à toute éventualité d'ordre militaire. Cela comprend une guerre, l'appui et l'assistance au pouvoir civil, l'instruction de la Milice, le maintien et l'opération des systèmes de communications au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Surtout, elles sont chargées, dans un premier temps, de protéger la souveraineté canadienne, ce qui inclut de nombreux exercices dans le Nord et le développement d'équipements appropriés.
Une autre leçon qu'ont tirée nos politiciens des années 30 c'est que l'espoir mis dans la coopération internationale pour que la paix soit maintenue peut être bien mince s'il ne repose pas sur des moyens d'action. Il faut être présent dans le monde : la génération née au XIXe siècle, qui s'apprête à quitter les affaires, et sa relève le savent bien. Il n'y a pas de paix assurée sans qu'existent des forces qui pourront la sauvegarder. Tous les peuples sont liés entre eux et le repli sur soi n'élimine pas les problèmes. On aura donc plus de militaires qu'après 1918 et on retournera à l'idée d'avoir un seul ministre pour les trois services, alors que chacun a eu le sien durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce retour du principe d'unification annonçait des changements bien plus radicaux, qui viendront moins de 20 ans plus tard.
Du côté de l'armée de terre, on garde les régions militaires avec leurs quartiers généraux et leurs états-majors qui, en principe, pourraient servir chacun une division. Les lieux pour l'instruction sont toujours là, ainsi que le personnel administratif et celui pour la formation des réservistes. La Réserve doit avoir l'effectif de base nécessaire au fonctionnement de six divisions d'infanterie et de quatre brigades blindées. Au total, cette armée, une fois mobilisée, aurait deux corps, plus des unités de défense côtière. Mais les Forces armées restent en général aussi peu attirantes après 1945 qu'avant 1939. En 1949, il manque quelques milliers d'hommes dans les forces régulières et, comme d'habitude, celles de réserve sont bien loin de leur plafond.
La défense durant la guerre froide
Grumman Avenger AS Mk. 3M, 881e Escadron anti-sous-marine, NCSM Magnificent, Marine royale du Canada, 1950-1952. L'Avenger peut transporter 2 000 livres de bombes ou de torpilles à 270 mi/h. Cet aéronef embarqué a contribué en grande partie au dénouement de la Deuxième Guerre mondiale. Cette photo montre une variante de l'anti-sous-marine en service avec le 881e Escadron. C’est à compter de 1946 que la feuille d’érable rouge remplaça le cercle central dans les marques d'avion canadiennes.
La nouvelle Loi de la Défense nationale réaligne quelque peu ce qui a existé depuis 1904, sauf en temps de guerre. Il y aura désormais un Comité ministériel de la Défense présidé par le premier ministre. Le vice-président en sera le ministre de la Défense et les membres, les ministres des Finances, de l'Industrie et du Commerce et des Affaires étrangères.
Le ministre de la Défense présidera également le Conseil de la Défense dont les membres seront : l'assistant parlementaire du ministre, le sous-ministre, les sous-ministres adjoints, les trois chefs d'état-major et le président du Centre de recherches de la Défense. Fait remarquable et trop souvent oublié : en 1950, pour la première fois depuis la première Loi de la Milice et de la Défense ayant suivi la Confédération, on ne trouve pas de clause prévoyant un service obligatoire pour les hommes en âge de le faire. Autrement dit, la loi rattrape enfin la pratique qui s'était implantée dès les années 1870.
Les budgets considérables des années 1940-1946 dégringolent : celui de 1949 sera de 361 millions de dollars par rapport à 2,9 milliards de dollars en 1944-1945.
Mais les prévisions vont exploser pour deux raisons qui reposent sur le grand but du gouvernement : aider à maintenir la paix en se préparant à la guerre. Ainsi, en 1951, sera adopté un budget de cinq milliards de dollars sur trois ans qui sera d'ailleurs dépassé. En 1952-1953 seulement, plus de deux milliards de dollars seront consacrés à la Défense au Canada. Quant aux effectifs, ils seront de près de 50 000 hommes et femmes dans l'Armée régulière seulement, au 31 mars 1954, soit neuf ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est la première fois, en temps de paix, que le nombre des professionnels dépasse celui des miliciens établis à 46 500. Il faut noter ces faits, car ils marquent un changement remarquable dans l'attitude du public face à ses forces. Par exemple, en 1927, neuf ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'Armée de terre comptait à peine 4 000 hommes.
Les réserves depuis 1945. Le rôle de la défense
La Réserve de l'Armée canadienne est de loin la partie des Forces canadiennes qui a la plus grande profondeur historique. Sa tradition remonte directement au Régime français et elle a presque 300 ans d'histoire officielle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été, depuis la Confédération, l'épine dorsale de l'effort de défense du Canada, ici même et outre-mer. Par ses effectifs, par son organisation très enracinée dans les petites localités comme dans les grandes villes, elle a été incontournable au moment des deux grandes mobilisations de ce siècle. Or, à compter de 1945, l'armée professionnelle canadienne tant décriée par les miliciens des XIXe et XXe siècles, va la supplanter grâce à l'arrivée de technologies qui forcent une révision en profondeur des stratégies et de l'utilisation des armées.
En 1946, la Milice a été plus ou moins restaurée dans son statut d'avant 1939. L'arme nucléaire existe déjà, mais on en ignore toutes ses possibilités. Par exemple, est-ce qu'une armée qui se bâtit sur environ deux ans à partir de presque rien (comme après 1914 et 1939) peut être encore utile dans un conflit qui se joue loin de ses bases ? Bien vite, on saura qu'une guerre totale pourrait être terminée avant qu'une telle armée « en devenir » puisse être utilisée.
En 1952, le chef de l'état-major général, le lieutenant général Guy Simonds, qui vient de vivre la création rapide de deux brigades d'infanterie destinées respectivement à la Corée et à la République fédérale allemande, conclut que la Milice ne peut répondre aux attentes soulevées par de soudaines crises. Les guerres risquent d'être courtes et très techniques. Pour les conduire, il faudra des professionnels surentraînés et toujours prêts à entrer en lice. En Europe de l'Ouest, où le Canada maintient une brigade à compter de 1951, il s'agit d'arrêter toute invasion dès les premières semaines de son déclenchement. Dans ce cas, à quoi sert l'organisation de la Milice en six divisions ?
En 1953, Simonds, ayant obtenu l'appui de la Conférence des associations de la Défense, confie à une commission l'étude d'une réforme de la Milice, en fonction de sa raison d'être et de son coût d'opération. Dans son rapport déposé en avril 1954, la commission recommande l'élimination des divisions et des brigades (avec leurs quartiers généraux) et celle de la plupart des défenses côtières et des batteries antiaériennes. Le nombre d'unités blindées croît (de 18 à 22) et celui des unités d'infanterie diminue (de 66 à 54).
Les normes d'entraînement restent les mêmes, mais on donnera plus de temps aux réservistes pour les atteindre. On jumellera les unités de réserve à des unités de la Force régulière durant une semaine ou deux chaque année.
La restructuration de la réserve
Cette nécessaire réorganisation choque tout de même plusieurs qui voient disparaître des bataillons à la source de tant d'excellentes recrues par le passé, en fournissant, par exemple, le commandant du Corps d'armée, dans la Première Guerre mondiale, et trois des cinq commandants de division de la Deuxième Guerre mondiale. Toujours est-il que des régiments, comme le Royal 22e Régiment, accueillent, au titre de leurs 4e et 6e Bataillons, des unités de la Milice et que les régiments amalgamés Canadian Fusiliers/Oxford Rifles forment le 3e Bataillon du Royal Canadian Regiment. De plus, il est implicitement entendu (on ne le crie pas sur les toits et plusieurs miliciens l'ignorent) que lorsque deux régiments de réserve s'appuient, seul le plus puissant d'entre eux serait mobilisé en temps de guerre, l'autre recrutant pour compenser les pertes. Peu à peu, l'on souhaite que les régiments de milice qui marcheront en couples finiront par fusionner, ce qui donnera 27 régiments de réserve, à peu près ce qui serait nécessaire à deux divisions outre-mer plus la défense territoriale.
Le rapport rédigé par le major général Kennedy va aussi dans le sens d'une Réserve de l'Armée régulière formée de personnes ayant terminé leurs contrats dans la Force régulière, mais prêtes à s'entraîner durant 21 jours par année au sein de leur ancien régiment. Ce régime, très peu populaire, sera abandonné après trois ans. C'est à ce moment de ferveur historique que la Réserve de l'après Deuxième Guerre mondiale devient l'Armée canadienne (Milice), ce qui fait réapparaître le lien avec le Régime français.
La Réserve revit un peu à la suite de ces changements, mais certaines évidences sont toujours là. La prolifération des armes nucléaires stratégiques et tactiques rend très improbable que deux divisions puissent arriver en Europe avant que l'issue d'un conflit soit déjà plus ou moins décidée. D'autre part, l'équipement de la Milice vieillit et l'on manque d'argent pour remplacer les blindés Sherman et certains canons de campagne. Simonds, avant de quitter son poste, propose une autre révision de la Réserve. Son successeur, Howard Graham, la fera entreprendre par le brigadier W A. B. Anderson qui conclura, comme par le passé, que la Milice est mal préparée à l'action. Selon lui, aucune unité ne serait prête à combattre 30 jours après l'ordre de mobilisation et plusieurs auraient besoin de quelques mois pour remplir leurs effectifs. Les recommandations d'Anderson qui visent, entre autres, à éliminer complètement les unités les moins performantes, ne seront jamais implantées. Avec l'arrivée du gouvernement conservateur, la Milice se voit assigner un nouveau rôle par le ministre responsable George R. Pearkes, Croix de Victoria de la Première Guerre mondiale, soit celui d'organiser la survie en cas d'attaque nucléaire. La politique d'utilisation change, mais non l'organisation de la Milice issue du rapport de Kennedy. Malgré la résistance de Pearkes qui voudrait tout garder, Graham et son successeur, le lieutenant général S.F. Clark, se débarrassent d'environ 150 sous-unités inefficaces installées à des endroits trop isolés.
Une nouvelle milice
Le retour des Libéraux au pouvoir, en 1963, avec un programme radical de changements pour les Forces armées, incluant des diminutions dans les budgets et les effectifs, appelle une nouvelle étude de la Réserve. Le Comité des chefs d'état-major, le 18 novembre 1963, dit au ministre Paul Hellyer que la Milice ne pourrait guère être utile dans un conflit majeur outre-mer, mais qu'elle peut toujours servir à la défense territoriale et aux opérations de survie suivant une attaque nucléaire.
Le lieutenant général Walsh croit toutefois qu'il y aurait un avenir pour la Milice si on la faisait passer de 51 000 à 30 000 membres (on en comptait 180 000 aussitôt après la fin de la Deuxième Guerre mondiale) et si on lui confiait de vrais rôles militaires, au Canada même et aussi outre-mer. D'où une autre commission qui doit analyser, cette fois, ce que l'on pourrait faire avec 30 000 hommes et femmes. Cette commission doit tailler le rôle d'une milice déjà déterminée politiquement quant à son ampleur. On peut s'y attendre, un grand nombre d'unités disparaissent de l'ordre de bataille, ne devenant que des noms dans la liste supplémentaire. De plus, on désigne des unités majeures et mineures.
Dans les années 70, le plafond des réservistes tombera à 19 200, il remontera dans les années 80 pour revenir se stabiliser autour des 23 000 (officiellement) après les diverses compressions à compter de 1993 : de ce nombre total, qui pourrait d'ailleurs être plus élevé, environ 14 500 appartiennent à la Milice de l'armée de terre.
Le concepte de la force vitale
Le livre blanc de 1987 redonne de l'importance aux réserves. La stratégie de l'OTAN de réponse « proportionnelle » aux attaques signifie que la possibilité d'une guerre nucléaire rapide, des années 1950-1960, a fait place à celle qui ne deviendrait atomique qu'à la suite de phases plus ou moins longues de combats conventionnels, ce qui donnerait le temps aux pays participants de mobiliser leurs réserves. Par conséquent, la Force régulière diminuera et celle de la Réserve augmentera jusqu'à 40 000, le plus grand nombre allant à la Milice. Parallèlement, on développe le concept de la Force totale, par lequel la réserve et la régulière sont mieux amarrées l'une à l'autre, les échanges étant facilités. Ce concept, développé durant le reste des années 1980, garde cependant le professionnel et le réserviste chacun sous des conditions de service qui lui sont particulières, ce qui irrite les miliciens, mais est en voie d'être résolu en 2000. Depuis 1991, par exemple, des milliers de réservistes ont servi en ex-Yougoslavie, à Haïti ou au Cambodge.
Un autre changement à l’horizon
Avion de transport léger de Havilland CC-108 Caribou, Aviation royale canadienne, 1967.
Le rôle principal du de Havilland CC-108 Caribou était le transport et il a participé à plusieurs missions outre-mer des Nations Unies (ONU). L'avion représenté ici a été détruit au mois d'août 1965 en Inde pendant une mission des Nations Unies. Il a été mitraillé par un chasseur de la force aérienne pakistanaise.
Une nouvelle milice
Selon les commissaires, la mobilisation de la Milice devrait se faire en fonction d'un corps d'armée de sept groupes-brigades de milice, chacun ayant à former et administrer de 9 à 11 unités. À nouveau, on souhaite donc la fusion des nombreuses unités actuelles : par exemple, le secteur de l'Ontario, qui a 43 unités, devrait rassembler ses unités en un maximum de 22. La Milice devra être mêlée au processus de rationalisation, recommandent les commissaires. De plus, il doit être entendu que le maximum des montants affectés à la Milice va au recrutement et à l'entretien des réservistes et qu'ils ne doivent pas servir à maintenir des quartiers généraux inutiles et des officiers sans troupes.
Les commissaires ont l'occasion de découvrir deux « cultures » dans l'Armée de terre, avec une Milice qui se méfie d'une Force régulière qu'elle trouve condescendante et qui lui prend ses meilleurs éléments. Du côté des professionnels, on trouve que les miliciens ont la vie trop facile après leur recrutement. D'où le rapprochement dans tous les domaines suggéré par la commission, dont des normes similaires (forme physique, par exemple).
Mais peu importe les réformes, la Réserve, encore réduite en nombre en 1995 par ordre gouvernemental, reste frappée d'un mal dont elle ne semble pas vouloir guérir : le recrutement des unités fonctionne bien, mais le maintien des effectifs est un problème. Une autre constante est la survivance du système régimentaire des unités de milice malgré toutes les attaques subies, surtout à compter de 1954. Depuis cette époque, le scénario stratégique a été modifié en profondeur tellement de fois, que toutes les solutions trouvées par les commissions d'études n'ont été que temporaires. Cette instabilité du cadre n'encourage guère la stabilité des effectifs.
Qu'on le déplore ou non, la Milice, à la fin du XXe siècle, n'a plus la force politique de celle qui existait voici 100 ans. Même en donnant un rôle plus près de la réalité à des milliers de réservistes, ces derniers ne restent pas nécessairement dans la Réserve après un tour opérationnel. Encore ici, la récente commission sur les Réserves a proposé des solutions qui sont, entre autres : la garantie du nombre de jours d'entraînement mensuel entre septembre et mai (en plus des deux semaines de camp) ; les mêmes avantages pour les professionnels et les réservistes, quant à la pension, par exemple ; la recherche de protection de l'emploi quand un milicien part en service. Déjà, fait-on remarquer, le recrutement des réguliers et des miliciens se fait en commun.
Les changements. Le rôle de la force régulière
NCSM Nootka, Marine royale canadienne, vers 1960. Le destroyer Nootka, l’un des huit destroyers de la classe “Tribal” en service dans la Marine canadienne à compter de 1943.
Les Forces permanentes seront également ballottées entre les impératifs politiques internes et les changements stratégiques externes. Le Canada est très tôt attiré dans la guerre froide, ne serait-ce que par les recherches atomiques qui ont été conduites sur son territoire durant la guerre et, quelques semaines seulement après la fin de celle-ci dans le Pacifique, par la défection d'un chiffreur de l'ambassade soviétique, Igor Gouzenko, qui place notre pays au centre d'un réseau d'espionnage soviétique. En février 1948, survient un coup d'État prosoviétique en Tchécoslovaquie suivi, en mars, du blocus de Berlin. La réaction de l'Europe de l'Ouest au danger venu de l'Est sera suivi d'un amarrage de sa défense à l'Amérique du Nord, incluant le Canada.
Le Canada était militairement absent de l'Europe depuis le printemps 1946. Ses troupes stationnées au Canada et ayant survécu à la démobilisation sont peu nombreuses. La Marine a demandé 20 000 hommes et a proposé une flotte comprenant, entre autres, deux porte-avions, et quatre croiseurs. Le gouvernement lui a accordé la moitié de tout cela. L'Armée voulait 55 788 soldats réguliers, 155 396 réservistes et 48 500 conscrits. Elle n'obtient pas la conscription et se voit allouer un effectif de 25 000. L'Aviation obtient 16 000 des 30 000 hommes sollicités.
Le transport Fairchild CC-119G 'Flying Boxcar', Commandement du transport aérien, Aviation royale canadienne. Entré en service en 1952, le Fairchild CC-119 “Flying Boxcar” (wagon de marchandises volant) est le principal avion de transport utilisé par l'Aviation royale canadienne jusqu’en 1965.
Il est entendu qu'on assure la sécurité du territoire tout en se préparant à d'éventuels combats outre-mer. Mais la Marine éprouve des difficultés à garder son personnel qu'elle jugule en augmentant les soldes, en 1947 et 1948 mais aussi la proportion des sous-officiers par rapport aux matelots. Sur les navires qui sont en mer, en février 1949, lorsque cette dernière réforme est implantée, on se retrouve soudainement avec plus de chefs que de matelots, alors que les tâches réservées à ces derniers n'ont pas diminué. De plus, comme c'est l'ancienneté qui a prévalu pour ces promotions, quelques-uns des nouveaux sous-officiers ne sont pas des meilleurs. S'ensuivront les incidents qualifiés trop facilement de mutineries. Jusqu'ici, on a trop relié ces « arrêts de travail » au fait que les officiers de la marine étaient coupés de leurs marins par leur formation trop britannique. La discipline telle qu'elle a été apprise en Grande-Bretagne n'est pas celle qui devrait se pratiquer au Canada, comme l'a signalé la commission, sous la conduite du contre-amiral Rollo Mainguy, qui a étudié les incidents en 1949. Ses recommandations étaient valables à ce sujet. Mais les études des commissaires n'ont pas assez tenu compte de la réaction provoquée à court terme par des réformes dans la gestion du personnel qui, à moyen et long terme, étaient très positives.
L'Armée, pour sa part, crée sa Force de frappe mobile que certains, dont le lieutenant-colonel Ralph Becket, avaient préconisée durant la guerre. Des soldats reçoivent une formation de parachutistes et la force, transportée par l'Aviation canadienne, peut être déployée rapidement sur tout point du territoire susceptible d'être attaqué. Comme l'ennemi reconnu devient vite l'URSS et que celle-ci pourrait arriver par le nord, les exercices arctiques avec équipements et matériel spéciaux sont de mise.
Une force accordéon
L’avion d’entrainnement de Havilland-Canada DHC-1 Chipmunk T.1, Aviation royale canadienne, 1965. L’avion d’entraînement DeHavilland Chipmunk utilisé pour la formation des pilotes durant les années 1950 et 1960. Cette photo était prise à l'École élémentaire de pilotage à Bordon, Ontario, en juillet 1965.
La guerre en Corée et le lancement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord viendront vite changer cette perspective. Entre 1950 et 1953, les forces régulières voient leur effectif passer de 47 000 à 104 000. Le budget de 1947 est multiplié par dix, en 1953, passant à 1 907 000 000 $.
La Marine, qui a besoin de bons techniciens, n'atteindra son nouvel effectif permis qu'à la fin des années 1950 et l'Aviation y mettra aussi quelques années, surtout qu'encore une fois, elle débute avec du matériel de combat déphasé. Quant à l'Armée, elle ressuscite en 1952 le rectangle rouge historique de la 1re Division, porté tout au haut de la manche, à l'épaule : ce signe distinctif disparaîtra quelques années plus tard pour revenir dans les années 80.
Comme nous l'avons vu, plusieurs régiments de milice seront transférés à la Force régulière, dont le Queen's Own Rifle of Canada et le Black Watch. On voudra récrire l'histoire en mettant sur pied le Regiment of Canadian Guards, avec quatre bataillons, une unité qui n'avait guère d'assise historique au Canada. À partir de 1955, des exercices au niveau de la division auront lieu à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, un camp de 440 milles carrés, qu'on vient d'acquérir.
Avec le retour des Conservateurs au pouvoir, en 1957, les budgets de la Défense nationale se remettent à descendre de 1,8 milliard de dollars, en 1957, à 1,5 milliard en 1960. En 1963, on a tout de même 120 871 militaires dans la Force régulière, un record en temps de paix. En 1967, ce nombre est réduit à 110 000. Et, l'année suivante, tous les nouveaux bataillons ajoutés à l'ordre de bataille en 1953 (sauf les 2e et 3e Bataillons des Royal 22e Régiment, du PPCLI et du RCR) retournent à la Réserve. Dans les années 70, le nombre de militaires de la Force régulière baissera jusqu'à environ 80 000 avant de remonter vers 88 000, dans les années 1980. En 1999, ce nombre tombera à 60 000. Quant aux budgets, ils seront gelés dans les années 60 aux environs de 1,5 milliard de dollars, avant de reprendre de l'ampleur en suivant plus ou moins la courbe de l'inflation. Ils plafonneront à 12 milliards au début des années 90, avant de décroître vers les 9 milliards à la fin du siècle.
L’unification. Un nouveau concept
Un des changements marquants subis par les Forces armées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est sans nul doute l'intégration et l'unification des Forces armées canadiennes durant les années 60. Ces modifications n'arrivent pas aussi soudainement qu'on le laisse souvent entendre. Le premier vrai pas vers l'intégration des Forces armées a lieu en 1923 quand, en vue d'accroître à la fois les économies et l'efficacité de la défense nationale, deux ministères (Milice et Défense, et Service naval), auxquels on ajoute l'Aviation nouvellement créée, sont intégrés en un seul. On tente, sans succès, à la même époque, comme nous l'avons déjà souligné, une intégration limitée du grand quartier général. Les officiers supérieurs en poste résistent à cette intégration. En 1939, le comité des chefs d'état-major est créé, mais on doit attendre jusqu'en 1951 pour qu'un président lui soit donné. Ce poste survit, sans pouvoir réel et sans son propre état-major, jusqu'à ce qu'il soit remplacé, en 1964, par le nouveau poste de chef de l'état-major de la défense. C'est aussi en 1939 qu'une ébauche de loi pour l'unification des Forces armées est préparée. Celle-ci n'est toutefois jamais présentée au Parlement, la résistance interne étant très forte et la guerre en Europe l'ayant fait mettre en veilleuse. L'élan vers l'unification reprend en 1947, avec le ministre Brooke Claxton. Il présente au Parlement un texte qui indique en 14 points les objectifs à long terme de son ministère.
Le premier de ceux-ci stipule le besoin d'une coordination plus serrée entre les services militaires et l'unification du ministère, afin de créer une seule force de défense à l'intérieur de laquelle les trois armées pourraient œuvrer ensemble. Claxton ordonne immédiatement l'établissement d'un seul quartier général rassemblant sous un même toit les trois armées. De plus, les trois sous-ministres de celles-ci sont réunis en un seul poste, celui de sous-ministre de la Défense. Claxton ordonne ensuite à chacune des armées d'adopter une structure organisationnelle similaire composée de trois divisions principales, c'est-à-dire planification et opérations, personnel et solde, approvisionnement et équipement. Il ne peut poursuivre ses efforts compte tenu de la force d'inertie des services, de la guerre de Corée et de la création de l'OTAN.
L’intégration des services de soutient
De 1947 à 1951, certains progrès ont cependant été accomplis. Le service de soins dentaires est intégré en 1947 (bien qu'il faille 11 autres années avant que cette intégration soit achevée), et le service de santé en 1951 (consolidé enfin en 1959). Un conseil de recherches pour la défense naît également. Le Royal Military College de Kingston est réouvert pour les trois armées. Le Royal Roads Military College, à Victoria, et le Collège militaire royal de Saint-Jean (bilingue) seront fondés par la suite et accueilleront également des élèves-officiers et des cadres des trois armées dès leurs débuts. Les services juridiques et d'aumônerie sont aussi intégrés ainsi que quelques autres fonctions au grand quartier général, tels les services de la solde et alimentaires. Quant au poste de président du comité des chefs de l'état-major, il apparaît finalement en 1951, en réponse aux besoins créés par la guerre de Corée et aux nécessités organisationnelles de l'OTAN, organisme qui regroupe en conférence régulière les chefs d'état-major des pays membres ou le président de leur comité.
De 1951 à 1961, l'élan intégrateur ralentit. On peut évoquer une période de digestion ou de consolidation. De nombreux comités inter-armées fonctionnent au grand quartier général, mais ils demeurent beaucoup plus des centres d'information que de coordination ou de l'unification des normes. Une commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement (présidée par J. Grant Glassco) est lancée en 1961 et son rapport remis en 1962. On y trouve de solides raisons justifiant une plus grande intégration des fonctions communes aux trois armées. Le document évite toutefois de faire des recommandations trop précises. Le gouvernement Pearson prend les rênes du pouvoir en 1963, décidé à revoir toute la question de la politique de défense du Canada dont les maillons faibles ont été la cause, en partie, de la chute du gouvernement Diefenbaker : le coût des équipements militaires, la défense canado-américaine (surtout la question de la défense aérienne) et finalement le contentieux nucléaire (ayant opté pour le non-nucléaire, le Canada est-il quand même obligé d'accepter ou d'utiliser les armes nucléaires des États-Unis ?). De plus, le besoin d'économiser se fait cruellement sentir, bien qu'il faille aussi rééquiper les armées canadiennes. Le pourcentage du budget militaire affecté à l'achat d'équipement est passé de 42,9 pour cent en 1954, à 13,3 pour cent en 1963. À ce rythme, en 1966, les autres coûts de la défense mobiliseront toutes les sommes, ne laissant rien pour de nouvelles acquisitions.
La commission Glassco a indiqué le besoin de rationaliser non seulement les dépenses du ministère, mais aussi le double emploi (même le triple emploi). Elle a souligné le faible rôle joué par les civils, le sous-ministre en particulier, au grand quartier général, et a avancé qu'il fallait revoir certains règlements qui empêchaient le transfert de personnel compétent d'une armée à l'autre.
L’intégration des trois services Helleyr
Le nouveau ministre de la Défense décide donc de préparer un livre blanc (le dernier datant de 1959), qui est présenté au Parlement le 26 mars 1964. On y indique que le Canada est, à toute fin pratique, peu sujet à une attaque directe et que la politique canadienne de défense conserve son orientation vers la sécurité collective par l'entremise d'un système d'alliances et par une participation aux opérations de maintien de la paix. Le livre blanc conclut donc que des troupes mobiles, bien équipées et sous un seul commandement unifié, serviraient mieux les intérêts du Canada.
Considérant comme essentiel un système de contrôle opérationnel et efficace, un besoin de simplifier les procédures administratives et la nécessité de réduire les coûts généraux d'administration, le livre blanc spécifie qu'il n'existe qu'une seule solution satisfaisante : l'intégration des Forces armées du Canada sous un seul chef de l'état-major de la défense et un seul état-major de la défense. Cette décision constituera la première étape vers la création d'une force unifiée de défense pour le Canada.
Peu après la présentation du livre blanc, le ministre soumet à la Chambre le projet de loi C-90 qui, voté le 7 juillet, prend force de loi le let août 1964. Dès juin 1965, un nouveau chef de l'état-major dirige toutes les forces militaires canadiennes, aidé d'un grand quartier général intégré et réorganisé selon six commandements dits fonctionnels remplaçant les 11 précédents. « Fonctionnel » désigne un commandement non géographique, « hors éléments » et « hors arme traditionnelle ». La « base militaire » devient le point d'appui administratif à l'échelon local, fournissant aux unités « hébergées », c'est-à-dire souvent à des unités qui relèvent d'un autre commandement que celui auquel est liée la base, tous les services requis. En plus, des responsabilités régionales sont attribuées aux principaux commandements fonctionnels en particulier en ce qui a trait au personnel civil, aux cadets et au maintien de l'ordre.
Cette phase d'intégration (1964-1967) provoque assez peu de controverse. Elle est avant tout perçue comme une réorganisation administrative qui n'affecte pas directement les unités. Les armées, bien qu'ayant perdu leurs chefs et leur accès privilégié direct au ministre, survivent légalement au changement. C'est une intégration par le haut, sans doute plus complète et plus efficace que celle tentée à des niveaux inférieurs entre 1947 et 1964.
La réorganisation de l'état-major militaire a très peu d'influence sur la division du sous-ministre. Même si ses responsabilités demeurent les mêmes, son rôle se modifie légèrement, car, dorénavant, il est l'une des deux seules personnes, avec le chef de l'état-major, à conseiller le ministre.
Le livre blanc sur la défense de 1964 et la Loi C-90 contient le germe de l'unification. À la suite de l'abolition des postes de chef d'état-major de chacune des trois armées, de la création d'un poste de chef de l'état-major et de la réorganisation, sous un seul état-major de la planification, de la gérance du personnel, de l'administration, de l'instruction, du soutien logistique, du contrôle et du commandement, l'existence des trois armées, comme entités séparées, devient périmée.
La mise en œuvre de l’unification
Le transport Canadair CC-106 Yukon, Commandement du transport aérien, Aviation royale canadienne, 1967. Le quadrimoteur de transport CC-106 Yukon, alors le plus grand avion construit au pays par l’avionnerie Canadair de Montréal, fut utilisé par l’aviation pour les transports de personnel jusqu’à son remplacement par le Boeing 707 en 1981. Suite à l’adoption du drapeau national rouge et blanc, les rondelles extérieures blue des cocardes de certains avions furent peintes en rouge comme le montre cette photo.
En mai 1967, le parlement adopte la Loi C-243 qui complète le processus de réorganisation du grand quartier général et des commandements. Les trois armées sont dissoutes et tous les échelons militaires doivent se conformer à la nouvelle terminologie du commandement unique. Un système est organisé pour l'évaluation du personnel, la sélection et les promotions. Des comités se mettent à la recherche d'un uniforme commun et à sélectionner les traditions qu'adopte la force unifiée. Les dénominations armée, marine et aviation sont abandonnées pour celles d'éléments terre, mer et air. Un seul chef, une seule armée devient le mot d'ordre.
Pour la plupart des militaires et des civils, l'unification a été entrevue comme possible, mais dans un avenir lointain se situant quelque part dans les années 70, aussi bien dire jamais. Mais le ministre insiste : pour lui, 1968 représente les quelques années plus tard dont il a parlé en 1964 lorsqu'il a décidé l'unification. Il est le champion du changement contre les forces d'inertie et réussit à faire adopter par le parlement la loi C-243. Pour la faire appliquer, il donne quatre feuilles d'érable au seul général qui lui semble fiable pour une telle tâche. Le général Jean V. Allard, seul lieutenant général canadien-français jusque-là, raconte dans ses mémoires comment il est devenu le nouveau chef de l'état-major de la défense qui allait, lors de l'application de la Loi C-243, le 1re février 1968, guider les destinées de la nouvelle force unifiée dans des eaux fort troublées et inexplorées.
En effet, puisqu'en 1964, ni le ministre, ni le président du comité des chefs d'état-major n'avait à son service le personnel indépendant capable d'évaluer les demandes de chacune des armées ou de planifier pour l'ensemble des forces armées, aucun plan précis ni échéancier n'avaient été préparés pour les étapes de l'unification : celle-ci se déroule donc de façon aléatoire. Cette façon de procéder jette le trouble dans l'opinion publique et parmi les parlementaires. La confusion est encore plus grande chez les militaires qui, soit au grand quartier général, soit dans les commandements, reçoivent peu d'instructions précises. Toute la période 1964-1972 est dominée par une seule constante permanente et omniprésente le changement. Bien que tous les soubresauts se soient effectués au niveau militaire, il faut remarquer que ceux-ci ont été provoqués et ordonnés par des civils, surtout par le ministre et son entourage.
L'unification des forces canadiennes n'a pas été copiée ailleurs. Mais cela constitue moins un jugement sur la valeur du produit que sur les circonstances et particularités du Canada que nous avons déjà amplement soulignées immense territoire, faible population (d'où un nombre limité de militaires), faible tradition militaire qui, de plus, repose sur le volontariat, présence de menaces indirectes seulement, voisin allié et surpuissant.
Bien que l'on ait réussi à réduire, mais de très peu, le personnel du grand quartier général à Ottawa (et le calcul est difficile à faire compte tenu des changements de responsabilités des quartiers généraux et de la création de nouveaux), les économies espérées de l'unification ne se sont jamais matérialisées. Encore une fois, l'unification ne semble guère coupable du mince résultat. À partir de 1968, l'inflation devient galopante, rognant une bonne partie des économies qui auraient pu être réalisées.
La réséstance de la marine
NCSM Onondaga, sous-marin de patrouille de la classe 'Oberon', Forces canadiennes, 1987. Le sous-marin NCSM Onondaga était l'un de trois de la classe 'Oberon' en service avec le Marine royale du Canada à compter de 1965.
Somme toute, les armées de terre et de l'air acceptent assez bien l'intégration et l'unification. Le premier chef de l'état-major des forces intégrées est le maréchal de l'air F. Miller et c'est le modèle administratif de l'aviation qui est choisi pour l'organisation des commandements fonctionnels et des « bases militaires ». Le suit, durant la majeure partie du débat sur l'unification (1967-1969), le général d'armée Allard, à la personnalité imposante et fort charismatique, qui a une bonne emprise sur « l'ancienne » armée de terre. C'est principalement la marine qui mènera la campagne contre l'unification et qui en sera la plus heurtée. La marine, très loin d'être bilingue, est restée la plus britannique des trois armées par ses traditions et sa façon d'opérer. Les bases navales sont loin de la capitale et les officiers supérieurs se retrouvent sur les côtes, de 1964 à 1966, à distance du grand quartier général, se croyant à l'abri de la vague de fond unificatrice qui se prépare à faire chavirer tout le ministère. Il est clair que cette préoccupation quant à la « différence » intrinsèque des marins a isolé la marine. Déjà minoritaire en nombre, elle souffrira de « la révolte des amiraux » contre l'unification. Il faudra attendre jusqu'en 1977 avant qu'un amiral puisse occuper le poste de chef de l'état-major de la défense, et ce, pour une période de trois ans seulement. Le prochain amiral, au début des années 1990, ne gardera son poste qu'un an.
Les problèmes de gestions et les solutions
Pour certains, la modification des fonctions, des responsabilités et de la chaîne de commandement la plus sérieuse depuis 1947, malgré l'intégration et l'unification, est la réorganisation qui, en 1972, tente de marier de façon productive les influences militaires et civiles au sein du ministère de la Défense.
Les responsabilités de la division du sous-ministre, qui représente le pouvoir civil en ce qui concerne les fonctions reliées à l'économie et à l'efficacité, n'ont pas été définies dans le cadre de l'unification. Malgré tous les bouleversements survenus au sein de la structure militaire entre 1964 et 1968, le ministère de la Défense nationale est encore aux prises avec des problèmes de gestion. Le programme de remplacement des navires progresse très lentement et subit de fréquentes augmentations de coûts. Le processus de planification, le partage des responsabilités et le contrôle au chapitre des programmes d'immobilisation sont l'objet d'inquiétudes. C'est ainsi qu'un groupe d'étude de la gestion est chargé, en 1971, d'examiner en particulier le programme d'acquisition de navires et, plus généralement, les rapports entre les organisations civile et militaire et celle du conseil de recherches pour la défense. Son rapport, déposé en 1972, recommande la création d'un nouveau quartier général de la Défense nationale (QGDN), où fusionneraient les services du sous-ministre et ceux du chef de l'état-major de la défense. Cette réorganisation, ainsi que la mise en place d'un système de gestion du programme, se concrétise cette même année.
D'autres remaniements suivront sans que, dans un premier temps, l'unification soit remise en question. Ainsi naît le commandement aérien en 1975, alors que l'on abandonne certaines mesures considérées comme démoralisantes (par exemple, le port de certains insignes distinctifs sur l'uniforme, l'utilisation des titres et grades traditionnels dans la marine, etc.), ce qui permet, au dire de certains, d'atténuer le caractère absolu de l'unification. De fait, le costume unificateur commence à se défaire aux coutures.
En 1979, l'élection du gouvernement Clark (qui ne passera que six mois au pouvoir) est l'occasion pour un nouveau ministre de mandater un groupe de travail pour « étudier les avantages et les inconvénients de l'unification des forces canadiennes et [...] donner en même temps une opinion sur le système de commandement unifié ». Après de multiples audiences et une recherche fort détaillée, le groupe conclut qu'entre les années 1964 et 1980, il est très difficile d'évaluer le rôle direct joué par l'unification relativement aux économies de défense, étant donné les compressions des ressources, tant en personnel qu'en équipement, qui ont été imposées au ministère durant cette même période. Les Forces armées demeurent en général sous-équipées, et les sommes d'argent que l'unification aurait dû rendre possibles ont été absorbées par l'inflation, la montée frénétique des coûts de l'équipement militaire, les crises du pétrole (1973, 1979) ainsi que par la parité salariale entre militaires et fonctionnaires civils, instaurée en 1972. Le rapport se montre évasif sur l'atteinte de tous les objectifs recherchés par l'unification parce qu'il n'existe pas de plan de départ avec lequel on aurait pu comparer les buts de 1964 avec les réalisations de 1979. De plus, rien ne permet au groupe d'étude de conclure que l'unification a permis ou non d'accélérer la prise des décisions ou d'abréger le délai de réaction. Sans porter de jugement absolu, le groupe fait 30 recommandations concernant certains problèmes particuliers.
L'examen et la prévision tendancielle de 1980
Son rapport est cependant remis au nouveau gouvernement fédéral libéral qui en ordonne aussitôt la révision. Cette dernière conclut, le 31 août 1980, que le document étudié ne contient aucune recommandation générale sur l'unification elle-même et que ses 30 recommandations se sont fondées sur le principe de la poursuite de l'amélioration des institutions centrales existantes. On en déduit donc que la politique d'unification doit rester en vigueurs.
Le gouvernement conservateur revient au pouvoir en 1984 et ne touche pas à l'unification. Ni le livre blanc de 1987 ni celui de 1994 ne remettent en cause la centralisation.
Depuis 1980, les généraux-commandants sont membres du conseil de la défense et du comité militaire de la défense. Depuis 1985, les militaires portent une fois de plus des uniformes aux couleurs plus traditionnelles. Loin de signifier un retour au passé ou la désunification (ou la désintégration) des Forces canadiennes, ces changements relatent la souplesse et l'adaptation qu'ont su montrer les autorités militaires et civiles devant les difficultés inhérentes à l'établissement d'une structure organisationnelle unique au monde. Le long processus d'intégration et d'unification se déroule en trois phases : la première est d'ordre administratif ; la deuxième touche au commandement et au contrôle des forces armées ; la dernière à l'amalgame bureaucratique (vue dans son sens positif d'organisme de l'État). Cette centralisation trouve sa place dans l'histoire d'un pays relativement jeune, à un moment où celui-ci recherche sa spécificité dans une conjoncture difficile d'unité nationale, tout en faisant face à des difficultés d'acquisition d'équipements militaires coûteux alors que la menace externe est peu contraignante.
Les francophones depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Canadiens français et l'armée
Après la Deuxième Guerre mondiale, le brigadier J.P.E. Bernatchez est chargé de se pencher sur les raisons du manque de francophones au sein de l'Armée et de proposer des solutions à cette question. Dans l'atmosphère générale qui prévaut autour de la défense canadienne, ses recommandations ne vont pas loin, sauf celle préconisant la création d'une école ou seraient instruites dans leur langue les recrues francophones se joignant aux armes de combat. Elle naîtra, en effet, en 1949. Cela dit, après 1945, on a réorganisé les forces armées en fonction des demandes politiques et des schémas connus : on s'est peu empressé, en 1946, à refaire ce travail en incluant dans le processus la nouvelle donnée francophone que certains voudraient insérer. Ne dit-on pas qu'il est difficile de modifier le fonctionnement d'une armée victorieuse ?
La présence francophone dans les forces en expansion des années 1950 est marquée par une série d'études qui portent sur les trois armées. On commence enfin à s'intéresser à ce problème et on fait des constatations qui sont évidentes aux yeux de tout francophone servant ou non dans les forces. Quant à ceux qui ont évité, jusque-là, de réfléchir à toute cette problématique, ils apprennent que les Canadiens français perçoivent les forces de défenses canadiennes comme étant anglaises. Aucune carrière sérieuse n'y serait possible pour un francophone unilingue ou ne possédant pas une connaissance quasi parfaite de l'anglais. Les mutations un peu partout au Canada rendent à tout le moins aléatoires l'éducation en français des enfants et une vie culturelle un tant soit peu normale pour les familles. Toutes ces vérités, qui sont bien connues des francophones comme des sondages le démontrent, ont les effets les plus négatifs sur la participation de ceux-ci à la défense, donc sur la cohésion de l'effort canadien de défense.
Les obstacles à la participation des francophones
Les différentes enquêtes des années 50 mentionnent que les Canadiens français, qui représentent environ 27 pour cent des recrues, retournent à la vie civile dans des proportions effarantes dès la première année. Ceux qui traversent les 12 mois d'adaptation à une nouvelle vie et à une autre langue restent ensuite aussi longtemps que les anglophones. Mais ils sont bien peu. En 1951, 2,2 pour cent des officiers de la marine et 11 pour cent des sous-officiers et marins sont francophones. Une recrue de langue française nécessite 38 semaines d'instruction, en moyenne, avant d'être opérationnelle en milieu naval, alors qu'un anglophone n'en requiert que 21, la différence de 17 semaines sert à l'apprentissage de l'anglais qui s'avère d'ailleurs insuffisant, très souvent, lorsqu’arrive le moment des cours techniques. Le message est clair selon les études : les Canadiens français comprennent qu'ils sont indésirables dans la marine. Une première réponse de la marine arrive en 1952 : on met sur pied une école de langue anglaise où les francophones pourront passer jusqu'à six mois avant d'affronter l'instruction en anglais. En somme, on propose l'assimilation. Ceux qui ont pensé à cette solution se doutent-ils du peu de réponse qu'aura cette proposition ? Dans l'aviation, les choses ne sont guère plus brillantes, la représentation francophone se fixant à 4,7 pour cent parmi les officiers et à 16,3 pour cent pour les sous-officiers et la troupe. Dans l'armée de terre, en 1958, ces pourcentages sont respectivement de 14 et 21 pour cent.
Par ailleurs, dans les années 50, les changements profrancophones sont surtout faits dans l'armée de terre, mais de façon partielle et parfois malhabile. Ainsi, en 1954, on forme une sous-unité francophone d'artillerie que l'on fait servir dans une petite localité de l'Ontario, Picton, où la francophobie est bien vivante. En 1957, c'est un escadron de blindés qui naît. Ces deux sous-unités seront rayées des effectifs dès le début des années 60. En revanche, le Collège militaire royal de Saint-Jean, au Québec, ouvert aux élèves-officiers des trois armées, en 1952, restera jusqu'en 1995 un élément du mouvement en faveur d'une plus grande présence des francophones. On y prêche en faveur d'un bilinguisme fonctionnel de tous les élèves-officiers, anglophones ou francophones, les cours universitaires ou autres sont offerts à chaque groupe dans sa langue, on recrute en moyenne deux francophones pour un anglophone. Durant près de 20 ans cependant, si les trois premières années se passent à Saint-Jean, les deux dernières sont au Royal Military College de Kingston, et en anglais seulement. Qui plus est, les périodes de formation militaire (entraînement d'été, comme on dit) se déroulent très souvent en anglais. Le taux d'abandon des francophones restera très élévé dans ce programme durant cette période initiale.
La situation s'améliore donc très lentement alors qu'au Québec, à compter de la fin des années 50, les francophones revendiquent de plus en plus fortement l'égalité formelle avec les anglophones. Au ministère, on continue de se satisfaire d'études. Ainsi, en 1960, Marcel Chaput, futur champion du séparatisme québécois, produit une analyse sur les résultats obtenus par les officiers anglophones et francophones de l'infanterie, lors de leurs examens de promotion, au cours desquels les seconds réussissent moins bien que les premiers. Les examens sont préparés en anglais avant d'être traduits de façon approximative. Les réponses rédigées en français font, elles aussi, l'objet d'une traduction avant d'être corrigées. Ici se situe une cause importante de problème, dit Chaput. Ajoutons que tout cela se passe dans l'armée de terre, celle où les Canadiens français sont les plus présents et où ils réussissent le mieux. De fait, à compter de 1957, deux majors généraux issus du Royal 22e Régiment vont atteindre, successivement, le deuxième poste dans la hiérarchie de l'état-major de l'Armée : Jean Allard et Paul Bernatchez.
Une politique sur le bilinguisme
Dans le rapport de Glassco, en 1962, on retrouve l'amorce d'un principe de bilinguisme institutionnel qui s'instaurerait dans la Fonction publique canadienne. Retenons surtout les divergences d'un des commissaires, Eugène Therrien, qui consacre de longs paragraphes aux problèmes que rencontrent les francophones dans les forces. Therrien souligne qu'il leur est impossible de se joindre à cet organisme et de s'y sentir à l'aise.
Un an plus tard, la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme est instaurée. En avril 1966, le premier ministre Lester B. Pearson annonce une première série de mesures qui devraient permettre que le français et les francophones soient proportionnellement mieux représentés dans les institutions fédérales. En 1969 arrive, enfin, la Loi sur les langues officielles qui préconise un bilinguisme institutionnel fédéral - c'est-à-dire que, si tous les fonctionnaires n'ont pas à devenir bilingues, l'appareil doit être capable, lui, de servir dans leur langue les clientèles externe et interne. La déclaration de Pearson de 1966 excluait les forces armées, non pas la loi de 1969 toutefois. Mais, entre ces deux moments, les choses se sont mises à bouger rapidement chez les militaires. L'intégration et l'unification ont largement fait leur œuvre. Dans les deux études qui préconisent la réorganisation des anciens métiers (hommes) et classifications (officiers), on a inclus des chapitres sur le bilinguisme. Il y a un refus catégorique du comité d'étude sur les métiers (présidé par un contre-amiral) de voir apparaître plus d'unités de langue française (le Royal 22e Régiment suffit) et de reconnaître au français plus qu'un rôle social. Le comité traitant des classifications (présidé par un major général de l'Armée) est beaucoup plus ouvert, suggérant même que toute l'instruction puisse être un jour disponible en français pour les francophones. Ayant pris connaissance des conclusions préliminaires du rapport de la Commission royale, ce groupe de travail a même fait une première estimation du nombre de postes d'officiers bilingues dont les forces unifiées auraient besoin.
On s’attaque à la question de la langue
On doit surtout retenir qu'au milieu des années 1960, alors qu'on se prépare à une réorganisation de taille, on est prêt à aborder, même imparfaitement, la question des francophones et de leur langue dans les Forces canadiennes. Mais il y a plus. Deux ministres, Paul Hellyer et Léo Cadieux, futur ambassadeur en France, vont se succéder, entre 1964 et 1970, à la tête du ministère. Ils veulent que le sort des francophones change. En outre, pour la première fois, un Canadien français accède au poste militaire suprême. Le général Jean Allard est un héros de la Deuxième Guerre mondiale qui, en 1943, son horizon semblant bouché parmi les cavaliers, est passé de l'arme blindée à l'infanterie. Au milieu des difficultés que l'on imagine, il a réussi à préserver son identité francophone et à faire instruire ses trois enfants en français. En 1985, Allard a publié des mémoires dans lesquelles il consacre de grands extraits aux francophones dans les forces ainsi qu'un chapitre entier à ce qu'il a fait pour renverser le sort plus que centenaire qui leur était réservé.
Entre 1966 et 1969, le général Allard fera de la question francophone un dossier prioritaire. Il avancera sur tous les fronts et fixera de grands objectifs. C'est ainsi que le livre blanc de 1971 - deux ans après son départ - fera état d'une de ses adjonctions, à savoir que les francophones devraient être représentés dans tous les métiers, classifications et grades, en proportion de leur poids démographique au sein de la population canadienne. Durant ses trois ans comme chef de l'état-major, il multipliera les unités de langue française (ULF) dans les trois armées, mais aussi dans les différentes armes de l'armée de terre. Il lancera un programme qui, une fois achevé, permettra aux francophones d'être recrutés et instruits en français avant de servir certaines parties de leur carrière dans leur langue, au sein des ULF.
Ces grandes poussées amorcées, Allard laissera à ses successeurs le soin de poursuivre. La voie qu'il a ouverte a été reprise avec plus ou moins de bonheur par ses successeurs francophones ou anglophones depuis 1969. Une défense pancanadienne exige la participation de tous les citoyens et, surtout, de la minorité importante de francophones qui habitent ce pays. Ceux-ci doivent être traités avec justice et leurs particularités culturelles, ce qui inclut la langue, doivent être reconnues et respectées.
Il serait trop facile de conclure qu'aujourd'hui toutes les anomalies traditionnelles dans les forces ont été effacées. Depuis 1983, les francophones comptent pour environ 27 pour cent dans les forces, ce qui était un des buts fixés par Allard. Cependant, ils restent surreprésentés à la base des grades et sous-représentés à peu près partout ailleurs. De plus, dans certains des emplois militaires, d'où ils avaient été notablement absents jusque dans les années 1960, le déficit n'a pas été comblé, loin de là. Et que dire de l'instruction, où le français a fait des gains impressionnants, entre 1969 et 1972, pour ne plus progresser que très lentement durant quelques années avant de régresser dans certains aspects, au début des années 1980, pour ne reprendre un élan qu'une douzaine d'années plus tard.
Alors que le bilinguisme était l'apanage presque uniquement des francophones, les plans de la fin des années 1960 et du début des années 1970 ont tous fait une place très grande à des cours de langue française aux anglophones. Malheureusement, peu des objectifs établis à cet égard ont été atteints à ce jour.
En somme, beaucoup a été accompli pour reconnaître formellement que la cohésion de la défense nationale passait par une intégration parfaite des francophones dans l'institution militaire. On a échafaudé un cadre d'accueil et de vie en français dans les forces qui sert aussi bien les francophones que les anglophones bilingues. Toutefois, il est évident à tout observateur impartial qu'il reste du chemin à parcourir. Sans certains coups de frein appliqués durant les années 70, la situation actuelle serait encore plus positive qu'elle ne l'est présentement.
Le maintien de la paix. Le Canada et les nations Unies
Le 2ème bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, Kap’Yong, Corée, 1951. Les 24 et 25 avril 1951, le 2ème bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry posté à Kap’Yong, en Corée, repoussa jour et nuit les assauts répétés de la 118ème division chinoise. Cette action arrêta le progrès de l’armée chinoise vers Séoul, la capitale coréenne. Impressionné par tant de bravouve et de ténacité, le président des États-Unis lui décerna la “American Distinguished Unit Citation” portée depuis par le bataillon.
Créée en 1945, l’aéronavale canadienne eut d’abord le porte-avion NCSM Warrior en 1946 bientôt remplacé de 1948 à 1957 par le NCSM Magnificient, illustré ici à Port-Saïd, Egypte, durant 1957.
NCSM Magnificient, porte-avion d’escadre léger de la classe 'Majestic', Marine royale du Canada, 1957.
L'ouverture du Canada sur le monde passe par sa participation à la vie internationale. La Société des Nations ayant échoué, les grands de ce monde essaieront de faire mieux avec l'Organisation des Nations unies (ONU). Dans les années 20, les Canadiens pouvaient dire qu'ils étaient si loin des sources de conflagration qu'ils n'avaient pas besoin d'assurance contre le feu. Mais les années 1939-1945 ont démontré, tout comme la période 1914-1918, que ce qui ce passait sur une partie de la planète pouvait facilement toucher le Canada.
La politique étrangère du Canada d'après 1945 sera de faire en sorte que la sécurité internationale soit assurée. Il n'y a donc guère d'hésitation à accepter le chapitre VII de la Charte des Nations unies qui prévoit l'action de ces dernières « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Évidemment, dans le monde de droit dans lequel nous évoluons, chaque mot a un sens. À l'ONU, on est parvenu à s'entendre sur la définition du mot agression vers le milieu des années 70. Du coup, ce terme devient très difficile à prononcer et, jusqu'à l'invasion irakienne du Koweit, il ne sera plus utilisé à l'ONU.
La partie III de la Charte permet aussi au Conseil de sécurité « d'entreprendre au moyen de forces (armées), toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité ». Comme le secrétaire général de l'ONU peut enquêter dans des situations où la paix est menacée, on lui permettra d'envoyer des observateurs dans certains cas. D'ailleurs, la période immédiate d'après-guerre est passablement troublée, soit au Moyen-Orient, avec la création d'Israël, soit un peu partout dans le monde à la faveur de la décolonisation. C'est dans cette fonction d'observation qu'en 1949 des militaires canadiens serviront pour la première fois l'ONU, au Cachemire.
Mais il ne faut pas se leurrer, l'observation ou le maintien de la paix ne constitue pas une très haute priorité à la défense : jusqu'en 1955, on est en peine de trouver quelque référence que ce soit à cette fonction dans les documents officiels du ministère. Cela dit, les missions d'observation auxquelles les militaires canadiens seront conviés jusqu'à nos jours seront nombreuses et les plus évidentes se passeront au Moyen-Orient avec l'Organisation des Nations unies pour la surveillance de la trêve (ONUST) qui doit enquêter et faire rapport sur les violations du cessez-le-feu de 1949 entre Israël et ses voisins. Cette mission a accueilli des centaines d'officiers-observateurs canadiens jusqu'à nos jours, certains occupants des postes très importants, comme le major général E.L.M. Burns, qui en a été le chef d'état-major au milieu des années 50, après avoir commandé un corps d'armée canadien en Italie durant la guerre. La participation directe ou indirecte à l'observation au nom de l'ONU par des militaires canadiens se fera aussi bien entre l'Inde et le Pakistan qu'au Yemen ou au Liban. Au fil des ans, ce travail s'étendra à une panoplie d'activités dont, entre autres, l'aide à l'organisation d'élections et à la supervision de leur tenue dans divers pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale ou des Caraïbes.
La guerre de Corée
Parfois, l'intervention canadienne reliée à l'objectif « paix » se fera à l'aide de moyens importants. Ainsi en est-il de la première grande mission de paix sous l'égide de l'ONU, mais commandée par des Américains, qui est mieux connue sous le nom de guerre de Corée. En 1945, les occupants japonais de la Corée du Nord s'étaient rendus aux Soviétiques et ceux de la Corée du Sud aux Américains. L'entente entre alliés stipulait que des élections pan-coréennes seraient rapidement organisées. Une commission spéciale de l'ONU chargée de veiller à la réalisation de cette élection n'a pas abouti. Dans la nuit du 24 au 25 juin 1950, la Corée du Nord décide de régler à sa façon la réunification coréenne, par une attaque massive contre le sud de la péninsule. La guerre froide qui a cours dès 1945, mais qui a pris une certaine ampleur à partir de 1948, risque de tourner en une vraie guerre. La politique de la chaise vide adoptée par l'URSS au Conseil de sécurité, à ce moment-là, permet à ce dernier de décider d'une intervention sous direction américaine en faveur de la Corée du Sud.
Pour aider à ce rétablissement de la paix, le Canada envoie, le 30 juin, trois de ses destroyers qui seront rapidement engagés dans la protection de convois, le bombardement en appui aux débarquements ou rembarquements de troupes terrestres de l'ONU ou, encore, dans celui de trains ennemis qui utilisent les voies ferrées côtières. En juillet, un escadron de transport aérien est aussi placé sous le commandement de l'ONU pour servir entre les États-Unis et le Japon. Puis le 7 août, on annonce la formation de la Force spéciale de l'Armée canadienne. Plutôt que d'envoyer la brigade de la Régulière, on se fonde, comme en 1914 et 1939, sur le volontariat pour créer la 25e Brigade d'infanterie. Les trois régiments du moment formeront chacun un deuxième bataillon de volontaires pour l'occasion.
Fantassin canadien en Corée, 1951-1954. Entre 1950 et 1955, douze bataillons d'infanterie canadienne ont servi en Corée, 1951-1954, la plupart dans la 25 e brigade d'infanterie canadienne, une partie de la Première division du Commonwealth.
C'est au 2e Bataillon du PPCLI que revient l'honneur d'être le premier au combat. À l'été 1951, lorsque la brigade canadienne sera complète, en Corée, elle fera partie de la 1re Division du Commonwealth composée aussi d'Australiens et de Britanniques. Cette intervention qui devait être de courte durée se poursuivra pendant quatre ans et amènera le Canada à y commettre, en roulement, ses bataillons de la Régulière ainsi qu'un 3e Bataillon que chacun des régiments ajoutera à ses 1er et 2e Bataillons.
On se souvient que la division canadienne prévue pour la guerre du Pacifique, en 1945, devait être entraînée et équipée à l'américaine : c'est exactement ce qui se produit en 1950 en ce qui a trait à l'entraînement, bien que l'équipement soit un mélange canado-britannico-américain.
Avant que le Canada soit présent sur le terrain, les troupes appuyant la Corée du Sud, américaines surtout, rétablissent temporairement les choses. Si bien qu'en novembre 1950, elles ont reconquis tout ce qui avait été perdu au sud (en fait, la majorité du territoire sud-coréen) et ont tellement avancé au nord qu'elles approchent des frontières chinoises.
Chars Canadiens M4A3E8 Sherman, Corée, 1951. Chars Sherman du Escadron 'C' du Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) (2nd Armoured Regiment) en Corée durant l’année 1951.
C'est alors que les Chinois entrent en ligne et, avec leurs alliés nord-coréens, font reculer l'ONU qui contre-attaque à compter de février 1951. C'est durant cette phase de la bataille que le 2e Bataillon du PPCLI est engagé. À la mi-avril, on est au nord de la frontière nord-sud qui existe depuis 1945. Le 22 avril, une division sud-coréenne est cependant mise en déroute au nord de Kap'Yong et la 27e Brigade du Commonwealth est ramenée, alors qu'elle était en réserve, pour empêcher la percée à travers la vallée de la Kap'Yong. De la fin du jour du 22 jusqu'au matin du 23, le PPCLI résiste à toutes les attaques au prix de pertes somme toute minimes (10 tués et 23 blessés). Cela lui vaudra une citation à l'ordre du jour du président américain, un fait tout à fait singulier dans notre histoire militaire. C'est plus ou moins la fin de la poussée sino-coréenne. Le front est rétabli aux environs du 38e parallèle, soit à la frontière qui séparait les Corées avant le début des hostilités. En 1952 et 1953, plusieurs combats défensifs de petite ou moyenne envergure et d'actions pour le contrôle du no man's land auront lieu, et ce, jusqu'à la trêve signée le 27 juillet 1953. Plusieurs de ces engagements seront plus coûteux que celui de Kap'Yong. En mai 1953, par exemple, les Canadiens perdent 60 hommes à la suite d'une attaque contre une position tenue par le 3e Bataillon du RCR. En novembre 1951, ce sont les hommes du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment qui ont subi le coup d'une dure attaque. Le 8 novembre 1954, les combattants canadiens reviennent au pays.
Presque 22 000 Canadiens auront servi en Corée. Avec plus de 1 500 pertes, dont 309 morts, cette intervention canadienne devient la troisième plus coûteuse de celles menées outre-mer.
Les urgences au Kongo et à Chypres
Un 'béret bleu' canadien, vers 1975. Un 'béret bleu' canadien au service des forces de la paix des Nations Unies à Chypre, vers 1975.
Ce ne seront pas les seules opérations d'envergure que le Canada consentira à l'ONU. Au Congo (Zaire), par exemple, entre 1960 et 1964, plus de 400 Canadiens serviront surtout à titre de signaleurs, au sein de l'Organisation des Nations unies au Congo, dans une mission de rétablissement et de maintien de la loi et de l'ordre qui requerra au total, la présence de près de 20 000 représentants de l'ONU. À Chypre, le Canada interposera entre Chypriotes turcs et grecs, entre avril 1964 et juin 1993, 58 contingents différents totalisant des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, dont plusieurs auront eu l'occasion de répéter plus d'une fois un séjour dans l'île. Depuis 1993, le Canada ne maintient plus que deux militaires au sein du quartier général de cette force internationale d'interposition.
Le maintien de la paix et la guerre du golfe Persique de 1990-1991
NCSM Protecteur, navire de soutien opérationnel de la classe 'Protecteur', Forces canadiennes, avec le cuirassé américan USS Wisconsin, 1990.
Le NCSM Protecteur est le seul navire de soutien opérationnel des Forces canadiennes en station sur la côte pacifique. Dans la photo, Protecteur ravitaille le cuirassé américain USS Wisconsin dans le golfe Persique. Des navires et des avions canadiens participèrent à la guerre du golfe 1990 contre l’Irak.
L'intervention qui se rapprochera le plus de celle faite en Corée sera la guerre pratiquée dans le golfe Persique, en 1990-1991, où seront déployés trois navires, deux escadrons d'avions de chasse, une compagnie d'infanterie et un hôpital de campagne. Les Canadiens, sous la conduite d'un quartier général intégré situé à Al-Manama, au Bahrein, seront surtout présents dans le blocus naval de l'Irak et les patrouilles aériennes de reconnaissance ou de combat. Aucune perte ne sera subie en cette occasion. La petite participation canadienne (environ 1 000 hommes et femmes, au total) à la coalition anti-irakienne montée par l'ONU sous commandement américain, aura joué son rôle dans la libération du Koweit envahi par l'Irak durant l'été 1990.
Adjudant-chef Gagné, Forces canadiennes, Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR), 1994. L’infirmière Gagné donnant des soins à des enfants blessés dans un dispensaire de fortune au Rwanda lors du génocide en 1994.
Depuis 1991, le Canada a contribué à d'autres grandes opérations de maintien de la paix sous le chapeau de l'ONU, entre autres en mer Rouge, avec un navire et 250 hommes, en ex-Yougoslavie, entre 1991 et 1995, au Cambodge et en Somalie (1992-1993), au Rwanda (de 1994 à 1996), à Haïti (de 1995 à 1997), au Timor Oriental (1999-2000).
Le Canada est devenu le champion quant au nombre de participations à différents types de missions de maintien de la paix de l'ONU. Mais notre pays a également lancé un nouveau genre de mission en 1956. Lester B. Pearson, alors secrétaire d'État canadien aux Affaires extérieures, propose de placer des soldats de l'ONU entre Israël et l'Égypte, sur la ligne d'armistice instaurée à la suite d'un conflit de quelques semaines entre ces deux pays - Israël étant soutenu par la France et la Grande-Bretagne. Pearson fait sa proposition le 1er novembre et, quelques jours plus tard, l'Assemblée générale de l'ONU approuve le projet. Il s'agit, en quelque sorte, de séparer les belligérants jusqu'à ce qu'une entente intervienne. Ce qui devait prendre quelques mois, prit plus de 20 ans, parsemés d'autres batailles.
Transports de troupes blindées M113 canadiens, Force de protection des Nations Unies (UNPROFOR), 1993. Des transports de troupes blindées canadiens au service des Nations Unies à l’aéroport de Sarajevo, en Bosnie, durant le siège de la ville en 1993.
Bien que cette nouvelle façon de maintenir la paix grâce à une Force d'urgence des Nations unies (FUNUI) n'ait pas été parfaite, loin de là, elle lancera un processus qui, sous diverses formes, se continue de nos jours, en particulier à Chypre.
Au moment de la mise sur pied de la FUNUI, le Canada choisit d'y commettre un bataillon du Queen's Own Rifles of Canada. À l'époque, les soldats canadiens se distinguent à peine des Britanniques qui viennent tout juste de quitter l'Égypte et qui ont pris fait et cause pour Israël en octobre-novembre 1956. Les Égyptiens font comprendre qu'une telle unité, fût-elle canadienne, serait des plus mal vues dans les circonstances. Finalement, le Canada appuiera la mission par la logistique, avec plus de 1 000 hommes, (signaleurs, ingénieurs, logisticiens, aviateurs ou marins). À la FUNU II (1973 à 1979), le Canada fournira à peu près le même nombre de militaires qui joueront un rôle presque similaire à celui de leurs prédécesseurs.
Caporal-chef, Forces canadiennes, Haïti, 1996. Soldat canadien au service des Nations Unies devant le palais présidentiel à Port-au-Prince, Haïti, en 1996.
Dans toutes ses missions reliées au maintien de la paix (une quarantaine à ce jour), qui ne relèvent pas toutes de l'ONU d'ailleurs - les observateurs canadiens au Viêt-nam, au Laos et au Cambodge, de 1954 à 1973, travaillent pour la Commission internationale de supervision et de contrôle, composée de quatre pays - les Forces canadiennes fourniront, au total, plus de 100 000 hommes et femmes. Plus de 100 de leurs militaires seront tués un peu partout dans le monde lors de ce type d'opérations.
Evacuent un soldat blessé, Force de protection des Nations Unies (UNPROFOR), durant 1994. Des militaires canadiens évacuent un soldat des Nations Unies blessé en Bosnie en 1994.
'La vie militaire', 1994. On oublie parfois que nos soldats qui partent pour les missions des Nations Unies ont souvent des jeunes familles.
L’OTAN. Une nouvelle allaince de dissuasion
Quatre ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada décide de devenir membre d'une alliance de type conventionnel en vertu de l'article 51 et du chapitre VIII de la Charte des Nations unies, qui permettent des accords régionaux en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales. Dans l'histoire contemporaine de notre pays, le Traité de l'Atlantique Nord de 1949 est un événement important, car le Canada fait désormais partie d'une vaste alliance militaire, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là : sa zone de défense inclut maintenant les deux rives de l'Atlantique et une partie de la Méditerranée.
On comprend mal ce traité si l'on ne s'arrête pas à quelques faits importants. L'Union soviétique a connu une expansion territoriale importante à la suite du second conflit mondial, englobant dans son territoire de petits États comme la Lituanie, et s'emparant de parties de la Finlande. Elle a aussi conquis la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Au total, l'URSS s'est agrandie de centaines de milliers de kilomètres carrés, et quelques dizaines de millions de personnes sont passées sous son joug. Cette politique de l'annexion s'appuie à la fois sur une idéologie communiste dynamique et sur une armée qui n'a pas été démobilisée après 1945. La présence de celle-ci est très visible jusqu'au centre de l'Allemagne.
Par ailleurs, de 1945 à 1947, les effectifs américains en Europe sont réduits et passent de 3 100 000 hommes à 154 000 ; ceux des Britanniques, de 1 300 000 en 1945 à 500 000 en 1946. Quant aux troupes canadiennes, elles sont toutes ramenées au pays à la fin de 1946. La contribution canadienne au relèvement de l'Europe se fera par des crédits financiers ou l'envoi de nourriture et d'approvisionnements de toutes sortes dont les nombreux équipements des démobilisés canadiens offerts à des divisions néerlandaise et belge.
D'autre part, l'Europe de l'Ouest est en pleine reconstruction économique. La priorité est donnée aux besoins primaires. Ses forces armées sont mal équipées et pratiquement inexistantes. Une force militaire défensive, considérable en nombre et puissamment armée, doit logiquement y être constituée en vue d'intimider d'éventuels agresseurs, au premier rang desquels on place l'Union soviétique. Signé le 17 mars 1948 par la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, le Traité de Bruxelles établit les bases de cette puissance militaire.
Cependant, les Européens n'ignorent pas que seule la présence militaire américaine en Europe peut les protéger face à l'Union soviétique. Déjà, avant la signature du Traité de Bruxelles, l'Angleterre fait parvenir aux États-Unis une proposition d'alliance entre les pays bordant l'Atlantique Nord ; le Canada en ferait partie. À ce sujet, entre mars et juin 1948, le Canada participe avec la Grande-Bretagne et les États-Unis à des négociations qui seront accessibles, par la suite, aux autres pays désireux de s'engager.
Lors des négociations entourant le traité, le Canada constate que plusieurs des points de vue qu'il avance sont rejetés. Il obtiendra toutefois un succès mitigé. Dès l'ouverture des pourparlers, les négociateurs canadiens ont insisté pour que le traité ne se limite pas aux aspects militaires. Cela a été accepté à la suite de longues discussions avec d'autres représentants incrédules.
La clause Canada de L’OTAN
L'article 2 du traité, qui en contient 14, est souvent qualifié de « clause canadienne ». Essentiellement, on y encourage la coopération économique entre les pays membres. De vives réticences venaient surtout du fait qu'on croyait inutile d'ajouter aux instances internationales de coopération économique déjà nombreuses.
Cette opposition à la volonté canadienne était pertinente jusqu'à un certain point et il ne faut pas s'étonner si l'article 2 du traité a été peu fréquemment utilisé jusqu'à tout récemment. Cependant, des liens très forts ont été formés sur les plans politique et économique entre les pays membres depuis 1949.
Dix-huit pays font aujourd'hui partie de l'Alliance et, selon l'article 5 du traité, toute attaque contre l'un d'entre eux sera considérée comme une attaque contre tous. Bien qu'elle ait varié, notre contribution navale, terrestre et aérienne à l'OTAN est restée constante au cours des années. Elle s'affiche aujourd'hui par la participation canadienne à la mission d'appui à la réorganisation de l'ex-Yougoslavie où l'OTAN joue un rôle beaucoup plus semblable à celui des gardiens de la paix de l'ONU, auquel les Canadiens sont habitués, qu'à celui pour lequel les armées de l'OTAN ont été préparées. Peut-être est-ce, tout bien analysé, un signe du succès qu’a connu l'OTAN.
Cela dit, une alliance reste un conglomérat d'intérêts particuliers et les alliés sont loin de parler tous le même langage sur une question donnée. Dans l'affaire de Cuba, en 1962, les instances consultatives, pourtant nombreuses à l'OTAN, sont plus ou moins mises de côté par les États-Unis. Il est évident que la super grande puissance américaine est prêt à écarter ses petits partenaires lorsqu’elle le juge approprié. D'autres grandes puissances peuvent agir aussi de cette façon : la France et l'Angleterre, en 1956, dans l'affaire de Suez, en est un exemple.
La Corée et les engagements outre-mer
Dans un premier temps, en 1949-1950, le Canada perçoit que sa participation au fonctionnement du traité sera économique et se fera à l'intérieur du plan Marshall. Mais la guerre de Corée précipite les choses. La Corée n'est-elle pas, se demande-t-on, qu'une attaque de diversion, la véritable devant se dérouler contre l'Europe de l'Ouest ? Du coup, on commence à organiser le traité (d'où l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord). Le général Dwight Eisenhower accepte de quitter sa retraite dorée pour prendre le commandement suprême des troupes de l'OTAN. Même avant d'avoir été installé en poste, à l'automne 1950, il demande que le Canada lui fournisse des troupes, ce qui est accepté.
N'en doutons pas, l'affaire de Corée, sitôt après 1945, à des effets psychologiques palpables. Ainsi, Brooke Claxton déclare, le 18 juillet 1951, lors d'une émission radiophonique politique de la CBC : « Les succès en Corée, loin de diminuer le besoin de puissance, ont montré que nous ne devons plus jamais désarmer en face d'un éventuel ennemi complètement armé. C'est pourquoi nous devons continuer cet effort combiné pour empêcher l'agression en édifiant nos forces et en les gardant toujours prêtes. »
Et Claxton de continuer dans la même veine en disant que la Corée a souligné nos déficiences, que les pertes de vies et les pertes financières qui en ont découlé ont servi de leçons : « Le fardeau du maintien de nos forces armées est lourd et continuera d'être lourd pendant quelques années encore. Le fait que le conflit actuel prendra peut-être fin en Corée devrait augmenter notre résolution d'être suffisamment forts pour prévenir une agression ailleurs. »
En 1951, le gouvernement ajoute un nouveau groupe-brigade d'infanterie (le 27e), qui sera recruté en grande partie parmi les unités de Milice (comme le 25e, pour la Corée) afin de servir sous le contrôle de l'OTAN, en Europe. Pour le moment, cette formation est appelée à faire partie du Service spécial, qui est différent de la Force régulière et de la Milice. Ce groupe-brigade aura son quartier général, son artillerie de campagne, ses escadrons blindés (venus de la Force régulière), des sapeurs, des signaleurs, en plus d'autres unités de soutien aux trois bataillons d'infanterie. Cela s'ajoute donc à la Force de frappe mobile (un groupe-brigade d'infanterie de la Force régulière) et aux deux divisions de la Milice servant au Canada, ainsi qu'au 25e Groupe-brigade d'infanterie en Corée.
Le plus long déploiement outre-mer de troupes canadiennes en temps de paix débute avec l'arrivée du navire Fairsen à Rotterdam, le 21 novembre 1951, ayant à son bord les noyaux précurseurs du 27e Groupe-brigade. En 1993, alors que l'on s'apprête à mettre fin à cette présence, plus de 100 000 militaires canadiens auront servi pour l'OTAN.
Il n'y a d'ailleurs pas que l'armée de terre sous commandement de l'OTAN. On y engagera neuf escadrons de chasse, nombre qui sera porté à 11 puis à 12, donc à une division aérienne, dès 1953. Dans les années 1950, l'Aviation fournira aussi l'entraînement à de nombreux pilotes des Forces aériennes alliées de l'OTAN. Pour sa part, la Marine canadienne sera présente dans l'organisation navale visant à protéger les voies commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Europe : depuis des années, un de ses navires (en rotation) est membre de la flotte permanente de l'OTAN dans l'Atlantique, laquelle est constituée d'unités fournies par plusieurs alliés.
Au départ, le Canada croit que ses troupes pourront être rapatriées au fur et à mesure du redressement de l'Europe. En fait, le nombre diminuera de façon substantielle au tournant des années 70, mais l'effort canadien sera là jusqu'à ce que la menace soviétique disparaisse, à compter de 1991. Les avantages économiques de la présence canadienne là-bas n'ont jamais pu être comptabilisés de façon précise, mais il n'est pas du tout évident qu'ils aient pu à eux seuls la justifier, contrairement à ce que de nombreux commentateurs ont souvent avancé
L’effet de l’OTAN
Chasseur Lockheed CF-104 Starfighter, le 417e Escadron d'entraînement opérationnel d'attaque et de reconnaissance, Forces canadiennes, le 4 juin 1983.
Le CF-104 Starfighter de conception américaine ayant une vitesse maximale de 1,450 m/h (2320 km/h), servit dans l’Aviation royale canadienne et les Forces canadiennes de 1961 jusqu’au milieu des années 1980. Il équipa les escadrilles basées en Allemagne.
Chose certaine, l'OTAN a permis l'effort de réarmement canadien des années 50, à un moment où l'Europe est économiquement faible. Les milliards de dollars votés ont été consacrés à la mise sur pied d'une marine de 100 navires de tout tonnage, de 40 escadrons de l'ARC et de l'équivalent d'une division d'infanterie. Mais, à la fin des années 60, les Canadiens en Europe sous l'égide de l'OTAN passeront d'environ 10 000 à 2 800 du côté de l'armée de terre, et le nombre d'escadrons baissera à trois, désormais armés de CF-104, plutôt que des Sabres F-86 du début. Le porte-avions Bonaventure prendra le chemin de la ferraille et le Commandement maritime baissera à environ 10 000 hommes. Dans les années 80, après des années d'oubli, les forces subiront un réarmement coûteux, surtout du côté naval et aérien, avec 12 nouvelles frégates, 137 nouveaux chasseurs aériens, 18 avions de patrouille Lockheed Aurora.
Tout au long des années 1951-1993, l'OTAN sera l'une des priorités du gouvernement, parfois même, la première.
Chasseur McDonnell-Douglas CF-18, Forces canadiennes, 1985. Un chasseur McDonnell-Douglas CF-18 lors d’un essai des fusées CRV-7 de construction canadienne par le Centre d'essais techniques (Aérospatiale) en 1985. Le CF-18 entra en service en 1982.
Le char de combat Léopard C1, Forces canadiennes, 1981. Le char de combat allemand Léopard C1 remplace le Centurion britannique dans les Forces armées canadiennes depuis 1978. (MDN, 81-137)
Le groupe brigade de l’infanterie
Les miliciens qui partent pour l'Europe en 1951 ont signé un contrat de deux ans. Dès que le Canada a su que son séjour européen serait plus long que prévu, il a fait du 27e Groupe-brigade de la Force spéciale son 1er Groupe-brigade d'infanterie canadienne de la Force régulière, qui est officiellement établi à la mi-octobre 1953. Les formations utilisées deviennent permanentes et les miliciens en fin de contrat ont le choix entre le retour à la vie civile ou l'entrée dans la force active. À ce moment, plusieurs des unités de la Force régulière qui sont allées en Corée au sein de la 25e Brigade se transportent en Allemagne, au sein de ce nouveau groupe-brigade qui tombe sous le commandement des Britanniques, dans une partie de leur secteur.
Pendant ce temps, les 2e et 3e Groupes-brigades, formés lors de la réorganisation de 1954, commencent à s'entraîner. En 1955, le 25e Groupe-brigade rapatrié de Corée prend le nom de 4e Groupe-brigade d'infanterie. Dès lors, on aura une brigade réservée à l'OTAN, alors que les trois autres seront au Canada, dont deux brigades attachées à la 1re Division canadienne et l'autre formant la Force de frappe mobile. Une deuxième division est censée être prête à se battre 30 jours après l'émission d'un ordre de mobilisation.
En 1967, la division aérienne qui logeait en France et était sous commandement américain doit quitter le pays. On l'installe à Lahr et à Baden-Solingen, deux petites villes séparées par quelques kilomètres. En 1970, ce qui reste du 4e Groupe-brigade quitte ses quartiers du nord de l'Allemagne pour venir rejoindre l'aviation. Ainsi peut-on unifier la participation canadienne. Mais du fait de la réduction des effectifs et de la disparition du rôle nucléaire tactique pour l'armée de terre, les troupes canadiennes se retrouvent en réserve, avec une mission importante, mais façonnée à la lumière de ses petites possibilités.
Après quelques changements de brigades en Allemagne, le Canada a adopté la politique suivante : le nom de la formation de l'armée de terre en Allemagne sera le 4e Groupe-brigade d'infanterie mécanisée et, à l'intérieur de celui-ci, on fera désormais une rotation des individus, non des unités. Au fil des années, le Canada a dû améliorer la vie de ses militaires et de leurs dépendants, en fournissant des écoles, par exemple. Tout cela est devenu extrêmement coûteux. Dès que la menace soviétique est disparue, l'effort canadien outre-mer a fait de même.
Le NORAD (North American Air Defense Command). La défense continentale
Ainsi, en 1936, le président américain Delano Roosevelt laisse entendre que la défense du Canada fait partie de la politique de défense des États-Unis. Deux ans plus tard, il déclare, très clairement cette fois, que les États-Unis ne se contenteraient pas de laisser faire si le territoire canadien était menacé d'invasion. Le premier ministre canadien, William Lyon Mackenzie King, répond alors que son pays fera tout en son pouvoir pour se garder à l'abri d'une attaque ou d'une invasion. Le Canada s'arrangera pour que, si une telle occasion se présentait, les forces ennemies ne puissent poursuivre en territoire canadien leur route jusqu'aux États-Unis, que ce soit par terre, par mer ou par air. Les états-majors des deux pays mènent dès lors des discussions secrètes destinées à mettre au point des mesures de défense communes en cas d'attaque.
En août 1940, deux mois après la défaite française en Europe et alors que les États-Unis sont toujours neutres dans le conflit, Roosevelt et King se rencontrent et s'entendent, à la suite d'une proposition américaine, pour mettre sur pied la Commission permanente conjointe de planification militaire. Cette entité à caractère consultatif tient ses réunions à huis clos et prépare des recommandations à l'intention des deux gouvernements.
Une collaboration dynamique s'instaure. Elle s'amenuise après 1944 pour renaître en 1946, au moment où s'annonce la guerre froide. Les innovations technologiques des années 1939 à 1945, ainsi que l'apparition de l'ennemi soviétique ont rendu tout le continent nord-américain très vulnérable. Des mesures communes de défense s'imposent.
Entre 1950 et 1954, trois réseaux de radar sont construits au nord du continent (dont la ligne DEW), en très grande partie en sol canadien. En cas de menace venant de cette direction, ils alerteront les forces aériennes américaines prévues pour la défense et les représailles nucléaires. En 1956, un groupe d'étude canado-américain se penche sur la défense aérienne des deux pays, et en décembre, il recommande la création d'une structure intégrée binationale comme méthode la plus efficace pour assurer cette défense.
Le 10 juin 1957, les Conservateurs, après 22 ans passés dans l'opposition, forment le gouvernement. Les chefs militaires canadiens soumettent presque aussitôt au ministre de la Défense, George Pearkes, un projet d'entente, déjà accepté par les Américains, qui mettrait sur pied un commandement opérationnel canado-américain pour la défense du continent. Le 24 juillet, le premier ministre John Diefenbaker et George Pearkes, sans consulter d'autres membres du Cabinet, accepte l'entente.
Le NORAD (North American Air Defense Command). Un commandement Canada-É.-U. Intégré
Un accord comme celui qui crée le NORAD, liant deux pays voisins dont la puissance politique, économique et militaire, réciproque est tellement disproportionnée devrait causer de nombreuses mésententes. Il y en a eu et il continue d'y en avoir. Les plus importantes sont politiques et sont reliées, d'une façon ou d'une autre, à la délicate question de la souveraineté du Canada.
L'affaire de Cuba, à l'automne 1962, a servi de révélateur. À cette occasion, les États-Unis, se disant menacés par l'installation de rampes de lancement soviétiques à Cuba, ont entrepris de dangereuses manœuvres anti-soviétiques qui auraient pu conduire à la guerre. Le Canada ne fut pas consulté avant la prise de décision, les Américains croyant que les Canadiens l'accepteraient d'emblée : ce ne fut pas le cas et cela créa un grand malaise.
Dès ses débuts, le NORAD a divisé l'Amérique du Nord en commandements régionaux dont plusieurs, qui incluent des territoires s'étendant des deux côtés de la frontière, sont exclusivement couverts par des forces aériennes américaines. En 1969, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau annonçait que les activités du NORAD se passant en territoire canadien relèveraient des seuls Canadiens dès que possible. En 1986, certaines régions canadiennes étaient encore sous la protection américaine. Les nouveaux moyens de défense dont s'est muni le Canada depuis (en particulier les avions F-18) ont finalement permis de concrétiser la volonté gouvernementale.
Depuis 1978, le Canada s'est lancé dans un vaste programme de réarmement qui servira non seulement le NORAD, mais aussi l'OTAN. Simultanément, les Canadiens veulent contrôler entièrement leur espace aérien civil ou militaire. Des milliards de dollars sont et seront investis à la suite de ces décisions : le seul système d'alerte et de défense contre une attaque aérienne est, de quelque point de vue que l'on se place, extrêment coûteux.
L’héritage du NORAD
Certains prétendent que le NORAD est absolument nécessaire aux Canadiens, qui ne pourraient assumer seuls les coûts d'une telle défense. D'autres y cherchent leur profit. Dès 1958, on s'est demandé si le Canada aurait au moins sa juste part dans la production de défense pour le NORAD. La réponse, affirmative, sera fournie l'année suivante lorsque l'on créera le Programme conjoint de productions militaires par lequel les industries canadiennes peuvent participer à l'adjudication des contrats de défense américains. Cela conduira à un genre de marché commun en matière de défense qui devient très rapidement profitable au Canada. Le Comité permanent des affaires extérieures et de la Défense nationale a estimé, en octobre 1980, que, depuis 1959, le Programme a permis au Canada d'obtenir un solde global positif de 1,1 milliard de dollars. De plus, le Canada a pu se tenir à la fine pointe dans certains secteurs, dont l'électronique et l'aviation.
Au NORAD, au contraire de ce qui se passe à l'OTAN, Canadiens et Américains se retrouvent en tête à tête. Le Canada a-t-il une véritable liberté de choix dans ses affaires militaires ? A-t-il ou aurait-il une voix à émettre sur le « quand » et le « comment » de l'utilisation de représailles nucléaires par les Américains ? Au fond, le Canada dirige-t-il vraiment sa destinée ou n'est-il qu'un wagon attaché à la locomotive américaine ? À la fin, il s'agit de savoir si plusieurs des empiètements sur notre souveraineté, imputés au NORAD, n'auraient pas existé de toute façon.
Conclusion. Le rôle de l’armée au Canada
Des constantes existent dans notre vie militaire en ce qui concerne les années sur lesquelles nous venons de nous pencher. Comme hier, les militaires d'aujourd'hui sont soumis à l'autorité politique du pays. Cette relation civile-militaire exige beaucoup des deux parties et elle a eu, nous avons pu le constater, des hauts et des bas. Des militaires ont tenté de passer outre la volonté des politiciens, surtout au XIXe siècle et jusqu'au tournant du XXe, ce qui n'a guère aidé leur carrière et a nui à l'institution militaire, laquelle était perçue avec méfiance par les autorités politiques. Par ailleurs, certains ministres se sont trop immiscés dans le fonctionnement des forces militaires, par exemple, durant la Première Guerre mondiale, portant ainsi atteinte à leur crédibilité auprès de la troupe qui versait alors son sang. La conséquence finale de décisions peut devenir une question de vie ou de mort de Canadiens et de Canadiennes au service de leur pays et cela est bien compris. Mais les erreurs de jugement restent une réalité trop humaine, hélas ! : il faut les admettre, en corriger les résultats et, surtout, ne pas les jeter inutilement au visage de ceux qui les ont commises.
NCSM Labrador, navire de patrouille Arctique de la classe 'Modified Wind', Marine royale du Canada, 1954. Dans l'année 1954, le NCSM Labrador était le premier navire à circumnavigué l'Amerique du Nord. Il était en service de 1954 à 1957.
Les forces armées canadiennes d'aujourd'hui restent, tout comme elles l'étaient en 1871, un instrument de guerre prêt à s'adapter. Au début du XIXe siècle, quatre bataillons de 750 hommes chacun pouvaient fournir un feu à peu près équivalent à celui de la mitrailleuse M61A1 « Vulcan » (20 mm) de la fin du XXe siècle. Cette dernière, plus précise, a un rayon d'action beaucoup plus grand et son effet est bien supérieur aux bataillons de 1815. Le combattant a dû évoluer avec la technologie qui, aujourd'hui, va de la frappe aérienne chirurgicale au sous-marin nucléaire. Nous avons vu comment la tactique a été modifiée durant la Première Guerre mondiale afin de survivre lors d'assauts contre des positions défensives qualifiées d'imprenables. Pour servir la grande stratégie, le couple technologie-tactique, sans cesse en évolution, reste à la base de la survie du combattant.
Les Canadiens du XIXe siècle désiraient déjà aller combattre à l'étranger. C'est au tournant du XXe siècle que ce mouvement devint déterminant. Aujourd'hui, pour visiter un cimetière militaire canadien, il faut se déplacer hors du pays. Ces lieux de repos de héros, combinés à des monuments de diverses factures et ampleurs, se retrouvent en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe. L'engagement canadien dans le monde à l'intérieur de la notion générale et changeante du maintien de la paix est un prolongement contemporain de cette tendance qui existait déjà sous le Régime français, alors que de jeunes Canadiens s'enrôlaient dans les armées royales. Depuis 1945, ce concept du maintien de la paix s'est imposé comme une pratique internationale reconnue, dont l'objectif est de contribuer, modestement, à la résolution pacifique des conflits et, par extension, à la stabilité et à la sécurité mondiales. Mais les deux grandes guerres du XXe siècle restent les points d'orgue de notre présence militaire hors des frontières du Canada.
Un nouveau point de vue et une nouvelle vision
Ce qui nous conduisons à d'autres constatations. Il y a eu les Régimes français et anglais qui ont permis aux Canadiens de faire assumer l'effort de leur défense largement par d'autres. Lorsque cette période fut terminée, le Canada se porta au secours de ses deux mères patries. Mais pour la période étudiée dans ce tome-ci, la mentalité des Canadiens les portait à demeurer dans une attitude de sujétion plus ou moins prononcée vis-à-vis de la Grande-Bretagne, même durant la Deuxième Guerre mondiale. En février 1946, un comité conjoint américano-canadien de collaboration militaire est créé. Chacun des deux pays y délègue des représentants militaires des trois éléments ainsi que des fonctionnaires des Affaires étrangères. Le 12 février 1947, le premier ministre du Canada et le secrétaire d'État américain font une déclaration simultanée sur la collaboration des deux pays en matière de défense en temps de paix. On y prévoit l'échange de militaires et, en certaines occasions, d'observateurs (manœuvres, élaboration ou essai d'armes nouvelles de combat, normalisation des armes, du matériel et de l'organisation) ; la mise à leur disposition mutuelle d'installations militaires navales et aériennes ; un minimum de formalités dans les mouvements d'aéronefs et de navires au-dessus du territoire et dans les eaux territoriales de chaque pays. D'une certaine façon, dans le processus des normes unifiées qui datait d'avant 1914, avec les Britanniques, les Américains venaient de prendre le relais.
Malgré cette tendance lourde de dépendance, une autre a fait son chemin durant toute la période étudiée dans ce tome, comme dans celles couvertes par les deux précédents, il s'agit de la canadianisation. Cela se remarque dans la mentalité et les actions de notre monde militaire, en somme, dans les grandes et les petites choses. Mais on semble incapable de faire les derniers pas, les plus coûteux. Ainsi, le système des honneurs militaires canadiens mis en place à partir des années 70 a maintenu la Croix de Victoria à son sommet. Cette décoration suprême de l'Empire britannique n'a pas été accordée à un Canadien depuis la Deuxième Guerre mondiale. La question se pose : pourquoi pas une « Croix de Vimy » pour reconnaître un acte de bravoure hors du commun accompli par un combattant ?
Un facteur vital- La milice
Un dernier aspect qui mérite d'être mentionné est la présence toujours vivante de la Milice ou de la Réserve dans notre concept de défense. Évidemment, elle est plus importante en nombre et en influence en 1871 qu'en l'an 2000. Au début, et jusqu'à 1939, elle est encadrée par une petite armée permanente. Durant la guerre, un comité de planification de l'après-guerre, où siégeaient de hauts fonctionnaires et qui était présidé par Norman Robertson, a décidé de renverser la situation. Désormais, bien qu'il ait fallu une bonne trentaine d'années pour bien « asseoir » les nouveaux faits, les réserves ne serviront plus que d'apport à une armée professionnelle plus importante, mieux équipée et plus occupée que celle d'avant 1939. On n'avait peut-être pas tort si l'on se fie à ce témoignage, datant de 1952, de ce qu'étaient encore les exercices annuels de la milice.
« Les officiers, de même que les soldats, considéraient ces camps d'entraînement, celui de Lévis comme les autres, comme une chose agréable, plutôt une récréation ou une sorte de sport, ou encore une occasion de grouper ensemble les gens d'une même localité, suivant notre mentalité grégaire, mais jamais ces expériences n'auraient pu être considérées comme suffisamment efficaces, en cas de déclaration de guerre. »
Lorsque les recommandations de la plus récente des études sur les réserves auront été totalement mises en œuvre, on aura donné aux membres de cette organisation, rassemblés dans un nombre réduit d'unités, un rôle à la mesure de leurs possibilités, tout en rééquilibrant en leur faveur les conditions de service qui leur étaient faites depuis trop d'années par rapport aux forces professionnelles. En somme, le « contrat » qui existe au moment où nous écrivons ces lignes, entre, d'une part, la population canadienne, peu nombreuse, vivant sur un immense territoire et n'ayant aucun ennemi rapproché, et, d'autre part, ses forces de défense professionnelles et de réserve, devrait tenir durant quelques décennies, à moins d'un changement brusque et d'importance dans la situation internationale.
Au centre de nos réflexions historiques, sont restés les jeunes Canadiens et Canadiennes prêts, maintenant comme toujours, à mettre leur vie volontairement en jeu pour de grandes causes. Ce sont eux et elles que nous saluons ici le plus respectueusement.
Histoire de notre engagement Chronologie de L’engagement du Canada en Afghanistan 2001–2011
Traditionnellement
Le Canada a établi des relations diplomatiques avec l’Afghanistan pour la première fois en 1968 pour coordonner le travail humanitaire et de développement qu’il a commencé à fournir à la fin des années 1960 à la suite d’une série de catastrophes naturelles.
Avant 2001, l’assistance de l’Agence canadienne de développement international à l’Afghanistan consistait surtout en aide humanitaire, d’une valeur de 10 à 20 millions de dollars par année pour des besoins fondamentaux.
2001
11 septembre : Une série d’attaques suicides sont menées aux États-Unis par le groupe terroriste Al-Qaïda.
12 septembre : Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) adopte la résolution 1368, qui appuie les efforts pour éradiquer le terrorisme en Afghanistan.
7 octobre : Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent l’opération Enduring Freedom pour démanteler le réseau terroriste Al-Qaïda en Afghanistan et pour déloger le régime taliban du pouvoir.
8 octobre : Le Canada annonce qu’il fournira des forces aériennes, terrestres et maritimes à l’opération Enduring Freedom.
5 décembre : La conférence de Bonn établit les termes d’un accord pour que le gouvernement intérimaire de l’Afghanistan dirige le pays à la suite de la chute des talibans.
22 décembre : Hamid Karzaï est assermenté à titre de président de cet organe intérimaire, qui doit laisser place dans les six mois à un gouvernement de transition, choisi au moyen d’une Loya Jirga d’urgence (un grand conseil qui regroupe des représentants mâles sélectionnés localement de différentes tribus et factions de l’Afghanistan).
22 décembre : Le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise la création de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) (en anglais seulement), dont le mandat est de maintenir la sécurité à Kaboul et aux environs de manière à ce que les employés du gouvernement intérimaire afghan et des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sécuritaire.
2002
Janvier : Le Canada rétablit ses relations diplomatiques avec l’Afghanistan.
Janvier : À la suite de la Conférence internationale sur l'aide à la reconstruction de l'Afghanistan tenue à Tokyo, le Canada répond à la demande d’investissements pour le développement à long terme formulée par le gouvernement afghan en renforçant considérablement son engagement à l’égard du pays.
28 mars : Le Conseil de sécurité des Nations Unies (en anglais seulement) établit la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA). De concert avec le gouvernement intérimaire, la MANUA est responsable de la gestion et de la coordination de l’ensemble des activités d'aide humanitaire, de redressement et de reconstruction des Nations Unies en Afghanistan.
13 juin : La Loya Jirga élit Hamid Karzaï comme président du nouveau gouvernement de transition de l’Afghanistan. Le gouvernement intérimaire doit diriger l’Afghanistan jusqu’à ce qu’un gouvernement pleinement représentatif puisse être élu dans le cadre d’élections libres et justes, qui devront être tenues au plus tard deux ans après la présente Loya Jirga.
Octobre : des soldats canadiens sont déployés en Afghanistan dans le cadre de l’opération Enduring Freedom dirigée par les États-Unis.
2003
Août : Sous le mandat de l’opération Athena, des membres des Forces canadiennes sont déployés à Kaboul pour participer à la mission des Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) pour aider à maintenir la sécurité à Kaboul et dans les régions avoisinantes.
Août : Le Canada ouvre son ambassade à Kaboul.
2004
Janvier : L’Afghanistan met en œuvre une nouvelle constitution.
Mars : Le Canada s’engage à verser 250 millions de dollars d’aide à l’Afghanistan, et 5 millions de dollars pour appuyer l’élection présidentielle afghane de 2004.
Octobre : Des élections présidentielles sont tenues en Afghanistan pour la première fois depuis la chute des talibans. Les élections sont organisées par les Nations Unies avec l’aide de la communauté internationale.
2005
Septembre : On tient les premières élections législatives afghanes (Wolesi Jirga) depuis la chute des talibans. Les élections sont organisées par les Nations Unies (en anglais seulement) avec l’aide de la communauté internationale.
Août : Le Canada assume le leadership de l’Équipe provinciale de reconstruction de Kandahar (EPRK) et le commandement d’une mission militaire difficile : assurer la sécurité d’une grande province rurale (Kandahar), qui est de la taille de la Nouvelle-Écosse, avec seulement 2500 soldats.
2006
Janvier : La conférence de Londres approuve le Pacte pour l'Afghanistan, qui établit le cadre pour la coopération internationale avec l’Afghanistan pour une période de cinq ans. Par la suite, le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval à la Stratégie intérimaire de développement national de l'Afghanistan, qui fournit des stratégies et programmes précis pour améliorer la vie et les conditions de vie du peuple afghan.
Février : Le commandement permutant du Commandement régional sud passe des États-Unis au Canada
2007
Février : Le premier ministre Harper affecte 200 millions de dollars de plus à la reconstruction et au développement à l’appui des efforts du Canada en Afghanistan.
Octobre : Le gouvernement du Canada charge le Groupe d'experts indépendant d’examiner la mission du Canada en Afghanistan et de formuler des recommandations sur le rôle futur du Canada en Afghanistan.
2008
Janvier : Le Groupe d’experts indépendant publie son rapport, plus couramment connu sous le nom de « rapport Manley » (Le Groupe d’experts était dirigé par l’ancien ministre libéral des Affaires étrangères John Manley), dans lequel il recommande des priorités plus ciblées, des repères clairs, des communications plus fréquentes aux Canadiens concernant l’engagement du Canada en Afghanistan et une planification intégrée.
Février : Le Parlement vote pour prolonger la mission de combat à Kandahar jusqu'en 2011.
Juin : Le Canada définit le cap de son engagement en Afghanistan jusqu’en 2011, en établissant six priorités et trois projets de premier plan pour l’Afghanistan, et réoriente 50 p. 100 de sa programmation sur Kandahar.
Les quatre premières priorités portent principalement sur Kandahar :
Maintenir un environnement plus sécuritaire et la loi et l’ordre en renforçant la capacité de l’Armée nationale afghane et de la Police nationale afghane ainsi qu’en appuyant les efforts complémentaires dans les secteurs de la justice et des services correctionnels; fournir des emplois, de l’éducation et des services essentiels, tels que l’eau; offrir une aide humanitaire aux populations vulnérables, y compris les réfugiés; accroître la sécurité et la gestion transfrontalières entre le Pakistan et l’Afghanistan.Les deux dernières priorités ont une orientation nationale : renforcer les institutions afghanes qui sont au cœur des priorités à Kandahar et appuyer les processus démocratiques, tels que les élections; faciliter les efforts dirigés par les Afghans en vue d’une réconciliation politique afin d’affaiblir l’insurrection et d’encourager une paix durable.
Les trois projets de premier plan sont : la remise en état du barrage Dahla et de son système d'irrigation dans la province de Kandahar; la construction et la réparation de 50 écoles dans des districts ciblés de la province de Kandahar et assure la formation de 3000 enseignants; l’éradication de la polio à l’échelle nationale.
À ce moment :
La présence civile du Canada en Afghanistan triple;
Des rapports trimestriels au Parlement et des repères sont établis en ce qui concerne l’engagement du Canada en Afghanistan;
Le Canada annonce qu'il fera passer son affectation sur dix ans au développement et à la reconstruction en Afghanistan de 1,3 milliard à 1,9 milliard de dollars (de 2001 à 2011).
Juin : Conférence de Paris : Les ministres du Canada et de 67 autres pays se réunissent pour une Conférence internationale de soutien à l’Afghanistan. La Conférence de Paris vient renforcer le soutien au Pacte pour l'Afghanistan de 2006, la collaboration multinationale qui contribue au développement de l’Afghanistan, et recueille des promesses de dons de 20 milliards de dollars pour la stratégie de développement du pays.
Août : Le Bureau d'appui canadien à la gouvernance commence ses activités afin de fournir des conseils techniques d’expert au gouvernement afghan dans des secteurs clés qui sont mentionnés dans la Stratégie de développement national de l’Afghanistan, dont les services de maintien de l’ordre, la législation en matière de droits de la personne, les activités liées aux élections, la formation professionnelle et l’éducation, le génie, la gestion financière et l’administration.
2009
Mars : La Conférence internationale sur l’Afghanistan commence à La Haye. Des délégations de 72 pays discutent de l’avenir de l’Afghanistan et du rôle que peut jouer la communauté internationale.
Mai : Le Canada introduit le Défi afghan, une initiative de financement qui appuie les projets de développement d’organisations canadiennes et qui fait connaître des projets qui sont bénéfiques à la vie des Afghans.
Juin : Dans le cadre de son engagement à mieux informer les Canadiens du rôle du pays en Afghanistan, le Canada lance sa tournée pancanadienne de l’exposition multimédia Afghanistan360°.
20 août : On tient les premières élections présidentielles et les premières élections aux conseils de province dirigées par les Afghans depuis la chute des talibans. Ces élections représentent la deuxième série d’élections démocratiques tenues par le pays depuis la chute des talibans.
2010
Janvier : La deuxième Conférence de Londres a lieu et permet de réunir la communauté internationale et des partenaires afin d’aligner pleinement les ressources militaires et civiles derrière une stratégie politique dirigée par les Afghans. La stratégie mobilise le peuple afghan dans la défense de son pays pour diviser l’insurrection et renforcer la coopération régionale.
Juillet : La Conférence de Kaboulrenouvelle l’engagement de la communauté internationale à l’égard de l’Afghanistan et du peuple afghan. Plus de 75 pays et organismes internationaux participent à l’événement, qui est organisé par le gouvernement de l’Afghanistan.
Durant la conférence, la communauté internationale et le gouvernement de l’Afghanistan conviennent du plan de transition de l’Afghanistan—le processus Inteqal—pour voir les Afghans assumer le leadership en matière de sécurité, de gouvernance et de développement économique.
Septembre : Les premières élections législatives dirigées par les Afghans pour élire la Wolesi Jirga (chambre basse) sont tenues. Il s’agit des deuxièmes élections législatives en Afghanistan, mais des premières dont le processus électoral est dirigé par les Afghans depuis la chute des talibans en 2001.
Novembre : Le gouvernement annonce le nouveau rôle du Canada pour 2011-2014.
2011
Mars : L'Afghanistan annonce que les forces afghanes commenceront à assumer la responsabilité en matière de sécurité dans sept régions de l'Afghanistan d'ici juillet 2011. Le transfert de la responsabilité en matière de sécurité pour les sept régions représente un premier pas très important dans le processus Inteqal, qui verra la responsabilité première en matière de sécurité à l’échelle du pays être transférée de la FIAS aux Forces de sécurité nationale afghanes d’ici la fin de 2014.
Juin : Le contingent de représentants du gouvernement canadien quitte l’Équipe provinciale de reconstruction de Kandahar étant donné que les cibles de nos six priorités et trois projets de premier plan sont presque atteints.
Juillet : Le Canada met fin à sa mission de combat dans la province de Kandahar.
Juillet : Le Canada entame un nouvel engagement qui se concentrera à Kaboul et qui visera quatre priorités : investir dans l’avenir des enfants et des jeunes Afghans au moyen de programmes de développement dans les domaines de l’éducation et de la santé; renforcer la sécurité, la primauté du droit et le respect des droits de la personne en fournissant jusqu’à 950 formateurs des FC, du personnel de soutien et environ 45 policiers civils canadiens pour aider à former les Forces de sécurité nationale afghanes; favoriser la diplomatie à l’échelle régionale; fournir de l’aide humanitaire.
Juillet : Le processus Inteqal commence : les Forces afghanes commencent à assumer la responsabilité en matière de sécurité dans sept régions de l’Afghanistan, incluant : les provinces de Bamyan et Panjshir, la ville d’Herat, la province de Kaboul, Lashkar Gah (Helmand), Mazar-e-Charif (Balkh), et Mehtar Lam (Laghman).
2 novembre : La Conférence d'Istanbul sur l'Afghanistan a lieu, avec pour objectif de promouvoir la sécurité régionale et la coopération parmi les pays d'Asie centrale et australe. La déclaration issue de la conférence inclut des mesures visant à renforcer la confiance, qui seront mises en oeuvre par l'Afghanistan et les pays voisins afin de combattre le terrorisme et de renforcer le contrôle des stupéfiants et l'intégration économique régionale
27 novembre : L'Afghanistan annonce la deuxième phase de la transition de sécurité et identifie les villes, districts et provinces pour lesquels la responsabilité en matière de sécurité sera transférée des forces internationales aux Forces afghanes.
5 décembre : La Conférence internationale sur l'Afghanistan a lieu à Bonn, en Allemagne, dix ans après la chute du régime taliban. La communauté internationale et l'Afghanistan s'entendent sur un partenariat renouvelé et fondé sur le respect d'engagements mutuels, pour la "décennie de la transformation" au-delà de 2014.
15 décembre: La dernière rotation des Forces canadiennes à Kandahar, déployée sous l'égide de la Force opérationnelle de transition de la mission (FOTM) de juillet à décembre 2011, revient au Canada après avoir complété la clôture de la mission militaire menée dans la province de Kandahar.
2012
21 mai : Sommet de l’OTAN en Chicago, Illinois : Le Premier ministre Stephen Harper a issué une déclaration et a confirmé que la mission militaire du Canada en Afghanistan prendrait définitivement fin au terme de la mission de formation actuelle, le 31 mars 2014.
2 juin: Son Excellence l’ambassadeur Glenn Davidson a présenté ses lettres de créance au président Hamid Karzai et est officiellement entré en fonction à titre d’ambassadeur du Canada auprès de l’Afghanistan.
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 6 autres membres