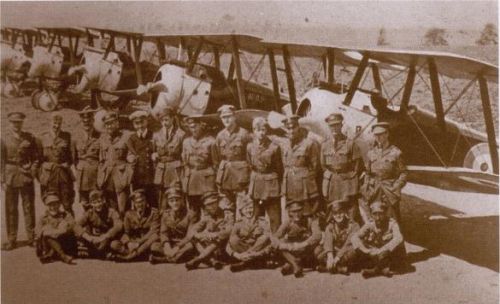Le Canada en 1914
La Première Guerre mondiale
Hôpital de campagne, 1914. Au début des hostilités, l'armée française portait encore l'uniforme bleu et le pantalon rouge. Déployés ainsi habillés dans les plaines de la Champagne et de la Flandre, les soldats subirent des pertes terribles face aux mitrailleuses modernes, l'artillerie rapide et les 'bolt action rifles.' Depuis, toutes les armées portent des tenues aux couleurs ternes.
En juillet et août 1914, de nombreux pays, dont la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Belgique et leurs colonies, partent au combat contre les empires centraux allemand et austro-hongrois. L'Italie les rejoint en mai 1915. En décembre 1917, la Russie signe une paix séparée, mais les États-Unis ont déjà commencé à la remplacer sur les champs de bataille, étant en guerre auprès des alliés depuis avril 1917.
À la suite de cette tourmente guerrière, des empires vont disparaître, de nouveaux pays vont être créés, une Société des Nations viendra relancer l'idéal de paix universelle. La grande énigme de cette guerre des peuples n'a jamais trouvé de réponse satisfaisante. Comment a-t-on pu main tenir sur les champs de bataille des millions de combattants qui, d'un côté comme de l'autre, étaient si peu guerriers et n'aimaient pas la guerre ? Un tourbillon de mort les écrasera au combat et les entraînera dans ces grands mouvements collectifs qui, après 1918, conduiront à un autre cataclysme.
La participation du Canada
En août 1914, lorsque l'Angleterre entre en guerre, l'économie canadienne n'est toujours pas remise de la dure dépression économique qui a débuté à la fin de 1912, dans un contexte de surproduction industrielle. Le chômage a augmenté et le resserrement du crédit est sévère. Des cultivateurs ont abandonné leurs terres avec l'espoir de trouver, dans les villes, des emplois qui n'existaient pas. Au mieux, la chance leur a souri sous forme d'un certain secours matériel. En 1914, les compagnies possédant les deux chemins de fer transcontinentaux sont dans une position difficile.
Par son statut colonial, le Canada est automatiquement en guerre lui aussi. Clausewitz n'avait-il pas déjà écrit, dans la première moitié du XIXC siècle, que la guerre est la poursuite, par d'autres moyens, de la politique étrangère ? Pour sa part, le Canada fait la guerre sans aucune politique étrangère digne de ce nom. En 1914, la plupart espèrent que ce conflit, dont peu de gens mesurent la véritable envergure, prenne fin rapidement. Néanmoins, le gouvernement veut se donner des pouvoirs exceptionnels. Dès le 18 août, il soumet donc au Parlement un projet de loi des mesures de guerre qui lui permettrait de gouverner par décrets : cette loi sera adoptée le mois suivant.
Lorsqu'il entre en guerre, l'Empire britannique n'est pas aussi uni qu'on pourrait le croire. Déjà en action en Irlande, le Sinn Fein entend bien saisir l'occasion pour faire progresser sa cause. En Afrique du Sud, les Afrikanders, aussi blancs que leurs compatriotes anglais, sont divisés sur une attaque contre la colonie du Sud-Ouest allemand. Au Canada, ils seront principalement soutenus par les francophones du Québec qui refuseront pour eux-mêmes une participation à outrance aux combats.
Dès les premières semaines du conflit, ici et là dans l'Empire, les Blancs expriment leur loyauté à la cause britannique. Mais un fond de divisions subsiste. Il s'atténuera sans disparaître quand, en 1915, le paquebot Lusitania sera coulé. Dès lors, une unanimité presque totale tourne l'Empire contre l'Allemagne et ses alliés qui incluent initialement l'Autriche-Hongrie, à laquelle s'ajouteront au fil des mois la Turquie et la Bulgarie. Presque partout, on se pose la même question : à quel prix ce combat doit-il être mené ?
En général, les colonies britanniques entrent en guerre en comptant sur l'expérience de l'Empire en cette matière. Plus tard, le match se transformera en boucherie et les colonies y participeront de leur mieux. En 1918, la fin du jeu de massacres apportera un grand soulagement.
La scène politique au Canada
Au Canada, on est loin de l'impression de guerre totale qui est ressentie à travers le continent européen et la Grande-Bretagne. Au contraire, rien n'empêche les gens de s'adonner à une existence paisible. Depuis 1912, l'Ontario continue de débattre du fameux règlement 17 qui vise à écarter le français comme langue d'enseignement dans ses écoles séparées, tout en reprochant aux francophones du Québec de ne pas se battre pour l'Empire. Les nationalistes québécois se disent prêts à se battre pour les victimes franco-ontariennes du règlement 17, plutôt que de fournir trop d'efforts outre-mer.
La poursuite de grands objectifs politiques ne se fait pas sans contradictions internes. Loin du champ de bataille, ces dernières sont encore plus criantes aux yeux des nationalistes du Québec. Pourquoi serait-il si important, en 1914, d'aller se battre pour la France, alors qu'un siècle plus tôt c'était plutôt le contraire, et qu'il y a moins de 50 ans, lors de la guerre de 1870, cela ne l'était guère ?
La marine du Canada en guerre
Tout n'est pas négatif, loin de là. Sans doute, la Grande-Bretagne aurait-elle voulu un plus grand resserrement de son empire. Mais, il n'en demeure pas moins vrai qu'en 1914, même si le Canada reste indépendant, une très grande collaboration existe entre les forces britanniques et canadiennes. Cela dit, les Anglais ne font pas entièrement confiance aux soldats citoyens du Canada et à leur embryon de force naval qui s'est enrichie de deux sous-marins, achetés des Américains, pour les patrouilles côtières. C'est un ajout aux deux croiseurs dépassés que le Canada possède depuis 1910 et qui tombent sous commandement britannique. Malgré sa quasi-insignifiance, la marine canadienne est la première des deux armées canadiennes à se présenter au combat. Le NCSM Rainbow part dans les eaux du Pacifique, à la recherche de raiders allemands, qu'heureusement pour lui il ne rencontrera pas.
Avec sa Loi navale, le premier ministre Wilfrid Laurier avait entrevu un Canada autonome, se donnant une marine complémentaire à une marine britannique sur laquelle le pays ne pouvait guère s'appuyer en cas de coup dur. Il avait raison et la Première Guerre mondiale allait lui donner, ainsi qu'à des centaines de milliers de Canadiens de tous horizons, le goût d'un pays totalement indépendant.
Les eaux territoriales canadiennes ne sont pas protégées contre les dangers provoqués par la guerre. Pour contrer l'activité des sous-marins allemands, le Canada se dote d'une flotte de 134 petits bateaux de surveillance qui navigueront principalement le long de la côte est. Les Britanniques en assumeront le commandement.
Le Canada devrait-il se donner une véritable marine, demande-t-on aux Anglais ? La réponse est non ! Mieux vaut concentrer les efforts canadiens du côté terrestre. C'est ainsi que moins de 5 000 hommes feront partie des forces navales canadiennes pendant la Première Guerre mondiale.
L’armée du Canada en guerre
Au mois d'août 1914, avec environ 3 000 soldats professionnels et 60 000 hommes de la Milice active non permanente, l'armée est loin de représenter une menace pour les puissances centrales. Le pays peut fabriquer des munitions pour des armes individuelles, des obus de canons, ainsi que certaines petites armes. Son armement utile pourrait à peine suffire pour deux divisions alors que l'aviation militaire est inexistante.
Si le Canada est automatiquement en guerre, il lui revient de décider de l'effort qu'il consentira dans la pratique. Les précédents, depuis 1867, indiquent la voie à suivre. Ainsi, le volontariat sera-t-il à la base du recrutement des forces que l'on compte envoyer outre-mer. Mais, dans un élan impérial mal calculé, on enverra tous les volontaires au combat, créant au cours des mois de nouvelles divisions plutôt que des troupes de réserve qui servirait à combler les pertes. Dès la fin de 1915, l'enthousiasme pour le front bat de l'aile et, à compter de 1917, le nombre de volontaires inscrits chaque mois ne suffit plus à combler les pertes. Viendra donc la conscription, source de blessures profondes qui n'ont jamais totalement guéri.
Les divisions politiques
En 1917, Canadiens français et Canadiens anglais sont déjà bien ancrés dans leurs positions. Les premiers sont à peu près indifférents à cette guerre qui se déroule loin de chez eux et dont les conclusions ne risquent pas de les affecter. Selon eux, c'est ici, en terre d'Amérique, qu'un combat de tous les instants pour leur survie doit se poursuivre.
De leur côté, les Canadiens d'origine britannique se portent massivement volontaires, accusant les francophones du Québec de ne pas faire leur part. En réagissant ainsi, ils ne tiennent pas compte de plusieurs éléments importants. Par exemple, près de 70 pour cent du premier contingent de volontaires est formé de jeunes gens nés dans les îles Britanniques. Sans la conscription de 1917-1918, il est probable que plus de 50 pour cent des volontaires qu'envoie le Canada outre-mer auraient été des personnes nées hors du Canada. Enfin, et ce n'est pas négligeable, les États-Unis qui ne font pas partie de l'Empire vont se tenir à l'écart du jeu mortel de la guerre jusqu'au printemps 1917. Enracinés depuis des générations en Amérique du Nord, les Canadiens français ont un réflexe de non-engagement semblable à celui de leurs voisins du sud, une singularité que trop de leurs compatriotes refuse de voir.
À l'annonce de la conscription, les Conservateurs du Québec ne manquent pas d'affirmer que cette politique va leur coûter cher, ainsi qu'au Parti conservateur. Le projet de loi est présenté le 29 août 1917. Le gouvernement écarte du revers de la main la demande de Wilfrid Laurier qui veut un référendum sur la question. Devant le mouvement de résistance qui déferle sur le pays, et principalement au Québec francophone, le premier ministre canadien, Robert Laird Borden, propose à Laurier de former un gouvernement de coalition. Malgré l'opinion de certains Libéraux disposés à accepter cette offre, l'ex-premier ministre canadien refuse. Un gouvernement d'union sera finalement formé avec 15 Conservateurs, neuves Libérales proconscriptions et un représentant des milieux ouvriers.
Ce gouvernement d'union est élu lors du scrutin général du 17 décembre 1917. Il remporte 153 sièges, n'en laissant que 82 à ses opposants. Le Québec s'isole en accordant aux Libéraux 62 de ses 65 sièges. Borden compense ce résultat en accueillant dans son nouveau cabinet un sénateur canadien-français. Le Canada échappera peut-être aux ravages de la guerre, mais le conflit l'aura politiquement divisé.
Entre 1914 et 1918, il est allé aux limites de ses forces matérielles. Ses territoires agricoles en exploitation ont doublé et sa production industrielle s'est remarquablement accru grâce, entre autres, à l'essor des industries du bois et du papier, ainsi qu'à ses usines de munitions, à ses chantiers maritimes ou à l'aéronautique. L'effort financier du Canada est considérable : la dette du pays passe de 336 millions à 3 milliards de dollars. Les dépenses de guerre se chiffrent à 1,5 milliard de dollars.
La mobilisation. La première phase de la guerre et la mobilisation au Canada
Bombardement allemand d'Arras, en 1914. Arras, située au nord-ouest de la France près de la frontière belge, est une ville au patrimoine architectural inestimable. En 1914, la destruction d'Arras contribua grandement à la propagande alliée assimilant l'Allemagne à la barbarie. Cette peinture de l'artiste belge Gustave Fraipont, montre l'Hôtel de Ville d'Arras avec son campanile Belfoi qui ont été détruit durant la guerre. Plusieurs villes historiques belges et françaises ont connu un destin semblable.
Selon les plans de l'Allemagne, l'attaque qui s'appuie sur un large mouvement d'enveloppement des armées françaises, doit sceller le sort de la France en six semaines. Après avoir envahi la Belgique, l'aile marchante allemande progresse dans le nord-est de la France. Objectif : prendre Paris et enfermer les combattants français entre cette aile et le mur à peu près immobile constitué en Alsace-Lorraine. Le plan ne se déroule pas comme prévu. La retraite des Français a lieu, mais dans l'ordre et ponctuée de coûteuses contre-attaques. Les Allemands rétrécissent donc la zone d'envahissement en passant à l'est de Paris. Ainsi découvert, le flanc allemand est la cible d'une attaque restée célèbre, la bataille de la Marne, qui oblige les Allemands à céder une partie du terrain conquis. S'ensuivent de mutuelles tentatives de débordement qui ne font pas de vainqueur immédiat, mais qui permettent de libérer une grande partie de la France envahie et un petit secteur de la Belgique. Bientôt, entre la frontière suisse et la mer du Nord, deux lignes de tranchées s'affrontent.
La guerre de mouvement, amorcée au mois d'août, se transforme, vers la mi-octobre, en une guerre de siège, au cours de laquelle les puissances centrales sont les places fortes à investir.
Le Canada, qui n'a pas eu le temps d'intervenir au cours du premier épisode du conflit, a néanmoins jeté les bases de sa participation aux événements qui vont suivre. La Loi de la Milice de 1904 prévoyait que le gouverneur en conseil pouvait mettre en service actif une partie ou la totalité de la milice, soit au Canada, soit hors du pays. Préparés en conformité avec les vues britanniques, les plans de mobilisation de 1911 prévoyaient que, dans des circonstances jugées critiques par son gouvernement, le Canada pouvait envoyer un contingent composé d'une division d'infanterie et d'une brigade montée se battre dans un pays du monde civilisé, comme on disait à l'époque, et ayant un climat tempéré.
Ces plans sont toutefois enveloppés de tant de mystère que Sam Hughes, ministre de la Milice et de la Défense depuis 1911, en ignore l'existence jusqu'en 1913.
À cette époque, la milice active est la plus considérable que le Canada ait pu former en temps de paix : 59 000 hommes se sont entraînés et on prévoit hausser leur nombre à 64 000, en 1915. Acheté par le gouvernement canadien, le camp de Petawawa accueille près de 34 000 hommes au cours de l'été 1914. Les exercices d'entraînement ont souvent lieu devant un parterre de belles dames qui ont répondu à l'invitation d'officiers.
Que pensaient du cirque des camps d'entraînement les huit millions de Canadiens ? Évoquant, en 1943, la faune de miliciens réunis au camp de Lévis avant 1914, l'abbé Alphonse Fortin raconte qu'à son avis, comme à celui de plusieurs, les miliciens s'entraînaient à « des exercices indéterminés qui ne rappelaient rien aux hommes mûrs de ce temps-là. Les Canadiens avaient vécu si longtemps dans la paix qu'ils avaient même perdu le souvenir d'une tradition militaire Nous avions l'impression d'une milice sur le papier, de cadres fantaisistes - pour tout dire : une sorte de gaspillage.
La création du corps expéditionnaire canadien
C'est avec ces miliciens et cette population mal préparée, mais en général enthousiaste, que le Canada s'engage dans le conflit. Le let août 1914, trois jours avant que la Grande-Bretagne entre en guerre, le Canada lui offre une aide qui est acceptée le 6 août. Sam Hughes a déjà déclenché le processus de mobilisation, mais sans égards aux plans de 1911.
Le 10 août, un décret autorise officiellement la création d'une force expéditionnaire.
Mais déjà, le quartier général de la milice s'est mis à communiquer directement avec les unités. Les hommes recrutés par celles-ci sont envoyés à Valcartier qui sera le centre de rassemblement de la force expéditionnaire. Les volontaires sont redistribués dans de nouveaux bataillons identifiés par des numéros. Ces bataillons ont peu ou rien à voir avec la tradition. Les volontaires du 89e Régiment de Témiscouata et Rimouski, par exemple, sont dispersés dans les nouvelles unités. Malgré tout, le résultat est impressionnant, car, le 8 septembre, 32 000 hommes sont déjà rassemblés. Le 3 octobre, la 1re Division quitte Gaspé pour l'Angleterre. On dénombre alors 33 000 hommes et femmes et 7 000 chevaux répartis sur 31 navires, un convoi protégé par sept croiseurs britanniques. Quand ils débarquent en Grande-Bretagne, le 14 octobre, les Canadiens sont encore loin du champ de bataille.
Le 30 octobre 1915, le nombre des Canadiens passés de l'autre côté de l'Atlantique atteint 250 000. L'enthousiasme est si grand que, le 30 décembre suivant, Borden et Hughes, qui participent à une conférence à Londres, promettent un demi-million d'hommes aux Britanniques. Aujourd'hui encore, on ignore s'ils parlaient de 500 000 en première ligne, ce que le Canada n'a pu fournir, ou d'un effort total de 500 000 hommes, comprenant l'ensemble des lignes de communications, les garnisons canadiennes, la marine et divers autre service. Dans ce cas, le Canada a amplement exécuté sa promesse puisqu'il a mobilisé plus de 600 000 personnes.
En 1916, les forces canadiennes déployées dans le nord-ouest de l'Europe sont composées d'un corps d'armée de quatre divisions, comprenant chacune trois brigades de quatre bataillons formés d'environ 3 000 hommes. Pour un pays dont la population est légèrement inférieure à 8 000 000 d'habitants, cette présence en Europe est remarquable, tout comme est significatif le bilan des pertes enregistrées : 59 544 morts et 172 950 blessés. Le coût humain de cette guerre est bien plus grand que son coût financier.
Le Princess Patricia's Canadian Light Infantry (PPCLI)
L'effort militaire initial du Canada, qui se voulait tous azimuts, reflète bien l'esprit original et même excentrique de Sam Hughes, ministre responsable de l'époque.
Le Royal Canadian Regiment, (RCR), le seul régiment professionnel d'infanterie canadien, est envoyé aux Bermudes pour relayer une unité anglaise rappelée en Europe, où se concentre la véritable action. À son tour remplacé par des unités de miliciens sans grande expérience levés au Canada, le RCR ira plus tard rejoindre la force combattante professionnelle.
La création du Princess Patriciâs Canadian Light Infantry est une singularité par rapport aux méthodes de recrutement appliquées par Hughes. Le 1er août 1914, l'industriel montréalais Hamilton Gault offre à Hughes un régiment de cavalerie. À 15 ans de distance, Gault semble s'inspirer de l'initiative de Strathcona mais, à la différence du précédent, il veut se battre avec le régiment qu'il aura acheté.
Le 2 août, le ministre accepte en exigeant que la formation soit un régiment d'infanterie. Son premier commandant sera Francis Farquhar, secrétaire militaire du duc de Connaught, gouverneur général du Canada et frère du roi d’Angleterre. Le duc est le père de la princesse Patricia, qui prêtera son nom au bataillon. Gault injecte donc les 100 000 $ nécessaires à la mise sur pied du régiment qui recrute surtout des vétérans, en particulier ceux de l’Afrique du Sud. On croit alors que l'instruction de ces hommes expérimentés sera plus brève et que le fait qu'ils soient issus d'un petit segment de la population ne nuira pas au recrutement du reste du Corps expéditionnaire canadien.
Le rassemblement du PPCLI a lieu à Ottawa et, le 24 août, les hommes prennent le train vers Montréal où un navire les attend. On ordonne au régiment de s'arrêter à Québec en attendant le convoi dont le départ pour l’Angleterre doit avoir lieu au début d'octobre. Entre-temps, le PPCLI s'entraîne à Lévis, non pas à Valcartier, faisant ainsi montre d'une indépendance qui s'accorde mal avec la volonté d'avoir une force canadienne exprimée par Hughes.
Intégré au sein de la 27e Division britannique, le PPCLI est la première unité d'origine canadienne à monter au front et à subir d'affreuses pertes. À l'automne 1915, la division est appelée en Salonique, avec des brigades de quatre plutôt que de cinq bataillons. Le PPCLI, qui doit choisir entre une nouvelle brigade britannique ou une formation canadienne équivalente, opte pour cette dernière possibilité, car cela simplifiera le remplacement de ses pertes. Le 25 novembre 1915, le transfert est complété. Le PPCLI compte alors beaucoup plus déjeunes recrues d'origine canadienne qu au moment de son arrivée en première ligne. À Londres, le 21 février 1919, la princesse Patricia, procédant à l'inspection de son régiment, n'y reconnaîtra que 44 hommes des 1 000 miliciens quelle avait vus à Ottawa en 1914. Parmi eux, Hamilton Gault, amputé d'une jambe.
La méthode Hughes et le camp Valcartier
En 1912, le ministère de la Milice et de la Défense veut acquérir un camp central pour l'instruction des miliciens du Québec. Cinq sites différents sont évalués. En novembre, le dossier est confié à un agent des terres, William McBain. Au mois de juin de l'année suivante, ce dernier acquiert un terrain de 4 931 acres situés à plus de 20 kilomètres au nord-ouest de Québec. Pour éviter la spéculation, la transaction est enregistrée au nom de l'agent fédéral. On prévoit y entraîner 5 000 hommes chaque été.
Au début de la guerre, c'est une zone pouvant accueillir de 25 000 à 30 000 hommes qui est nécessaire. Le ministère négocie donc l'expropriation de 125 cultivateurs auxquels il verse 40 000 $, ajoutant ainsi 10 116 arpents aux terrains de McBain. En 1918, le camp de Valcartier aura une étendue de 12 428 acres et il en aura coûté 428 131 $, y compris la commission de McBain. Le 10 août 1914, généreux dans l'attribution de grades honorifiques à lui-même et à ceux qui lui plaisent, Sam Hughes accordera le grade de lieutenant-colonel (honoraire) avec solde à William McBain.
Au moment où la guerre débute, des champs de tirs d'armes individuelles sont en chantier dans la région d'Ottawa. À la demande du ministère, l'entreprise abandonne momentanément les travaux en cours pour aller à Valcartier où un champ de tir de 15 000 cibles est nécessaire. Les travaux débutent le 8 août et, cinq jours plus tard, 1 000 cibles sont déjà prêtes. Le plus important et le plus réussi des champs de tir au monde, comprenant abris, positions de tir et affiches, est complété le 22 août suivant.
L'enthousiasme du ministre a triomphé, mais il veut davantage et, pour obtenir ce qu'il convoite, il se tourne vers les hommes d'affaires fortunés. William Price accepte la responsabilité d'approvisionner le camp en eau potable. Il fera installer une pompe d'une capacité de 500 000 gallons d'eau par jour et une autre d'un million de gallons. Ces pompes sont reliées à un réservoir de 50 000 gallons enserré dans une structure d'acier de 16 mètres de hauteur. Grâce à Price, il est désormais possible d'acheminer l'eau simultanément à 200 tables d'ablutions de quatre mètres de long chacune et à 80 douches cloisonnées. Comme McBain avant lui, Price est vite récompensé pour sa générosité. Dès 1914, le grade de lieutenant-colonel honoraire lui est décerné et, le 1er janvier 1915, il reçoit le titre de chevalier.
L'éclairage des routes du camp est assuré par la Quebec Light and Power Company. Des réseaux télégraphique et téléphonique relient Valcartier à Québec et une voie ferrée est posée sur des ponts surveillés par des piquets de gardes armés qui vivent sous les tentes dressées non loin du rivage.
L'ensemble n'aura coûté que 185 000 $pour sa mise en place et pour son entretien jusqu'à l’Armistice. Pendant toute la durée de la guerre, les portes de camp de Valcartier se refermeront pour l'hiver. À côté des abris temporaires, les immeubles permanents sont rares : la résidence du ministre, le bâtiment abritant les pompes et le dispositif de chloration de l'eau. Le camp accueillera 33 644 hommes en 1914. Mais l'entraînement de base ayant été décentralisé, par la suite, on n'en trouvera que 8 737 en 1915, 14 924 en 1916 et 1 811 en 1917. Son coût total d'opération, entre 1914 et 1918 sera de 590 278,24 $. Dès le printemps 1915, la presque totalité des renforts sont conduits à Halifax d'où ils peuvent prendre la mer à l'année longue, au contraire de Québec.
Ration quotidienne d'un soldat s'entraînant à Valcartier
Poivre et sel 2 onces de beurre Les fruits sont en supplément.
1 1/4 livre de pain 2 onces de sucre La ration quotidienne des chevaux est de 19 livres de foin, 10 livres d'avoine et 2 livres de paille.
1 once de thé 6 onces de légumes frais
1/3 once de café 1 livre de viande fraîche
1 once de fromage 1 livre de pommes de terre
2 onces de confitures 1 once d huile
2 onces de feues 1 pied cube de bois
L’instruction du fantassin au Canada
Depuis la guerre de l'Afrique du Sud, l'entraînement des Canadiens et celui des membres des autres forces impériales a été modifié. Si le terrain d'exercice est essentiel, on a fractionné les bataillons, créé des demi-compagnies et des pelotons divisés en sections de 10 hommes. Les sous-officiers sont devenus importants dans la conduite de la bataille. Au Canada, où le mythe du milicien supérieur au professionnel continue de fleurir, on prétend recourir plus qu'ailleurs à l'initiative et à l'intelligence du soldat. À partir de 1906, on lui enseigne les rudiments du métier, après quoi il s'entraîne en sections, pelotons et compagnies.
En 1911, la force permanente tient un grand exercice à Petawawa. Ce sera le dernier, l'apôtre du soldat citoyen, Sam Hughes, étant persuadé que le Canadien pourra éventuellement s'en passer. Résultat : l'amateurisme réel de la milice et les moyens déficients dont disposent les professionnels sont les deux grandes faiblesses du Canada qui entre en guerre.
L'enthousiasme du volontaire est aussitôt confronté à une donnée incontournable qui lui fait perdre un temps précieux : la pénurie d'instructeurs qualifiés au Canada. Ce n'est qu'en 1917, à un moment où le flot des volontaires est tari, qu'on met sur pied un stage de formation de base d'une durée de 14 semaines.
Jusque-là, le quotidien du volontaire ne le prépare guère à l'action. On le réveille à 6 heures. Il déjeune après la période consacrée à la gymnastique, aux ablutions et à l'inspection. L'instruction débute à 8 h 30 pour prendre fin à 16 h 30, avec une pause d'une heure pour le déjeuner. Pendant cette journée type, la recrue apprend à défiler et s'exerce à charger à la baïonnette, un des exercices préférés de Sam Hughes qui aime en faire la démonstration. Surtout, les hommes marchent beaucoup, portant entre 60 et 80 livres d'équipement. Ils utilisent peu leur arme et ils assistent à de nombreux cours théoriques ayant peu de rapport avec le contexte réel des combats tel qu'ils se déroulent en 1914.
Le combattant canadien L’uniforme,l’équipement et l’arme du fantassin
Fantassin du Corps expéditionnaire canadien en France, en 1915-1916
Durant les premières années de la guerre, les soldats du Corps expéditionnaire canadien portaient la tunique kaki du modèle canadien adopté en 1903. Les insignes sur la casquette et le col prenaient la forme d'une feuille d'érable. Le fusil canadien Ross armait les soldats. Cette arme était longue et pesante et ne fonctionnait pas bien lors qu'elle devenait sale ou mouillée. Une bonne partie de ces distinctions disparurent en 1916 quand le CEC fut doté de casques en fer, de fusils Lee-Enfield et d'uniformes selon le modèle britannique.
Quel est l'accoutrement du volontaire ? Une casquette à visière ornée d'une feuille d'érable en bronze ; une veste ajustée en serge de couleur kaki à col droit rigide, fermée par sept boutons en bronze, des pantalons de même tissu et couleur ; des bottines brunes avec de longues bandes molletières de laine enroulées à partir de la cheville jusqu'à mi-jambe - les cavaliers commencent cette opération par le haut ; une chemise grise sans col ; d'épaisses chaussettes de laine ; des sous-vêtements en laine ; un maillot avec manches ; un long et épais manteau protégeant du froid et de la pluie ainsi que deux rugueuses couvertures grises.
L'armée fournit au volontaire un rasoir avec blaireau, trois brosses, l'une pour les dents, l'autre pour les cheveux et la troisième pour les bottes, une gamelle, des ustensiles, deux serviettes, une paire de gants de laine et une cagoule. S'ajoute à cela l'équipement Oliver, un ensemble compliqué de ceintures en cuir auxquelles sont attachées différentes poches pouvant contenir des munitions, de la nourriture, une gourde d'eau et permettant de transporter certains vêtements. C'est un médecin de l'armée britannique en garnison à Halifax, vers 1890, qui a convaincu le gouvernement de fournir l'Oliver aux miliciens. Comme la poche réservée aux munitions est à la hauteur de l'estomac, cet équipement est bien peu pratique pour ramper. Mais, ce n'est pas son seul défaut. Les ceintures d'épaules irritent les aisselles, la gourde et plusieurs des poches sont minuscules, les bandes pour les balles se déforment, entraînant la perte des munitions. Quand il a été mouillé, tout ce fatras se fendille en séchant.
Pour attaquer ou pour se défendre, le fantassin reçoit un fusil Ross, une baïonnette, une bouteille d'huile et un nécessaire pour nettoyer l'intérieur du canon de l'arme. Le fusil Ross n'est pas sans faiblesses : son magasin ne tient que cinq balles, la tige que le soldat tire pour extraire la cartouche devient rapidement brûlante et il arrive que la baïonnette fixée au canon tombe au moment des tirs. Le Ross est aussi très long (50 pouces et demi), mais il pèse 450 grammes de moins que le Lee-Enfield britannique qui, plus court et, surtout, plus sûr, remplacera le Ross.
L’instruction de l’infanterie et les conditions de service en Angleterre
Voilà pour l'entraînement, la somme des connaissances acquises et l'équipement de la jeune recrue quand elle part pour l'Angleterre. Là, dans la plaine de Salisbury, sous la gouverne de militaires expérimentés, on va la préparer au véritable choc du combat. Le jeune homme ne tarde pas à découvrir que ce n'est pas seulement sa formation qui est bâclée. Sa tunique se découd, son manteau de coton et de laine ne le protège ni de la pluie ni du froid. Fabriquées en vitesse pour les besoins d'une armée qui grossit à folle allure, ses bottines se défont dans la boue. Pour pallier leur fragilité, il enfile des couvre-chaussures en caoutchouc qui, pendant un certain temps, sont expédiés par les soins du ministère.
On va combler la plupart des carences. L'équipement Oliver des Canadiens, que les Britanniques avaient déjà écarté en Afrique du Sud, est remplacé par le Webb, plus pratique pour le fantassin surchargé. La Grande-Bretagne devient donc un fournisseur de sa colonie canadienne, qui a négligé de faire l'effort requis pour soutenir adéquatement sa volonté de conduire elle-même ses affaires militaires. En plus du Webb, les Britanniques procurent des bottes résistantes et des tuniques moins ajustées.
Dans une division d'infanterie de l'époque, on trouve 6 000 chevaux, dont la plupart servent à tirer des chariots. Une fois en Angleterre, les Canadiens ont la surprise de constater que les attelages fournis pas leurs alliés anglais (prévus pour que les chevaux blessés ou morts en course puissent être facilement détachés) ne s'adaptent pas à leurs wagons-bains. Même ces wagons ne conviennent pas, le bois utilisé au Canada pour les construire étant trop vert. Il se fend, casse et pourrit facilement. Les chariots servant au transport de l'eau ne peuvent être drainés ou nettoyés. Quant aux véhicules à moteurs canadiens, ils sont bientôt hors d'usage, les pièces de rechange n'étant pas disponibles en Angleterre.
Dans tous ces cas, la Grande-Bretagne vient en aide à ses colonies. Elle-même aux prises avec un problème de réarmement, elle est quelquefois confrontée à l'intransigeance parfois pitoyable des politiciens canadiens qui refusent de remplacer le fusil Ross ou la mitrailleuse Colt. La pelle MacAdam devait servir de bouclier contre les balles et, grâce à un orifice percé dans un coin du haut, permettre au soldat d'observer le champ de bataille. Trop lourde (près de 5 livres et demie) et à peu près inutile pour creuser, surtout dans la boue, elle est abandonnée.
Les Canadiens formés dans la plaine de Salisbury se régalent-ils ? Chaque matin, on leur sert du gruau et du thé. À midi, une portion de ragoût, le « stew » dont ils se souviendront longtemps. Au repas du soir, leur menu, pain, confiture et thé, a des allures de petit déjeuner canadien. Les petites fantaisies comestibles sont rares et difficiles à obtenir.
Les règles d'ordre et de discipline auxquelles le militaire canadien en sol britannique est soumis sont celles de la Loi militaire canadienne. Tant qu'ils n'ont pas quitté le sol anglais, ses confrères britanniques sont soumis au code de droit qui s'applique à l'ensemble de la population britannique. Hors du territoire, ceux-ci observent un code militaire identique à celui qui prévaut parmi les troupes canadiennes.
Ce code régit officiers et soldats, mais il ne semble pas être appliqué aussi équitablement qu'il le devrait. Ainsi, entre 1914 et 1918, 25,4 pour cent des officiers jugés par la cour martiale ont été acquittés pendant que 10,2 pour cent des sans-grades ont eu droit à la clémence de ce tribunal militaire. Parmi les nombreux officiers jugés pour lâcheté, désertion face à l’ennemie et autre offense punissable par la peine de mort, aucun n'a connu le feu du peloton d'exécution.
Les officiers canadiens
Pour devenir officier, un volontaire doit détenir une commission de la milice et obtenir la permission de son colonel ou l'approbation d'un officier commandant dans la milice. Les officiers d'infanterie ont reçu une formation moins complète que leurs collègues artilleurs. La partie théorique a été plus déficiente quand leur entraînement s'est déroulé dans les manèges militaires de petites localités, leurs collègues des villes étant plus favorisés à ce chapitre.
Parmi les 44 officiers supérieurs des deux premiers contingents partis du Canada en 1914 et 1915, neuf seulement appartenaient à la Milice permanente. Parmi les 1 100 officiers qui partirent, plus de 200 n'avaient pas de qualifications connues et 186, dont 27 lieutenants-colonels - ceux qui commandaient les unités combattantes - n'étaient pas qualifiés pour le grade qu'ils détenaient.
Le portrait de l'officier de la Première Guerre mondiale est encore flou. Grâce aux renseignements recueillis et analysés pendant et depuis cette guerre, on peut observer quelques traits communs. La majorité d'entre eux serait des professionnels et des employés de banque. On remarque cependant d'importantes concentrations de fermiers, d'ouvriers et d'étudiants. Une mince majorité d'officiers serait originaire du Canada.
Pour devenir officier, des critères élémentaires s'imposent. Par exemple, il faut une taille minimum de 5 pi 4 pc et avoir atteint l'âge de 18 ans. Le volontaire doit pouvoir résister aux dures conditions de vie imposées par la guerre. Le futur lieutenant reçoit des cours devant lui permettre de conduire son peloton avec confiance. Il est initié au droit militaire et formé, autant pour diriger l'orientation pendant la marche ou pendant une patrouille, que pour réagir en cas de problèmes de santé de ses hommes. Le lieutenant connaît bien les armes utilisées (y compris la mitrailleuse) et les différents types de tranchées. Il peut évaluer les distances avec précision, veiller sur l'alimentation de ses hommes ou organiser des piquets de garde. Pour assimiler l'ensemble de ces connaissances et les mettre un jour en pratique sur les champs de bataille dans des conditions presque toujours complexes, dangereuses et pénibles, le lieutenant reçoit une solde de 2,60 $ par jour.
Les pertes
L'infirmière Blanche Lavallée, Service de santé de l'armée canadienne, 26 juin 1916.
Un dessin de craie de l'infirmière Blanche Lavallée (1891- ?) à l'hôpital militaire canadienne à St. Cloud, le 16 juin 1916. Surnommées par les soldats blessés «les Oiseaux bleus» à cause de leur uniforme bleu ciel, plus de 2 500 infirmières canadiennes servirent outre-mer. Dès 1899, nos infirmières détenaient le rang d'officier confirmant leur statut professionnel. Ce n'était pas le cas des infirmières militaires américaines et l'énergique Blanche Lavallée milita avec elles jusqu'à leur obtention de ce principe en 1920. Elle demanda aussi l'équité salariale avec les hommes du même rang, ce qui fut finalement accordé durant la Deuxième Guerre mondiale.
Les Canadiens n'ont pas produit d'études approfondies pour connaître la cause des décès ou la nature des blessures infligées aux soldats sur le champ de bataille pendant la guerre 1914-1918. Les conclusions des Britanniques à ce sujet indiquent ce qui suit : 59 pour cent des décès ont été causés par les tirs de mortier et de canon ; 39 pour cent par des balles de fusils et 2 pour cent sont attribués à une myriade d'autres facteurs. Les pertes de vie dues à l'artillerie semblent avoir été plus élevées chez les Allemands où elles auraient atteint 85 pour cent entre 1916 et 1918, périodes au cours de laquelle la coalition des pays alliés a bénéficié d'une supériorité matérielle croissante. On peut penser que les Canadiens qui se sont battus sous le commandement et dans les secteurs où opéraient les Anglais ont subi des pertes comparables aux leurs.
Si ces pourcentages indiquent que l'expérience du combat réduit les pertes, les chiffres soulignent également que celles-ci ont été affreuses et que le roulement au front a été considérable, surtout parmi les unités d'infanterie les plus durement frappées en nombre et en pourcentage.
En arrivant au front, un bataillon de fantassins rassemble entre 800 et 1 000 hommes. Or, entre 4 500 et 5 500 hommes passeront dans chacune des unités engagées, ce qui donne une idée de l'ampleur des remplacements constants qui ont cours. Dans la 4e Division, le 44e Bataillon, en deux ans de combats, reçoit 5 640 hommes dont 1 193 seront tués. Par contre, le 38e Bataillon, en voit défiler 3 512 et subit 691 décès. Il en passera 5 584 dans le 22e, qui aura 1 147 tués.
On comprend, à la vue de ces chiffres, que le Corps médical de l'armée canadienne, créé en 1901, a eu plus d'une occasion pour se faire valoir. Composé de 13 médecins et de 5 infirmières avant 1914, l'équipe compte 1 525 médecins, 1 901 infirmières et 15 624 sous officiers et soldats, au plus fort de la guerre. Particularité canadienne : les infirmières ont droit au rang et aux privilèges des officiers. Au niveau supérieur, le major Margaret Clothilde MacDonald avait déjà servi en Afrique du Sud.
Première Guerre Mondiale: pertes par battaille. Ce tableau fournit une comparaison des pertes soutenues dans quelques batailles dont le Corps expéditionnaire canadien était impliqué durant la Première Guerre mondiale.
Les fardeaux de la guerre
Parmi les 59 544 morts du Corps expéditionnaire canadien, 6 767 ont été emportés par la maladie et 13 289 ont succombé à des blessures subies au combat ou à la suite d'accidents divers. À ces quelque 20 000 militaires soignés puis décédés s'ajoutent les 154 361 blessés ayant survécu. Impressionnant, le taux de succès des interventions pratiquées sur ces blessés se situe autour de 90 pour cent. Un phénomène observé dans la plupart des armées impliquées dans le conflit mérite d'être souligné : cette guerre d'importance a été la première au cours de laquelle les maladies se sont avérées moins meurtrières que les combats...
En 1916, lorsque les Canadiens sont engagés dans les vastes offensives sur la Somme, le fantassin porte une charge, proportionnellement à son poids, plus lourde que celle qu'on ferait porter à une mule. Il a 220 cartouches, quatre bombes, un pic ou une pelle (parfois les deux), des rations pour 24 heures, un manteau d'hiver ou un poncho imperméabilisé, des sacs pour le sable, de l'équipement de signalisation et un fusil. Il lui est difficile de marcher et, encore plus, de courir sus à l'ennemi. Si en plus, comme ce fut souvent le cas, la boue adhère à ses bottes, il est quasi paralysé. Le fantassin peut transporter jusqu’à 120 livres de vêtements et d'équipement. Les officiers et les hommes admettent que ce n'est pas raisonnable et les initiatives pour se débarrasser du superflu sont nombreuses.
Lors de la bataille de la crête de Vimy en 1917, on a réduit à environ 40 livres, le poids des effets à transporter. On a sauvé le poncho, un masque à gaz, l'arme, les munitions, les pinces, les gants de protection pour couper les barbelés, les fusées de signalisation, les sacs pour le sable, les pics ou les pelles. Certains soldats emportent également avec eux de larges pièces de cuir rigide avec lesquelles ils peuvent se jeter sur les barbelés pour faire un pont que leurs collègues franchissent. Les unités ont prévu, derrière les premières vagues légères qui peuvent maintenant courir, des arrivages de pics et de pelles qui permettront aux hommes de consolider les positions conquises.
Au mois d'août 1918, à Amiens, chacun transporte des rations pour une journée, le fusil, 250 balles, le masque à gaz, une gourde, deux grenades et deux sacs pour le sable, un pic ou une pelle. S'il se compare à son collègue de 1915-1916, le fantassin de 1918 est léger comme l'air. Un caprice de la nature a voulu que le sol soit sec ! À Amiens, pas de boue.
Du Canada à la Grande-Bretagne et à la France. Les Canadiens sur la plaine de Salisbury Pour les Canadiens, l'apprentissage de la guerre et la guerre elle-même se sont déroulés sous tutelle britannique, du moins au cours des deux premières années. Ainsi, en 1915, un tiers des officiers d'état-major, dont le travail consiste à penser et à préparer le combat, sont britanniques. Il faudra plusieurs années avant que les Canadiens occupent la presque totalité de ces postes. Arrivé en Angleterre, le premier contingent s'est dirigé vers le camp de Bustard, dans la plaine de Salisbury. Ce territoire de 200 milles carrés est, depuis longtemps, presque exclusivement réservé aux manœuvres militaires. C'est aussi un haut lieu du tourisme, puisqu'on y trouve Stonehenge. Certains des hommes y vivent sous la tente, les autres en caserne. Les Canadiens n'y sont pas seuls, une partie de « l'armée de Kitchener » - expression servant à définir les « levées en masse » des Britanniques - s'y entraîne aussi. L'entraînement se fait au niveau de la compagnie. La première étape de la formation dure cinq semaines. Viennent ensuite deux semaines à l'échelon du bataillon et deux autres semaines au niveau de la brigade. Enfin, le 11 décembre 1914, pour la première fois, la division s'exerce en formation.
Deux événements ont retenu l'attention des Canadiens qui ont séjourné à Salisbury. Ils ont vu le roi d'Angleterre lors des deux inspections auxquelles il a procédé et... la pluie est tombée pendant 89 des 123 jours que dura leur séjour.
En janvier 1915, les leçons apprises sur les champs de bataille par les Britanniques sont transmises aux Canadiens. Leur allocation de mitrailleuse Colt passe de deux à quatre par bataillon : les 30 hommes chargés de les servir reçoivent un entraînement spécial.
En route vers le front
Le 6 février 1915, un premier groupe de Canadiens traverse la Manche. Quittant Bristol, ils débarquent en France, à Saint-Nazaire, pour se diriger vers les cantonnements d'Hazebrouck, au nord-est de la France. La 2e Division arrive au front en septembre 1915 et, avec la 1re Division, forme le Corps d'armée canadien. Peu après, celles-ci sont rejointes par la 3e Division dans laquelle se trouvent le PPCLI et le Royal Canadian Regiment, ce dernier revenant d'un séjour d'une année de garnison aux Bermudes. La 4e Division arrivera en 1916. Chacune de ces divisions est constituée de trois brigades de quatre bataillons. Jusqu'en 1917, le corps d'armée sera commandé par des Britanniques : les lieutenants généraux E.A.H. Alderson (de septembre 1915 à la fin mai 1916) et sir Julian Byng (jusqu'au 23 juin 1917). Puis, jusqu'à la fin de la guerre, le commandement sera placé entre les mains d'un Canadien, le lieutenant-général sir Arthur Currie.
Les 18 000 hommes de la 1re Division sont progressivement initiés au combat. Entre le 17 février et le 2 mars, chacune des trois brigades est détachée durant une semaine auprès d'une division britannique où elle est mise au fait de la routine entourant un siège, ce qu'est déjà devenue la Première Guerre mondiale sur son front ouest. Les procédures britanniques, adoptées par les Canadiens, vont faire qu'environ 2 000 hommes d'une même division pourront être sur le front en même temps. Un bataillon se retrouve en première ligne pendant quatre jours, puis il passe en appui direct pendant quatre autres. Viennent ensuite, à l'écart du front, quatre jours de repos, une période consacrée, en réalité, au travail et à l'entraînement. Au fur et à mesure qu'ils iront au combat, les Canadiens connaîtront la tension et l'ennui, l'action et la terreur.
Du 10 au 12 mars 1915, à Neuve-Chapelle, la 11e Division participe à son premier engagement. En position d'appui à une attaque anglo-française, l'artillerie canadienne joue le rôle qu'on attend d'elle, mais les fantassins, paralysés par un fusil Ross qui s'enraye trop souvent, sont incapables d'adopter un rythme de tir rapide. Leur sens inné de l'initiative parvient à combler cette lacune du système : en effet, plusieurs d'entre eux se saisissent des Lee-Enfield abandonnés sur le champ de bataille par les blessés et les morts anglais. Au mois d'août 1915, on modifie le Ross Mark III en adaptant à celui-ci la « chambre » du Lee-Enfield. Les 2e, 3e, 4e et 5e (cette dernière sera dissoute pour fournir des renforts aux quatre autres) Divisions recevront ce fusil modifié. Mais, en 1916, le Lee-Enfield remplacera le Ross, qui ne sera ensuite utilisé que par les tireurs d'élite qui sauront profiter de sa grande précision.
Ypres et la défense
La guerre de siège est ponctuée d'attaques menées par les assiégés désireux de briser leur carcan, et d'attaques conduites par les assiégeants pressés de vaincre.
La 1re Division se voit confier, en avril, environ deux mille de front, à l'extrême gauche du corps expéditionnaire britannique, et au contact, sur sa gauche, d'une division coloniale française. Entre le 20 avril et le 4 mai 1915, les Allemands tenteront de percer à ce point de rencontre entre les coloniaux algériens et canadiens.
En plus de bombarder sérieusement le secteur, les Allemands utilisent les gaz pour la première fois. Les troupes n'y sont pas préparées. Les Algériens vont fuir et les Canadiens se replier en ordre : malgré la souffrance (3 058 pertes dans la seule journée du 24 avril) et en engageant leurs réserves, ils parviennent à rétablir un front continu. Au total, dans ce rôle strictement défensif et en l'espace de deux semaines, les Canadiens subissent 5 975 pertes, dont plus de 1 000 tués, les autres ayant été blessés, capturés par l'ennemi ou portés disparus. Du nombre total des pertes, 5 026 sont des fantassins.
Givenchy et Festubert
Lors d'une offensive qui a lieu au cours de l'été 1915, les Britanniques utilisent les Canadiens. Les conditions ne sont pourtant pas propices, en particulier parce qu'il ne sera pas possible de surprendre l'ennemi. Le major général Arthur Currie, qui commande la division canadienne ne l'ignore pas, mais les ordres sont clairs. L'attaque, qui durera cinq jours, va donner aux Britanniques le contrôle d'un terrain mesurant approximativement 600 mètres de profondeur par 1,5 km de largeur. Prix de cette parcelle : 2 323 pertes canadiennes. Plus tard, quand les Britanniques demanderont d'autres troupes aux Canadiens, Sam Hughes, qui ne manque aucune occasion de souligner l'incompétence des professionnels, commentera les événements de Givenchy en disant que c'est à des bœufs du Texas plutôt qu'à des êtres humains qu'il faudrait faire appel pour de tels combats.
Reste qu'à Givenchy, 3 000 Canadiens ont opté pour le matériel de la mère patrie, en échangeant leurs Ross, dont la supériorité, vis-à-vis du Lee-Enfield, a toujours été défendue par Sam Hughes, même quand il était dans l'opposition.
Le 2e Division subit son baptême du feu lors d'une attaque dans le secteur de Saint-Éloi, au tout début d'avril 1916. Après quelques gains initiaux, une vigoureuse contre-attaque allemande ramène les brigades canadiennes presque à leur point de départ. L'action a causé 2 000 pertes à nos troupes.
Au mont Sorrel, du 2 au 13 juin, c'est un peu le scénario inverse qui se joue. Les Allemands attaquent la 3e Division. Les bombardements d'artillerie préliminaires tuent l'avocat et major général M.S. Mercer. Les Allemands s'avancent ensuite et se saisissent de positions qu'ils se contentent de consolider. Une contre-attaque canadienne échoue et une autre est annulée le 6 juin quand l'offensive allemande reprend pour s'arrêter en vue d'Ypres. Byng, le nouveau commandant du corps, profite de ce répit pour organiser la riposte. Le 13 juin, les troupes canadiennes reprennent à peu près tout le terrain cédé depuis le 2 juin. Mais, entre le début et la fin des hostilités, les Canadiens a subi 9 383 pertes.
La terrible Sommes
Sergent du Fort Garry Horse, Corps expéditionnaire canadien, 1916. Ce régiment servit avec la Brigade canadienne de cavalerie en France et en Belgique entre 1916 et 1918, se préparant pour un type de combat qui avait pratiquement disparu en Europe occidentale. La cavalerie tenta de s’adapter aux nouvelles réalités tactiques et, sur d’autres fronts, sa mobilité la rendait très utile pour les reconnaissances et les mouvements rapides. Cependant, sur le front ouest, la cavalerie eut un rôle statique jusqu’aux dernières semaines avant la fin de la guerre.
Les très coûteuses attaques lancées par les Britanniques sur la Somme vont s'échelonner sur la période qui va du ler juillet jusqu'à la fin du mois de septembre 1916. Les Alliés vont y perdre, en morts et en blessés, 350 000 hommes et les Puissances centrales subiront des pertes à peu près équivalentes. Lorsque les Canadiens arrivent dans ce secteur, il y a déjà plusieurs semaines que l'offensive a été lancée. À l'issue de ce « bain de sang » comme les Allemands qualifieront toute l'affaire, les attaquants auront conquis quelques malheureux kilomètres carrés de terrain.
Jusqu'à ce moment dans la guerre, les Canadiens ont plus ou moins bien répondu aux attentes à leur égard. Le 4 septembre 1916, ils prennent position devant le village de Courcelette où, durant deux semaines, le seul fait d'occuper et de défendre les tranchées du front leur coûte 2 600 hommes. Puis, le 15, les Britanniques, incluant les Canadiens, reprennent leur offensive sur toute la largeur du front. Les troupes canadiennes ont comme objectif une sucrerie des faubourgs de Courcelette, dont ils s'emparent aisément. Jusque-là, d'un côté comme de l'autre, on s'arrêtait après avoir saisi l'objectif et on renforçait les positions conquises. Cette fois-ci, les Canadiens décident de continuer. Le 22e Bataillon du Québec et le 25e, de la Nouvelle-Écosse, suivis du 26e, du Nouveau-Brunswick, traversent donc le village. Le lendemain, plus de 1 000 prisonniers ont été faits et beaucoup de matériel a été pris. Ce sont les Canadiens qui se sont illustrés lors de ce vaste mouvement de troupes alliées. Cela dit, leur élan est bientôt brisé et on retourne à la guerre bien connue. Du 15 au 20 septembre, la prise de Flers-Courcelette, de Fabeck Graben et de Zollern Graben, a causé 7 230 pertes aux Canadiens.
Du 26 au 28 septembre, les Canadiens participent à la prise de l'arête de Thiepval. Les contre-attaques locales allemandes qui suivent font mal. À la mi-octobre, trois des quatre divisions canadiennes sont ramenées vers le nord, pendant que la 4e subit la dure expérience de la Somme dans des attaques, souvent infructueuses, qui se succèdent du 21 octobre au 11 novembre 1916, jusqu'à ce que, finalement, elle se saisisse d'un système de tranchées nommées Regina. Puis, la 4e Division rejoint le reste du corps canadien pour préparer un combat qui est encore célébré de nos jours.
Sur la Somme, les Canadiens auront mérité un titre qui les suivra jusqu'à la fin de la guerre : celui de troupes de choc du Corps expéditionnaire britannique. Avec leurs quatre divisions et sous la conduite éclairée et minutieuse de Byng, futur gouverneur général du Canada, les Canadiens, malgré leurs souffrances, semblent désormais destinés à de grandes choses.
La Crête de Vimy et la stratégie Allemande
En 1917, les Français ont remplacé joseph Joffre par Robert Nivelle, qui prétend pouvoir enfin pénétrer le mur allemand au sud, entre Soissons et Reims. Au nord des armées françaises, les Britanniques acceptent la mission de monter de puissantes attaques de diversion, qui retiendront dans ce secteur des dizaines de divisions de réserve allemandes. Une de ces attaques anglaises, qui est confiée au corps canadien, visera la crête de Vimy.
Cet objectif, dont le point culminant est situé à près de 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'étire sur plusieurs kilomètres entre Lens, au nord, et Arras, au sud. Sa conquête ne changera pas la face de la guerre, mais elle arrachera aux Allemands un plateau qui, dans cette plaine des Flandres, permet de dominer la région avoisinante sur des kilomètres. Après leur défaite sur la Marne, les Allemands se sont retranchés sur ce point que les Français ont maintes fois essayé de leur reprendre. Seules des troupes coloniales marocaines sont montées sur le plateau en 1915, mais, laissées sans appui, elles ont cédé à la contre-attaque allemande.
À ce stade, soit au printemps 1917, les Allemands voient cet endroit comme l'un des pivots de la défense de leur forteresse tranchées, barbelés, redoutes en béton, abris secs, chemins de fer, etc. Procurent aux troupes occupantes l'illusion qu'elles ne pourront pas être vaincues. Les Canadiens ont une pente assez facile à grimper, alors que les défenseurs ont souvent derrière eux des falaises abruptes. La stratégie de défense allemande d'alors admet la perte de premières tranchées un peu partout sur son front, car elle en prévoit la reprise dans de vigoureuses contre-attaques menées par des réserves placées en profondeur. Cette tactique est inapplicable sur ce secteur. C'est donc la défense au maximum des premières lignes, quitte à tout perdre sans retour si cela tourne mal, puisqu'il serait difficile, à maints endroits, de chercher à reconquérir les falaises que l'on viendrait d'abandonner.
Les préparatifs des canadiens à l’assaut de la Crête
Estafette en motocyclette du Corps canadien des signaleurs, 1917. Avant le développement des radios sans fil, les estafettes en motocyclette offraient la façon la plus rapide de transmettre des messages du champ de bataille, particulièrement quand les fils de téléphone ou de télégraphe devenaient impossibles à installer. Ce tableau de 1917 réalisé par Inglis Sheldon-Williams, artiste de guerre canadien, montre une estafette montée sur sa moto avec un insigne blanc et bleu porté au bras. Il s’agit de l’insigne des signaleurs, originairement porté sous forme de brassard, qui annonçait qu’ils avaient la priorité du passage sur les chemins. Ces couleurs étaient également utilisées pour les fanions de signaux.
Les Canadiens préparent de façon minutieuse leur grand assaut initial de 1917 qui doit, pour la première fois, impliquer simultanément leurs quatre divisions. L'attaque va profiter des leçons apprises auprès des Français qui ont développé l'art d'utiliser leurs fantassins en petits groupes pour s'occuper de certains points de résistance ennemis dépassés par leurs premières vagues d'assaut, en particulier les nids de mitrailleuse bétonnés, résistant aux obus et entourés de tranchées et de barbelés. Des Britanniques, ils empruntent l'utilisation judicieuse de l'artillerie de barrage précise ouvrant la route aux fantassins. Ils renforceront ces techniques par un travail de contrebatterie qui leur permettra de repérer 176 des 212 canons allemands qui pourraient briser l'offensive canadienne. Dans tous les domaines d'ailleurs, les Canadiens se prépareront avec précision.
On fera « voir » le terrain aux troupes grâce à des montages préparés à l'arrière et on les préparera à reconnaître et à prendre les objectifs assignés. Tous les progrès techniques apportés par la guerre depuis 1914 seront mis à contribution. Cela ira des grenades tirées par des fusils jusqu'aux obus à fusée à combustion (amélioration d'une invention française) qui explosent en touchant le sol et qui détruisent les barbelés, en passant par le repérage aérien des batteries ennemies et par l'approche et la destruction de positions bien défendues grâce à des tunnels creusés dans le calcaire particulier à cette région.
L'ouverture de l'attaque a lieu le 20 mars 1917, avec le début d'un bombardement des positions allemandes qui s'intensifie jusqu'au 2 avril, pour se stabiliser ensuite. À Vimy, les Canadiens disposent de 480 canons de 18 livres, de 138 obusiers de 4,5 pouces, ainsi que de 245 canons lourds et obusiers : de plus, ils ont tous les obus nécessaires, ce qui n'était pas le cas pour les troupes britanniques qui, un an plus tôt, se battaient sur la Somme. Les Britanniques mettent à leur disposition 234 autres canons, dont 132 lourds. Ainsi, les Canadiens ont une pièce d'artillerie lourde tous les 20 mètres de front, une couverture bien supérieure à celle de la Somme. Raids terrestres et vols au-dessus des lignes allemandes se multiplient sur les six kilomètres et plus de la largeur du front. Avant l'aube du dimanche de Pâques du 9 avril 1917, sous un blizzard poussé dans les yeux des Allemands, l'offensive débute. À cause des caractéristiques du front, les attaquants auront presque quatre kilomètres à franchir sur la droite avant d'atteindre leur objectif et 650 mètres seulement sur la gauche où, cependant, se trouvent les hauteurs les plus importantes et où le combat s'annonce le plus difficile.
Au bombardement, stationnaire depuis le 2 avril, succède un barrage roulant, appuyé de tirs ininterrompus de mitrailleuses sur les lignes allemandes. Les fantassins collent si bien au barrage qu'ils sont sur les premières positions allemandes avant que les défenseurs soient sortis de leurs abris. Les points de résistance qui n'ont pas cédé sont dépassés pour être traités par les unités prévues à cet effet, dont le 22e bataillon. L'artillerie ennemie voit son action habituelle largement contrecarrée par la contrebatterie canadienne, très efficace. Dès 8 heures, la 3e Division a atteint son objectif, juste en face de Vimy. Les 1re et 2e Divisions assureront leurs positions aussi rapidement. Seule la 4e, face à la cote 145, piétinera jusqu'au 12 avril, avant de se saisir de cette hauteur. Dans la nuit du 12 au 13 avril, les Allemands qui restent se replient enfin.
Sur le sommet de Crête
Du haut de la crête, au matin, les Canadiens observent l'ennemi se retirer à travers des pâturages qui contrastent avec les boues où ils pataugeaient depuis des semaines de leur côté de l'arête. Ils viennent surtout de remporter une très grande victoire. Leurs trophées : 4 000 prisonniers, 54 canons, 104 mortiers et 124 mitrailleuses. Quatre Croix de Victoria sont décernées. Les succès de Vimy démontrent qu'artilleurs, sapeurs, signaleurs et fantassins sont parvenus, en travaillant de façon très concertée, à résoudre les nombreux problèmes tactiques du champ de bataille. La planification de l'action, la coordination des armes et les nombreuses répétitions faites à l'arrière a illustré la maîtrise dont le Corps canadien était désormais capable. Mais, à travers les joies de la victoire, ils sont frappés par la lourdeur du bilan : 10 602 pertes - morts ou blessés -, soit un homme sur huit, dont 3 598 morts. Que le plus éloquent des monuments canadiens commémoratifs des deux guerres mondiales se trouve à Vimy n'étonnera personne.
Tous reconnaissent qu'ils ne doivent pas s'asseoir sur leurs lauriers. Entre le 16 avril et le 9 mai, Nivelle et les Français ont progressé de six kilomètres seulement et les pertes qu'ils ont enregistrées bouleversent la sérénité des armées françaises, dont certains éléments se mutineront. Ces mouvements locaux seront jugulés par Philippe Pétain, qui remplace Nivelle et prétend attendre les Américains entrés en guerre en avril 1917. Pendant que ceux-ci rassemblent leurs forces et que, d'autre part, la Russie s'apprête à se retirer de la guerre, il ne reste guère plus que les Britanniques, passablement épargnés sur le front ouest, si l'on exclut la Somme, pour lancer des assauts. Au cours de l'été, des brigades canadiennes prennent Arleux-en-Gobelle et Fresnoy, au nord et au sud d'Arras, au prix de 1 259 pertes dans le cas de Fresnoy.
La colline 70 et lens
Canadiens seront désormais dirigés par l'un des leurs. Parmi les offensives organisées dans les Flandres par les Britanniques, celle contre la ville charbonnière de Lens sera menée par les Canadiens. Le plan prévoit d'attaquer Lens directement. Currie propose une alternative qui sera acceptée : on prendra la cote 70, une petite hauteur dominant Lens, que les Allemands tentera vraisemblablement de reprendre. L'artillerie canadienne devra briser ces contre-attaques, provoquer des pertes coûteuses et forcer l'ennemi à abandonner le terrain.
Le 15 août, l'assaut est donné par les 1re et 2e Divisions, derrière un puissant barrage d'artillerie roulant, soutenu par un travail de contrebatterie et de bombardement en profondeur de positions désignées. La colline est prise et, comme prévu, jusqu'au 18, les Allemands contre-attaquent, subissant 20 000 pertes, contre 9 000 chez les Canadiens. Pour la première fois, une grande victoire canadienne est attribuable à la vision d'un Canadien.
Passchendaele
Artillerie de campagne montant au front, vers 1916-1918. Durant la Première Guerre mondiale, les chevaux étaient encore essentiels, même sur le front occidental. Les camions avec des moteurs à gaz ou à vapeur commençaient à être pratiques et fiables sur les bons chemins mais le déplacement des objets lourds à travers les champs nécessitait un équipage de chevaux. Dans cette aquarelle, deux équipages de chevaux tirent deux canons de campagnes britanniques par-dessus un terrain vallonné. Notez que les hommes portent des casques de fer, qui indique que cette peinture date plus tard que 1916.
Depuis la fin juillet 1917, le secteur de Passchendaele avait été la cible d'attaques sanglantes de la part des Anglais qui en avaient tiré peu de gains. À l'automne, des troupes britanniques déprimées pataugent toujours dans un champ de boue immonde alors que les hauteurs sont encore contrôlées par les Allemands. Il est urgent de s'emparer de ce petit plateau ou de reculer pour aller cantonner plus loin. Les Canadiens reçoivent l'ordre de retourner dans ce secteur où ils sont passés en 1915 et d'y prendre la côte devenue méconnaissable. Le système d'écoulement des eaux a été détruit. Les canons s'enfoncent dans la boue jusqu'aux essieux. Dans la plaine bouleversée, couverte d'armes inutiles, pourrissent des milliers de cadavres d'hommes et d'animaux. L'air est putride et les pluies qui s'abattent sur la région confèrent à l'ensemble l'atmosphère d'un cauchemar. Les vétérans de la Somme revivent ici une situation qu'ils ont bien connue.
Au plan stratégique, la conquête de Passchendaele ne sera pas significative dans la marche des Alliés vers la victoire. Tactiquement réalisable, la mission sera très onéreuse. Currie informe ses supérieurs que l'opération peut entraîner jusqu'à 16 000 pertes. Passchendaele vaut-elle ce sacrifice ? Les Britanniques répondent oui, car il permettra d'accentuer la pression au nord du front, et de donner aux Français le répit dont ils ont besoin.
Les Canadiens reprennent donc ces minutieux préparatifs qui leur ont valu ces succès enregistrés depuis le début de l'année. Pour éviter aux artilleurs de rajuster constamment leur tir, on construit des bases pouvant supporter les canons et, pour assurer l'approvisionnement des troupes, on fait en sorte que, sur les 15 kilomètres de marécages qui séparent Ypres du front, les routes soient carrossables.
Le 18 octobre, les 3e et 4e Divisions canadiennes prennent place devant l'objectif. Sous la pluie froide qui, le 26 octobre, mouille ce bourbier large de près de trois kilomètres, l'attaque débute. N'ayant pas pu surprendre l'ennemi, deux bataillons se lancent contre le piton de Bellevue. Les hommes sont décimés par les mitrailleurs abrités allemands. Finalement, un petit groupe du 43e Bataillon parvient à prendre pied et à s'accrocher. Ceux du 52e bataillon, stimulés par l'exploit de leurs collègues, s'emparent de six blockhaus.
La demi-victoire de ce 26 octobre a coûté cher aux Canadiens qui dénombrent 2 500 pertes, mais Passchendaele est encore hors de portée. Le 30 octobre, une nouvelle progression de 800 mètres est entreprise au coût de 2 300 pertes. Il reste encore 400 mètres à parcourir pour occuper les restes du malheureux village. Les artilleries lourde et de campagne sont avancées lorsque les 11e et 2e Divisions remplacent les 3e et 4e. Le 6 novembre, les opérations sont terminées, elles ont occasionné 16 041 pertes, dont 3 042 tués.
Tout cela pour avancer de cinq kilomètres dans un saillant arrosé sur trois côtés à la fois. Quelques mois plus tard, les Britanniques abandonneront Passchendaele. Sur la Somme, les Canadiens ont mérité huit Croix de Victoria ; à Passchendaele, ils en recevront neuf. Quant à savoir lequel de ces deux secteurs d'opérations a été le plus exécrable, cela demeure une question sans réponse définitive de la part des acteurs canadiens des deux combats.
La dernière année. Le dernier souffle
Depuis la fin juillet 1917, le secteur de Passchendaele avait été la cible d'attaques sanglantes de la part des Anglais qui en avaient tiré peu de gains. À l'automne, des troupes britanniques déprimées pataugent toujours dans un champ de boue immonde alors que les hauteurs sont encore contrôlées par les Allemands. Il est urgent de s'emparer de ce petit plateau ou de reculer pour aller cantonner plus loin. Les Canadiens reçoivent l'ordre de retourner dans ce secteur où ils sont passés en 1915 et d'y prendre la côte devenue méconnaissable. Le système d'écoulement des eaux a été détruit. Les canons s'enfoncent dans la boue jusqu'aux essieux. Dans la plaine bouleversée, couverte d'armes inutiles, pourrissent des milliers de cadavres d'hommes et d'animaux. L'air est putride et les pluies qui s'abattent sur la région confèrent à l'ensemble l'atmosphère d'un cauchemar. Les vétérans de la Somme revivent ici une situation qu'ils ont bien connue.
Au plan stratégique, la conquête de Passchendaele ne sera pas significative dans la marche des Alliés vers la victoire. Tactiquement réalisable, la mission sera très onéreuse. Currie informe ses supérieurs que l'opération peut entraîner jusqu'à 16 000 pertes. Passchendaele vaut-elle ce sacrifice ? Les Britanniques répondent oui, car il permettra d'accentuer la pression au nord du front, et de donner aux Français le répit dont ils ont besoin.
Les Canadiens reprennent donc ces minutieux préparatifs qui leur ont valu ces succès enregistrés depuis le début de l'année. Pour éviter aux artilleurs de rajuster constamment leur tir, on construit des bases pouvant supporter les canons et, pour assurer l'approvisionnement des troupes, on fait en sorte que, sur les 15 kilomètres de marécages qui séparent Ypres du front, les routes soient carrossables.
Le 18 octobre, les 3e et 4e Divisions canadiennes prennent place devant l'objectif. Sous la pluie froide qui, le 26 octobre, mouille ce bourbier large de près de trois kilomètres, l'attaque débute. N'ayant pas pu surprendre l'ennemi, deux bataillons se lancent contre le piton de Bellevue. Les hommes sont décimés par les mitrailleurs abrités allemands. Finalement, un petit groupe du 43e Bataillon parvient à prendre pied et à s'accrocher. Ceux du 52e bataillon, stimulés par l'exploit de leurs collègues, s'emparent de six blockhaus.
La demi-victoire de ce 26 octobre a coûté cher aux Canadiens qui dénombrent 2 500 pertes, mais Passchendaele est encore hors de portée. Le 30 octobre, une nouvelle progression de 800 mètres est entreprise au coût de 2 300 pertes. Il reste encore 400 mètres à parcourir pour occuper les restes du malheureux village. Les artilleries lourde et de campagne sont avancées lorsque les 11e et 2e Divisions remplacent les 3e et 4e. Le 6 novembre, les opérations sont terminées, elles ont occasionné 16 041 pertes, dont 3 042 tués.
Tout cela pour avancer de cinq kilomètres dans un saillant arrosé sur trois côtés à la fois. Quelques mois plus tard, les Britanniques abandonneront Passchendaele. Sur la Somme, les Canadiens ont mérité huit Croix de Victoria ; à Passchendaele, ils en recevront neuf. Quant à savoir lequel de ces deux secteurs d'opérations a été le plus exécrable, cela demeure une question sans réponse définitive de la part des acteurs canadiens des deux combats.
La contre-offensive en mars 1917
C'est qu'à compter du 21 mars 1918, dans leur hâte d'en finir qui s'apparente à un espoir ultime, les Allemands ont attaqué juste à la jonction des armées anglo-françaises. La tactique utilisée est assez simple : s'infiltrer audacieusement en profondeur, en perturbant les centres de communication et en ignorant délibérément les noyaux de résistance qui, dans la confusion qui s'instaure, abandonnent le terrain. La 5e Armée britannique recule en effet, mais parvient à rétablir son front. Ces attaques se répètent à plusieurs endroits dans les Flandres et en Champagne. En quelques semaines, la majeure partie du terrain repris depuis 1915, au prix de centaines de milliers de pertes, retombe aux mains des Allemands. Devant la menace, les Alliés acceptent enfin de se rallier derrière un général en chef commun, le maréchal Ferdinand Foch.
Heureusement, les Canadiens ont pu rester à l'écart de ces combats qui, au 15 juillet 1918, ont atteint leurs limites. Déjà, les Alliés repartent à l'assaut, la supériorité numérique leur étant largement assurée grâce aux arrivées massives d'Américains. Les Allemands ont subi 1 000 000 de pertes, soit l'équivalent du nombre que le front russe avait libéré. Les contre-attaques alliées ont rétabli les lignes du siège en date du 7 août.
Amiens. Une duperie canadienne
La table est maintenant mise pour abattre le militarisme allemand qui, sous diverses formes depuis plus de 50 ans, fait trembler l'Europe. Pendant les longues et pénibles semaines vécues par les Alliés au printemps 1918, les Canadiens ont appris. Ils ont également eu tout le loisir de reconstituer leurs forces après les attaques coûteuses, mais réussies, de 1917.
Le secteur qu'on leur réserve maintenant est celui d'Amiens. Pour qu'ils puissent profiter de l'effet de surprise, on conduit les Canadiens à 60 kilomètres au nord de ce lieu. Habitués aux Australiens qui sont demeurés en face d'Amiens, les Allemands connaissent aussi les Canadiens qu'ils ont observés combattant à la pointe des attaques britanniques. Deux bataillons et deux postes de secours sont installés devant Kemmel où une incessante circulation de messages divers est mise en marche et captée par les Allemands. Entre le 30 juillet et le 4 août, dans le plus grand secret, le reste du Corps canadien descend vers le sud. Leur discrétion est facilitée par la température maussade qui raréfie les sorties aériennes allemandes et par le fait que seuls les commandants des divisions connaissent la cible de l'attaque. Ce secret provoque de nombreux problèmes logistiques, comme, par exemple, l'artillerie qui n'aura presque pas le temps de se préparer. En face d'Amiens, les officiers canadiens chargés d'étudier le terrain trompent les Allemands en se coiffant du chapeau mou caractéristique des soldats australiens.
Le bruit causé par la préparation de la plus grande bataille mécanisée jamais vue jusque-là, ne dévoile toutefois rien de précis à l'ennemi. Certaines de ses unités s'interrogent néanmoins sur les mouvements qu'elles ont détectés malgré toutes les précautions prises. Il faut dire que 604 chars de toutes sortes et des milliers de chevaux vont donner à la bataille des allures à la fois modernes et anciennes.
Un jour sombre de l’armée Allemande
Juste avant l'aube du 8 août, l'attaque s'ouvre par le tir de 2 000 canons. En plus des chars, les soldats peuvent s'appuyer sur deux brigades de mitrailleuses motorisées, un bataillon de cyclistes pour servir le corps et une section de mortiers lourds, montés sur des camions. Un millier d'avions français et 800 avions britanniques sillonnent les airs. Pendant ce brillant assaut, qui va sérieusement hypothéquer le moral des troupes allemandes, les Canadiens progressent de 13 kilomètres, à la pointe d'un vaste front de plus de 30 kilomètres. Australiens, Britanniques et Français font aussi partie de l'attaque : leur rôle consiste à respecter l'avance des Canadiens qui ont le plus de terrain à conquérir pour atteindre leurs objectifs. Les Canadiens se font tuer 1 036 hommes, 2 803 sont blessés et 29 sont capturés, des pertes largement compensées par la remarquable avance, la plus imposante sur le front ouest, depuis 1914. Quant aux Allemands, ils ont dû assumer 27 000 pertes, dont 16 000 prisonniers, 5 033 d'entre eux ayant été capturés par les Canadiens. Ces derniers se saisissent en outre de 161 pièces d'artillerie, d'un grand nombre de mitrailleuses et de canons anti-char. Même s'il ne reste que 132 chars aux Alliés pour repartir le lendemain, les Allemands ont perdu sept divisions. Constatant que sa machine de guerre n'est plus efficace, la confiance du haut commandement allemand est entamée.
Une expérience intéressante a été tentée le 8 août. Elle consistait à utiliser 30 chars Mark V pour transporter des troupes de la 4e Division jusqu'aux tranchées adverses. Mais beaucoup d'hommes sont incommodés par la chaleur et par l'échappement d'une partie des gaz des moteurs à l'intérieur des habitacles. Quelques hommes s'évanouissent. D'autres descendent et marchent. Les inconvénients liés à l'utilisation de ces chars dans cette fonction sont pour le moment incontournables et on n'y recourra plus au cours de cette guerre.
Les avances du corps canadiens
Dans la nuit du 8 au 9, le haut commandement britannique décide de prêter sa 32e Division aux Canadiens qui veulent retirer du front leur 3e Division. Les Canadiens de la 3e Division ont déjà marché vers l'arrière sur environ 10 kilomètres quand ils sont rappelés, les Britanniques étant revenus sur leur décision. Au retour, les hommes de la 3e Division sont épuisés. On décide donc de n'utiliser qu'une de ses brigades au front, ce qui exige des 1er et 2e Divisions qu'elles élargissent le secteur à couvrir. Dans ces conditions, l'attaque du 9 ne peut se déclencher que vers 11 heures, sans l'effet de surprise escompté la veille. Au prix de 2 574 pertes, les Canadiens prennent 6,5 kilomètres de terrain aux Allemands.
La poussée alliée s'étalera sur plusieurs jours, mais l'élan des 8 et 9 août est bien cassé. De plus, le nombre de chars disponibles diminue au point que, le 12 août, on n'en compte plus que six. Malgré 11 725 pertes, entre les 8 et 20 août, les Canadiens ont sonné le début de la fin de l'armée allemande en avançant de près de 30 kilomètres et en assurant le terrain conquis. Dans toute l'opération, 75 000 pertes allemandes sont enregistrées.
Un mois auparavant, les Français avaient déjà arraché l'initiative aux Allemands. Dans ce contexte, l'engagement d'Amiens aura une portée décisive. Il a brisé les derniers espoirs du grand état-major allemand et, surtout, la certitude que ses troupes voulaient encore se battre. Le succès des troupes canadiennes repose, entre autres, sur la surprise, la concentration de leurs effectifs et la coordination de différentes armes (avions, chars, canons, mitrailleuses).
La citadelle tombe. Les dernières batailles
En ce mois d'août 1918, c'est dans tous les secteurs que la défensive allemande a été mise à dure épreuve. Dans la portion somme toute limitée qu'il occupe sur le front, le puissant Corps canadien n'a pas encore complété sa tâche. Le 26 août, il est à nouveau le fer de lance de la 2e Armée britannique, qui lance une autre attaque vers Cambrai. Le 28, les Canadiens ont progressé de huit kilomètres, faisant 3 000 prisonniers, saisissant 50 canons et 500 mitrailleuses. Cette action les conduit à portée de la ligne Hindenburg.
Même si l'artillerie continue de jouer sa partition, les fantassins canadiens font une pause. Le 2 septembre, chars et fantassins reprennent leur avance derrière un feu roulant d'artillerie. À l'issue d'une difficile progression de 3,5 kilomètres, les Canadiens comptent leurs pertes qui s'élèvent à 5 500. Ils auront la consolation d'avoir mérité sept Croix de Victoria. Un des résultats de ce combat d'une importance plutôt mineure est de permettre aux Alliés du front ouest de parvenir sans encombre à la ligne Hindenburg. Prévoyant les difficultés à venir, les Allemands commencent à consolider une nouvelle ligne de repli qui, entre Anvers et la Meuse, prend le nom de Herman. Arras étant libérée, on prépare l'étape suivante qui consistera à traverser le Canal du Nord et à prendre Cambrai, événements qui se dérouleront entre le 27 septembre et le 11 octobre.
Valencienne
5ème Bataillon d’infanterie « (Western Cavalry) », CEC, Valenciennes, le 9 novembre 1918.
Valenciennes était une ville industrielle au nord de la France, près de la frontière belge, où se déroula la dernière grande bataille du Corps canadien en 1918. Cette aquarelle par l’artiste de guerre canadien Inglis Sheldon-Williams montre un groupe de fantassins canadiens qui avancent le long d’une route. Grâce à l’insigne qu’ils portent, le rectangle rouge de la première division surmonté par un cercle rouge du premier bataillon de la seconde brigade, l’unité se révèle être le 5ème bataillon d’infanterie (« Western Cavalry ») du Corps expéditionnaire canadien. Le bataillon portait le sous-titre de « Western Cavalry » ayant été formé avec des hommes provenant de régiments de cavalerie de milice dans l’ouest.
Les autres participants canadiens
Soldat, 2nd Construction Battalion, Corps expéditionnaire canadien, vers 1917.
Cette unité fut la première dans les forces armées à recruter des Canadiens d'origine africaine. Ils ne pouvaient pas se joindre à d’autres unités dues au racisme. La Construction Battalion fut formée en 1916 et en grande partie les volontaires provenaient de la Nouvelle-Écosse. L'unité a servi en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour un an et a été envoyé en France par la suite pour construire des chemins et des chemins de fer. La 2nd Construction Battalion suivit les unités d'avant la confédération telles que Captain Runchey's Company of Colored Men (1812-1815), Colored Infantry Company (1838-1850), and the Victoria Pioneer Rifle Corps (1860-1866).
Des dizaines de milliers d'autres Canadiens ont servi hors du Corps d'armée canadien. La Brigade de cavalerie canadienne, par exemple, travaillait au sein de la Division de cavalerie britannique. Il lui faut attendre le printemps 1918 et l'arrivée d'un début de guerre de mouvement, pour entrer en scène et poser les actes de courage qui, en très peu de temps, lui vaudront deux Croix de Victoria.
Ailleurs, à l'arrière, des milliers d'hommes étaient au combat dans les troupes ferroviaires. En 1918, un grand nombre de ceux-ci deviendront fantassins. Près de 2 000 morts décimeront leurs rangs entre l'attaque contre la crête de Vimy et l'Armistice. Par ailleurs, on aura trois compagnies de sapeurs auprès d'unités anglaises du génie qui, sur la fin de la guerre, reviendront auprès de leurs concitoyens canadiens au front. Le Corps forestier canadien comprendra jusqu'à 12 000 hommes en France et 10 000 en Grande-Bretagne. Plusieurs Canadiens - dont des infirmières et médecins - seront dans des unités de service en Palestine, en Égypte ou ailleurs contre les Turcs.
Pour contenir la Révolution bolchevique, environ 5 000 Canadiens séjourneront pendant quelques mois en Sibérie, où les Alliés entretiennent un corps expéditionnaire. Entre octobre 1918 et juin 1919, moment où ils quittent la Russie, les Canadiens ne se sont engagés dans aucune grande bataille. Leurs pertes se chiffrent alors à huit morts et 16 blessés.
L’évolution tactique durant la guerre
Entre février 1915 et novembre 1918, la tactique de guerre subite l'influence des armes. En 1918, les fantassins sont engagés dans des attaques passablement fluides sous un parapluie fourni par l'artillerie, les mitrailleuses lourdes, les chars et les avions. Depuis 1915, le nombre de canons par tranche de 1 000 fantassins a tout simplement doublé. De plus, le rationnement des munitions, strictement observé jusqu'à la fin de 1916, est pratiquement levé.
En trois ans de progrès, la guerre a beaucoup changé. En 1918, l'artillerie est plus présente, mais également les compagnies de transport motorisées, les bataillons d'ingénieurs, une compagnie antiaérienne équipée de projecteurs. Bien que l'armée soit encore tributaire des lignes de transmission souvent coupées dans les combats, les systèmes de communications se sont renouvelés.
Les ingénieurs, par exemple, sont devenus des acteurs très mobiles et présents sous le feu. Pour la traversée du Canal du Nord, le 27 septembre 1918, ils arrivent juste derrière les premières troupes ayant franchi le Canal. Sous le tir de nids de mitrailleuses ennemies qui ont été dépassés, ils construisent des ponts légers pour que la tête de pont soit renforcée en troupes et approvisionnée en munitions. En même temps, de plus gros ponts sont fabriqués afin de permettre aux chars de se joindre à la bataille et à une partie de l'artillerie de venir couvrir les troupes les plus avancées. Pour les ingénieurs, cette guerre de mouvement ressemble déjà beaucoup à ce que leurs successeurs vivront en Italie à compter de 1943.
Les aviateurs canadiens

Le chasseur britannique Bristol F2B et le chasseur allemand Albatros D.III au combat.
De nombreux canadiens se distinguèrent dans l’aviation britannique durant la Première Grande guerre. Les détails de cette illustration de l’époque sont imprécis mais c’était le type d’image qui captivait l’attention du public d’alors. La légende du pilote de combat perçu comme un « chevalier du ciel » est d’ailleurs encore tenace de nos jours. Néanmoins, les humbles escadrons de reconnaissance qui prenaient les photographies et dirigeaient les bombardements de l’artillerie eurent probablement un plus grand impact sur le déroulement de la guerre que les as de l’aviation.
Au cours de la Première Guerre mondiale, le Canada n'a pas d'aviation militaire qui lui soit propre, ce qui n'empêche pas environ 24 000 Canadiens de servir dans le Royal Flying Corps et le Royal Naval Air Service, avant que ces deux éléments soient combinés en Royal Air Force, au mois d'avril 1918. À ce niveau, le Canada subira 1 500 pertes. Unquart des officiers aviateurs britanniques sont des Canadiens et ils sont, en général, parmi les meilleurs.
Des représentations en faveur de la création d'une aviation militaire avaient été faites auprès des autorités militaires en 1911 et 1912, mais elles ne leur avaient enseigné que deux choses les appareils sont dangereux et chers et leur utilité douteuse. Dans ce vide stratégique, le Canada n'est pas si isolé qu'on pourrait le croire. En effet, personne n'était en mesure de prévoir que, 11 ans après le premier vol du « plus lourd que l'air » et malgré les bonds techniques importants accomplis depuis, l'avion deviendraient une formidable arme de guerre. Personne ne pouvait alors prédire que le Canada était à la veille de s'engager dans une guerre comme celle de 1914-1918.
Commandant d'escadron Raymond Collishaw et des pilotes du 203è escadron, Royal Air Force, juillet 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Canadiens composaient environ un quart de la Royal Air Force (RAF) formée en avril 1918. Plus de 8 000 Canadiens servirent dans la RAF et dans les corps qui la précédèrent, le Royal Flying Corps (RFC) et le Royal Naval Air Service (RNAS). Cette photographie montre un célèbre pilote canadien, le commandant d’escadrille Raymond Collishaw (1893-1975) en compagnie de pilotes britanniques à Allonville, en France, en juillet 1918. Les avions à l’arrière-plan sont des chasseurs Sopwith F. 1 « Camel ».
Au Canada, Alexander Graham Bell est l'un des pionniers de l'aviation. Un des hommes qu'il a alors côtoyés, J.A.D. McCurdy, essaie plus tard, mais sans succès, de vendre ses avions au gouvernement canadien. Il va alors aux États-Unis où il réussit assez bien. Revenu au Canada pendant la guerre avec son école de vol, il crée la Canadian Aeroplanes qui, de Toronto, s'engagera dans la production en série et l'exportation massive d'avions. Une première dans l'histoire de l'aéronautique.
Un jeune Canadien désireux de devenir pilote militaire devait assumer lui-même les coûts liés à sa formation, qu'elle ait lieu au Canada ou aux États-Unis. Si les Britanniques enrôlaient ensuite le nouveau pilote, soit dans le corps d'aviation rattaché à la marine, soit dans celui de l'armée, ils remboursaient les cours qu'il avait suivis. Au fil de la guerre, plusieurs volontaires du Corps d'armée canadien vont demander d'être mutés dans l'aviation ou recevront une proposition à cet effet.
La véritable naissance de l'arme aérienne a lieu sur la Somme. Dans ce secteur, au début des combats des Britanniques, en juillet 1916, 240 aviateurs canadiens sont en première ligne. À ce moment-là, les Alliés dominent l'espace aérien. Dans les premiers mois de 1917, de nouveaux avions allemands plus performants font basculer la maîtrise de l'air du côté de l'ennemi. Mais, dès la fin de 1917, les Alliés ont changé cela grâce à du nouveau matériel et à la présence de milliers de pilotes dont un grand nombre ont été formés au Canada. Cette domination aérienne alliée sera maintenue durant toute l'année 1918.
L’Instruction d’aviateurs en terre canadienne
Sur la Somme, les pertes aériennes impériales ont été importantes. L'Angleterre, qui a de plus en plus besoin d'aviateurs entraînés, crée au Canada un programme d'instruction structuré en fonction du Royal Flying Corps. Le moment est propice, car on célèbre déjà les exploits d'aviateurs canadiens, dont ceux de Billy Bishop. L'enthousiasme est si grand que le gouvernement canadien réexamine sa politique aérienne et songe à créer un corps d'aviation canadien, ce qui ne viendra cependant que dans les années 1920. À la fin de 1916, la proposition du Royal Flying Corps est acceptée. Parmi les avantages de ce projet, le gouvernement canadien décèle celui de servir l'Empire sans s'engager trop avant dans les questions aériennes à l'égard desquelles il entretient une certaine méfiance. En 1917, la formation de pilotes britanniques débute au Canada. Des milliers de spécialistes canadiens, tant pilotes que techniciens, seront formés grâce à cette initiative. Il faut signaler qu'à l'époque un pilote devait aussi être un mécanicien capable de réparer son avion. Entre les deux guerres, les hommes formés au Canada contribueront à l'éveil de l'intérêt public pour l'aviation et l'aéronautique. Même si les nouveaux aviateurs répondent à des chefs et à des critères britanniques, on observera bientôt parmi eux l'émergence d'un réel sentiment pro-canadien. C'est alors qu'on commencera à réclamer, assez timidement il est vrai, une aviation canadienne.
L’aéronavale
Pendant la Première Guerre mondiale, les avions de la marine sont utilisés pour le bombardement - très inefficace - des sous-marins ennemis et la surveillance des activités militaires le long des côtes. Sur les côtes françaises, certains des avions de la marine serviront parfois les armées. Quand les premiers porte-avions apparaissent, il s'agit de chalands halés par des navires. On aménagera bientôt des plates-formes sur certains navires existants. Différents agrès sont utilisés pour stopper un avion qui atterrit, mais la sécurité laissant à désirer, on déplorera de nombreux incidents dont nombre d'hommes tombés à la mer. C'est une formation aéronavale alliée qui sera la première à utiliser le bombardement stratégique, c'est-à-dire le vol en formation de plusieurs appareils munis de bombes vers un objectif à détruire.
Les rôles de l’aviation
Dirigeable allemand surpris par un projecteur. Bien que la Première Guerre mondiale ne fut pas le premier conflit dans lequel des avions furent utilisées à des fins militaires (ce fut en 1911 au cours de la guerre italo-turque), la Grande Guerre vit le début des missions de bombardement sur de longues distances. Les Allemands utilisaient des dirigeables (populairement appelés « Zeppelins » du nom de leur constructeur, le comte Zeppelin) pour des missions de bombardement nocturnes sur la France et la Grande-Bretagne. Cette illustration montre une technique utilisée par les défenseurs : des projecteurs pour éclairer les dirigeables et des canons anti-aériens pour tenter de les abattre.
De part et d'autre, on en viendra à bombarder des villes. Les bombes vont pleuvoir sur Londres et Paris ainsi que sur les villes allemandes de la Ruhr et dans les zones belges et françaises occupées par les Allemands. En 1918, on expérimente les bombardements aériens de nuit. Leur efficacité influencera le cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Les raids de bombardement créeront l'illusion que l'avion pourrait jouer un rôle plus important que les combats terrestres à l'occasion d'une autre guerre. Comme plusieurs des aviateurs ont auparavant vécu la terrible expérience des tranchées, il est sans doute normal qu'ils cherchent désespérément une façon plus propre pour eux, mais malheureusement plus meurtrière pour les populations touchées, de faire et de gagner toute guerre éventuelle.
Les avions rendent toutefois d'autres services, en particulier dans la surveillance de l'ennemi, la protection des ballons d'observation ainsi que dans le repérage et la destruction de sous-marins, navires et ballons ennemis.
Au cours de la guerre, la tactique et les techniques d'utilisation de l'avion au combat évolueront. On parviendra, par exemple, à synchroniser le tir des mitrailleuses avec le nombre de rotations à la seconde des hélices se trouvant dans la trajectoire des balles. À la fin de la guerre, les aviateurs sauront attaquer les troupes ennemies au sol avec des chasseurs ou des bombardiers modifiés.
L’efficacité de l’arme aérienne
Le 8 août 1918, à la bataille d'Amiens, le Corps d'armée canadien a excellé. Comment l'aviation alliée s'en est-elle tirée ? En raison du brouillard matinal, elle n'a pas pu prendre son envol avant 9 heures. Dès lors, quelques avions viennent étendre des écrans de fumée entre des chars de combat et certains points de résistance allemands. D'autres, de manière très inefficace, couvrent les troupes canadiennes en mitraillant et en bombardant les Allemands. Ainsi, à plusieurs reprises, des avions en nombre essaient vainement de faire sauter des ponts sur la Somme, surtout ceux de Péronne et de Python, par où arrivent (et arriveront dans la nuit) les nombreux renforts allemands qui, le lendemain, ralentissent l'élan canadien. Finalement, l'aviation aura surtout été utile, durant cette attaque, par sa capacité d'observation du dispositif ennemi
Les Canadiens dans les forces aériennes impériales
Ils ne seront pas réunis dans des escadrilles canadiennes ou au sein d'un corps aérien national et ne seront pas commandés par leurs officiers. En somme, les conditions qui ont été à la base du sentiment national canadien dans l'armée n'existent pas du côté aérien, car il s'agit de recrues coloniales dans un corps impérial.
Bien que des milliers de Canadiens aient servi dans l'aviation britannique, aucun Canadien ne s'élèvera au-dessus du grade de capitaine de groupe (colonel). Ces hommes, qui formeront l'ossature de l'Aviation royale du Canada encore en devenir, auront été déployés partout. Sur le front franco-belge et en Grande-Bretagne, ils ont fait face aux meilleurs appareils et pilotes allemands. On les a aussi rencontrés dans des secteurs aériens moins actifs en Italie, en Macédoine, où les Bulgares et les Turcs sont les principaux ennemis, en Égypte et, plus tard, en Russie. Parmi eux, de grands noms ressortiront : Billy Bishop, A.A. McLeod et Billy Barker mériteront chacun une Croix de Victoria. Raymond Collishawn enregistrera 66 victoires et D.R. MacLaren, 54, en huit mois de combat seulement. Parmi les 10 premiers as de toutes les nations combattantes, on retrouvera quatre Canadiens (Barker, Bishop, Collishaw et MacLaren).
Bilan de l’effort militaire canadien
Drapeau régimentaire et drapeau du roi, 38ème Bataillon, Corps expéditionnaire canadien, 1914-18. Le 38ème bataillon du Corps expéditionnaire canadien fut levé à Ottawa, en 1915. Il servit aux Bermudes avant de joindre la 4ème division du Corps canadien en France en 1916. Sauf pour les insignes, les drapeaux des unités canadiennes étaient similaires à ceux des Britanniques jusqu’en 1968. Avant son départ d’Ottawa, le 38ème bataillon reçut le drapeau régimentaire tel qu’illustré dans ce tableau. Le drapeau du roi fut présenté en 1921 à l’unité qui perpétua le 38ème, The Ottawa Regiment (Duke of Cornwall’s Own).
Comparée à l'effort total industriel et militaire fourni par les principaux belligérants, la contribution du Canada semble faible. Cependant, compte tenu de sa population, alors inférieure à huit millions, et de son expérience militaire, presque inexistante en 1914, l'effort qu'il a consenti est considérable. Il est de plus très coûteux humainement : 212 688 pertes au 11 novembre 1918, dont 53 216 morts et mourants dans l'armée de terre seulement. Ces chiffres disent l'immensité de l'effort, mais ils ne traduisent pas du tout le courage et l'abnégation consentis par les volontaires, qu'ils y soient restés ou qu'ils en soient revenus. Un petit exemple suffira. Dans un article destiné à la revue des anciens du collège Loyola de Montréal, Gilbert Drolet rappelait qu'un peu moins de 300 jeunes hommes formés dans cette institution étaient allés se battre en Europe et que 37 d'entre eux (12 pour cent) y avaient perdu la vie. Un cas d'espèce qui s'est répété d'un océan à l'autre.
Le sacrifice des Canadiens en terre de France est commémoré à plusieurs endroits. On peut voir Le Soldat mélancolique, près de Saint-Julien, où la première attaque allemande au gaz a eu lieu. À Vimy, le Canada entretient un immense et magnifique monument rempli de signification. Enfin, à Beaumont-Hamel, un impressionnant caribou de bronze domine le champ de bataille où le Régiment de Terre-Neuve (province qui ne faisait pas encore partie de la Confédération canadienne) fut anéanti le 1er juillet 1916, pendant la première demi-heure de la première grande attaque sur la Somme.
L’identité canadienne s’affirme
Durant la guerre, c'est l'armée de terre qui porte et transforme l'identité canadienne que veulent les autorités politiques. En Grande-Bretagne, le Canada organise son propre système d'approvisionnement, ses écoles et ses hôpitaux qui sont placés sous le commandement du major général Turner, décoré de la Croix de Victoria, en Afrique du Sud. À compter de 1916, le gouvernement canadien crée en Grande-Bretagne le ministère des Forces militaires du Canada au Royaume-Uni, afin que tout ce qui concerne les forces canadiennes en Europe puisse être discuté sur place, à travers cet organisme politique reconnu. Quant au Corps canadien au combat, on a vu comment, en 1918, il a refusé de copier les nouveaux corps britanniques. Mais, dès 1915, les Canadiens avaient refusé de fractionner leur seule division afin de servir des intérêts britanniques à court terme.
Ces centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes contribuent à ce que leur pays soit reconnu par leurs alliés. Leurs actions glorieuses et leur volonté d'être différents influenceront le gouvernement dans sa politique de désengagement de l'emprise impériale. À l'autonomie militaire du champ de bataille succédera l'autonomie politique acquise graduellement au cours des décennies à venir. Dans les mois et les années qui suivront immédiatement la fin de la guerre, notre pays participera aux négociations de paix, signera des traités de paix et deviendra membre à part entière de la Société des Nations.
Les prisonniers de guerre canadiens
Réveil 8 h 00
Petit déjeuner 8 h 30
Lecture et/ou exercice jusqu'à 13 h
Déjeuner 13 h
Lecture et/ou exercice jusqu’à 18 h 30
Dîner 18 h 30
Appel 20 h 30 - 21 h
Extinction des feux 22 h
Ces officiers ont le droit d'écrire deux lettres par mois et quatre cartes postales. Ils doivent payer leurs repas (environ huit marks par jour ou cinq livres par mois). Lorsqu'ils écrivent à leur famille, ces hommes demandent qu on leur envoie des vêtements propres, des livres, des magazines ou des chaussures
Le Canadien français et le français dans le Corps expéditionnaire canadien
22e Bataillon (canadien-français), Corps expéditionnaire canadien, en juillet 1916
Cette photographie prise en juillet 1916 montre des hommes du 22e Bataillon (canadien-français) CEC qui réparent des tranchées. Notez les caillebotis au pied qui maintenait l'équilibre lors que la terre devenait de la boue à cause de la pluie. Le panneau de tôle ondulée au premier plan de la photo aida à renforcer le mur des tranchées dans ces conditions. À compter du mois septembre 1915 jusqu'en novembre 1918, 'les vingt-deux' ont établi une réputation de combat formidable.
La mobilisation initiale des volontaires se fait dans l'espacement des unités de milice existantes et des particularités linguistiques du pays. Des pressions exercées de plusieurs côtés conduisent le gouvernement à accepter de créer le 22e Bataillon (Canadien français), l'ancêtre de l'actuel Royal 22e Régiment. Mais les décennies d'oblitération du fait francophone dans l'institution militaire canadienne devaient avoir des répercussions. L'historien J. Granatstein pense qu un maximum de 50 000 francophones se sont portés volontaires, soit moins de huit pour cent des enrôlements. Et l'on sait que la conscription de 1917-1918 causera de sérieux troubles au Québec, en plus d y détruire le Parti conservateur pour quelques générations.
Pourtant, au début de la guerre, l'enthousiasme règne partout au pays. Dès le 1er août 1914, le 6e Régiment d'artillerie canadienne, de Québec et Lévis, se propose pour participer à la guerre qui sévit en Europe. Mais les autorités ne veulent pas mobiliser les unités. Cela dit, à cause de la menace des sous-marins, le 6e Régiment se voit ordonner d'aller prendre ses positions de défense côtière en aval de Québec, au Fort de la Martinière et à l'île d'Orléans. Jusqu'à la fin de la guerre, durant la saison navigable, le 6e Régiment sera confiné à ce rôle. Durant ces périodes de service, officiers et soldats vivent sous la tente et servent deux batteries. Des volontaires du régiment iront aussi à l'île Sainte-Lucie, dans les Indes occidentales, et y resteront jusqu’à la fin de la guerre. Quelques hommes du régiment se porteront volontaires pour aller outre-mer. Certains auront l'occasion de séjourner aux Bermudes comme membres d'une garnison de remplacement des Britanniques. Dans une autre partie du pays, la Libre Parole de Winnipeg indique, le 20 avril 1916, que 30 descendants des Métis de 1870 et de 1885 - dont 19 semblent être francophones - viennent de s’enrôler à Qu’Appelle. À la même époque, le Free Press, également de Winnipeg, publie un texte du capitaine MA. Fiset, de la 36e Batterie de campagne, qui décrit les exploits du soldat P. Riel, neveu de Louis Riel, qui, de mars 1915 à janvier 1916, a abattu 30 Allemands comme tireur embusqué. Ayant été tué par un éclat d'obus le 13 janvier 1916, son fusil est exposé bien en vue dans une fenêtre d'un édifice de Londres.
Au vu de ces deux petits exemples, on peut se demander combien de francophones de tout le pays seraient allés outre-mer volontairement si un cadre d'accueil avait existé pour eux avant et après l'ouverture du conflit. L'insensibilité au fait francophone du système militaire canadien de l'époque a eu des répercussions. Pourtant, les cadres n'étaient pas systématiquement anti-francophones.
Ainsi, le lieutenant-colonel Francis Farquhar, secrétaire militaire du gouverneur général, jusqu'à ce qu'il devienne commandant du PPCLI, annonce à ses officiers qu'il veut qu’ils puissent lire le français ou envoyer un message simple dans cette langue. Il croit que les officiers devraient connaître environ 500 mots de base en français avant d'arriver en France. Des cours sont donnés durant la traversée de l’Atlantique, même si la plupart des étudiants s'en passeraient volontiers.
Le rejet de certains volontaires
On a ouvertement parlé au Canada d'une guerre entre hommes blancs. On entend par là que le sport consistant à tuer un ennemi de race blanche doit être réservé aux Blancs. Au Canada, ce sont les commandants locaux qui acceptent ou refusent les volontaires. Dans les premiers jours, seuls les autochtones sont explicitement exclus, sous prétexte que dans les aléas du combat, les Allemands pourraient leur refuser le traitement habituellement réservé aux combattants « civilisés ». Cela n'empêche pas plusieurs commandants, conscients ou pas de cette directive, d'accepter des autochtones, et certains d'entre eux se feront ensuite toute une réputation, en particulier à titre de francs-tireurs.
Cependant, les membres de groupes plus visibles, comme les Noirs des Maritimes, ou les Asiatiques et les Indiens de la Colombie-Britannique, qui se présentent par centaines à divers centres de recrutement, ne peuvent participer à cette guerre de Blancs. En 1915, on écarte les propositions d'un bataillon de Canadiens d'origine nipponne et d'un autre composé d'hommes de race noire. Pourtant, le bassin de volontaires blancs s'épuise déjà.
Même si aucune directive discriminatoire n'existe, il est clair qu une politique de discrimination a été appliquée. Des offres visant à créer des compagnies formées de Noirs ou d’Asiatiques échouent, mais on en viendra à intégrer deux compagnies autochtones au sein d'un bataillon qui recrute surtout en Ontario. Finalement, en 1916, un bataillon de travailleurs noirs est créé, le N° 2 Construction Battalion (Coloured), qui sera encadré par des Blancs et dont le seul o acier noir sera l'aumônier auquel on a donné le grade de capitaine honoraire.
À compter de l'été 1916, les problèmes de recrutement s'étant intensifiés, le ministère prône enfin une politique d'ouverture, mais le racisme n'étant pas le seul apanage des Blancs, des problèmes surgissent. Ainsi, les autochtones font clairement savoir qu'ils ne veulent pas servir au sein du N° 2 Construction Battalion, qui manque d'hommes. Ils ne veulent, à la guerre, ne côtoyer aucun Noir. Deux ans après le début du conflit, la ferveur guerrière s'est estompée. Aucun des bataillons levés à compter de 1916, y compris le N° 2 Construction Battalion, n'arrivera à combler ses cadres. Le bataillon ne sera jamais plus qu'une grosse compagnie de 500 hommes commandés par un major plutôt que par un lieutenant-colonel.
Quant à la conscription de 1917, elle s'applique à tous, sauf aux autochtones qui ne manquent pas de rappeler qu'ils sont encore privés du droit de vote. Les Nippo-Canadiens, qui n'ont pas davantage le statut de citoyen à part entière, réclament le même privilège d'exemption. La Loi des Indiens servira à exempter les autochtones, alors qu un décret du 17 janvier 1918 exemptera japonais et Indiens.
Malgré ces obstacles, on a établi comme suit la participation de ces groupes à la Première Guerre mondiale : 3 500 autochtones, 1 000 Noirs et 600 Nippo-Canadiens.
La particularité des âmes canadiennes
réparant le transport de la 1re Division canadienne sur le continent européen, l'aumônier supérieur canadien, Richard Steacy, tente d'assurer la participation de ses 33 aumôniers, un pour un millier d'hommes environ. Pour leur part, les Britanniques disposent de cinq aumôniers par division d'infanterie, soit un pour 4 000 hommes. Lord Kitchener demande à Sam Hughes d'envoyer moins de pasteurs à l'avenir et refuse que les 33 qui sont en Angleterre passent en France. Steacy propose alors le nombre de 25 aumôniers, ce qui est refusé par les Britanniques qui tiennent au chiffre magique de cinq. Les Canadiens sont furieux.
Une délégation composée d'un pasteur de l'Église Unie et d'un prêtre catholique se rend au War Office. Les Britanniques persistent dans leur résistance jusqu’à ce que les délégués soulignent l'évidence : le Canada paie et il fera ce qu'il veut. Au War Office, on rappelle que, malgré le grand nombre d'aumôniers qui les accompagnent, la conduite des troupes canadiennes en sol anglais ne sont pas des plus civilisées. La réponse vole aussi vite : la situation serait bien pire si nous n'étions pas là, dit le pasteur Frederick George Scott. Finalement, l'aumônier général britannique promet d'intervenir en leur faveur auprès de ses supérieurs. Le 2 février 1915, les Britanniques acceptent enfin 11 aumôniers pour chaque division canadienne, une proportion qui sera plus tard adoptée pour toutes les divisions britanniques.
Les Canadiens ont-ils montré la route en ce domaine ? Chose certaine, ils ont signalé leur statut canadien distinct, tel que le voulait le ministre Sam Hughes.
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 6 autres membres